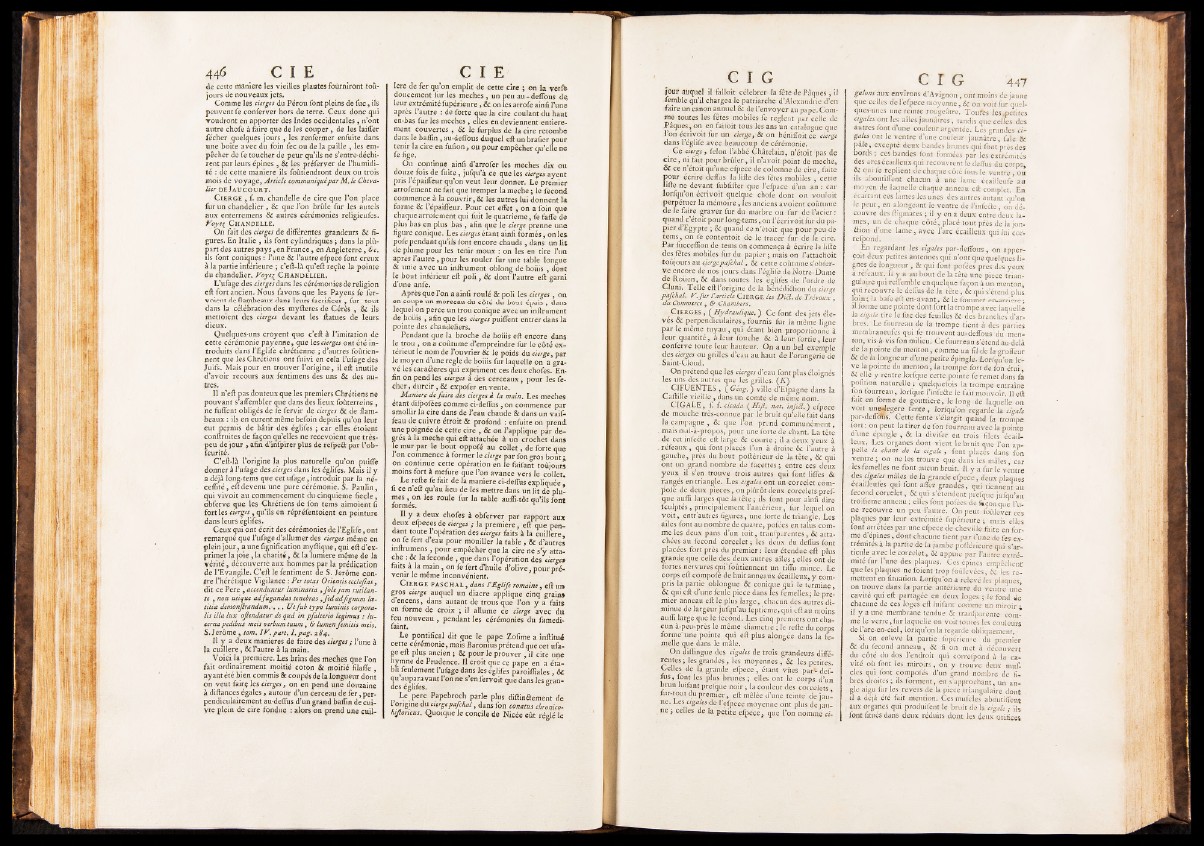
446 C I E
de cette maniéré les vieilles plantes fourniront toujours
de nouveaux jets.
Comme les cierges du Pérou font pleins de fu c , ils
peuvent fe conferver hors de terre. Ceux donc qui
voudront en apporter des Indes occidentales , n’ont
autre chofe à faire que de les couper, de les laiffer
fécher quelques jours , les renfermer enfuite dans
une boîte avec du foin fec ou de la paille , les empêcher
de fe toucher de peur qu’ils ne s’entre-déchirent
par leurs épines , & les préferver de l’humidité
: de cette maniéré ils foûtiendront deux ou trois
mois de voyage, Article communiqué par M. le Chevalier
d eJa u c o u r t .
C ier ge , f. m. chandelle de cire que l ’on place
fur un chandelier, 6c que l ’on brûle fur les autels
aux enterremens 6c autres cérémonies religieufes.
Voyez C handelle.
On fait des cierges de differentes grandeurs & figures.
En Italie , ils font cylindriques ; dans la plupart
des autres pa ys, en France, en Angleterre, &c.
ils font coniques : l’une 6c l’autre efpece font creux
à la partie inférieure ; c’eft-là.qu’eft reçûe la pointe
du chandelier. Voyez C handelier.
L’ufage des cierges dans les cérémonies de religion
eft fort ancien. Nous favons que les Payens fe fer-
voient de flambeaux dans leurs facrifices , fur-tout
dans la célébration des myfferes de Cérès , 6c ils
mettoient des cierges devant les flatues de leurs
dieux.
Quelques-uns croyent que c’eft à l ’imitation de
cette cérémonie payenne, que les cierges ont été introduits
dans l’Eglife chrétienne ; d’autres foûtien-
jient que les Chrétiens ont fuivi en cela l’ufage des
Juifs. Mais pour en trouver l’origine, il eft inutile
d’avoir recours aux fentimens des uns 6c des autres.
Il n’eft pas douteux que les premiers Chrétiens ne
pouvant s’affembler que dans des lieux foûterreins ,
ne fulfent obligés de le fervir de cierges 6c de flambeaux
: ils en eurent même befoin depuis qu’on leur
eut permis de bâtir des églifes ; car elles étoient
conftruites de façon qu’elles ne recevoient que très-
peu de jour , afin d’infpirer plus de refpeét par l’ob-
l'çurité.
C ’eft-là l’origine la plus naturelle qu’on puiffe
donner à l’ufage des cierges dans les églifes. Mais il y
a déjà long-tems que cet ufage, introduit par la né-
ceflïté, eft devenu une pure cérémonie. S. Paulin,
qui vivoit au commencement du cinquième fieçle,
obferve que les Chrétiens de fon tems aimoient fi
fort les cierges, qu’ils en répréfentoient en peinture
dans leurs églifes.
Ceux qui ont écrit des cérémonies de l’Eglife, ont
remarque que l’ufage d’allumer des cierges même en
plein jour, a une lignification myftique, qui eft d’exprimer
la joie , la charité, & la lumière même de la
vérité, découvertè aux hommes par la prédication
de l ’Evangile. C ’eft le fentiment de S. Jerome contre
l’hérétique Vigilance : Per totas Orieniis ecclejias ,
dit ce Pere , accenduntur luminaria f fole jam rutilante
, non mique adfugandas tenebras ,fedadjîgnum la-
titue demonjlrandum. . Utfub typo luminis corpora-
lis ilia lux ojlendatur de quâ in pfalterio legimus : Interna
pedibus meis verbum tuum, & lumen femitis meis.
S. Jerome , tom. IV. part. I. pag. 284.
Il y a deux maniérés de faire des cierges ; l’une à
la cuillère, 6c l’autre à la main.
Voici la première. Les brins des meches que l’on
fait ordinairement moitié coton & moitié filaffe ,
ayant été bien commis & coupés de la longueur dont
on veut fairç les cierges, on en pend une douzaine
à diftances égales , autour d’un cerceau de fe r , perpendiculairement
au-deffus d’un grand baflin de cuivre
plein de cire fondue : alors on prend une cuil-
C I E
lere de fer qu’on emplit de cette cire ; on la verfe
doucement fur les meches, un peu au - deffous dç
leur extrémité fupérieure, & on les arrofe ainfi l’une
après l’autre : de forte que la cire coulant du haut
en-bas fur les meches, elles en deviennent entièrement
couvertes , & le furplus de la cire retombe
dans le baflin , au-aeflous duquel eft un brafier pour
tenir la cire en fufion, ou pour empêcher qu’elle ne
fe fige.
On continue ainfi d’arrofer les meches dix ou
douze fois de fuite, jufqu’à ce que les cierges ayent
pris l’épaiffeur qu’on veut leur donner. Le premier
arrofement ne fait que tremper la meche ; le fécond
commence à la couvrir, & les autres lui donnent la
forme 6c l’épaiffeur. Pour cet effet , on a foin que
chaquearrolement qui fuit le quatrième, fe faffe de
plus bas en plus bas , afin que le cierge prenne une
figure conique. Les cierges étant ainfi formés, on les
pofe pendant qu’ils font encore chauds , dans un lit
de plume pour les tenir moux : on les en tire l’un
après l’autre, pour les rouler fur une table longue
& unie avec un infiniment oblong de boiiis , dont
le bout inférieur eft p o li, 6c dont l’autre eft garni
d’une anfe.
Après que l’on a ainfi roulé & poli les cierges , on
en coupe un morceau du côté du bout épais , dans
lequel on perce un trou conique avec un infiniment
de boiiis , afin que les cierges puiffent entrer dans la
pointe des chandeliers.
Pendant que la broche de boiiis eft encore dans
le trou , on a coutume d’empreindre fur le côté ex-
térieut le nom de l’ouvrier 6c le poids du cierge, par
le moyen d’une réglé de boiiis fur laquelle on a gravé
les carafteres qui expriment ces deux chofes. Enfin
on pend les cierges à des cerceaux, pour les fe-?
çher, durcir, & expofer en vente.
M.anierp de faire des cierges à la main. Les meches
étant difpofees comme ci-deffus , on commence par
amollir la cire dans de l’eau chaude & dans un vaif-
feau de cuivre étroit & profond : enfuite on prend
une poignee de cette cire , & on l’applique par degrés
à la meche qui eft attachée à un crochet dans
le mur par le bout oppofé au co llet, de forte que
1 on commence à former le cierge par fon gros bout £
on continue cette operation en le faifant toujours
moins fort à mefure que l’on avance vers le collet.
Le relie fè fait de la maniéré ci-deffus expliquée ,
fi ce n’eft qu’au lieu de les mettre dans un lit de plumes
, on les roule fur la table aufli-tôt qu’ils font
formes.
Il y a deux chofes à obferver par rapport aux
deux efpeces de cierges ; la première, eft que pendant
toute l’opération des cierges faits à la cuillère,
on fe fert d’eau pour mouiller la table, & d’autres
inftrumens , pour empêcher que la cire ne s’y attache
: 6c la fécondé , que dans l’opération des cierges
faits à la main, on fe fert d’huile d’o live , pour prévenir
le même inconvénient.
C ierge pas CH AL, dans l'Eglife romaine, eft ut»
gros cierge auquel un diacre applique cinq grains
d encens, dans autant de trous que l’on y a faits
en forme de croix ; il allume ce cierge avec du
feu nouveau , pendant les cérémonies du famedi-
faint.
Le pontifical dit que le pape Zofime a inftitué
cette cérémonie, mais Baronius prétend que cet ufage
eft plus ancien ; 6c pour le prouver , il cite une
hymne de Prudence. Il croit que ce pape en a établi
feulement l’ufage dans les églifes paroifliales , 6c
qu’aupara vant l’on ne s’en fervoit que dans les grandes
églifes.
Le pere Papebroch parle plus diftinûement de
1 origine du ciergepafehal, dans ion conatus chronicq-
hiforicus. Quoique le concile de Nicée eût réglé le
C I G
joui* auquel il falloit célébrer la fête de Pâques , il
•femble qu’il chargea le patriarche d’Alexandrie d’en
faire un canon annuel & de l’envoyer au pape. Comme
toutes les fêtes mobiles fe règlent par celle de
Pâques, on en faifoit tous les ans un catalogue que
l ’on écrivoit fur un cierge, & on béniffoitee cierge
dans l’églife avec beaucoup de cérémonie.
. Ce cierge y félon l’abbé Châtelain, n’étoit pas de
cire , ni fait pour brûler, il n’a voit, point de meche,
& ce n’étoit qu’une efpece de colomne de cire, faite
pour écrire deffus la lifte des fêtes mobiles , cette
lifte ne devant fubfifter que l’efpace d’un an : car
lorfqu’on écrivoit quelque chofe dont on vouloit
perpétuer la mémoire, les anciens avoient coûtume
de le faire graver fur du marbre ou fur de l’acier:
quand c’étoit pour long-tems, on l’écrivoit fur du papier
d’Egypte ; 6c quand ce n’étoit que pour peu de
tems, on le contentoit de le tracer fur de la cire.
Par fucceflion de tems on commença à écrire la lifte
des fêtes mobiles fur du papier ; mais on l’attachoit
toujours au ciergepafehal, & cette coûtume s’obfer-
ve encore de nos jours dans l’églife de Notre-Dame
de Rouen, 6c dans toutes les églifes de l’ordre de
Cluni. Telle eft l’origine de la bénédittion du cierge
pafehal. V fu r Varticle C ierge les Dicl. de Trévoux,
du Commerce, & Chambers.
;C ierges , ( Hydraulique. ) Ce font des jets élevés
& perpendiculaires, fournis fur la même ligne
par le meme tuyau, qui étant bien proportionné à
leur quantité, à leur fouche & à leur fortie, leur
conferve toute leur hauteur. On a un bel exemple
. des cierges ou grilles d’eau au haut de l’orangerie de
. Saint-Cloud.
On prétend que les cierges d’eau font plus éloignés
les uns des autres que les grilles. (A )
CIFUENTES , ( Géog. ) ville d’Elpag ne dans la
Caftille vieille , dans un comté de même nom.
.CIGALE, f. f. cicada ( Hijl. nat. infect f efpece
de mouche très-connue par le bruit qu’elle fait dans
la campagne , & que L’on prend communément,
. mais mal-à-propos, pour une forte de chant. La tête
de cet infeâe eft large 6c courte ; il a deux yeux à
. réfeaux , qui font placés l’un à droite 6c l’autre à
gauche, près du bout poftérieur de la tête, 6c qui
ont un grand nombre de facettes ; entre ces deux
yeux il s’en trouve trois autres qui font liffes &
rangés en triangle. Les cigales ont un corcelet com-
pofe de deux pièces, ou plûîôt deux c.orceïets pref-
que aufli larges que la tête ; ils font pour ainfi dire
fculptés, principalement l’antérieur, fur lequel on
v o it, entr’autres figures, une forte de triangle. Les
ailes font au nombre de quatre, pofées en talus comme
les deux pans d’un toit, tranfparentes, 6c attachées
au fécond corcelet ; les deux du deflus font
placées fort près du premier: leur étendue eft plus
grande que celle des deux autres ailes ; elles ont de
fortes nervures quiYofitiennent un tiflii mince. Le
corps eft compofë de huit anneaux écailleux, y compris
la partie oblongue 6c conique qui le termine
6c qui eft d’une feule pièce dans les femelles; le premier
anneau eft le plus large, chacun des autres diminue
de largeur jufqu’au lèptieme, qui eft au moins
aufli large que le fécond. Les cinq premiers ont chacun
à-peu-près le même diamètre ; le refte du corps
forme"\ine pointe qui eft plus alongée dans la femelle
que dans le mâle.
On diftingue des cigales de trois grandeurs differentes
; les grandes, les moyennes , & les petites.
Celles de la grande efpece, étant vûes par*- def-
fus, fontries plus brunes; elles,ont le corps d’un
brun luifant prefcpie noir ; la couleur des corcelets
fur-tout du premier, eft mêlée d’une feinté de jau-
ne. Les cigales de l’efpece moyenne ont plus de jaune
; celles de la petite efpece, que l’on nomme ci-
C I G 4 47
galons aux environs d’Avignon , ont moins de jaune
que celles de 1 efpece moyenne, & on voit fur quelques
unes une reinte rougeâtre. Toufes les «petites
cigales ont les alles-jaunàtres, tandis que celles des
autres font d’une couleur argentée. Les grandes cigales
ont le ventre d’une couleur jaunâtre, fale &
pale, excepté deux bandes brunes qui font près des
bords; ces bandes font formées par les.extrémités
des arcs écailleux qui recouvrent le deffus du corps,
6c qui fe replient de chaque côté fous le ventre, ou
ils aboutiffent chacun à une lame écailleufe au
moyen de laquelle chaque anneau eft complet. En
écartant ces lames les unes des autres autant qu’on
le peut, en alongeant le ventre de l’infe&e., on dér
couvre des ftigmates ; il y en a deux entre deux lames,
un de chaque côté, placé tout près de la jon-
i • élion d’une lame, avec l’arc écailleux qui lui cor-
refpond.
.En regardant les cigales par-deflous, on apper-
çoit deux petites antennes qui n’ont que quelques lignes
de longueur, & qui font pofées près des yeux
à réfeaux. Il y a au bout de la tête une piece triangulaire
qui reffemble en quelque façon à un menton,
qui recouvre le deffus de la tête, & qui s’étend plus
loin; la bafe eft en-avant, & le fommet en^arriere;
il forme une pointe dont fort la trompe avec laquelle
la cigale tire le fuc des feuilles 6c des branches d’arbres.
Le fourreau de la trompe tient à des- parties
mernbraneufes qui fe trouvent au-deffous du menton,
vis-à-vis fon milieu. Ce fourreau s’étend au-delà
de la pointe du menton, comme un fil de la groffeur
& de la longueur d’une perite épingle. Lorfqu’on levé
la pointe du menton, la trompe fort de ion étui,
& elle y rentre lorfque cette pointe fe remet dans fa
pofition naturelle ; quelquefois la trompe entraîne
fon fourreau, lorfque l’infede le fait mouvoir. Il eft
fait en forme de gouttière, le long de laquelle on
voit une*legere fente, lorfqu’on regarde la cigale
par-deffems. Cette fente s’élargit quand la trompe
fortr-’on peut la tirer de fon fourreau avec la pointe
d’une épingle , & la divifer en trois filets écailleux.
Les organes dont vient le bruit que l’on appelle
le chant de La cigale , font placés dans fon
ventre; on ne les trouve que dans les mâles, car
■ les femelles ne font aucun bruit. Il y a fur le ventre
des cigales mâles de la grande efpece, deux plaques
écaiileufes qui font aflez grandes, qui tiennent au
fécond corcelet, 6c qui s ’étendent prefque jufqu’au
troifieme anneau; elles font pofées de foçonque l’une
recouvre un peu l’autre. On peut foûlever ces
plaques par leur extrémité fupérieure ; mais elles
font arrêtées par une efpece de cheville faite en for-.
m? ^’®P^nes » A°nt chacune tient par l’une de fes extrémités
à la partie de la jambe poftérieure qui s’articule
avec le corcelet, 6c appuie par l’autre extrémité
fur l’une des plaques. Ces épines empêchent:
que les plaques ne foient trop foûlevées , 6c les remettent
en fituation. Lorfqu’on a relevé les plaques,
on trouve dans la partie antérieure du ventre une
cavité qui eft partagée en deux loges ; le fond de
chacune de ces loges eft luifant comme un miroir *
il y a une membrane tendue & tranfparente comme
le verre, fur laquelle on voit toutes.les couleurs
de l’arc-en-ciel, lorfqu’on la regarde obliquement.
Si on enlevé la partie fupérieure du premier
6c du fécond anneau, & fi on met à découvert
du côté du dos l’endroit qui correlpond à la cavité
où font les miroirs, on y trouve deux mut
clés qui font compofés d’un grand nombre de fibres
droites ; ils forment, en s’approchant, un angle
aigu fur les revers de la piece triangulaire dont
il a déjà été fait mention. Ces mufcles aboutiflent
aux organes qui produifent le bruit de la cigale ; ils
fojnt fîmes dans deux réduits dont les deux°orifices