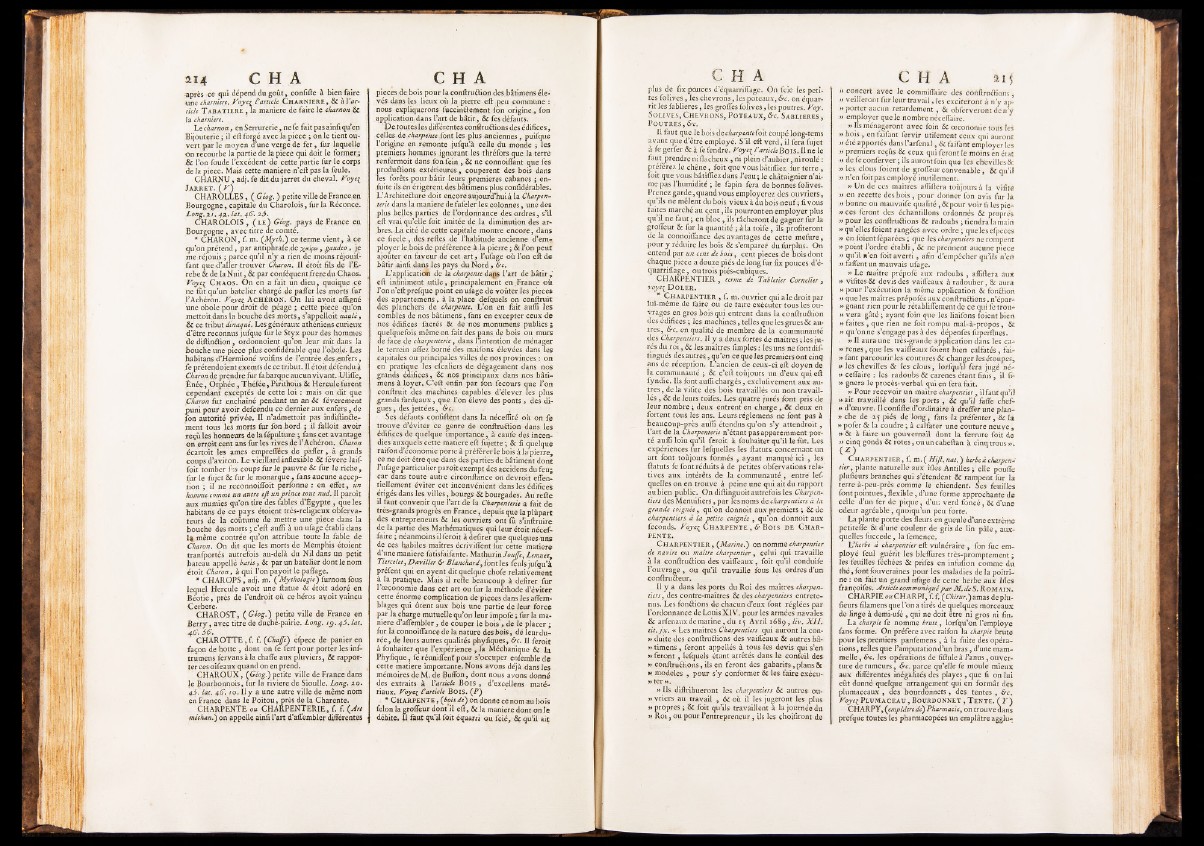
apres ce qui dépend du goût, confifte à bien faire
«ne charnière. Voyt^ Üarticle CHARNIERE, & h l ’ar-
ticle T abatière , ia maniéré de faire le charnon &
\z charnière.
Le charnon, en Serrureriene fe fait pas ainfi qu’en
Bijouterie ; il eft forgé avec la piece ; on le tient ouvert
par lé moyen d’une verge.de fe r , fur laquelle
on récourbe la partie de la piece qui doit le former ;
& l’on foude l’excédent de cette partie fur le corps
de la piece. Mais cette maniéré n’eft pas la feule.
CHARNU, adj. fe dit du jarret du cheval. V
Ja r r e t . ( V )
CHAROLLES, ( Géog. ) petite ville de France,eu
Bourgogne, capitale du Charolois, fur la Réconçe.
Long, z i . 4z. lat. 4<f. z â .
CHAROLOIS , ( le ) Géog. pays de France en
Bourgogne, avec titre de comté.
* CHARON, f. m. (Myth.) ce terme vient, à çe
qu’on prétend, par antiphrafe.de Xaipt* , gaudeo , je
me réjouis ; parce qu’il n’y a rien de moins réjouif-
fant que d’aller trouver Charon. Il étoit fils de l’E-
rebe & de la Nuit, & par conféquentfrere du Chaos.
Voyei C h a o s . On en a fait un dieu, quoique ;çe
ne fîit qu’un batelier chargé de paffer les morts fur
l’Achéron. Xoye^ A ch éro n . On lui avoit affigné
une obole pour droit de péage ; cette piece qu’on
mettoit.dans la bouche des morts , s’appelloit naulé,
& ce tribut dinaqué. Les généraux athéniens curieux
d’être reconnus jufque fur le Styx pour des hommes
de diftinûion, ordonnoient qu’on leur mit dans la
boüche une piece plus confidérable que l’obole. Les
habitans d’Hermioné voifins de l’entrée des •enfers,
fe prétendoient exemts de ce tribut. Il étoit défendu à
Char on f e prendre fur fa barque aucun vivant. Uiiffe,
Ênée, Orphée , T héfée, Pirithoiis & Hercule furent
cependant exceptés de cette loi : mais on dit que
/Charon fut .ejichaîné pendant un an & féverement
puni pour avoir defeendu ce dernier aux enfers, de
fon autorité privée. Il n’admettoit pas indiftinde-
ment tous les morts fur fon bord ; il falloir avoir
reçû tes honneurs de la fépulture ; fans cet avantage
on errait cent ans fur les riv.es de l’Achéron. Charon
écartoit tes âmes empreffées de paffer , à grands
coups d’aviron. Le vieillard inflexible & fèvere laif-
foit tomber tes coups fur le pauvre & fur le riche,
fur 1e fujet & fur 1e monarque, fans aucune acception
; il ne reconnoiffoit perfonne : en effet, un
homme comme un autre ejl un prince tout nud. Il paroît
aux mumies qu’on tire des fables d’Égypte , que tes
habitans de ce pays étoient très-religieux obferva-
teurs de la coûtume de mettre une piece dans la
bouche des morts ; c’eft aufli à un ufage établi dans
1% même contrée qu’on attribue toute la fable de
Charon. On dit que tes morts de Memphis étoient
tranfportés autrefois au-delà du Nil dans un petit
bateau appellé haris, & par un batelier dont 1e nom
étoit Charon, à qui l’on payoit 1e paffage.
* CHAROPS, adj. m. ( Mythologie) furnom fous
lequel Hercule avoit une ftatue & étoit adoré en
Béotie, près de l’endroit où ce héros avoit vaincu
Cerbere.
CHAROST, ( Géog. ) petite ville de France en
B e r ry , avec titre de duché-pairie. Long. ic/.qS. lat.
4G.5.Ç.
CH AROTTE, f. f. (Chajjë) efpece de panier en
façon de hotte , dont on fe fèrt pour porter les inf-
trumens fervans à la chaffe aux pluviers, & rapporter
ces oïfeaux quand on en prend.
CHAROUX, (Géog.') petite ville de France dans
le ÎJpurbonnois, fur la riviere de Sioulle. Long. zo .
4$. lat. 4Ç. 10. Il y a une autre ville de même nom
en France dans 1e Poitou, près de la Charente.
CHARPENTE ou CHARPENTERIE, f. f. (Art
méchant) on appelle ainft l’art d’affembler différentes
pièces de bois pour la conftruflion des: bâtimens élevés
dans les lieux où la pierre eft peu commune :
nous expliquerons fuccin&ement fon origine., fon
.application,dans l’art de bâtir , & fes défauts.
D e toutes tes différentes conûru&ions des édifices,
celles de charpente.font les plus anciennes , puifque
l’origine en remonte jufqu’à celte du monde ; tes
premiers hommes ignorant tes thréfors que la terre
renfermoit dans fon fein , & ne connoiffant que fes
productions extérieures, coupèrent des bois dans
les forêts pour bâtir leurs .premières cabanes ; en-
fuite ils en érigerent des bâtimens plus confîdérables.
L’Architecture doit encore aujourd’hui à Xz Charpenterie
dans la maniéré de fufeler tes colonnes, une des
plus belles parties de l’ordonnance des ordres, s’il
eft vrai qu’elle foit imitée de la diminution des arbres.
La cité de cette capitale montre encore, dans
ce fiecle , des reftes de l’habitude ancienne d’employer
le bois de préférence à la pierre; & l ’on peut
ajoûter en faveur de cet a r t, l’ufage où l’on eft de
bâtir ainfi dans les pays du Nord , &c.
L’application de la charpente daps l ’art de bâtir ,'
eft infiniment utile , principalement en France où
l’on n’eft prefque point en ufage de voûter les pièces
des appartemens, à la place defquels on confirait
des planchers de charpente. L’on en fait aufli tes
combles de nos bâtimens, fans en excepter ceux de
nos édifices facrés & de nos monumens publics ;
quelquefois même on fait des pans de bois ou murs
de face de charpenterie, dans l’intention de ménager
1e terrein affez borné des maifons élevées dans les
.capitales ou principales villes de nos provinces : on
en pratique les efcaliers de dégagement dans nos
grands édifices, & nos principaux dans nos bâtimens
à loyer. C ’eft enfin par fon fecours que l’on
confirait des machines capables d’élever les plus
grands fardeaux, que l’on éleye des ponts , des digues
, des jettées, &c.
Ses .défauts confiftent dans la néceflité où on fe
trouve d’éviter ce genre de conftrudion dans les
édifices de quelque importance, à caufe des incendies
auxquels cette matière eft fujette ; & fi quelque
raifon d’économie porte à préférer le bois à la pierre,
ce ne doit être que dans des parties de bâtiment dont
l’ufage particulier paroît exempt des accidens du feu;
car dans toute autre circonftance on devrait effen-
tiellement éviter cet inconvénient dans tes édifices
érigés dans les villes, bourgs & bourgades. Au refte
il faut convenir que l’art de la Charpenterie a fait de
trèsrgrands progrès en F rance, depuis que la plûpart
des entrepreneurs & tes ouvriers ont fû s’inftruire
de la partie des Mathématiques qui leur étoit nécef-
faire ; néanmoins il ferait à defirer que quelques-uns
de ces habiles maîtres écrivirent fur cette matière
d’une maniéré fatisfaifante. Mzûmxïn JouJJe, Lemuet,
Tiercelet, Daviller & Blanchard, font les teuls jufqu’à
préfent qui en ayent dit quelque chofe relativement
à la pratique. Mais il refte beaucoup à defirer fur
l ’oeconomie dans cet art ou fur la méthode d’éviter
cette énorme complication de piçces dans les affem-
blages qui ôtent aux bois une partie de leur force
par la charge mutuelle qu’on leur impofe ; fur la maniéré
d’affembler, de couper te b o is , de le placer ;
fur là connoiffance de la nature des bois, dé leur durée,
de leurs autres qualités phyfiques, &c. Il feroit
à fouhaiter que l’expérience , la Méchanique & la
Phyfique, fe réunifient pour s’occuper enfemble de
cette matière importante. Nous avons déjà dans les
mémoires de M. de Buffon, dont nous avons donné
des extraits à f article Bo is , d’excellens matériaux.
Voye[ Carticle BOIS. (P)
* C harpente , (bois de) on donne ce nom au bois
félon la groffeur dont il eft, & la maniéré dont on le
débite. Il faut qu’il foit équarri ou fgié, & qu’il ait
plus de fix pouces d’équarriffage. On fete les petites
folives , tes chevrons, les poteaux, &c. on équar-
rit tes fablieres, les groffes folives -, tes poutres. P'oy.
S o liv e s, C hevrons, Po t e a u x , &c. Sablières ,
Po u t r e s , & c.
Il faut que 1e bois de charpenté foit coupé long-tems
avant que d’être employé. S’il eft verd, il fera fujet
à fe gerfer & à fe fendre. Voye^ Varticle B o is . Il ne 1e
faut prendre ni flacheux, ni plein d’aubier, ni roulé :
préférez 1e chêne, foit que vous bâtifliez fur terre ,
foit que vous bâtifliezdans l’eau; 1e châtaignier n’aime
pas l’humidité ; 1e fapin fera de bonnes folives.
Prenez garde, quand vous employerez des ouvriers,
qu’ils ne mêlent du bois vieux à du bois neuf ; fi vous
faites marché au qent, ils pourront en employer plus
qu’il ne faut ; en b lo c , ils tâcheront de gagner fur la
groffeur & fur la quantité ; à la toife , ils profiteront
de la connoiffance des avantages de cette mefure,
pour y réduire les bois & s’emparer du furplus. On
entend par un cent de bois, cent pièces de bois; dont
chaque piece a douze piés de long fur fix pouces d’é-
quarriffage, outrais piés-cubiques.
CHARPENTIER , terme de Tabletier Corneliet,
voyei D o ler.
•* Ç HARPENJ I1&R 9 H ni. ouvrier qui a le droit par
lui-même de faire ou de faire exécuter tous les ouvrages
en gros bois qui entrent dans la eonftruftion
des édifices ; les machines, telles que les grues & autres,
&c. en qualité de membre de la communauté
des Charpentiers. Il y a deux fortes de maîtres ; les jurés
du ro i, & les maîtres fimples : tes uns ne font distingués
des autres, qu’en ce que les premiers ont cinq
ans de réception. L’ancien de ceux-ci eft doyen de
la communauté ; Sc c’eft toûjours un d’eux qui eft
fyndic. Ils font aufli chargés, exclufivement aux autres
, de la vifite des bois travaillés ou non travaillés
, & de leurs toiles. Les quatre jurés font pris de
leur nombre ; deux entrent en charge, & deux en
Portent tous tes ans. Leurs réglemens ne font pas à
beaucoup-près aufli étendus qu’on s’y attendrait,
l ’art de la Charpenterie n’étant pas apparemment porté
aufli loin qu’il feroit à fouhaiter qu’ il 1e fût. Les
expériences lur lefqtielles tes ftatuts concernant un
art font toûjours formés , ayant manqué ici , tes
ftatuts fe font réduits à de petites obfervations relatives
aux intérêts de la communauté , entre lef-
quelles on en trouve à peine une qui ait du rapport
au bien public. On diftinguoit autrefois tes Charpentiers
des Menuifiers, par tes noms àe charpentiers à la
grande coignée, qu’on donnoit aux premiers ; & de
charpentiers à la petite coignée , qu’on donnoit aux
féconds. Voye^ C harpente , & B o is de C harpent
e.
C h a r p en t ie r , (Marine.) on nomme charpentier
de navire ou maître charpentier, celui qui travaille
à la conftruélion des vaiffeaux, foit qu’il conduife
l ’ouvrage, ou qu’il travaille fous tes. ordres d’un
conftruéleur.
Il y a dans tes ports du Roi des maîtres charpentiers,
des contre-maîtres & des charpentiers entretenus.
Les fondions de chacun d’eux font réglées par
l’ordonnance de Louis XIV. pour les armées navales
& arfenaux de marine, du 15 Avril 1689, liv. X I I .
tit. j x . « Les maîtres Charpentiers qui auront la con-
>» duite des conftrudions des vaiffeaux & autres bâ-
» timens , feront appellés à tous les devis qui s’en
» feront, lefquels étant arrêtés dans le conseil des
» conftr u étions, ils en feront des gabarits, plans &
n modèles , pour s’y conformer & tes faire exécu-
» ter ».
» Ils diftribueront tes charpentiers & autres ou-
» yriers au travail , & où il tes jugeront les plus
» propres ; & foit qu’ils travaillent à la journée du
» R o i, ou pour l’entrepreneur, ils tes choifiront de
» concert avec 1e commiffaire des côhftru&ioïis,
» veilleront fur leur travail, les excitefont à n’y ap-
» porter aucun retardement , & obferveront de n’y
» employer que 1e nombre néceffaire.
» Ils ménageront avec foin & oecortottiie toüs les
» bois , en faifant fervir utilement ceux qui auront
» ete apportes dans l’arfenal, & faifant employer les
» premiers reçûs & ceux qui feront le moins en état
» de fe conferver ; ils auront foin que les chevilles &
» les clous foient de groffeur convenable, & qu’il
» n’en foit pas employé inutilement.
» Un de ces maîtres afliftera toûjours à la vifité
» en recette des bois, pour donner fon avis fur lâ
» bonne ou mauvaife qualité, & pour voir fi les pie-
»ces feront des échantillons ordonnés & propres
» pour tes conftruâions & radoubs ; tiendra la main
» qu’elles foient rangées avec ordre ; quelesefpeces
» en foientféparées ; que tes charpentiers ne rompent
» point l’ordre établi, &: ne prennent aucune piece
» qu’il n’en foit averti , afin d’empêcher qu’ils n’en
» faffent un mauvais ufage.
» Le maître prépofé aux radoubs , afliftera aux
» vifites & devis des vaiffeaux à radouber, & aura
» pour l’exécution la même application & fonûion
» que tes maîtres prépofés aux conftruélions, n’épar-1
» gnant rien pour 1e rétabliffement de ce qui fe trou-»
» vera gâté ; ayant foin que tes liaifons foient bien
» faites , que rien ne foit rompu mal-à-propos, &
» qu’on ne s’engage pas à des dépenfes fuperflues.
» Il aura une très-grande application dans tes ca-
» renes, que les vaiffeaux foient bien calfatés, fai-
» fant parcourir les coutures & changer les étoupes,
» les chevilles & les clous, lorfqu’il fera jugé hé-
» ceffaire : les radoubs & carénés étant finis, il fi-
» gnera le procès-verbal qui en fera fait.
» Pour recevoir un maître charpentier, il faut qu’il
» ait travaillé dans les ports , & qu’il faffe chef-
» d’oeuvre. Ilconfifte d’ordinaire à dreffer une plan-
» che de 25 pies de long, làns la préfenter, & là
» pofer & la coudre ; à calfater une couture neuve ,
» & à faire un gouvernail dont la ferrure foit de
» cinq gonds & rotes, ouuncabeftan à cinq trous ».
( Z )
C harpentier , f. m. ( Hijl^nat. } herbe à charpentier,
plante naturelle aux Mes Antilles ; elle pouffe
plufieurs branches qui s’étendent & rampent fur la
terre à-peu-près comme le chiendent. Ses feuilles
font pointues, flexible, d’une forme approchante de
celte d’un fer de pique, d’uu verd foncé, & d’une
odeur agréable, quoiqu’un peu forte.
La plante porte des fleurs en gueule d’une extrême
petiteffe & d’une couleur de gris de lin pâle, auxquelles
fuccède, la femence.
L herbe à charpentier eft vulnéraire , fon fuc employé
feul guérit tes bleffures très-promptement ;
les feuilles féchées & prifes en infufion comme du
thé, font fouveraines pour les maladies de la poitrine
: on foit un grand ufage de cette herbe aux Ifles
françoifes. Article communiqué par M. de S. R om ain .
CHARPIEokCHARPI, f.f, (Chirur.)amasdeplu-
fieurs filamens que l’on a tirés de quelques morceaux
de linge à demi-ufé , qui ne doit être ni gros ni fin.
La charpie fe nomme brute, lorfqu’on Remployé
fans forme. On préféré avec raifon la charpie brute
pour tes premiers panfemens , à la fuite des opérations
, telles que l’amputation d’un bras, d’une mam-
melle, &c. tes opérations, de fiftuleà l’anus, ouverture
de tumeurs, &c. parce qu’elle fe moule mieux
aux différentes inégalités des playes , que fi on lui
eût donné quelque arrangement qui en formât des
plumaceaux , des bourdonnets, des tentes , &c.
fbye^PLUMACEAU, B6URDONNET , TENTE. ( T )
CHARPY, (emplâtre de) Pharmacie, on trouve dans
prefque toutes tes pharmacopées un emplâtre agglu