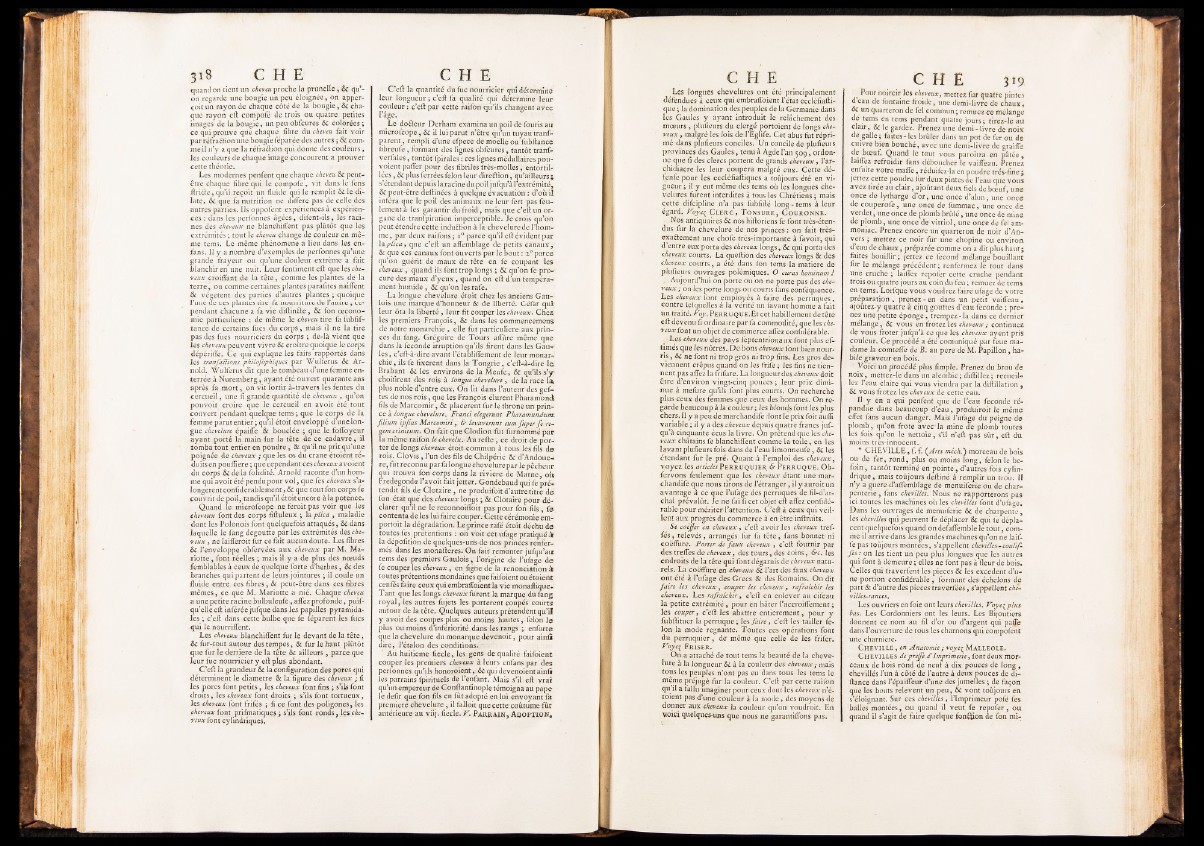
quand on tient un cheveu proche la prunelle , & qu’on
regarde une bougie un peu éloignée, on apper-
çoit un rayon de chaque côté de la bougie, & chaque
rayon eft compofé de trois ou quatre petites
images de la bougie, un peu obfcures & colorées ;
ce qui prouve que chaque fibre du cheveu fait voir
par réfrafrion une bougie féparée des autres ; & comme
il n’y a que la réfrafrion qui donne des couleurs,
les couleurs de chaque image concourent a prouver
cette théorie.
Les modernes penfent que chaque cheveu & peut-
être chaque fibre qui le compofe, vit dans le fens
ftricle, qu’il reçoit un fluide qui le remplit & le dilate,
& que fa nutrition ne différé pas de celle des
autres parties. Ils oppofent expériences à expériences
: dans les perfonnes âgées, difent-ils, les racines
des cheveux ne blanchiflent pas plutôt que les
extrémités ; tout le cheveu change de couleur en même
tems. Le même phénomène a lieu dans les en-
fans. Il y .a nombre d’exemples de perfonnes qu’une
grande frayeur ou qu’une douleur extrême a fait
blanchir en une nuit. Leur fentiment eft que les che- .
veux croiffant.de la tête, comme les plantes de la
terre, ou comme certaines plantes parafites naiffent
& végètent des parties d’autres plantes ; quoique
l ’une de ces plantes tire fa nourriture de l’autre, cependant
chacune a fa vie diftin&e, & fon oecono-
mie particulière : de même le cheveu tire fa fubfif-
tance de certains fucs du corps, mais il ne la tire
pas des fucs nourriciers du corps ; de-là vient que
les cheveux peuvent vivre & croître quoique le corps
dépériffe. Ce qui explique les faits rapportés dans
les tranfactions philofoplüques par "Wiilferus & Arnold.
Wulferus dit que le tombeau d’une femme enterrée
à Nuremberg, ayant été ouvert quarante ans
après fa mort, on vit fortir à-travers les fentes du
cercueil, une fi grande, quantité de cheveux , qu’on
po'uVoit croire que le. cercueil en avoit été tout
couvert pendant quelque tems; que le corps de la
femme parut entier ; qu’il étoit enveloppé d’une lon-
gue chevelure épaiffe & bouclée ; que le foffoyèur
ayant porté la. main fur la tête de ce cadavre, il
tomba tout entier en poudre, & qu’il ne prit qu’une
poignée de cheveux ; que les os du crâne étaient réduits
en poufliere ; que cependant ces cheveux avoient
du corps & de la folidité. Arnold raconte d’un homme
qui avoit été pendu pour v o l, que fes cheveux s’a-
longerent considérablement, & que tout fon corps fe
couvrit de poil, tandis qu’il étoit encore à la potence*
Quand le microfcope ne feroit pas voir que les
cheveux font des corps fiftuleux ; la plica , maladie
dont les Polonois font quelquefois attaqués, & dans
laquelle le fang dégoutté par les extrémités des cheveux
, ne laifferoit fur ce fait aucun doute. Les fibres
& l’enveloppe obfervéës aux cheveux par M. Ma-
riotte, fpnt réelles ; mais il y a de plus des noeuds
Semblables à ceux de quelque forte d’herbes, & des
branches qui partent de leurs jointures ; il coule un
fluide entre ces fibres, & peut-être dans ces fibres
mêmes , ce que M. Mariotte a nié. Chaque cheveu
a une petite racine bulbuleufe,.affez profonde, puif-
qu’elleeft inférée jufque dans les papilles pyramidales
; e’eft dans cette bulbe que fe féparent les fucs
qui le nourriffent.
Les cheveux blanchiflent fur le devant de la tê te ,
& fur-tout autour des tempes, & fur le haut plutôt
que fur le derrière de la tête &c ailleurs, parce que
leur fuc nourricier y eft plus abondant. .
C ’eft la grandeur & la configuration des pores qui
déterminent le diamètre & la. figure des cheveux ; fi
les pores font p etits, les cheveux font fins ; s’ils font
droits, les cheveux font droits ; s’ils font tortueux,
les cheveux font frifés ; fi ce font des poligones, les
cheveux font prifmatiques ; s’ils font ronds, les cheveux
font cylindriques.
C ’eft la quantité du fuc nourricier qui déterminé
leur longueur ; c’eft fa qualité qui détermine leur
couleur : ç’eft par cette raifon qu’ils changent avec
l’âge.
Le dofreur Derham examina un poil dé fouris au
microicope, & il lui parut n’être qu’un tuyau tranf-
parent, rempli d’une efpece de moelle ou fubftance
ribreufe, formant des lignes obfcures, tantôt tranf-
verfales, tantôt fpirales : ces lignes médullaires pou-
voient paffer pour des fibriles très-molles, entortillées
, & plus ferrées félon leur direûion, qu’ailleurs j
s’étendant depuis la racine du poil jufqu’à l’extrémité,
& peut-être deftinées à quelque évacuation : d’où il
inféra que le poil des animaux ne leur fert pas feulement
à les garantir du froid, mais que c’eft un organe
de tranfpiration imperceptible. Je crois qu’on
peut étendre cette induélion à la chevelure de l ’homme,
par deux raifons; i° parce qu’il eft évident par
la plica, que c’eft un aflëmblage de petits canaux,’
& que ces canaux font ouverts par le bout : i ° parce
qu’on guérit de maux de tête en fe coupant les
cheveux , quand ils font trop longs ; & qu?ôn fe procure
des maux d’y e u x , quand on eft d’un tempéra-*
ment humide, & qu’on les rafe.
La longue chevelure étoit chez les anciens Gaulois
une marque d’honneur & de liberté. Céfar qui
leur ôta la liberté, leur fit couper les cheveux. Chez;
les premiers François, & dans les commencement
de notre monarchie, elle fut particuliere aux princes
du fang. Grégoire de Tours affûre même que
dans la fécondé irruption qu’ils firent dans les Gauv
les, c’eft-à-dire avant l’établiffement de leur monar-»
chie, ils fe fixèrent dans la Tongrie, c’eft-à-dire le
Brabant & les environs de la Meufe, & qu’ils s’y*
choifirerit des rois à longue chevelure, de la race 1%
plus noble d’entre eux. On lit dans l’auteur des gef-
tes de nos rois, que les François élurent Pharamond
fils de Marçomir, & placèrent fur le throne un prince
à longue chevelure. Franci elegerunt Pharamundum.
filium ipfius Marcomiri , & lev'averünt eum fuper fe regent
crinitum. On-fait que Clodion fut furnommé par
la même raifon le chevelu.* Au refte, ce droit de porter
de longs cheveux étoit-commun à tous les fils do
rois. C lo vis , l’un des fils de Chilpéric & d’Andoue-
re, fut reconnu par fa longue chevelure par le pêcheur
qui trouva fon corps dans la riviere de Marne, oit
Fredegonde Pavoit fait jetter. Gondebaud qui fe prétendit
fils de Clotaire, ne produifoit d’autre titre de
fon état que des cheveux longs ; & Clotaire pour déclarer
qu’il ne lereconnoiffoit pas pour fon fils, fe
contenta de les lui faire couper. Cette cérémonie em-
portoit la dégradation. Le prince rafé étoit déchu de
toutes fes prétentions : on voit cet ufage pratiqué k
la dépofition de quelques-uns de nos princes renfermés
dans les monafteres. 0 n fait remonter jufqu’ai*
tems des premiers Gaulois, l’origine de l’ufage de
fe couper les cheveux, en fighe de la renonciation à
toutes prétentions mondaines que faifoient ou étaient
cenfés faire ceux qui embraffoient la vie monaftique-
Tant que les longs cheveux furent la marque du fang
ro ya l, les autres fujets les portèrent coupés courts?
autour de la tête. Quelques auteurs prétendent qu’il
y avoit des coupes plus ou moins hautes, félon les
plus ou moins d’infériorité .dans les rangs enforte
que là chevelure du monarque devénoit, pour ainfî
dire, l’étalon des conditions.:"
Au huitième fiecle, les gens de qualité faifoient
coupèr les premiers cheveux à leurs enfans par des
perfonnes qu’ils honoroieiit,,„& quidevenoientainfî
les parrains fpirituels de l’enfant. Mais s’il eft vrai
qu’uii empereur de Conftantinople témoigna au pape
le defir que fon fils en fût adopté en lui envoyant fa
première chevelure, il falloit que cette coûtume fût
antérieure au viij. fiecle. K Parrain, Adoption,
Les longues chevelures ont été principalement
défendues à ceux qui embraffoient l’état eccléfiafti-
que ; la domination des peuples de la Germanie dans
les Gaules y ayant introduit le relâchement des
moeurs , plufieurs du clergé portoient de longs cheveux
, malgré les lois de l’Eglife. Cet abus fut réprimé
dans plufieurs conciles. Un concile de plufieurs
provinces des Gaules, tenu à Agdel’an $09, ordonne
que fi des clercs portent de grands cheveux, l’archidiacre
les leur coupera malgré eux. Cette dé-
fenfe pour les eccléfiaftiques a toûjours été en vigueur
; il y eut même des tems où les longues chevelures
furent interdites à tous les Chrétiens ; mais
cette difcipline n’a pas fubfifté long - tems à leur
é,gard. Voye{ C l e r c , T onsure, C o uronne.
Nos antiquaires & nos hiftoriens fe font très-étendus
fur la chevelure de nos princes : on fait très-
exa&ement une chofe très-importante à favoir, qui
d’entre eux porta des cheveux longs, & qui porta des
cheveux courts. Là queftion des cheveux longs & des
cheveux courts, a été dans fon tems la matière de
plufieurs ouvrages polémiques. O curas hominum !
. Aujourd’hui on porte ou on ne porte pas des cheveux;
on les porte longs ou courts fans conféquence.
Les cheveux font employés à faire des perruques,
contre lefquelles à la vérité un lavant homme a fait
un traité. Foy. Perruque.Et cet habillement de tête
eft de venu fi ordinaire par fa commodité, que les cheveux
font un objet de commerce affez confidérable.
Les cheveux des pays feptentrionaux font plus ef-
timés que les nôtres. D e bons cheveux font bien nourris
, & ne font ni trop gros ni trop fins. Les gros deviennent
crépus quand on les frife ; les fins ne tiennent
pas affez la frifure. La longueur des cheveux doit
etre d’environ vingt-cinq pouces ; leur prix diminue
à mefure qu’ils font plus courts. On recherche
plus ceux des femmes que ceux des hommes. On regarde
beaucoup à la couleur ; les blonds font les plus
chers. Il y a peu de marchandife dont le prix foit aulîi
variable ; il y a des cheveux depuis quatre francs jufqu’à
cinquante écus la livre. On prétend que les cheveux
châtains fe blanchiflent comme la toile, en les
lavant plufieurs fois dans de l’eau limonneufe, & les
étendant fur le pré. Quant à l’emploi des cheveux,
yoye z les articles Perruquier & Perruque. Ob-
fervons feulement que les cheveux étant une marchandife
que nous tirons de l’étranger, il y auroit un
avantage à ce que l’ufage des perruques de fil-d’ar-
chal prévalût. Je ne fai fi cet objet eft affez confidérable
pour mériter l’attention. C’eft à ceux qui veillent
aux progrès du commerce à en être inftruits.
. Se co'èffer en cheveux, c’eft avoir les cheveux tref-
fés , relevés, arrangés fur fa tête, fans bonnet ni
çoëffure. Porter de faux cheveux , c’eft fournir par
des treffes de cheveux, des tours, des coins, &c. les
endroits de la tête qui font dégarnis de cheveux naturels.
La çoëffure en cheveux & l ’art des faux cheveux
ont été à l’ufage des Grecs & des Romains. On dit
faire les cheveux, couper les cheveux, rafraîchir les
cheveux. Les rafraîchir, c’eft en enlever au cifeau
la petite extrémité, pour en hâter l’accroiffement ;
les couper, c’eft les abattre entièrement, pour y
fubftituer la perruque ; les faire, c’eft les tailler fe-
l<?n la mode régnante. Toutes ces opérations font
du perruquier, de même que celle de les frifer.
Friser.
On a attaché de tout tems la beauté de la chevelure
à la longueur & à la couleur des cheveux ; mais
tous les peuples n’ont pas eu dans tous les tems le
meme préjugé fur la couleur. C ’eft par cette raifon
qu’il a fallu imaginer pour ceux dont les cheveux n’é-
toient pas d’une couleur à la mode, des moyens de
donner aux cheveux la couleur qu’on voudroit. En
voici quelques-uns que nous ne garantiffons pas. 1
Pour noircir les cheveux, mettez fur quatre pintes
d eau de fontaine froide, une demi-livre de chaux ^
& un quarteron de fel commun; remuez ce mélange
de tems en tems pendant quatre jours ; tirez-le au
clair, & le gardez. Prenez une demi-livre de noix
de galle; faites-les brûler dans un pot de fer ou de
cuivre bien bouché, avec une demi-livre de graiflb
de boeuf. Quand le tout Vous paroîrra en pâtée *
• laiffez refroidir fans déboucher le vaiffeau. Prenez
enfuite votre mafle, réduifez-la en poudre très-fine j
jettez cette poudre fur deux pintes de l’eau que vous
avez tirée au clair, ajoûtant deux fiels de boeuf, Une
once de lytharge d’or, une once d’alun, une once
de cOuperofe, une once de fummac, une once de
verdet, une once de plomb b rûlé, une once de mine
de plomb, une once de vitriol, une once de fel ammoniac.
Prenez encore un quarteron de noir d’Anvers
; mettez ce noir fur une chopine ou environ
d’eau de chaux, préparée comme on a dit plus haut;
faites bouillir ; jettez ce fécond mélange bouillant
fur le mélange précédent; renfermez le tout dans
une cruche ; laiffez repofer cette cruche pendant
trois ou quatre jours au coin du feu ; remuez de tems
en tems. Lorfque vous voudrez faire ufage de votre
préparation , prenez - en dans un petit vaiffeau ,
ajoûtez-y quatre à cinq gouttes d’eau fécondé ; prenez
une petite éponge, trempez - la dans ce dernier
mélange, & vous en frotez les cheveux ; continuez
de vous frôter jufqu’à ce que les cheveux ayent pris
couleur. Ce procédé a été comuniqué par feue madame
la comteffe de B. au pere de M. Papillon, habile
graveur en bois.
' Voici un procédé plus fimple. Prenez du brou de
noix, mettez-le dans un alembic ; diftillez ; recueil4*
lezri’eau claire qui vous viendra par la diftillation ,
& vous frotez les cheveux de cette eau.
Il y en a qui penfent que de l’eau fécondé répandue
dans beaucoup d’eau, produiroit le même
effet fans aucun danger. Mais l’ufage du peigne de
plomb, qu’on frote avec*la mine de plomb toutes
les fois qu’on le nettoie, s’il n’ eft pas sûr, eft du
moins très-innocent.
* CHEVILLE, f. f. {Arts mêch.') morceau de bois
ou de fer, rond, plus ou moins long, félon le be-
foin, tantôt terminé en pointe, d’autres fois cylindrique
, mais toûjours deftiné à remplir un trou. Il
n’y a guère d’affemblage de menuiferie ou de charpenterie
, fans chevilles. Nous ne ràpporterons pas
ici toutes les machines où les chevilles font d’ufage.
Dans les ouvrages de menuiferie & de charpente,
les chevilles qui peuvent fe déplacer & qui fe déplacent
quelquefois quand on defaffemble le tout, comme
il arrive dans les grandes machines qu’on ne laifi-
fe pas toûjours montées, s’appellent chevilles-coulif-
fes: on les tient un peu plus longues que les autres
qui font à demeure ; elles ne font pas à fleur de bois.
Celles qui traverfent les pièces & les excédent d’une
portion confidérable , formant des échelons de
part & d’autre des pièces traverfées, s’appellent chevilles
rances.
Les ouvriers en foie ont leurs chevilles. Foyer plus
bas. Les Cordonniers ont les leurs. Les Bijoutiers
donnent ce nom au fil d’or ou d’argent qui pafije
dans l’ouverture de tous les charnons qui compofent
une charnière.
C heville , en Anatomie ; voye{ MALLEOLE.
C hevilles de preffe d'Imprimerie, font deux morceaux
de bois rond de neuf à dix pouces de long ,
chevillés l’un à côté de l’autre à deux pouces de di-
ftance dans l’épaiffeur d’une des jumelles ; de façon
que les bouts relevent un peu, & vont toûjours en
s’éloignant. Sur ces chevilles, l’Imprimeur pofé fes
balles montées, ou quand il veut fe repofer, ou
quand il s’agit de faire quelque fonction de fon mi