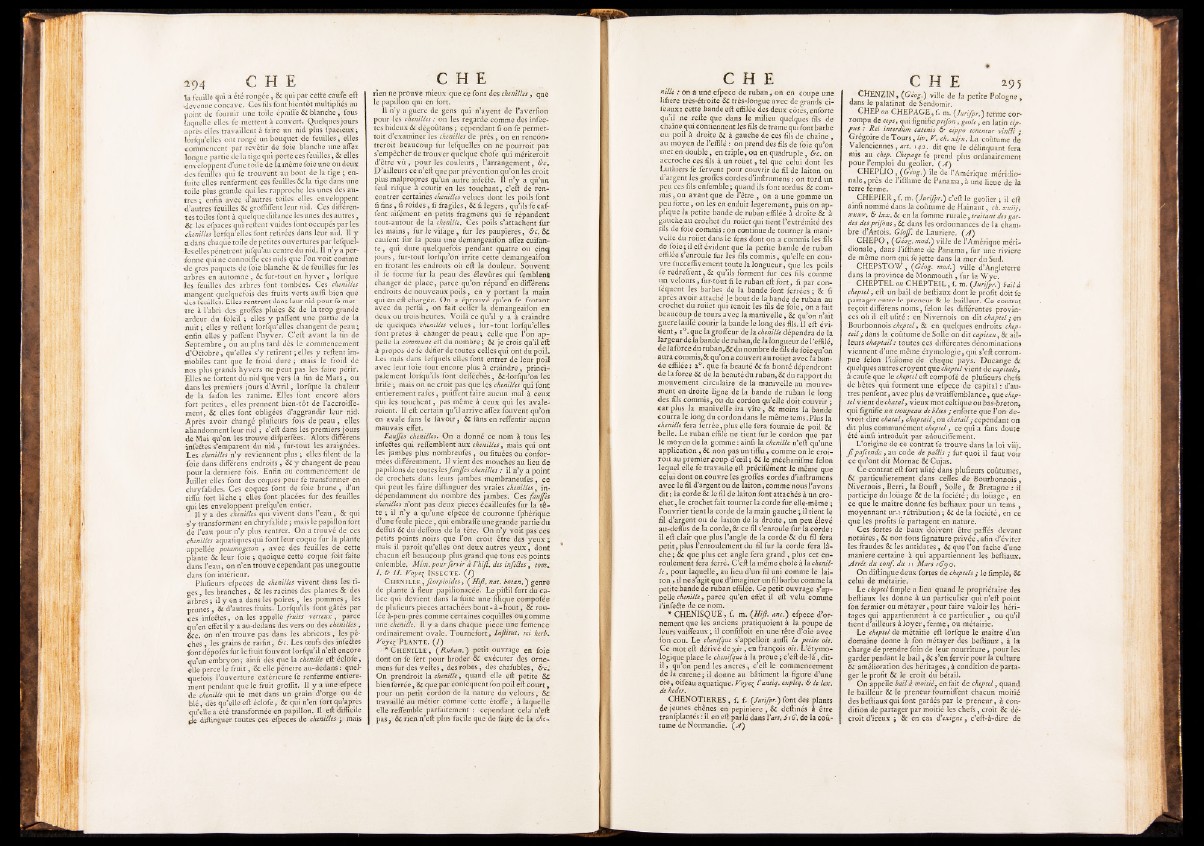
ta feuille qui a été ro n g é e , 6c qui par Cette câufe eft
•devenue con ca ve . C e s fils font b ientôt multipliés au
point de fournir une toile épaiffe 6c blan ch e , fous
laquelle elles fe mettent à couvert. Quelques jo u rs
après elles travaillent à faire un nid plus IpacieuX;
lorfqu’elles ont rongé un bouquet de feu ille s , elles
commencent par revêtir de ioie blanche une allez
longue partie de la tige qui porte ces feuilles, & elles
enveloppent d’une toile de la même foie une ou deux
des feuilles qui fe trouvent au bout de la tige ; en-
fuite elles renferment ces feuilles 6c la tige dans une
to ile plus grande qui les rapproche les unes des autres
; enfin a v e c d’autres toiles elles enveloppent
d ’autres feuilles 6c groflilfent leur nid. C es différentes
toiles font à quelque diftance les unes des au tre s ,
8c les efpaces qui relient vuides font occupés par les
chenilles lorfqu’elles font retirées dans leur nid. Il y
•a dans chaque toile de petites ouvertures par lefquel-
îe s elles pénètrent jufqu’au centre du nid. 11 n’y a personne
qui ne connoiffe ces nids que l’on v o i t comme
•de gros paquets de foie blanche 6c de feuilles fur les
arbres en automne, 6c fur-tout en h y v e r , lorfque
•les feuilles des arbres font tombées. C e s chenilles
mangent quelquefois des fruits verts aufli bien que
d e s feuilles. Elles rentrent dans leur nid pour fe mettre
à l’abri des groffes pluies 6c de la trop grande
ardeur du foleii ; elles y paffent une partie de la
nuit ; elles y relient lorfqu’elles changent de pe au ;
enfin ellès y paffent l’h y v e r . C ’eft avant la fin de
S eptemb re , ou au plus tard dès le commencement
d ’O â o b r e , qu’elles s’y retirent ; e lles y relient immobiles
tant que le froid dure ; mais le frôid de
nos plus grands hy v e r s ne peut pas les faire périr.
Elles ne iortent du nid que v ers la fin de Ma r s , ou
dans les premiers jours d’A v r i l , lorfque la chaleur
de la faifon les ranime. Elles font encore alors
fo rt pe tite s , elles prennent bien-tôt de l’accroiffe-
xnent, & elles font obligées d’aggrandir leur nid.
Après avo ir changé plufieurs fois de p e a u , elles
abandonnent leur nid ; c’eft dans les premiers jours
de Mai qu’on les trou v e difperfées. Alors différens
infe&es s’emparent du nid , fur-tout les araignées.
L e s chenilles n’y reviennent plus ; elles filent de la
fo ie dans différens endroits , 6c y changent de peau
pour la derniere fois. Enfin au commencement de
Juillet elles font des coques pour fe transformer en
chryfalides. Ces coques font de foie b ru n e , d’un
tiffu fort lâche ; elles font placées fur des feuilles
q u i les enveloppent prefqu’en entier.
Il y a des chenilles qui v iv en t dans l’ e a u , & qui
s’y transforment en chryfalide ; mais le papillon fort
de l’eau pour n’y plus rentrer. On a trouv é de ces
chenilles aquatiques qui font leur coque fur la plante
appellée potamogeton , a v e c des feuilles de cette
plante 6c leur foie ; quoique cette coque fo it faite
dans l’e au , on n’en trouv e cependant pas une goutte
dans fon intérieur.
Plufieurs efpeces de chenilles v iv en t dans les tiges
, les branche s, & les racines des plantes & des
arbres ; il y en a dans les poires , les pommes, les
prunes , & d’autres fruits. Lorfqu’ ils font gâtés par
c e s in feftes, on les appelle fruits verreux, parce
qu’en effet il y a au-dedans des v ers ou des chenilles^
& c . on n’en trouve pas dans les abricots , les pêches
, les grains de raifin, &c. Les oeufs des infeéles
font dépofés fur le fruit fouvent lorfqu’ il n’ eft encore
qu ’un embryon; ainfi dès que la chenille eft é c lo fe ,
e lle perce le f r u it , 6c elle pénétré au-dedans : quelquefois
l’ouverture extérieure fe renferme entièrement
pendant que le fruit groflit. Il y a une efpece
de chenille qui fe met dans un grain d’orge o u de
b lé , dès qu’elle eft é clo fe , & qui n’eri fort qu’après
qvfelle a été transformée en papillon. Il eft difficile
diftinguer toutes ces efpeces de chenilles ; mais
rien ne prouve mieux que ce font des chenilles, que
le papillon qui en fort.
Il n’y a guere de gens qui n’ayent de l’averfion
pour l'es chenilles : on les regarde comme des infectes
hideux & dégoûtans ; cependant fi on fe permet*
toit d’examiner les chenilles de près, on en rencon-
treroit beaucoup fur lefquelles on ne pourroit paa
s’empêcher de trouver quelque chofe qui mériteroit
d’être v u , pour les couleurs, l’arrangement, b c .
D ’ailleurs ce n’eft que par prévention qil’on les croit
plus malpropres qu’un autre infefte. Il n’y a qu’uii
feul rifque à courir en les touchant, c’eft de rencontrer
certaines chenilles velues dont les poils font
fi fins, fi roides, fi fragiles, 6c fi légers, qu’ils fe cafi-
fent aifément en petits fragmens qui fe répandent
tout-autour de la chenille. Ces poils s’attachent fur
les mains, fur le vifa g e, fur les paupières, b c . 6c
caufent fur la peau une demangeaifôn allez cuifan-
t e , qui dure quelquefois pendant quatre ou cinq
jours, fur-tout lorfqu’on irrite cette demangeaifôn
en frotant les endroits où eft la douleur. Souvent
il fe forme fur la peau des élevûres qui femblent
changer de place, parce qu’on répand en différens
endroits de nouveaux poils, en y portant la main
qui en eft chargée. On a éprouvé qu’en fe frotant
avec du perfil, on fait ceffer la demangeaifôn en
deux ou trois heures. Voilà ce qu’il y a à craindre
de quelques chenilles velues, fur-tout lorfqu’elles
font prêtes à changer de peau ; celle que l’on appelle
la commune eft du nombre; 6c je crois qu’il eft
à propos de fe défier de toutes celles qui ont du poil.
Les nids dans lelquels elles font entrer de leur poil
avec leur foie font encore plus à craindre, principalement
lorfqu’ils font defféchés, &-iorfqu’on les
brile ; mais on ne croit pas que les chenilles qui font
entièrement rafes, puiffent faire aucun mal à ceux
qui les touchent, pas même à ceux qui les avale-.
roient. Il eft certain qu’il arrive affez fouvent qu’on
en avale fans le fa v o ir , 6c fans en reffentir aucun
mauvais effet.
Faußes chenilles. On a donné ce nom à tous les
infeétes qui reffemblent aux chenilles, mais qui ont
les jambes plus nombreufes, ou fituées ou conformées
différemment. Il vient des mouches au lieu de
papillons de toutes les faußes chenilles : il n’y a point
de crochets dans leurs jambes membraneufes, ce
qui peut les faire diftinguer des vraies chenilles, indépendamment
du nombre des jambes. Ces faußes
chenilles n’ont pas deux pièces écailleufes fur la tête
; il n’y a qu’une efpece de couronne fphérique
d’une feule piece, qui embraffe une grande pâirtie du
deffus & du deffous de la tête. On n’y voit pas ces
petits points noirs que l’on croit être des yeux ;
mais il paroît qu’elles ont deux autres y e u x , dont
chacun eft beaucoup plus grand que tôiri ces points
enfemble. Mém. pour fervir à F hiß. des infectes, tom.
I . & I I . Voye^ In se c te . (/)
C henille , feorpioides, ( H iß .n a t. bot an. ) genre
de plante à fleur papilionacée. Le piftil fort du calice
qui devient dans la fuite une filique compofée
de plufieurs pièces attachées bout -? à -b ou t, 6c roulée
à-peu-près comme certaines coquilles'ou comme
un e chenille. Il y a dans chaque piece une femence
ordinairement ovale. Tournefort, Inßitut. rei herb.
V o y e f Plan t e . (/)
- * C hen ille, ( Ruban. ) petit ouvrage en foie
dont on fe fért pour broder 6c exécuter des orne-
mens fur des veftes, des robes, des chafubles, &ci
On prendroit la chenille, quand elle eft petite 6c
bien ferrée, & que par conféquent fon poil eft court,
pour un petit cordon de la nature du velours, 6c
travaillé aii métier comme cette étoffe ; à laquelle
elle reffemble parfaitement : cependant cela n’eft
pas, 6c rien n’eft plus facile que de faire de la ehe-.
nillè ; on a une efpece de ruban, on en Coupe une
lifiere très-étroite 6c très-longue avec de grands ci-
l’eaux : cette bande eft effilée des deux côtés, enforte
qu’il ne relie que dans le milieu quelques fils de
chaîne qui contiennent les fils de trame qui font barbe
ou poil à droite 6c h gauche de c es fils de chaîne ,
au moyen de l’effilé : on prend des fils de foie qu’on
met en double, en triple, ou en quadruple, &c. on
accroche ces fils à un roiiet, tel que celui dont les
Luthiers fe fervent pour couvrir de fil de laiton ou
d’argent les groffes cordes d’inftrumens : on tord un
peu ces fils enfemble; quand iis font tordus 6c commis
, ou avant que de l’être , on a une gomme un
peu forte, on les en enduit Iegerement, puis on applique
la petite bande de ruban effilée à droite 6c à
gauche au crochet du roiiet qui tient l’extrémité des
fils de foie commis : on continue de tourner la manivelle
du roiiet dans le fens dont on a commis les fils
de foie ; il eft évident que la petite bande de ruban
effilee s’enroule fur les fils commis, qu’elle en couvre
fucceffivement toute la longueur, que les poils
fe redrefient, & qu’ils forment fur ces fils comme
im velours, fur-tout fi le ruban eft fort, fi par conféquent
les barbes de la bande font ferrées ; & fi
après avoir attaché le bout de la bande de ruban au
crochet du roiiet qui tenoit les fils de foie, on a fait
beaucoup de tours avec la manivelle, & qu’on n’ait
guere laiffé courir la bande le long des fils. 11 eft évident
, i °. que la groffeur de la chenille dépendra de la
largeur de la bande de ruban,de la longueur de l ’effilé,
de la force du ruban, & du nombre de fils de foie qu’on
aura commis,& qu’on a couvert au roiiet avec la bande
effilée : z°. que fa beauté 6c fa bonté dépendront
de la force 6c de la beauté du ruban, 6c du rapport du
mouvement circulaire de la manivelle au mouvement
en droite ligne de la bande de ruban le long
des fils commis, ou du cordon qu’elle doit couvrir ;
car plus la manivelle ira v ite , 6c moins la bande
courra le long du cordon dans le même tems. Plus la
chenille fera ferrée, plus elle fera fournie de poil 6c
belle. Le ruban effilé ne tient fur le cordon que par
le moyen de la gomme : ainfi la chenille n’eft qu’une
application , 6c non pas un tiffu , comme on le croi-
roit au premier coup d’oeil; 6c le méchanifme félon
lequel elle fe travaille eft précifément le même que
celui dont on couvre les groffes cordes d’inftrumens
avec le fil d’argent ou de laiton, comme nous l’avons
dit : la corde 6c le fil de laiton font attachés à un crochet
, le crochet fait tourner la corde fur elle-même ;
l’ouvrier tient la corde de la main gauche ^il tient le
fil d’argent ou de laiton de la droite, un peu élevé
au-deffus de la corde, & ce fil s’enroule fur là corde :
il eft clair que plus l’angle de la corde & du fil fera
petit, plus l’enroulement du fil fur la corde fera lâche
; 6c que plus cet angle fera grand, plus cet enroulement
fera ferré. C ’eft la même choie à la chenille
, pour laquelle, au lieu d’un fil uni comme le laiton
, il ne s’agit que d’imaginer un fil barbu comme la
petite bande de ruban effilée. Ce petit ouvrage s’appelle
chenille, parce qu’en effet il eft velu comme
l’infeéle de ce nom.
* CHENISQUE, f. m. (Hifi. anc.) efpece d’ornement
que les anciens pratiquoient à la poupe de
leurs vaiffeaux ; il confiftoit en une tête d’oie avec
fon cou. Le chenifque s’appelloit aufli la petite oie.
Ce mot eft dérivé de , en françois oie. L’étymologique
place le chejùfque à la proue ; c’eft de-là , dit-
il y qu’on pend les ancres-, c’eft le commencement
de la caréné ; il donne au bâtiment la figure d’une
oie, oifeau aquatique. Voye^ l'antiq. expliq. & le lex.
de heder.
CHENOTIERES, f. f. (Jurifpr.) font des plants
de jeunes chênes en pepiniere , 6c deftinés à être
tranfplantés : il en eft parlé dans l’art, S i G. de la coutume
de Normandie. (A )
CîfËNZlN, ([Géog.) ville de la petite Pologne,
dans le palatinat de Sendomir.
CHEP ou CHEPAGE, f. m. (Jurifpr.) terme corrompu
de ceps, qui lignifie prifon, geôle, en latin dp-
pus : Rei interdum catenis & cippo tenentur vincli
Grégoire de Tours, liv. V. ch. x ljx . La coutume de
Valenciennes, art. 142. dit que le délinquant fera
mis au chep. Chepage fe prend plus ordinairement
pour l’emploi du geôlier. (A )
CHEPLIO, ( Geog.) île de l’Amérique méridionale
, près de l’ifthme de Panama, à une lieue de la
terre ferme.
CHEPIER, f. m. (Jurifpr.') c’eft le geôlier ; il eft
ainfi nommé dans la coûtume de Hainaut, ch. xxiij,
xxxv. & Ixx. & en la fomme rurale, traitant des gardes
desprifons ,6c dans les ordonnances de la chambre
d’Artois. Gloff. de Lauriere. (A)
' CHEPO, (Géog. mod.) ville de l’Amérique méridionale,
dans l’ifthme de Panama, fur une rivière
de même nom qui fe jette dans la mer du Sud.
CHEPSTOW, (Géog. mod.) ville d’Angleterre
dans la province de Monmouth , fur la \Vye.
CHEPTEL ou CHEPTEIL, f. m. (Jurifpr.) bail à
cheptel, eft un bail de beftiaux dont le profit doit fe
partager entre le preneur & le bailleur. Ce contrat
reçoit différens noms, félon les différentes provinces
où il eft ufité : en Nivernois on dit chaptel ; en
Bourbonnois cheptel, & en quelques endroits chep-
teil; dans la coûtume de Solle on dit capitau, & ailleurs
chaptail: toutes ces différentes dénominations
viennent d’une même étymologie, qui s’eft corrompue
félon l ’idiome de chaque pays. Ducange &
quelques autres croyent que cheptel vient de capitale,
à caufe que le cheptel eft compofé de plufieurs chefs
de bêtes qui forment une efpece de capital : d’autres
penfent, avec plus de vraiffemblance, que cheptel
vient de chatal, vieux mot celtique ou bas-breton,
qui fignifie un troupeau de bêtes ; enforte que l’on de-
vroit dire chatal, chaptail, ou chatail; cependant on
dit plus communément cheptel, ce qui a fans doute
été ainfi introduit par adouciffement.
L’origine de ce contrat fe trouve dans la loi viij.
Jipafeenda, au code de paclis ; fur quoi il faut voir
ce qu’ont dit Mornac 6c Cujas.
Ce contrat eft fort ufité dans plufieurs coûtumes,
6c particulièrement dans celles de Bourbonnois,
Nivernois, Berri, la Bouft, Solle, & Bretagne : il
participe du loiiage 6c de la fociété ; du louage, en
ce que le maître donne fes beftiaux pour un tems ,
moyennant une rétribution ; 6c de la fociété, en ce
que les profits fe partagent en nature.
Ces fortes de baux doivent être paffés devant
notaires, & non fous fignature privée, afin d’éviter
les fraudes 6c les antidates, 6c que l’on fâche d’une
maniéré certaine à qui appartiennent les beftiaux.
Arrêt du conf. du 11 Mars iGqù.
On diftingue deux fortes de cheptels ; le iimpie, 6c
celui de métairie.
Le cheptel fimple a lieu quand le propriétaire des
beftiaux les donne à un particulier qui n’eft point
fon fermier ou métayer, pour faire valoir les héritages
qui appartiennent à ce particulier , ou qu’il
tient d’ailleurs à loyer, ferme, ou métairie.
Le cheptel de métairie eft lorfque le maître d’un
domaine donne à fon métayer des beftiaux, à la
charge de prendre foin de leur nourriture, pour les
garder pendant le bail, 6c s’en fervir pour la culture
6c amélioration des héritages, à condition de partager
le profit & le croît du bétail.
On appelle bail à moitié, en fait de cheptel, quand
le bailleur 6c le preneur fourniffent chacun moitié
des beftiaux qui font gardés par le preneur, à condition
de partager par moitié les chefs, croît 6c décroît
d’iceux ; 6c en cas d’exigne, c’eft-à-dire de