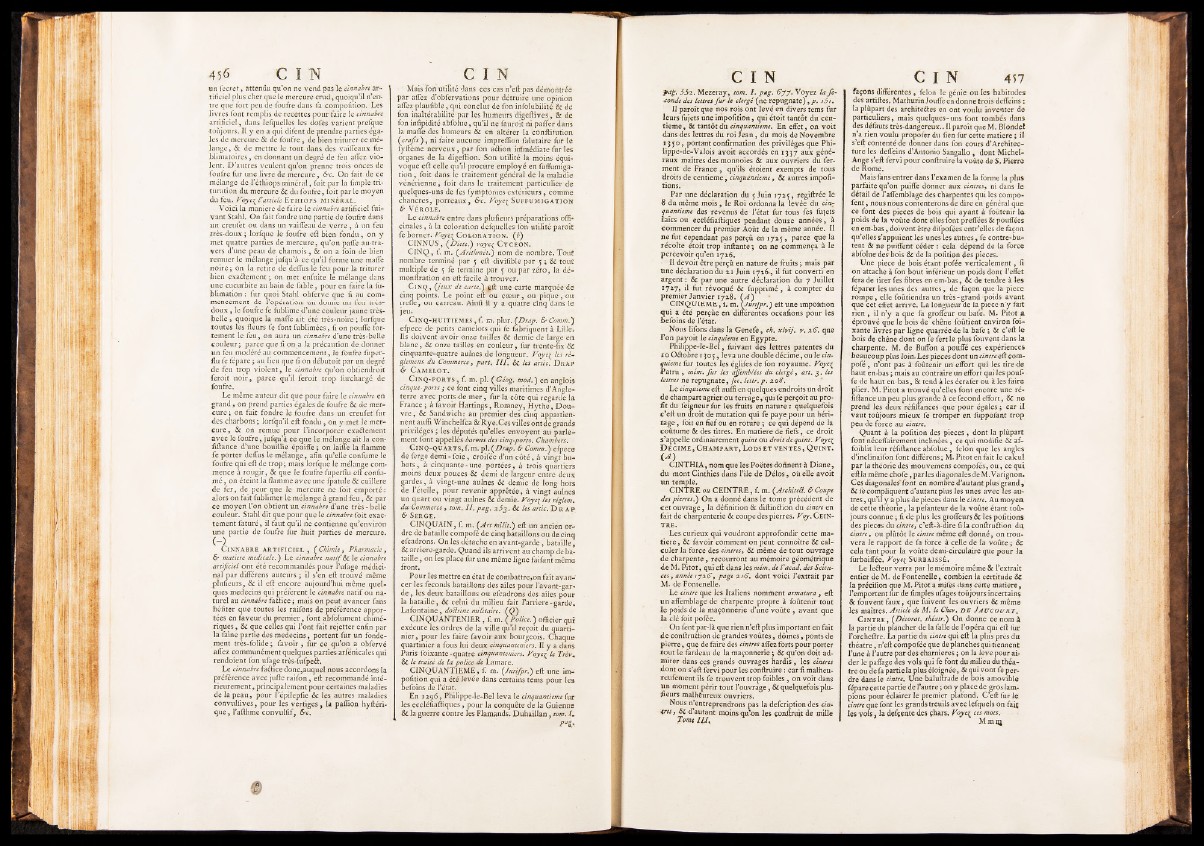
45<$ C I N
un fecref, attendu qu’on ne vend pas le cinnabre artificiel
plus cher que le mercure crud, quoiqu’il n’entre
que fort peu de foufre dans fa compofition. Les
livres font remplis de recettes pour faire le cinnabre
artificiel-, dans lefquelles les dofes varient prefque
toujours. Il y en a qui difent de prendre parties égales
de mercure & de foufre, de bien triturer ce mélange
, & de mettre le tout dans des vaiffeaux fu-
blimaroires, en donnant un degré de feu affez violent.
D ’autres veulent qu’on prenne trois onces de
•foufre fur une livre de mercure, &c. On fait de ce
mélange de l’éthiops minéral, foit par la fimple trituration
du mercure Sc du foufre, foit par le moyen
du feu. Voye^ l'article E t h ïOPS MINÉRAL.
Voici la maniéré de faire le cinnabre artificiel fui-
Vant Stahl. On fait fondre une partie de foufre dans
un creufet ou dans un vaiffeau de verre , à un feu
très-doux ; lorfque le foufre eft bien fondu, on y
met quatre parties de mercure, qu’on palfe au-travers
d’une peau de chamois, & on a foin de bien
remuer le mélange jufqu’à-ce qu’il forme une maffe
noire ; on la retire de deffus le feu pour la triturer
bien exactement ; on met enfuite le mélange dans
une cucurbite au bain de fable, pour en faire la fu-
blimation : fur quoi Stahl obferve que fi au commencement
de l’opération on donne un feu très-
doux , le foufre fe fublime d’une couleur jaune très-
belle , quoique la maffe ait été très-noire ; lorfque
toutes les fleurs fç font fublimées, fi on pouffe fortement
le feu, on aura un cinnabre d’une très-belle
couleur ; parce que fi on a la précaution de donner
un feu modéré au commencement, le foufre fuper-
flu fe fépare ; au lieu que fi on débutoit par un degré
de feu trop violent, le cinnabre qu’on obtiendroit
feroit noir , parce qu’il feroit trop furchargé de
foufre.
Le même auteur dit que pour faire le cinnabre en
grand, on prend parties égales de foufre Sc de mercure
; on fait fondre le foufre dans un creufet' fur
des charbons; lorfqu’il eft fondu, on y^met le mercure
, & on remue pour l’incorporer, exactement
avec le foufre, jufqu’à ce que le mélange ait la con-
fiftance d’une bouillie épaiffe ; on laiffe la flamme
fe porter deffus le mélange, afin qu’elle confume le
foufre qui eft de trop; mais lorfque le mélange commence
à rougir, & que le foufre fuperflu eft confu-
mé, on éteint la flamme avec une fpatule Sc cùillere
de fer, de peur que le mercure ne foit emporté:
alors on fait fublimer le mélange à grand feu , Sc par
ce moyen l’on obtient un cinnabre d’une très - belle
couleur. Stahl dit que pour que le cinnabrefoit exactement
faturé, il faut qu’il ne contienne qu’environ
une partie de foufre fur huit parties de mercure.
< -) ■ " I H H H H
C innabre a r t if ic ie l , ( Chimie, Pharmacie,
& matière medicale. ) Le cinnabre natif Sc le cinnabre
artificiel ont été recommandés pour l’ufage médicinal
par différens auteurs ; il s’en eft trouvé même
plufieurs, Sc il eft encore aujourd’hui même quelques
médecins qui préfèrent le cinnabre natif ou naturel
au cinnabre faftice; mais on peut avancer fans
héfiter que toutes les raifons de préférence apportées
en faveur du premier, font abfolument chimériques
, & que celles qui l’ont fait rejetter enfin par
la faine partie des médecins, portent fur un fondement
très-folide ; fa voir , fur ce qu’on a obfervé
affez communément quelques parties arfénicales qui
rendoient fon ufage très-fufpeCl.
Le cinnabre faftice donc,auquel nous accordons la
préférence avec jufte raifon, eft recommandé intérieurement,
principalement pour certaines maladies
de la peau, pour l ’épilepfie & les autres maladies
convulfives, pour les vertiges, la paflion hyftéri-
que, l’afthme convulfif, &c.
C I N
Mais foil utilité dans ces cas n’eft pas démontréô
par affez d’obfervations pour détruire une opinion
affez plaufible, qui conclut de fon infolubilité & de
fon inaltérabilité par les humeurs digeftives, & de
fon infipidité abfolue, qu’il ne fauroit ni paffer dans
la maffe des humeurs Sc en altérer la cOnftitution
(crafis), ni faire aucune impreflion falutaire fut le
fyftème nerveux, par fon aftion immédiate fur les
organes de la digeftion. Son utilité la moins équivoque
eft celle qu’il procure employé en fuffumiga*
tion, foit dans le traitement général de la maladie
vénérienne, foit dans le traitement particulier de
quelques-uns de fes fymptomes extérieurs, comme
chancres, porreaux, &c. Voye^ Su f fum ig a t io n
& VÉROLE.
Le cinnabre entre dans plufieurs préparations officinales
, à la coloration defquelles fon utilité paroît
fe borner. Voyt{ C o lo r a t io n , (fi)
CINNUS, (Diete.) voye{ C y CEON.
CIN Q , f. m. (Aritkmét.) nom de nombre. Tout
nombre terminé par 5 eft divifible par 5 ; & tout
multiple de 5 fe termine par 5 ou par zéro, la dé-
monftration en eft facile à trouver.
C in q , (jeux de cane.).£ft une carte marquée de
cinq points. Le point eft ou coe u r, ou pique, ou
trefle, ou carreau. Ainfi il y a quatre cinq dans le
jeu.
ClNQ-HUiTiEMES , f . m. plur. (Drap. & Comrh.)
efpece de petits camelots qui fe fabriquent à Lille*
Us doivent avoir onze tailles & demie de large en
blanc, Sc onze tailles en couleur, fur trente-fix St
cinquante-quatre aulnes.de longueur. Voye\ les ré-
glemens du Commerce, part. I I I . & les àrtic. D rap
& C am e lo t .
C inq-p o r t s , f. m. pi. ( Géog. mod.) en anglois
cinque-ports ; ce font cinq villes maritimes d’Angleterre
avec ports de mer, fur la côte qui regarde la
France ; à favoir Hartings, Romney, Hythe, Dou-
v r e , Sc Sandwich : au premier des cinq appartiennent
aufli 'Winchelfca & Rye.Ces villes ont de grands
privilèges ; les députés qu’elles envoyent au parlement
font appellés barons des cinq-ports. Chatnbers.
C inq-q ua rt s , f.m. pi. (Drap. & Comm.) efpece
de ferge demi - foie, croiféè d’un cô té, à vingt bu-
hots, à cinquante - une portées , à trois quartiers
moins deux pouces & demi de largeur entre deux
gardes, à vingt-une aulnes Sc demie de long hors
de l’ételle, pour revenir apprêtée, à vingt aulnes
un quart ou,vingt aulnes Sc demie. Voye{ les réglem.
du Commerce , tom. I I . pag. z J j . & les artic. D r a p
& Serge.
CINQUAIN, f. m. (Art fnilit.) eft un ancien ordre
de bataille compofé de cinq bataillons ou decinq
efeadrons. On les détache en avant-garde, bataille,
& arriere-garde. Quand ils arrivent au champ de bataille
, on les place fur une même ligne faifant même
front.
Pour les mettre en état de combattre,on fait avancer
les féconds bataillons des ailes pour l ’ayant-gar-
d e , les deux bataillons ou efeadrons des ailes pour
la bataille, & celui du milieu fait l’arriere-garde.
Lafontaine, doctrine militaire. (Q )
CINQUANTENIER, f. m. (Police.) officier qui
exécute les ordres de la ville qu’il reçoit du quarti-
nier, pour les faire favoir aux bourgeois. Chaque
quartinier a fous lui deux cinquanteniers. Il y a dans
Paris foixante-quatre cinquanteniers. Voye[ le Trév«
St le traité de la police .de Lamare.
- .CINQUANTIEME, f. m. (Jurifipr.) eft une im-
pofition qui a été levée dans certains tems pour les
befoins de l’état.
En 1296, Philippe-le-Bel leva 1 e cinquantième fur
les eccléfiaftiques, pour la conquête de la Guienne
Sc la guerre contre les Flamands. Duhaillan, tom.I.
P aS.'.
• f )
C I N
jpag. Ü 2 . Mezeray, tom. I . pag. 67J . Voyez la fe-
conde des lettres fur le clergé (ne repugnate), p. iâi.
Il paroît que nos rois ont levé en divers tems fur
leurs fujets une impofition, qui étoit tantôt du centième
, & tantôt du cinquantième. En effet, on voit
dans des lettres du roi Jean, du mois de Novembre
1350, portant confirmation des privilèges que Phi-
lippe-de-Valois avoit accordés en 1337 aux généraux
maîtres des monnoies & aux ouvriers du ferment
de France, qu’ils étoient exempts de tous
droits de centième, cinquantième , & autres impofi-
tions.
Par une déclaration du 5 Juin 17 15, regiftrée le
8 du même mois , le Roi ordonna la levée du cinquantième
des revenus de l’état fur tous fes fujets
laïcs ou eccléfiaftiques pendant douze années, à
commencer du premier Août de la même année. Il
ne fut cependant pas perçu en 17 15 , parce que la
récolte étoit trop inftante 3 on ne commença à le
percevoir qu’en 1726.
Il devoit être perçu en nature de fruits ; mais par
une déclaration du 21 Juin 1726-, il fut converti en
argent : Sc par une autre déclaration du 7 Juillet
1727, il fut révoqué Sc fupprimé, à compter du
premier Janvier 1728. (A )
CINQUIEME, f. m. (Jurifpr.) eft une impofition
qui a été perçue en différentes occafions pour les
befoins de l’état.
Nous lifons dans la Genefe, ch. xlvij. v. zC. que
l’on payoit le cinquième en Egypte.
Philippe-le-Bel, fuivant des lettres patentes du
io Octobre 1305, leva une double décime, ou le cinquième
fur toutes les églifes de fon royaume. Voye^
Patru , mém. fur les affemblées du clergé , art. g . les
lettres ne repugnate, fiée, lettr. p. zo8.
Le cinquième eft aufli en quelques endroits un droit
de champart agrier ou terrage ,-qui fe perçoit au profit
du feigneur fur les fruits en nature : quelquefois
c ’eft un droit de mutation qui fe paye pour un héritage
, foit en fief ou en roture ; ce qui dépend de la
coûtume & des titres. En matière de fiefs, ce droit
s ’appelle ordinairement quint ou droit de quint. Voye{
D é c i m e , C h a m p a r t , Lodset v e n t e s , Q u i n t .
Hl ■ .
CINTHIA, nom que les Poètes donnent à Diane,
du mont Cinthies dans l’île de Délos, où elle avoit
un temple.
CINTRE ou CEINTRE, f. m. (Architect. & Coupe
des pierres.) On a donné dans le tome précédent de
cet ouvrage, la définition & diftin&ion du cintre en
fait de charpenterie & coupe des pierres. Vqy. C e i n -
t r e .
Les curieux qui voudront approfondir cette matière
, Sc favoir comment on peut connoître & calculer
la force des cintres, Sc même de tout ouvrage
de charpente, recourront au mémoire géométrique
de M. Pitot, qui eft dans les mém. de l'acad. des Sciences,
année rpzG, page ziG. dont voici l’extrait par
M. de Fontenelle.
Le cintre que les Italiens nomment armatura , eft
un affemblage de charpente propre à foûtenir tout
le poids de la maçonnerie d’une voûte , avant que
la clé foit pofée.
On fent par-là que rien n’eft plus important en fait
de conftrudtion de grandes voûtes, dômes, ponts de
pierre, que de faire des cintres affez forts pour porter
tout le fardeau de la maçonnerie ; & qu’on doit admirer
dans ces grands ouvrages hardis , les cintres
.dont on s’eft fervi pour les conftruire : car fi malheu-
reufement ils fe trouvent trop foibles, on voit dans
lin moment périr tout l’ouvrage, & quelquefois plusieurs
malhëureux ouvriers.
Nous n’entreprendrons pas la defeription des cintres,
Sc d’autant moins qu’-on les çonftruit de mille
Tome I I I »
C I N 457
façons différentes, félon le génie ou les habitudes
des artiftes. Mathurin Jouffe en donne trois deffeins t
la plûpart des architeâes en ont voulu inventer de
particuliers, mais quelques-uns font tombés dans
des défauts très-dangereux.. Il paroît que M. Blondel!
n’a rien voulu propol'er du fien fur cette matière ; il
s’eft contenté de donner dans fon cours d’Architecture
les deffeins d’Antonio Sangallo , dont Michel-
Ange s’eft fervi pour conftruire la voûte de S. Pierre
de Rome.
Mais fans entrer dans l’examen de la forme la plus
parfaite qu’on puiffe donner aux cintres, ni dans le
détail de l’affemblage des charpentes qui les compo-
fent, nous nous contenterons de dire en général que
ce font des pièces de bois qui ayant à foûtenir le
poids de la voûte dont elles font preffées& pouffées
en em-bas, doivent être difpofées entr’elles de façon
qu’elles s’appuient les unes les autres, fe contre-bu-
tent & ne puiflent céder : cela dépend de la force
abfolue des bois & de la pofition des pièces.
Une pièce de bois étant pofée verticalement, fi
on attache à fon bout inférieur un poids dont l’effet
fera de tirer fes fibres en em-bas, de tendre à les
féparer les unes des autres, de façon que la piece
rompe, elle foûtiendra un très-grand poids avant
que cet effet arrive. La longueur de la piece n’y fait
rien , il n’y a que fa groflèUr ou bafe. M. Pitot a
éprouvé que le bois de chêne foûtient environ foixante
livres par ligne quarrée de la bafe ; & c’eft le
bois de chêne dont on le fert le plus fouvent dans la
charpente. M. de Buffon a pouffé ces expériences
beaucoup plus loin. Les pièces dont un cintre eft compofé
, n’ont pas à foûtenir un effort qui les tire de
haut en-bas ; mais au contraire un effort qui les poufi
fe de haut en-bas, & tend à les écrafer ou à les faire
plier. M. Pitot a trouvé qu’elles font encore une ré-
fiftance un peu plus grande à ce fécond effort, & ne
prend les deux réfifiances que pour égales ; car il
vaut toûjours mieux fe tromper en fuppofant trop
peu de force au cintre.
Quant à la pofition des pièces , dont la plûpart
font néceffairement inclinées, ce qui modifie & af-
foiblit leur réfiftance abfolue , félon que les angles
d’inclinaifon font différens; M. Pitot en fait le calcul
par la théorie des mouvemens compofés, ou , ce qui
eft la même chofe, parles diagonales de M. Varignon.
Ces diagonales*font en nombre d’autant plus grand 9
Sc fe compliquent d’autant plus les unes avec les autres
, qu’il y à plus de pièces dans le cintre. Au moyen
de cette théorie, la pefanteur de la voûte étant toûjours
connue ; fi de plus les groffeurs.& les pofitions
des pièces du cintre, ç’eft-à-dire fi la conftruôion du
cintre, ou plûtôt le cintre même eft donné, on trouvera
le rapport de fa force à celle de la voûte ; Sc
cela tant pour la voûte demi-circulaire que pour la
furbaiffée. Voye£ Surbaissé.
Le leéleur verra par le mémoire même & l’extrait
entier de M. de Fontenelle, combien la certitude Sc.
la précifion que M. Pitot a mifes dans cérte matière,
l’emportent fur de fimples ufages toûjours incertains
& fouvent faux, que fuivent les ouvriers Sc même
les maîtres. Article de M. le Cher, d e J a u c o u r t .
C intre , (Décorât, théatr.) On donne ce nom à
la partie du plancher de la falle de l’opéra qui eft fur
l’orcheftre. La partie du cintre qui eft la plus près du
théâtre, n’eft compofée que de planches qui tiennent
l’une à l’autre par des charnières ; on la leve pour aider
le paffage des vols qui fe font du milieu du théâtre
ou de fa partie la plus éloignée, & qui vont fe perdre
dans le cintre. Une baluftrade de bois amovible
fépare cette partie de l’autre ; on y place de gros lampions
pour éclairer le premier plafond. C ’eft fur le
cintre que font les grands treuils avec lefquels on fait
les vols a la dcfçente des çhars, Voye{ ces mots.
M mm