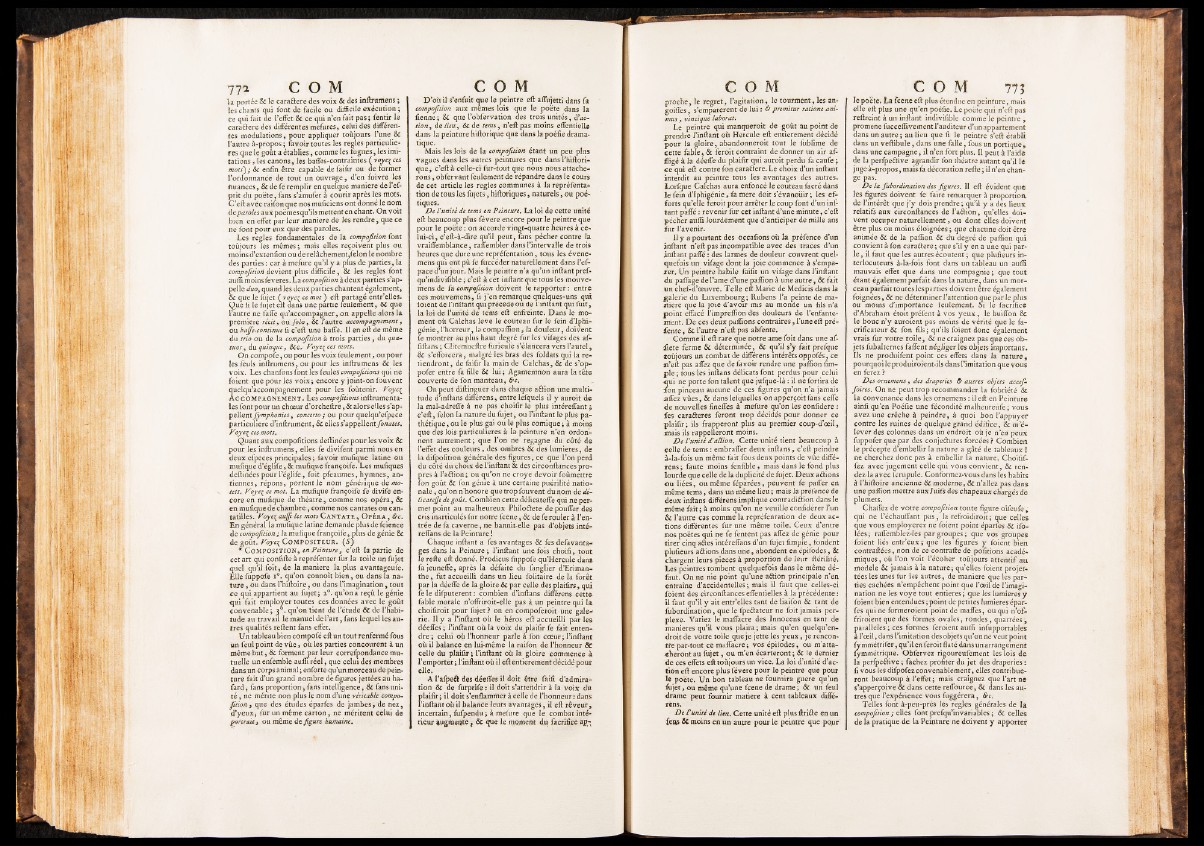
ïff C O M
Va portée & le caraôere des voix & des inftrumens ;
les chants qui font de facile ou difficile exécution ;
ce qui fait de l’effet 8c ce qui n’en fait pas; fentir le
carafrere des différentes mefures, celui des différentes
modulations, pour appliquer toûjours l’une &
l’autre à-propos ; favoir toutes les réglés particulières
que le goût a établies, comme les fugues, les imitations
i les canons, les baffes-contraintes ( voye^ ces
mots') i & enfin être capable defaifir ou dé former
l ’ordonnance de tout un ouvrage, d’en fuivre les
nuances, & de fe remplir en quelque maniéré de l’ef-
prit du poète, fans s’amufer à courir après les mots.
C ’eft avec raifon que nos muficiens ont donné le nom
âeparoles aux poëmesqu’ils mettent en chant. On voit
bien en effet par leur maniéré de les rendre, que ce
ne font pour eux que-des paroles.
Les réglés fondamentales de la compofidon font
toûjours les mêmes ; mais elles reçoivent plus ou
moins d’exteniioii ou de relâchement,félon le nombre
des parties : car à mefure qu’il y a plus de parties, la
compofidon devient plus difficile, 8c les réglés font
aulîi moins feveres. La compofidon à deux parties s’appelle
duo, quand les deux parties chantent également,
& que le fujet ( voye^ ce mot ) e'ft partagé entr’elles.
Que fi le fujet eff dans une partie feulement, & que
l’autre ne faffe qu’accompagner, on appelle alors la
première récit, ou folo, & l’autre accompagnement,
ou bajfe-condnue fi c’eft une baffe. Il en eft de même
du trio ou dé la compofidon à trois parties, du quatuor,
du quinque, & c . Voye^tes mots.
On compofe, ou pour les voix feulement, ou pour
les féuls inftrumens, ou pour les inftrumens & les
voix. Les chanfons font les feules compofidons qui né
foient que pour les voix ; encore y joint-on fouvent
quelqu’accompagnement pour les foûtenir. Voye{
Accompagnement. Les compofidons inftrumentales
font pour un choeur d’orcheftre ,& alors elles s'appellent
fymphonies, concerto j ou pour quelqu’efpece
particulière d’inftrument, 8c elles s’appellent fonates.
Voyeç ces mots.
Quant aux eompolitions deftinées pour les voix &
pour les inftrumens, elles fe divifent parmi nous en
deux efpeces principales; favoir mufique latine ou
mufique d’églife, & mufique françoife. Les mufiques
deftinées pour l’églife, foit pfeaumes, hymnes, antiennes,
répons, portent le nom générique de motets.
Voye{ ce mot. La mufique françoife fe divife encore
en mufique de théâtre, comme nos opéra, &
en mufique de chambre, comme nos cantates ou can-
tatilles. Voye^auJJiles mots C antate, Opéra, & c.
En général la mufique latine demande plus de fcience
de compofidon; la mufique françoife, plus de génie 8c
de goût. Foye{ Compositeur. (S)
* Composition, en Peinture 3 c ’eft la partie de
cet art qui confifte à repréfenter fur la toile un fujet
quel qu’il foit , de la maniéré la plus avantageufe.
Elle fuppofe i° . qu’on connoît bien, ou dans la nature
, bu dans l’hiftoire, ou dans l’imagination, tout
ce qui appartient au fujet; z°. qu’on a reçu le génie
qui fait employer toutes ces données avec le goût
convenable; 3 . qu’on tient de l’étude & de l’habitude
au travail le manuel de l’art, fans lequel les autres
qualités relient fans effet.
Un tableaubien compofé eft un tout renfermé fous
un feul point de vu e, où les parties concourent à un
même but ; 8c forment par leur correfpondance mutuelle
un enfemble aulîi réel, que celui des membres
dans un corps animal ; enforte qu’un morceau de peinture
fait d’un grand nombre de figures jettées au ha-
fard, fans proportion, fans intelligence, & fans unité
, ne mérite non plus le nom d’une véritable compo-
fidon, que des études éparfes de jambes, de nez,
d’yeux j fur un même carton, ne méritent celui de
portrait > ou même défiguré humaine.
C O M
D ’où il s’enfuit que le peintre eft affujetti dans fa
compofidon aux memes lois que le poète dans la
fienne ; 8c que l’obfervation des trois unités, action
, de lieu y 6c de terris, n’eft pas moins effentielle
dans la peinture hiftorique que dans la poéfie dramatique.
Mais les lois de la compofidon étant Un peu plus
vagues dans les autres peintures que dans l’hiftori-
que, c’eft à celle-ci fur-tout que nous nous attacherons
, obfervant feulement de répandre dans le cours
de cet article les réglés communes à la repréfenta*
tion de tous les fujets, hiftoriques, naturels, ou poétiques.
De Vunité de tems en Peinture. La loi de cette unité
eft beaucoup plus févere encore pour le peintre que
pouf le poète : on accorde vingt-quatre heures à celui
ci, c’eft-à-dire qu’il peut, fans pécher contre la
vraiffemblanee, raffembler dans l’intervalle de trois
heures que dure une repréfentation, tous les évene-
mens qui ont pu fé füccéder naturellement dans l’ef-
pace d’un jour. Mais le peintre n’a qu’un inftant pref-
qu’indivifible ; c’eft à cet inftarit que tous les mouve-
mens de fà compofidon doivent (è rapporter : entre
ces mouvemens, fi j ’en remarque quelques-uns qui
foient de Piüftarit qui précédé ou de l’inftant qui fuit,
la loi de l’ùnité de tems eft enfreinte. Dans le moment
où Gàlchas leve le cbtiteau fur le fein d’Iphigénie,
l’horreur, la compalfion, la douleur, doivent
fe montrer àii plus haut degré fur les Vifages des af-
fiftans ; Clitemneftre furieufe s’élancera vers l’autel,
ôc s’efforcera, malgré les bras dés foldàts qui la retiendront,
de faifir la main de Calchas, 8i de s’op-
pofer entre fa fille 6c lui ; Agamemnon aura la tête
couverte de fon manteau, &c.
On peut diftingüer dans chaque aôiort Une multitude
d’inftans différens, entre lefqùels il y auroit de
la mal-adreffe à ne pas choifir le plus intéreffant ;
c’eft, félon la nature du fujet, ou l’inftant le plus pathétique
, ou le plus gai ou le plus comique ; à moins
que des lois particulières à la peinture n’en ordonnent
autrement ; que l’on ne regagne du côté de
l’effet des couleurs, des ombres 8c des lumières, de
la difpofition générale des figures, ce que l ’on perd
du côté du choix de l’inftant & des circonftances propres
à l’aôion ; bu qu’on ne croye devoir foûmettre
ïon goût & fon génie à une certaine puérilité nationale
, qu’on n’honore que trop fouvent du nom de délicate]}
e de goût. Combien cette délicateffe qui ne permet
point au malheureux Philo&ete de pouffer des
cris inarticulés fur notre fcene, & de fe rouler à l’entrée
de fa caverne, ne bannit-elle pas d’objets inté-
reffans de la Peinture !
Chaque inftant a fes avantages & fes defavanta-
ges dans la Peinure; l’inftant une fois choili, tout
le refte eft donné. Prodicus fuppofe qu’Hercule dans
fa jeuneffe, après la défaite du fanglier d’Eriman-
the, fut accueilli dans un lieu folitaire de la forêt
par la déeffe de la gloire & par celle des plaifirs, qui
fe le difputerent : combien d’inftans différens cette
fable morale n’offriroit-elle pas à un peintre qui la
choifiroit pour fujet ? on en compoferoit une galerie.
Il y a l’inftant où le héros eft accueilli par les
déeffes ; l’inftant où là voix du plaifir fe fait entendre;
celui où l’honneur parlé à fon coeur; l’inftant
où il balance en lui-même la raifon de l’honneur 8c
celle du plaifir ; l’inftant où la gloire commence à
l’emporter; rinftahtôù il eft entièrement décidé pour
elle.
A l’afpeél des déeffës il doit être fâifî d’admiration
8c de futprife : il doit s’aîtèftdrir à la voix du
plaifir ; il doit s’enflammer à Celle de l’honneur : dans
î’inftant où il balance leurs avantages, il eft rêveur,
incertain, fufpendu ; à mefure que le combat intérieur
augmente ? ÔC que le moment du facrifice ap-
C O M
proche, le regret, l’agitation, le tourment, les an-
goiffes, s’emparèrent de lui : & premitur radone animas
, viatique laborat.
Le peintre qui manqueroit de goût au point de
prendre l’inftant où Hercule eft entièrement décidé
pour la gloire, abandonneroit tout le fublime de
cette fable j & feroit contraint de donner un air affligé
à la déeffe du plaifir qui auroit perdu fa caufe ;
ce qui eft contre fon caraôere. Le choix d’un inftant
interdit au peintre tous les avantages des autres.
Lorfque Calchas aura enfoncé le couteau facré dans
le fein d’Iphigénie , fa mere doit s’évanouir ; les efforts
qu’elle feroit pour arrêter le coup font d’un inftant
paffé : revenir fur cet inftant d’une minute, c’eft
pécher aulîi lourdement que d’anticiper de mille ans
fur l’avenir.
Il y a pourtant des occafions où la préfence d’un
inftant n’eft pas incompatible avec des traces d’un
inftant paffé : des larmes de douleur couvrent quelquefois
un vifage dont la joie commence à s’emparer.
Un peintre habile faifit un vifage dans l’inftant
du pafl'age de l’ame d’une paiîïon à une autre, & fait
un chef-d’oeuvre. Telle eft Marie de Medicis dans la
galerie du Luxembourg; Rubens l’a peinte de maniéré
que la joie d’avoir mis au monde un fils n’a
point effacé l’impreffion des douleurs de l’enfantement.
De ces deux pallions contraires, l’une eft préfente
, & l’autre n’eft pas abfente.
Comme il eft rare que notre ame foit dans une af-
iiete ferme & déterminée, & qu’il s’y fait prefque
toûjours un combat de différens intérêts oppofés, ce
n’eft pas affez que de favoir rendre une paflion fim-
ple ; tous les inftans délicats font perdus pour celui
qui ne porte fon talent que jufque-là : il ne fortira de
fon pinceau aucune de ces figures qu’on n’a jamais
affez vûes, & dans lefquelles on apperçoit fans ceffe
de nouvelles fineffes à mefure qu’on les confidere :
fes carafteres feront trop décidés pour donner ce
plaifir; ils frapperont plus au premier coup-d’oeil,
mais ils rappelleront moins.
De Vunité d’action. Cette unité tient beaucoup à
celle de tems : embraffer deux inftans , c’eft peindre
à-la-fois un même fait fous deux points de vûe différens
; faute moins fenfible, mais dans le fond plus
lourde que celle delà duplicité de fujet. D eux aâions
ou liées, ou même féparées, peuvent fe paffer en
même tems, dans un même lieu ; mais la préfence de
deux inftans différens implique contradiction dans le
même fait ; à moins qu’on ne veuille confidérer l’un
& l’autre cas comme la repréfenration de deux actions
différentes fur une même toile. Ceux d’entre
nos poètes qui ne fe fentent pas affez de génie pour
tirer cinq aCtes intéreffans d’un fujet iîmple, fondent
plufieurs aftions dans une, abondent en épifodes, &
chargent leurs pièces à proportion de leur ftérilité.
Les peintres tombent quelquefois dans le même défaut.
On ne nie point qu’une aCtion principale n’en
entraîne d’accidentelles ; mais il faut que celles-ci
foient des circonftances effentielles à la précédente :
il faut qu’il y ait entr’elles tant de liaifon & tant de
fubordination, que le fpeCtateur ne foit jamais perplexe.
Variez le maffacre des Innocens en tant de
maniérés qu’il vous plaira ; mais qu’en quelqu’en-
droit de votre toile que je jette les y eux , je rencontre
par-tout ce maffacre ; vos épifodes, ou m’attacheront
au fujet, ou m’en écarteront ; & le dernier
de ces effets eft toûjours un vice. La loi d’unité d’action
eft encore plus févere pour le peintre que pour
le poète. Un hon tableau ne fournira guere qu’un
fujet, ou même qu’une fcene de drame ; & un feul
drame peut fournir matière à cent tableaux différens.
De l'unité de lien. Cette unité eft plus ftrifte en un
{ests & moins en un autre pour le peintre que pour
C O M 77?
le poète. La fcene eft plus étendue en peinture, mais
elle eft plus une qu’en poéfie. Le poète qui n’eft pas
reftreint à un inftant indivifible comme le peintre ,
promene fuccelîivement l’auditeur d’un appartement
dans un autre ; au lieu que fi le peintre s’eft établi
dans un veftibule, dans une falie, fous un portique ,
dans une campagne, il n’en fort plus. Il peut à l’aide
de la perfpe&ive agrandir fon théâtre autant qu’il le
juge à-propos, mais fa décoration refte ; il n’en change
pas.
De la fubordination des figures. Il eft évident que
les figures doivent fe faire remarquer à proportion,
de l’intérêt que j’y dois prendre ; qu’il y a des lieux
relatifs aux circonftances de l’aâion, qu’elles doivent
occuper naturellement, ou dont elles doivent
être plus ou moins éloignées ; que chacune doit être
animée 8c de la paflion St du degré de paflion qui
convient à fon cara&ere ; que s’il y en a une qui parle
, il faut que les autres écoutent ; que plufieurs interlocuteurs
à-la-fois font dans un tableau un aufli
mauvais effet que dans une compagnie ; que tout
étant également parfait dans la nature, dans un morceau
parfait touteslesparties doivent être également
foignées, St ne déterminer l’attention que par le plus
ou moins d’importance feulement. Si le facrifice
d’Abraham étoit préfent à vos y e u x , le buiffon Sc
le bouc n’y auroient pas moins de vérité que le fa-
crificateur St fon fils ; qu’ils foient donc également
vrais fur votre toile, St ne craignez pas que ces objets
fubalternes faffent négliger les objets importans.
Ils ne produifent point ces effets dans la nature,
pourquoi le produiroient-ils dans l’imitation que vous
en ferez ?
Des ornemens, des draperies & autres objets accej-
foires. On né peut trop recommander la fobriété &
la convenance dans les ornemens : il eft en Peinture
ainfi qu’en Poéfie une fécondité malheureùfe; vous
avez une crèche à peindre, à quoi bon l’appuyer
contre les ruines de quelque grand édifice, St m’élever
des colonnes dans un endroit où je n’én peux
fuppofer que par des conjectures forcées ? Combien
le précepte d’embellir la nature a gâté de tableaux !
ne cherchez donc pas à embellir la nature. Choilif-
fez avec jugement celle qui vous convient, St ren-
dez-la avec fcrupule. Conformez-vous dans les habits
à l’hiftoire ancienne St moderne, St n’allez pas dans
une paflion mettre aux Juifs des chapeaux chargés de
plumets.
Chaffez de votre compofidon toute figure oifeufe ,
qui ne l’échauffant pas, la refroidiroit ; que celles
que vous employerez ne foient point épar les St ifo-
lées ; raffemblez-les par groupes ; que v q s groupes
foient liés entr’eux ; que les figures y foient bien
contraftées, non de ce contrafte de pofitions académiques
, où l’on voit l’éèolier toûjours attentif au
modèle St jamais à la nature; qu’elles foient projet-
tées les unes fur les autres, de maniéré que les parties
cachées n’empêchent point que l’oeil de l’imagination
ne les voye tout entières ; que les lumières y
foient bien entendues ; point de petites lumières éparfes
qui ne formeroient point de maffes, ou qui n’of-
friroient que des formes ovales, rondes, quarrées ,
parallèles ; ces formes feroient aulîi infupportables
à l’oeil, dans l’imitation des objets qu’on ne veut point
fymmétrifer, qu’il en feroit flaté dans un arrangement
lyminétrique. Obfervez rigoureufement les lois de
la perfpeftive ; fâchez profiter du jet des draperies :
fi vous les difpofezconvenablement, elles contribueront
beaucoup à l’effet ; mais craignez que l’art ne
s’apperçoive & dans cette reffource, 8c dans les autres
que l’expérience vous fuggérera, &c.
Telles font à-peu-près lês regies générales de la
compofidon ; elles font prefqu’invariables ; & celles
de la pratique de la Peinture ne doivent y apporter
1I
Ui
I