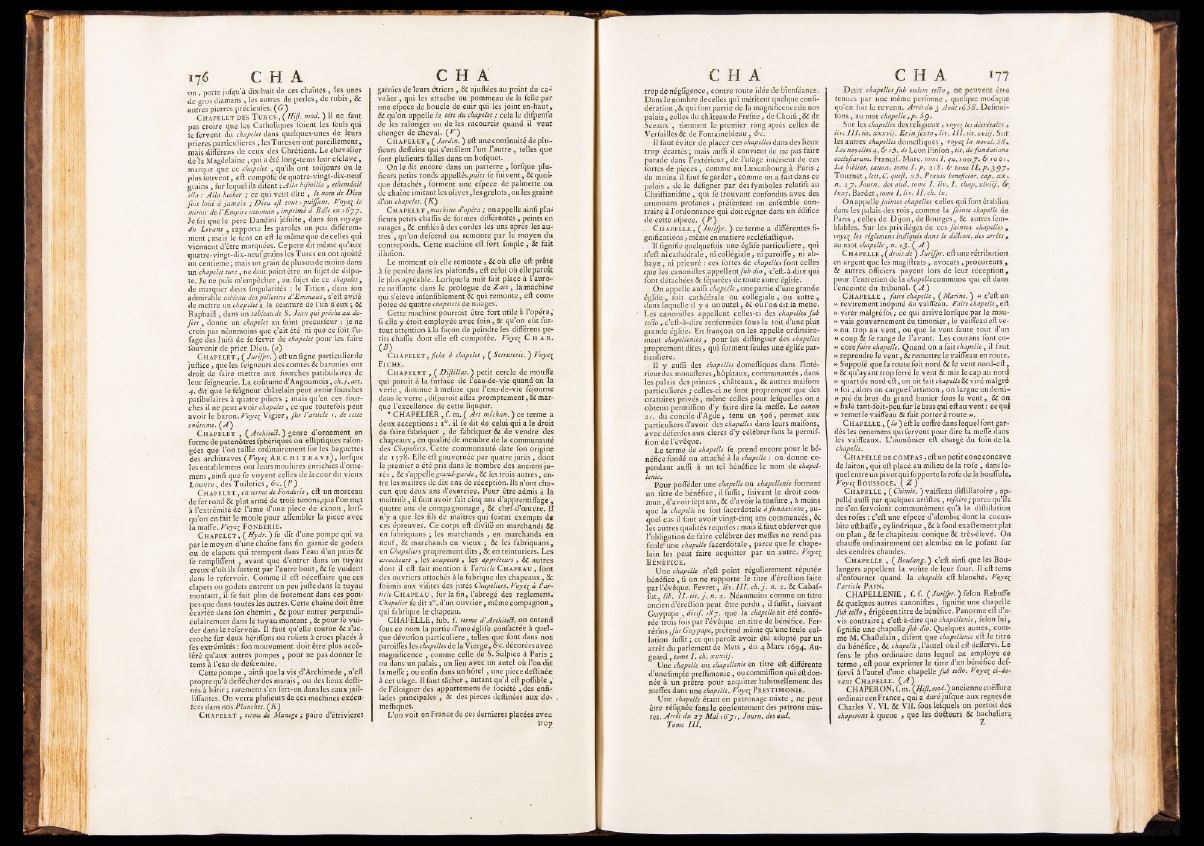
t>n , porte jufqu’à dix-huit de ces chaînes , ies^ unes
de gros diamans, les autres de perles, de rubis, 8c
•autres pierres précieufes. (GA .
C hapelet des T u r c s , (Hift.mod. ) Il ne faut
pas croire que les Catholiques foient les feuls qui
lb fervent du chapelet dans quelques-unes de leurs
.prières particulières ; les Turcs en ont pareillement,
mais différens de ceux des Chrétiens. Le chevalier
d e là Magdelaine , qui a été long-tems leur e fclave,
marque que ce chapelet , qu’ils ont toujours ou le
plus fouvent, eft compofé de quatre-vingt-dix-neuf
grains , fur lequel ils difent '.Alla bifmilla , ethemdail
ilia : Alla hecker ; ce qui veut dire , le nom de Dieu
Joit loue à jamais Dieu efl tout -puiffant» Voye£ le
miroir de l'Empire ottoman > imprime a Baie en / S y y.
Je fai que le pere Dandini jefuite, dans fon voyage
du Levant , rapporte les paroles un peu différemment
; mais le fens en eft le même que de celles qui
viennent d’être marquées. Ce pere dit meme qu aux
quatre-vingt-dix-neuf grains les Turcs en ont ajouté
un centième ; mais un grain deplusoude moins dans
•un chapelet turc, ne doit point être un fujet de difpu-
te. Je ne puis m’empêcher , au fujet de ce chapelet,
de marquer deux fingularités : le T itien , dans Ion
admirable tableau despellerins d'Emmaùs, s’eft avifé
de mettre un chapelet à la ceinture de l’un d’eux ; 8C
Raphaël, dans un tableau de S. Jean qui prêche au de~
fe r t , donne un chapelet au faint précurfeur : je ne
crois pas néanmoins que ç’ait été ni que ce foit l’u-
fage des Juifs de fe fervir de chapelet pour les faire
fouvenir de prier Dieu. («)
C hapelet , ( Jurifpr. ) eft un ligne particulier de
juftice, que les feigneurs des comtés & baronies ont
droit de faire mettre aux fourches patibulaires de
leur feigneurie. La coûtume d’Angoumois, ch.j. art.
4. dit que le feigneur châtelain peut avoir fourches
patibulaires à quatre piliers ; mais qu’en ces fourches
il ne peut avoir chapelet, ce que toutefois peut
avoir le baron. Voye£ V igie r, fur C article /. de cette
coutume. ( A )
C hapelet , ( Architecl. ) genre d’ornement en
forme de patenôtres fphériques ou elliptiques ralon-
gées que l’on taille ordinairement fur les baguettes
des architraves ( Voye[ A r c h i t r a v e ) , lorfque
les entablemens ont leurs moulures enrichies d’orne-
méns, ainfi que fe voyent celles de la cour du vieux
Louvre, des Tuileries, &c. (P )
C hapelet , en terme de Fonderie , eft un morceau
de fer rond & plat armé de trois tenons,que l’on met
à l’extrémité de l’a me d’une piece de canon , lorsqu'on
en fait le moule pour affembler la piece avec
la maffe. Voye^ Fonderie.
C h apelet , ( Hydr. ) fe dit d’une pompe qui va
par le moyen d’une chaîne fans fin garnie de godets
ou de clapets qui trempent dans l’eau d’un puits 8c
fe rempliffent , avant que d’entrer dans un tuyau
creux d’où ils fortent par l’autre bout, & fe vuident
dans le refervoir. Comme il eft néceflaire que ces
clapets ou godets entrent un peu jufte dans le tuyau
montant, il fe fait plus de frotement dans ces pompes
que dans toutes les autres. Cette chaîne doit être
écartée dans fon chemin , 8c pour entrer perpendiculairement
dans le tuyau montant, & pour le vui-
der dans le refervoir. Il faut qu’elle tourne 8c s’accroche
fur deux hériffons ou roiiets à crocs placés à
fes extrémités : fon mouvement doit être plus accéléré
qu’aux autres pompes , pour ne pas donner le
tems à l’eau de defcendre.
Cette pompe , ainfi que la vis d’Archimede, n’eft
propre qu’à deffécher des marais, ou des lieux defti-
nés à bâtir ; rarement s’en fert-on dans les eaux jail-
liffantes. On verra plufieurs de ces machines exécutées
dans nos Planches. (A )
C hapelet , terme de Manège ; paire d’étrivieres
gafnies de leurs étriers , 8c ajuftées au poifit du ca*
v a lier, qui les attache au pommeau de la felle par
une efpece de boucle de cuir qui les joint en-haut,
8c qu’on appelle la tête du chapelet : cela le difpenfe
de les ralonger ou de les racourcir quand il veut
changer de cheyal. ( V )
C hapelet , ( Jardin, ) eft une continuité de plufieurs
deflfeins qui s’enfilent l’un l’autre- , telles que
font plufieurs falles dans un bofquet.
On le dit encore dans un parterre , lorfque plufieurs
petits ronds appelléspuits fe fuivent, 8c quoique
détachés, forment une efpece de palmette ou
de chaîne imitant les olives, les grelots, ou les grains
d’un chapelet. (K )
C h a p e le t , machine £ opéra ; on appelle ainfi plu-J
fieurs petits chaflis de formes différentes , peints en
nuages, 8c enfilés à des cordes les uns après les au-;
très , qu’on defeend ou remonte par le moyen du
contrepoids. Cette machine eft fort fimple , & fait
illufion.
Le moment oîi elle remonte, & où elle eft prêté
à fe perdre dans les plafonds, eft celui où elleparoît
le plus agréable. Lorfque la nuit fait place à l’auro-;
re naiffante dans le prologue de Z aïs, la machine
qui s’élève infenfiblement 8c qui remonte, eft com-;
polée de quatre chapelets de nuages.
Cette machine pourroit être fort utile à l’opéra^
fi elle y étoit employée avec foin, & qu’on eût fur-
tout attention à la façon de peindre les différens petits
chaflis dont elle eft compofée. Voye^ C h a r .
(B)C
HAPELET, fiche à chapelet, ( Serrurerie. ) Voye^
Fic h e .
C h apelet , ( Diftillat. ) petit cercle de moufle
qui paroît à la furface de l’eau-de-vie quand on la
verfe , diminue à mefure que l’eau-de-vie féjourne
dans le verre , difparoît affez promptement, 8c marque
l’excellence de cette liqueur.
* CHAPELIER, f. m. ( Art méchan. ) ce terme a
deux acceptions : i° . il fe dit de celui qui a le droit
de faire fabriquer , de fabriquer 8c de vendre des
chapeaux, en qualité de membre de la communauté
des Chapeliers. Cette communauté date fon origine
de 1578. Elle eft gouvernée par quatre jurés , dont
le premier a été pris dans le nombre des anciens jurés
, 8c s’appellz grand-garde, 8c les trois autres, entre
les maîtres de dix ans de réception. Ils o’ont chacun
que deux ans d’exercice. Pour être admis à la
maîtrife , il faut avoir fait cinq ans d’apprentiflage
quatre ans de compagnonage , & chef-d’oeuvre. II
n’y a que les fils de maîtres qui foient exempts d«
ces épreuves. Ce corps eft divifé en marchands 8c
en fabriquans ; les marchands , en marchands en
neuf, 8c marchands en vieux ; & les fabriquans,
en Chapeliers proprement dits, & en teinturiers. Les
arracheurs , les coupeurs , les apprêteurs , & autres
dont il eft fait mention à l’article C hapeau , font
des ouvriers attachés à la fabrique des chapeaux, 8c
fournis aux vifites des jurés Chapeliers. Voyeç à. Par-
tic le C hapeau , fur la fin, l’abregé des reglemens.'
Chapelier fe dit 20. d’un ouvrier, même compagnon,
qui fabrique le chapeau.
CHAPELLE, fub. f. terme d'Architecl. on entend
fous ce nom la partie d’une églife confacrée à quelque
dévotion particulière, telles que font dans nos
paroifles les chapelles de la Vierge, &c. décorées avec
magnificence , comme celle de S. Sulpice à Paris ;
ou dans un palais, un lieu avec un autel où l’on dit
la mefle ; ou enfin dans un hôtel, une piece deftinée
à cet ufage. Il faut tâcher , autant qu’il eft poflible
de l’éloigner des appartenons de lociété , des enfilades
principales , & des pièces deftinées aux do-;
meftiques.
L’on voit en France de ces dernieres placées avec
trop
trop de négligence, contre toute idée de bienféance.
Dans le nombre de celles qui méritent quelque confi-
dération, 8c qui font partie de là magnificence de nos
palais, celles du château de Frefne, de Choifi, 8c de
Sceaux , tiennent le premier rang après celles de
Verfailles 8c de Fontainebleau, &c.
Il faut éviter de placer ces chapelles dans des lieux
trop écartés; mais aufli.ilconvient de ne pas faire
parade dans l’extérieur, de l’ufage intérieur de ces
fortes de pièces, comme au Luxembourg, à Paris ,•
du moins il faut fe garder , comme on a fait dans ce
palais , de le défigner par. des fymboles relatifs au
Chriftianifine, qui fe trouvant confondus avec des
ornemens profanes , préfentent un.enfemble contraire
à l’ordonnance qui doit régner dans un édifice
de ce.tte efpece. ( P ) :
C hapelle , ( Jurifpr. ) ce terme a différentes fi-
gnifiçations, même en matière eccléfiaftique.
Il fignifie quelquefois une églife particuliere, qui
n’eft. ni cathédrale, ni collégiale , ni paroiffe , ni abbaye
, ni prieuré : ces fortes de chapelles font celles
que les .canoniftes appellent fub dio, c’eft-à-dire qui
font détachées & féparées de toute autre églife.
, On appelle aufli chapelle , une partie d’une grande
églife foit cathédrale ou „collégiale , ou autre,
dans laquelle il y a un autel, 8c oùl’on dit la mefle.
Les canoniftes appellent celles-ci des chapelles fub
teclo, c’eft-à-dire renfermées fous le toit d’une plus
grande églife. En françois on les appelle ordinairement
chapellenies , pour les diftinguer des chapelles
proprement dites, qui forment feules une églife particuliere.
Il y aufli des chapelles domeftiques dans Tinté-*
rieur des mqnafteres, hôpitaux, communautés, dans
les palais des princes , châteaux, 8c autres maifons
particulières ; celles-ci ne font proprement que des
oratoires privés, même celles pour lefquelles on a
obtenu permiflion d’y faire dire la mefle. Le canon
2/. du concile d’A gd e, tenu en çotf, permet aux
particuliers d’avoir des chapelles dans leurs maifons,
avec défenfes aux clercs d’y célébrer fans la permif-
fion de l’évêque.
Le terme de chapelle fe prend encore pour le bénéfice
fondé ou attaché à la chapelle : on donne cependant
aufli à un tel bénéfice le Hom de chapellenie.
,
Pour pofféder une chapelle ou chapellenie formant
un titre de bénéfice, il fuffit, fuivant le droit commun
, d’avoir fept ans, 8c d’avoir la tonfure , à moins
que la chapelle ne foit facerdotale àfundatione, auquel
cas il faut avoir vingt-cinq ans commencés, 8c
les autres qualités requifes : mais ilfautobferverque
l’obligation de faire célébrer des mefles ne rend pas
feulé* une chapelle facerdotale, parce que le chapelain
les peut faire acquitter par un autre. Voye1
B én é f ic e .
Une chapelle n’eft point régulièrement réputée
bénéfice, fi on ne rapporte le titre d’éreétion faite
par l’évêque. Fevret, l iv .I lï . ch .j. n. 2. 8c Cabaf-
fut, lib. I I . tit. j . n. 2. Néanmoins comme un titre
ancien d’éreâion peut être perdu, il fuffit, fuivant
Guy pape , décif. 18y. que la chapelle ait été conférée
trois fois par l’évê^ue en titre de bénéfice. Fer-
rérius 9fur Guy pape, prétend même qu’une feule collation
fuffit ; ce qui pàroît avoir été adopté par un
arrêt du parlement de Mets , du 4 Mars 1694. Au-
geard, tome I . ch. xxxiij.
Une chapelle ou chapellenie en titre eft différente
d’une fimple preftimonie , oucommiflion qui eft donnée
à un prêtre pour acquitter habituellement des
mefles dans une chapelle. Voye{ Prest imo nie.
Une chapelle étant en patronage mixte , ne peut
être réfignée fans le confentement des patrons mixtes.
Arrêt du 2 7 Mai 16 j t , Journ, des aud»
Tome I I I ,
Deiix chapelles fub eodem teclo, ne peüveiit être
tenues par une même perfonne, quelque modique
qu’èn foit le revenu. Arrêt du 3 Août 1668. Defmai-
fons , au mot chapelle, p* 5 c).
Sur les chapelles des religieux > voyé[ les décrétales ,
liv. I I I . tit. xxxvij. Et in fexto , liv. I II. tit.xviij. Suf.
les autres chapelles domeftiques , voye[ la novel. S8±
Les novelles 4. & ià. de Léon Pinfon , tit. de fundatione
ecclefiarüm. Francif. Marc, tomel. q u.too y . & 1001 +
La bibliot. canon, tome I. p. 218. & tome I I . p. ^ÿy»
Tournet, lett.C. quefl. 26. Praxis beneficior. cap. xx*
n. 2 J . Journ. des aud. tome I. liv. I . chap, xlviij. &.
Ixxj. Bardet, tome I, liv. II. ch. Ix.
On appellé Jaintes chapelles celles qui font établies
dans les palais des rois, comme la fainte chapelle de
Paris , celles de Dijon, de Bourges, 8c autres fem-
blables. Sur les privilèges de ces faintes chapelles ,
voyeç les réglemens indiqués dans le diction, des arrêts
au mot chapçjle , n. i j . ( A )
C hapelle , {droit de ) Jurifpr. eft une rétribution
en argent que les magiftrats, avocats, procureurs ,
& autres officiers payent lors de leur réception,
pour l’entretien de la chapelle commune qui eft dans
l’enceinte du tribunal. ( A )
C hapelle , faire chapelle, (Marine.') « c’eftun
» revirement inopiné duvaiffeau. Faire chapelle, eft:
» virer malgré foi y ce qui arrive lorfque par le mau-
» vais gouvernement du timonier, le vaiffeau eft ve-
» nu trop au vent, ou que le vent faute tout d’un
» coup & fe range de l’avant. Les courans font en-
» core faire chapelle. Quand on a fait chapelle, il faut
» reprendre le vent, 8c remettre le vaiffeau en route,
» Suppofé que la route foit nord 8c le vent nord-eft ,
» 8c qu’ayant trop ferré le vent 8c mis le cap au nord
» quart de nord-eft, on ait fait chapelle 8c viré malgré
» foi ; alors on cargue l’artimon, on largue un demi-,
» pié du bras du grand hunier fous le vent, 8c on
» haie tant-foit-peu fur le bras qui eft au vent ; ce qui
» remet le vaiffeau 8c fait porter à route ».
C hapelle , ( la ) eft le coffre dans lequel font gardés
les ornemens qui fervent pour dire la mefle dans
les vaiffeaux. L’aumônier eft chargé du foin delà
chapelle.
C hapelle de compas , eft un petit cône concave
de laiton, qui eft placé au milieu de la rofe , dans lequel
entre un pivot qui fupporte la rofe de la bouffole*
VoyeiBoussole. ( Z )
C hapelle ; ( Chimie, ) vaiffeau diftillatoire , ap-
pellé aufli par quelques artiftes , rofaire ; parce qu’ils
ne s’en fervoient communément qu’à la diftillation
des rofes : c’eft une efpece d’alembic dont la cucur-
bite eft baffe, cylindrique , 8c à fond exa&ement plat
ou plan, 8c le chapiteau conique 8c très-élevé. On
chauffe ordinairement cet alembic en le pofant fur
des cendres chaudes.
C hapelle , ( Boulang. ) c’eft ainfi que les Boulangers
appellent la voûte de leur four. Il eft tems
d’enfourner quand la chapelle eft blanche. Voye^
Varticle Pa in .
. CHAPELLENIE , f. f. (Jurifpr.) félon Rebuffe
8c quelques autres canoniftes, fignifie une chapelle
fub teclo, érigée en titre de bénéfice. Panorme eft d’avis
contraire ; c’eft-à-dire que chapellenie, félon lui,
fignifie une chapelle fub dio. Quelques autres, comme
M. Chaftelain, difent que chapellenie eft le titre
du bénéfice, 8c chapelle, l’autel où il eft deflervi. Le
fens le plus ordinaire dans lequel on employé ce
terme , eft pour exprimer le titre d’un bénéfice def-
fervi à l’autel d’une chapelle fub teclo. Voye{ ci-devant
C h a p e l l e . ( A )
CHAPERON, f. m. (Hift.mod.) ancienne coëffure
ordinaire en France, quia duréjufque aux régnés de
Charles V. VI. 8c VII. fous lefquels on portoit des
chaperons à queue , que les dofteurs 8c bacheliers