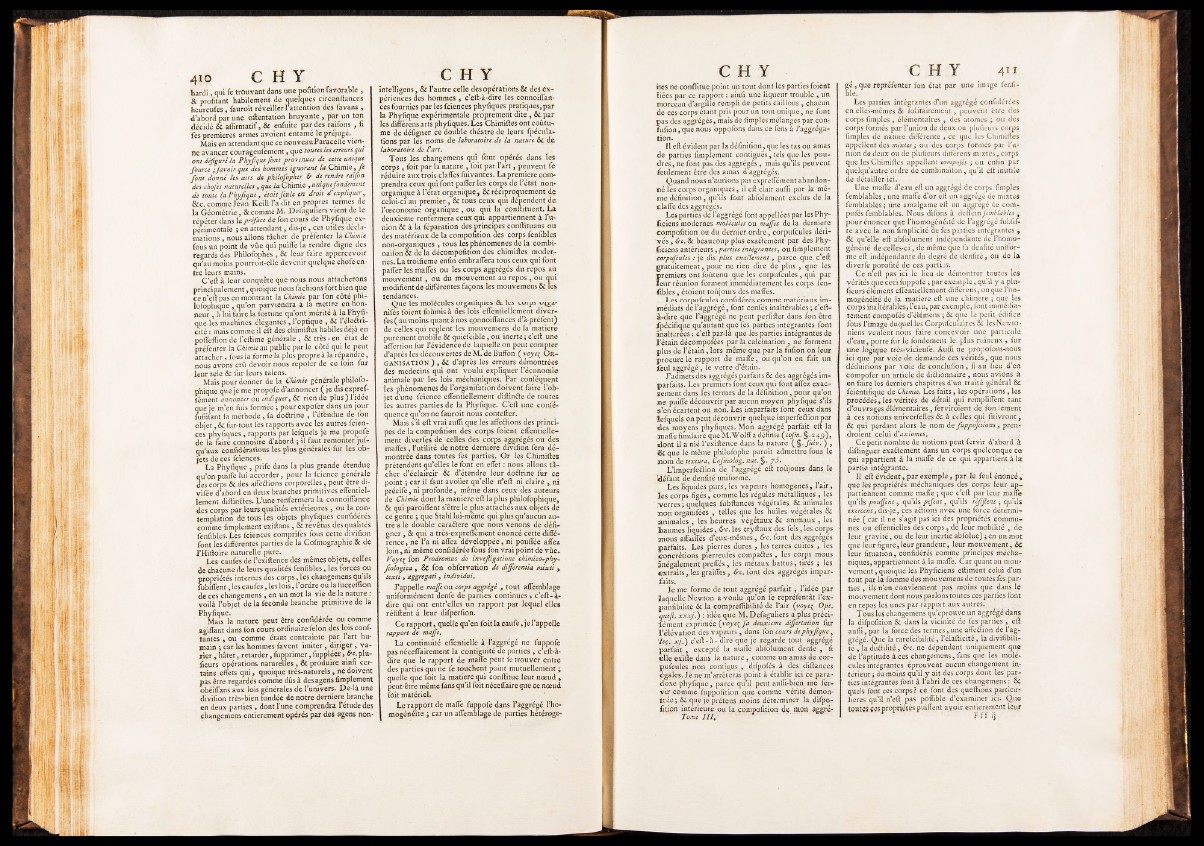
hardi, qui fe trouvant dans une pofition favorable ,
& profitant habilement de quelques circonftances
heureufes, fauroit réveiller 1 attention des favans ,
d’abord par une oftentation bruyante , par un ton
décidé 6c affirmatif, ÔC enfuite par des raifons , fi
fes premières armes avoient entame le préjugé.^
Mais en attendant que ce nouveau Paracelfe vienne
avancer courageufement, que toutes les erreurs qui
ont défiguré la Phyfique font provenues de cette unique
fource i f avoir que des hommes ignorant la Chimie, fie
font donné les airs de philofopher & de rendre raifon
des chofes naturelles , que la Chimie , unique fondement
de toute la Phyfique y étoit feule en droit d expliquer,
& c . comme Jean Keill l’a dit en propres termes de
la Géométrie, & comme M. Del'aguliers vient de le
répéter dans la préface de fon cours de Phyfique expérimentale
; en attendant, dis-je, fies utiles déclamations
, nous allons tâcher de préfenter la Chimie
fous un point de vue qui puifle la rendre digne des
regards des Philofophes , & leur faire appercevoir
qu’au moins pourroit-elle devenir quelque chofe entre
leurs mains.
C ’eft à leur conquête que nous nous attacherons
principalement, quoique nous fâchions fort bien que
ce n’eupas en montrant la Chimie par fon cote phi-
lofophique , qu’on parviendra à la mettre en honneur
, à lui faire la fortune qu’ont mérité à la Phyfique
les machines élégantes , l ’optique , 6c l’éle&ri-
cité : mais comme il eft des chimiftes habiles déjà en
poffeffion de l’eftime générale , & très-en état de
préfenter la Chimie au public par le cote qui le peut
attacher, fous la forme la plus propre à la répandre,
nous avons crû devoir nous repolèr de ce loin fur
-leur zele & lur leurs talens. f f
Mais pour donner de la Chimie générale philofo-
phique que je me propofe d’annoncer ( je dis expref-
lément annoncer ou indiquer, & rien de plus ) 1 idee
que je m’en fuis formée ; pour expofer dans un jour
fuffifant là méthode, fa doûrine , l’étendue de fon
objet, 6c fur-tout fes rapports avec les autres feien-
ces phyfiques , rapports par lefquels je me propofe
de la faire connoître d’abord ; il faut remonter juf-
qu’aux confidérations les plus générales fur les objets
de ces fciences.
La Phyfique , prife dans la plus grande etendue
qu’on puifle lui accorder, pour la fcience générale
des corps 6c des affeéHons corporelles, peut être di-
vifée d’abord en deux branches primitives eflentiel-
lement diftinâes. L’une renfermera la connoiffance
des corps par leurs qualités extérieures , ou la contemplation
de tous les objets phyfiques confidérés
comme fimplement exiftans , 6c revêtus des qualités
fenfibles. Les fciences comprifes fous cette divifion
font les différentes parties de la Cofmographie & de
l’Hiftoire naturelle pure.
Les caufes de l’exiftence des mêmes objets, celles
de chacune de leurs qualités fenfibles, les forces ou
propriétés internes des corps, fes changemens qu’ils
lubiffent ,les caufes, les lois, l’ordre ou lafucceflion
de ces changemens , en un mot la vie de la nature :
voilà l’objet de la fécondé branche primitive de la
Phyfique. r ,
Mais la nature peut être confideree ou comme
agiffant dans fon cours ordinaire félon des lois confiantes
, ou comme étant contrainte par l’art humain
; car les hommes favent imiter, diriger, varier
, hâter, retarder, fupprimer, fuppléer, &c. plu-
fieurs opérations naturelles, 6c produire ainfi certains
effets qui, quoique très-naturels, ne doivent
pas être regardés comme dûs à desagens fimplement
obéiffans aux lois générales de l’univers. De-là une
divifion très-bien fondée de notre derniere branche
en deux parties , dont l’une comprendra l’étude des
changemens entièrement opérés par des agens nonintelligens,
6c l’autre celle des opérations 6c des expériences
des hommes , c’eft-à-dire les connoiffan-
ces fournies par les fciences phyfiques pratiques, par
la Phyfique expérimentale proprement dite , 6c par
les différens arts phyfiques. Les Chimiftes ont coûtu-
me de défigner ce double théâtre de leurs fpécula-
tions par les noms de laboratoire de la nature ÔC de
laboratoire de Part.
Tous les changemens qui font opérés dans les
corps , foit par la nature , foit par l’a r t , peuvent fe
réduire aux trois claffes fuivantes. La première comprendra
ceux qui font paffer les corps de l’état non«
organique à l’etat organique, & réciproquement de
celui-ci au premier, 6c tous ceux qui dépendent de
l’oeconomie organique , ou qui la conftituent. La
deuxieme renfermera ceux qui appartiennent à l’union
& à la féparation des principes conftituans ou
des matériaux de la compofition des corps fenfibles
non-organiques , tous les phénomènes de la combi-
naifon 6c de la décompofition des chimiftes modernes.
La troifieme enfin embraffera tous ceux qui font
paffer les maffes ou les corps aggrégés du repos au
mouvement, ou du mouvement au repos , ou qui
modifient de différentes façons les mouvemens 6c les»
tendances.
Que les molécules organiques & les corps crçga-
nifés foient foûmis à des lois effentiellement diver-
fes ( aumoins quant à nos c.onnoiffances d’à-préfent)
de celles qui règlent les mouvemens de la matière
purement çiobile 6c quiefcible, ou inerte ; c’eft une
affertion fur l’évidence de laquelle on peut compter
d’après les découvertes de M. de Buffon ( voye^ Org
a n i s a t i o n ) , 6c d’après les erreurs démontrées
des médecins qui ont voulu expliquer l’économie
animale par les lois méchaniques. Par conféquent
les phénomènes de l’organifation doivent faire l’objet
d’une fcience effentiellement diftinéte de toutes
les autres parties de là Phyfique. C ’eft une confé-
quence qu’on ne fauroit nous contefter.
Mais s’il eft vrai aufli que les affeâions des principes
de la compofition des corps foient effentiellement
diverfes de celles des corps aggrégés ou des
maffes, l’utilité de notre derniere divifion fera démontrée
dans toutes fes parties. Or les Chimiftes
prétendent qu’elles le font en effet : nous allons tâcher
d’éclaircir 6c d’étendre leur doârine fur ce
point ; car il faut avouer qu’elle ri*eft ni claire , ni
précife, ni profonde, même dans ceux des auteurs
de Chimie dont la maniéré eft la plus philofophique,
& qui paroiffent s’être le plus attachés aux objets de
ce genre ; que Stahi lui-même qui plus qu’aucun autre
a le double caraôere que nous venons de défigner
, & qui a très-expreffément énoncé cette différence
, ne l’a ni affez développée, ni pouffée affez
loin, ni même confidérée fous fon vrai point de vûe.
Voye^ fon Prodromus de invefiigatione chimicoTphy-
fiologica, 6c fon obfervation de differentia mixti ,
texti y aggregati , individui.
J’appelle maffe ou corps aggrégé , tout affemblage
uniformément denfe de parties continues , c’eft -à-
dire qui ont entr’elles un rapport par lequel elles
réfiftent à leur difperfion.
Ce rapport, quelle qu’en foit la caufe, je l’appelle
rapport de mafie.
La continuité effentielle à l’aggrégé ne fuppofe
pas néceffairement la contiguité de parties , c’eft-à-
dire que le rapport de maffe peut fe trouver entre
des parties qui ne fe touchent point mutuellement ;
quelle que foit la matière qui conftitue leur noeud ,
peut-être même fans qu’il foit néceffaire que ce noeud
foit matériel.
Le rapport de maffe fuppofe dans l’aggrégé l’ho-
mogénéite ; car un affemblage de parties hétérogehes
ne conftitue point un tout dont les parties foient
liées par ce rapport : ainfi une liqueur trouble , un
morceau d’argille rempli de petits caillous, chacun
de ces corps étant pris pour un tout unique, ne font
pas des aggrégés, mais de fimples mélanges par con-
fufion ,que nous oppofons dans ce fens a l’aggréga-
tion.
Il eft évident par la définition, que les tas ou amas
de parties fimplement contiguës, tels que les poudres,
ne font pas des aggrégés , mais qu’ils peuvent
feulement être des amas d’aggrégés.
Quand nous n’aurions pas expreffément abandonné
les corps organiques, il eft clair aufli par la même
définition, qu’ils font abfolument exclus de la
claffe des aggrégés.
Les parties de l’aggrégé font appellées par les Physiciens
modernes molécules ou maffes de la derniere
compofition ou du dernier ordre, corpufcules dérivés
, &c. & beaucoup plus exa&ement par des Physiciens
antérieurs yparties intégrantesy ou fimplement
corpufcules : je dis plus exactement, parce que c’eft
gratuitement, pour ne rien dire de plus , que les
premiers ont foûtenu que les corpufcules, qui par
leur réunion forment immédiatement les corps fenfibles
, étoient toûjours des maffes.
Les corpufcules confidérés comme matériaux immédiats
de l’aggrégé, font cenfés inaltérables ; c’eft-
à-dire que l’aggrégé ne peut perfifter dans fon être
Spécifique qu’autant que fes. parties intégrantes font
inaltérées : c’eft par-la que les parties intégrantes de
l ’étain décomposées par la calcination , ne forment
plus de l’étain, lors même que par la fufion on leur
procure le rapport de maffe, ou qu’on en fait un
feul aggrégé, le verre d’étain.
J’admets des aggrégés parfaits 8c des aggrégés imparfaits.
Les premiers font ceux qui font affez exactement
dans les termes de la définition, pour qu’on
p e puifle découvrir par aucun moyen phyfique ‘s’ils
s ’en écartent ou non. Les imparfaits font ceux dans
lefquels on peut découvrir quelque imperfection par
!ries moyens phyfiques. Mon aggrégé parfait eft la
anaffe fimilaire que M/Wolff a définie (cofm. §.245)),
riont il a nié l’exiftence dans la nature ( § . fuiv. ) ,
& que le même philofophe paroît admettre fous le
jziom de textura. Cofmolqg. nat. §,. j 5. ^ .
L’imperfeCtion de l’aggrégé eft toûjours dans le
Idéfaut de denfité uniforme.
Les liquides purs, les vapeurs homogènes, l’air ,
les corps figés, comme les régules métalliques , les
Verres ; quelques fubftances végétales 8c animales
non organifées , telles que les huiles végétales 8c
animales , les beurres végétaux 8c animaux , les
jbaumes liquides, &c. les cryftaux des fels,, les corps
mous affaiffés d’eux-mêmes, &c. font des aggrégés
parfaits. Les pierres dures , les terres cuites , les
concrétions pierreufes .compares , les corps mous
inégalement preffés, les métaux battus, tirés ; les
extraits, les graiffes, &c. font des aggrégés imparfaits,.
. . ,
Je me forme de tout aggrégé parfait , l’idée par
laquelle Newton a voulu qü’on le repréfentât l’ex-
panfibilité & la eompreflibilité de l’air (voye^ Opt.
quefi. x x x j.) : idée que M. Defaguliers a plus précisément
exprimée ( voye^fa deuxieme difiértatipn fur
l ’élévation des vapeurs , dans fon cours de phyfique,
'Jeç. xj.') c’eft-à - dire que je regarde tout aggrégé
parfait , excepté la maffe abfolument denfe , fi
elle exifte dans la nature, comme un amas de corpufcules
non contigus,, difpofés à des diftances
égales. Jè ne m’arrêterai point à établir ici ce paradoxe
phyfique, parce qu’il peut aufli-bien me fer-
vir comme fuppofition que comme vérité démontrée;
& que je prétens moins déterminer la difpo-
fition intérieure ou la compofition de mon aggré-
Tome JÏI,'
g é , que repréfenter fon état par une image fenfi-
ble.L
es parties intégrantes d’un aggrégé confidérees
en elles-mêmes & folitairement , peuvent être des
corps fimples, élémentaires , des atomes ; ou des
corps formés par l’union de deux ou plufieurs corps
fimples de nature différente , ce que les Chimiftes
appellent des mixtes ; ou des corps formés par l’union
de deux ou de plufieurs différens mixtes, corps
que les Chimiftes appellent compofès ; ou enfin par
quelqu’autre ordre de combinaifon, qu’il eft inutile
de détailler-ici.
Une maffe d’eâu eft un aggrégé de corps fimples
femblables ; une maffe d’or eft un aggrégé de mixtes
femblables ; une amalgame eft un aggrégé de com-
pofés femblables. Nous difons à deffein femblables ,
pour énoncer que l’homogénéité de l’aggrégé fubfif-
te avec la non fimplicité de fes parties intégrantes ,
& qu’elle eft abfolument indépendante de l’homogénéité
de celles-ci, de même que fa denfité uniforme
eft indépendante du degré de denfité, ou de la
diverfe porofité de ces parti;s.
Ce n’eft pas ici le lieu de démontrer toutes les
vérités que ceci fuppofe ; par exemple, qu’il y a plufieurs
élémens effentiellement différens, ou que l’homogénéité
de la matière eft une chimere ; que les
corps inaltérables, l’eau, par exemple, font immédiatement
compofès d’élémens ; & que le petit édifice
fous l ’image duquel les Corpusculaires & les Newto»
niens veulent nous faire concevoir une particule
d’eau, porte fur le fondement le .plus ruineux , fur
une logique très-vicieufe. Aufli ne propofons-nous
ici que par voie de demande ces vérités, que nous
déduirions par voie de conclufion, fi au lieu d’en
compofer un article de diûionnaire , nous avions à
en faire les derniers chapitres d’un traité général &C
feientifique dq Chimie. Les faits, les opérations, les
procédés, les-vérités ■ de détail qui rempliffent tant
d’ouvrages élémentaires, ferviroient de fondement
à ces notions univerfelles & à celles qui fuivront,
& qui perdant alors le nom de fuppofitions, pren-
droient. celui d’axiomes.
Ce petit nombre de notions peut fervir d’abord'à
diftinguer exactement dans un corps quelconque ce
qui appartient à la maffe de ce qui appartient à la
partie intégrante.
II eft évident, par exemple, par le feul énoncé,
que les propriétés méchaniques des corps leur appartiennent
comme maffe ; que c’eft par leur maffe
qu’ils pouffent, qu’ils pefent, qu’ils réfiftent ; qu’ils
exercent y dis-je, ces a&ions avec une force déterminée
( car il ne s’agit pas ici des propriétés communes
ou effentielles des corps, de leur mobilité , de
leur gravité, ou de leur inertie abfolue) ; en un mot
que leur figure, leur grandeur, leur mouvement, &
leur fituation, confidérés comme principes mécha-r
niques, appartiennent à la maffe. Car quant au mou*
vement, quoique les Phyficiens eftiment celui d’un
tout par la fomme des mouvemens de toutes fes. parties
, ils n’en conviennent pas moins que dans le
mouvement dont nous parlons toutes ces parties font
en repos les unes par rapport aux autres. '
Tous les changemens qu’éprouve un aggrégé dans
la difpofition & dans la vicinité de fes parties , eft
aufli, par la force des termes, une affeâion de l’ag-
grégé. Que la rarefeibilite, l’élafticité, la divifibili-
.té , la duCtilité, &c. ne dépendent uniquement que
de l’aptitude à ces changemens, fans que les molécules
intégrantes éprouvent aucun changement intérieur
; du moins qu’il y ait des corps dont les parties
intégrantes font à l’abri de ces changemens : 6c
quels font ces corps? ce font des queftions particulières
qu’il n’eft pas poffible d’examiner ici. Que
toutes çes propriétés puiffent avoir entièrement leur