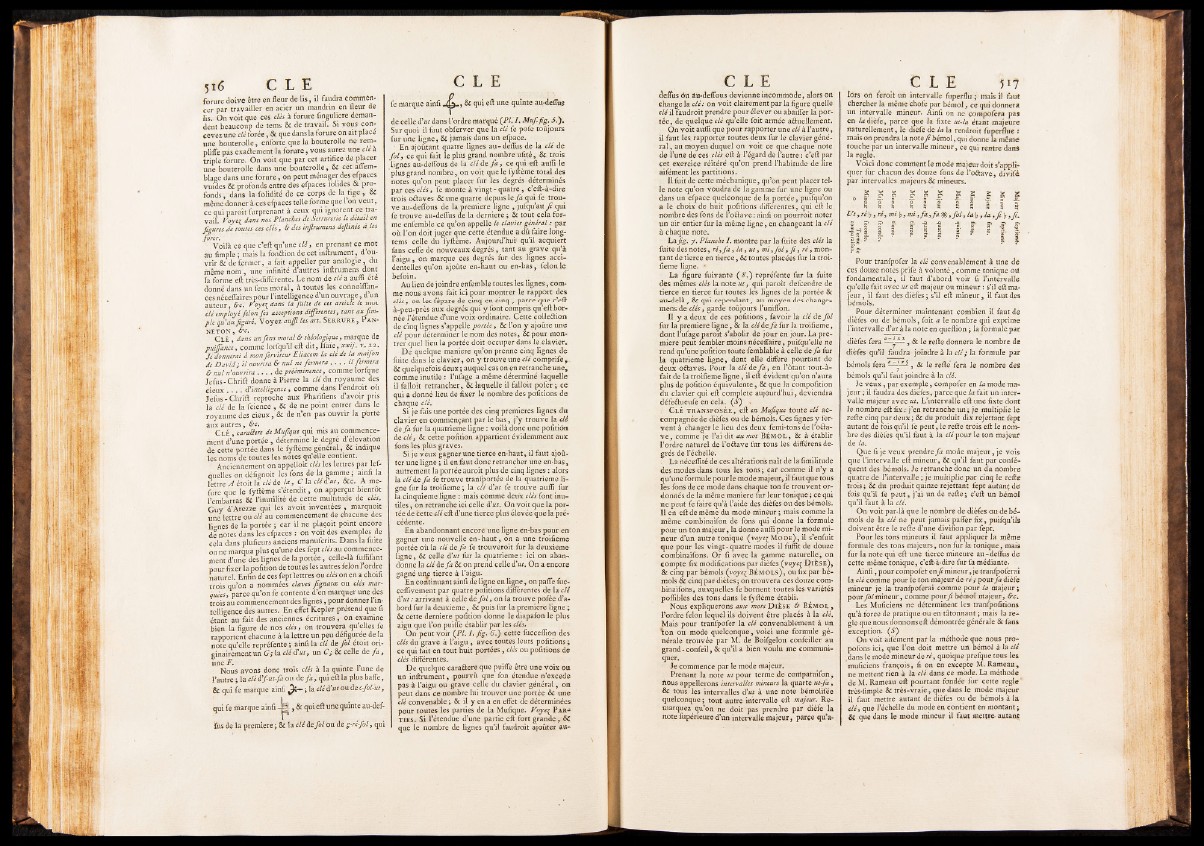
forure doive être en fleur de lis, il faudra commencer
par travailler en acier un mandrin en fleur de
lis. On voit que ces clés à forure finguliere demandent
beaucoup de tems & de travail. Si vous concevez
une clé torée, & que dans la forure on ait place
une bouterolle, enforte que la bouterolle ne rem-
pliffe pas exa&ement la forure, vous aurez une cle à
tripleforure. On voit que par cet artifice de placer
une bouterolle dans une bouterolle, & cet affem-
blage dans une forure, on peut ménager des efpaces
vuides & profonds entre des efpaces lolides^ & profonds,
dans la folidité de ce corps de la tige , &
même donner à-ces efpaces telle forme que l’on veut,
ce qui paroît furprenant à ceux qui ignorent -ce travail.
Voyt{ dans nos Planches de Serrurerie le detail en
figures de toutes ces clés , & des infirumens dejlines a les
forer.
• Voilà ce que c’eft qu’une clé; en prenant ce mot
au fimple ; mais la fonaion de cet inftrument, d’ouvrir
& de fermer, a fait appeller par analogie, du
même nom', une' infinité d autres inftrumeUs dont
fâ forme eft très-différente. Le nom de cüc'simffi été
donné dans un fens moral, à toutes les connoiffan-
ées néceffaires pour l’intelligence d’un ouvrage, d’un
auteur, d’ci Foÿe[ dans la fuite de cet article U mot
clé employé, filon fis acceptions différentes, tant au fimple
qu'au figuré. Voyez, aiijfi les art. Serrure, Panneton
, 6c. J ", . ' '
ËEE , déins un fens moral & lheologiqne, marque de
puffance, comme iorfqu’il eft dit, Kùiefxxifi V. jtz.
Jé donnerai à mon ferviteur Eiiacem la clé de la maifim
de David'; i l ouvrira & nul ne fermera . . i l fermera
nul n'ouvrira , . . . de prééminence, comme iorfnuc
Jefus - Chrift donne à Pierre la clé du royaume dés
e ieu x___d’intelligence , comme dans l’endroit où
Jefûs-Chrift reproche aux Pharifiens d’avoir pris
Ira clé de la fcience , & de ne point entrer dans le
royaume des eieux, 8î de n’en pas ouvrir la porte
aux autres, érc. ,
' C lé caractère de Mufique qui mis au commencement
d’une portée , détermine le degré d’élévation
de cette portée dans le fyftème général, 8c indique
les noms de toutes les notes qu’elle contient.
Anciennement on appelloit clés lés lettres par lef-
miélles on défignoit les fons de la gamme ; ainfi la
léttre A étoit la clé de la , C la clé S u t, Scc. A me-
fiire que le fyftèmé s'étendit, on apperçut bientôt
f embarras 8c l’inutilité de cette muhitude de clés.
Guy' d’Arezze qui lés avoit inventées , marquoit
une lettre ou de au commencement de chacune des
lignes de là portée ; car il ne plaçoit point encore
de notes dans les efpaces : on voit des exemples de
Cela dans plufieurs anciens manufcrits, Dans la fuite
on ne marqua plus qu’une des feçt clés au commencement
d’une des lignes de la portée, celle-là fuffifant
pour fixer la pofition de toutes les autres félon l’ordre
naturel. Enfin de ces fept lettres ou clés on en a choifi
trois qu’on a nommées slaves fignatce ou clés marquées,.
parce qu’on fe contente d’en marquer une des
trois au commencement des lignes,, pour donner 1 intelligence
des autres. En effet Kepler prétend que fi
étant au fait des anciennes écritures ,■ on examine
bien la figure de nos cUs , on trouvera qu’elles fe
rapportent chacune à la lettre un peu défigurée de la
note qu’elle repréfente ’, ainfi la cle de fo l etoit originairement
un G; la clé Su t, un C; 8c celle de fa ,
une F. . . . . - 1 ,
Nous avons donc trois clés à la quinte 1 une de
l’autre ; la clé S f ut-fa ou de fa , qui eft la plus baffe,
8c qui fe marque ainfi ; la clé d'ut ou de c-fol-ut,
4 , & qui eft une quinte au-deffe
qui fe marque ainfi
fus de la première ; & la clé défolou de g-ré-fol, qui
marque ainfi qui eft une quinte au-deffus
de celle d'ut dans l ’ordre marqué (Pl. I. Muf.fig. i . ) .
Sur quoi il faut obferver que la clé fe pofe toujours
fur une ligne, & jamais dans un efpace.
■ En ajoutant quatre lignes au-deffus de la clé de
fo l , ce qui fait le plus grand nombre u fité, & trois
lignes au-deffous de la clé de f a , ce qui eft aufli le
plus grand nombre, on voit que le fyfteme total des
notes qu’on peut placer fur les degrés déterminés
par ces clés, fe monte à vingt - quatre, c’eft-à-dire
trois o&aves & u n e quarte depuis 1 e fa qui fe trouve
au-deffous de la première ligne , jufqu’au J î qui
fe trouve au-deffus de la derniere ; & tout cela forme
enfemble ce qu’on appelle le clavier général : par
OÙ l ’on doit juger que cette étendue a dû faire long-
tems celle du fyftème. Aujourd’hui* qu’il acquiert
fans ceffe de nouveaux degrés, tant au grave qu’à
l’aigu, on marque ces degrés fur des lignes accidentelles
qu’on ajoute en-haut ou en-bas, félon le
bçfoin.
Au lieu de joindre enfemble toutes les lignes, comme
nous avons fait ici pour montrer le rapport des
clés, on les fépare de cinq en cinq , parce que c’eft
à-peu-près aux degrés qui y font compris qu’eft bornée
l’étendue d’une voix ordinaire. Cette colleâion
de cinq lignes s’appelle portée, & l’on y ajoute une
clé pour déterminer le nom des notes, & pour montrer
quel lieu la portée doit occuper dans le clavier*
De quelque maniéré qu’on prenne cinq lignes de
fuite dans le clavier, on y trouve une clé comprife,.
& quelquefois deux ; auquel cas on en retranche une,
comme inutile : l’ufage a même déterminé laquelle
il falloit retrancher, & laquelle il falloit pofer ; ce
qui a donné lieu de fixer le nombre des pofitions de
chaque clé.
Si je fais une portée des cinq premières lignes du
clavier en commençant par le bas, j’y trouve la clé
de fa fur la quatrième ligne : voilà donc une pofition
de clé, & cette pofition appartient évidemment aux
fons les plus graves.
Si je veux gagner une tierce en-haut, il faut ajouter
une ligne ; il en faut donc retrancher une en-bas,
autrement la portée auroit plus de cinq lignes : alors
la clé de fa fe trouve tranfportée de la quatrième ligne
fur la troifieme ; la clé d'ut fe trouve aufli fur
la cinquième ligne : .mais comme deux clés font inutiles
, on retranche ici celle dé ut. On voit que la portée
de cette clé eft d’une tierce plus élevée que la précédente.
En abandonnant encore une ligne en-bas pour en
gagner une nouvelle en-haut, on a une troifieme
portée où la clé de fa fe trouveroit fur la deuxieme
ligne, & celle d'ut fur la quatrième : ici on aban-<
donne la clé de fa & on prend celle d'ut. On a encore
gagné une tierce à l’aigu.
En continuant ainfi de ligne en ligne, on paffe fuc-
cefîivement par quatre pofitions différentes de la clé
d'ut : arrivant à celle de fo l , on la trouve pofée d’abord
fur la deuxieme, & puis fur la première ligne ;
& cette derniere pofition donne le diapafon le plus
aigu que l’on puiffe établir par les clés.
On peut voir (PL. /, fig. <T.) cette fucceflion des
clés du grave à l’aigu, avec toutes leurs pofitions ;
ce qui fait en tout huit portées, clés ou pofitions de
clés différentes.
De quelque cara&ere que puiffe être une voix ou
un inftrument, pourvu que fon étendue n’excede
pas à l’aigu ou grave celle du clavier général, on
peut dans ce nombre lui trouver une portée & une
clé convenable ; & il y en a en effet de déterminées
pour toutes les parties de la Mufique. Voye^ Parties.
Si l’étendue d’une partie eft fort grande, &
que le nombre de lignes qu’il faudrait ajoûter audeflus
dit au-deffous devienne incommode, alors on
change la clé: on voit clairement par la figure quelle
clé il faudroit prendre pour élever ou abaiffer la portée,
de quelque clé qu’elle foit armée aéhiellement.
On voit aufli que pour rapporter une clé à l’autre,
il faut les rapporter toutes deux fur le clavier général,
au moyen duquel on voit ce que chaque note
de l’une de ces clés eft à l’égard de l’autre : c’eft par
cet exercice réitéré qu’on prend l’habitude de lire
aifément les partitions.
Il fuit de cette méchanique, qu’on peut placer telle
note qu’on voudra de la gamme fur une ligne ou
dans un efpace quelconque delà portée, puifqu’on
a le choix de huit pofitions différentes, qui eft le.
nombre des fons de l’oftave : ainfi on pourrait noter
lin air entier fur la même ligne, en changeant la clé
à chaque note.
La fig. j . Planche I. montre par la fuite des clés la
fuite des notes, ré, fa fila, ut, mi, f o l , f i , ré , montant
de tierce en tierce, & toutes placées für la troifieme
ligne. *
La figure fuivante (<?,) repréfente fur la fuite
des mêmes clés la note ut, qui paroît descendre de
tierce en tierce fur toutes les lignes de la portée &
au-delà, & qui cependant, au moyen des change-
mens de clés , garde toûjours l’uniffon.
Il y a deux de ces pofitions, favoir la clé de fol
fur la première ligne, & la clé de fa fur la troifieme,
dont l’ufage paraît s’abolir de jour en jour. La première
peut fembler moins néceffaire, puifqu’elle ne
tend qu’une pofition toute femblable à celle de fa fur
la quatrième ligne, dont elle différé pourtant de
deux oftaves. Pour la clé de f a , en l’ôtant tout-à-
fait de la troifieme ligne, il eft évident qu’on n’aura
plus de pofition équivalente, & que la compofition
du clavier qui eft complété aujourd’hui, deviendra
défeftueufe en cela. ( S ) ,
. C lé tr an spo sé e , eft en Mufique toute clé accompagnée
de dièfes ou de bémols. Ces lignes y fervent
à changer le lieu des deux femi-tons de l’o&a-
v e , comme je l’ai dit au mot Bém o l , & à établir
l’ordre naturel de l’o&ave fur tous les diffétens degrés
de l’échelle.
. La néceflité de ces altérations ilaît de la fimilitude
des modes dans tous les tons ; caf comme il n’y a
qu’une formule pour le mode majeur, il faut que tous
les fons de ce mode dans chaque ton fe trouvent ordonnés
de la même maniéré fur leur tonique ; ce qui
ne peut fe faire qu’à l’aide dès dièfes ou des bémols.
Il en eft de même du mode mineur ; mais comme la
même combinaifon de fons qui donne la formule
pour un ton majeur, la donne aufli pour le mode mineur
d’un autre tonique (voye^ Mode) , il s’enfuit
que pour les vingt - quatre modes il fuffit de douze
combinaifons. Or fi avec la gamme naturelle, on
compte fix modifications par dièfes (*oye{ E)ièse) ,
& cinq par bémols (voyei Bémo ls) , ou fix par bémols
& cinq par dièfes; on trouvera ces douze combinaifons,
auxquelles fe bornent toutes les variétés
poflibles des tons dans le fyftème établi.
Nous expliquerons aux mots D ièse & BÉMOL ,
l’ordre félon lequel ils doivent être placés à la clé.
Mais pour tranfpofer la clé convenablement à un
‘ion ou mode quelconque, voici une formule générale
trouvée par M. de Boifgelou confeiller au
grand -confeil, & qu’il a bien voulu me communiquer.
Je commence par le mode majeur.
Prenant la note ut pour terme de cortlpataifon,
nous appellerons intervalles mineurs la quarte ut-fa,
& tous les intervalles d'ut à une note bémolifée
quelconque ; tout autre intervalle eft majeur. Remarquez
qu’on ne doit pas prendre par dièfe la
note fupérieurc d’un intervalle majeur, parce qu’a-
Idrs oii ferait un intervalle fupefflu ; biais il faut
chercher la même cbofe par bémol, ce qui donnera
un intervalle mineur. Ainfi on ne compofera pas
en la dièfe, parce que la fixte ut-la étant majeure
naturellement, le dièfe de la la rendroit fuperflue î
mais on prendra la note f i bémol, qui donne la même
touche par un intervalle mineur, ce qui rentre dans
la réglé.
Voici donc comntent le mode majeur doit s’appliquer
fur chacun des douze fons de l’o&ave divifé
par intervalles majeurs & mineurs.
o g. S S. J g " S S 2 2 2 S
Ut,ré \j,ré, mi \ ,>m i,fa ,fa ^ ,fo l, l a ^ , la , f i^,f i.
Pour tranfpofer là clé convenablement à une de
ces douze notes prife à volonté, comme tonique oit
fondamentale, il faut d’abord voir fi l’ intervalle
qu’elle fait avec üt eft majeur ou mineur : s’il eft majeur
, il faut des dièfes ; s’il eft mineur, il faut des
bémols.
Pour déterminer maintenant combien il faut de
dièfes ou de bémols, foit a le nombre qui exprime
l’intervalle d'ut à la note en queftion ; la formule par
dièfes fera •l 3C7' , & le refte donnera le nombre de
dièfes qu’il faudra joindre à la clé ; la formule par
bémols fera , & le refte fera le nombre des
bémols qu’il faut joindre à la clé.
Je v eu x , par exemple, compofer en la mode majeur
; il faudra des dièfes, parce que la; fait un intervalle
majeur avec ut. L’intervalle eft une fixte dont
le nombre eft fix : j’en retranche un je multiplie le
refte cinq par deux ; & du produit dix rejettant fept
autant de fois qu’il fe peut, le refte trois eft le nombre
des dièfes qu’il faut à la clé pour le ton majeur
de la.
Que fi je veux prendre fa mode majeur, je vois
que l’intervalle eft mineur, & qu’il faut par conl’é-
quent des bémols. Je retranche donc un du nombre
quatre de l’intervalle ; je multiplie par cinq le refte
trois ; & du produit quinze rejettant fept autanç de
fois qu’il fe peut, j’31 un dè refte; c’eft un bémol
qu’il faut à la clé.
On voit par-là que le nombre de dièfes ou de bémols
de la clé ne peut jamais paffer fix, puifqu’ils
doivent être le refte d’une divifion par fept.
Pour les tons mineurs il faut appliquer la même
formule des tons majeurs, non fur la tonique, mais
fur la note qui eft une tierce mineure au-deffus de
cette même tonique, c’eft-à-dire fur fa médiante.
Ainfi, pour compofef en f i mineur, je tranfpoferai
la clé comme pour le ton majeur de ré; pour fa dièfe
mineur je la tranfpoferai comme pour la majeur ;
pour fo l mineur, comme pourf i bémol majeur, &c.
Les Muficiens ne déterminent les tranfpofitions
qu’à force de pratique ou en tâtonnant ; mais la réglé
que nous donnons eft démontrée générale & fans
exception. ( S f
On voit aifément paf la méthode que nous pro-
pofons ici, que l’on doit mettre un bémol à la clé
.dans le mode mineur de ré, quoique prefque tous les
muficiens françois, fi on en excepte M. Rameau,
ne mettent rien à la clé dans ce mode. La méthode
de M. Rameau eft pourtant fondée fur cette réglé'
trèsffimple & très-vraie, que dans le mode majeur
il faut mettre autant de dièfes ou de bémols à la
clé, que l’échelle du mode en contient en montant ;
& que dans le mode mineur il faut mettre- autant