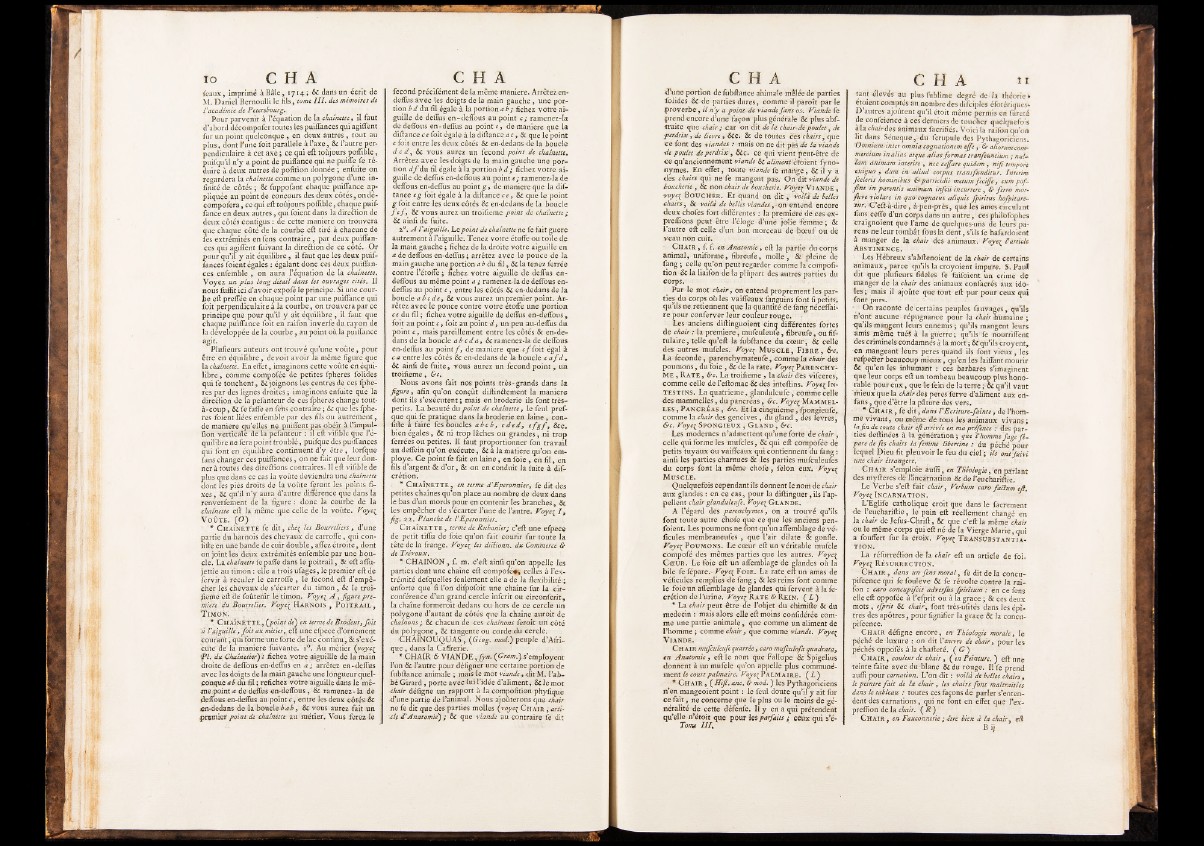
féaux, imprimé à B âle, 1714» & dans un écrit de
M. Daniel Bernoulli le fils, tome I II. des mémoires de
Vacadémie de Petersbourg.
Pour parvenir à l’équation de la chaînette, il faut
d’abord décompofer toutes les puiffances qui agiffent
fur un point quelconque , en deux autres , tout au
plus, dont l’une foit parallèle à l’ax e, ôc l’autre perpendiculaire
à cet axe ; ce qui eft toujours poflible ,
puifqu’il n’y a point de puiffance qui ne puifle fe réduire
à deux autres de pofition donnée ; enfuite on
regardera la chaînette comme un polygone d’une infinité
de côtés ; ôc fuppofant chaque puiffance appliquée
au point de concours des deux côtés, ondé-
compofera, ce qui eft toujours poflible, chaque puiffance
en deux autres, qui foient dans la direûion de
deux côtés contigus : de cette maniéré on trouvera
que chaque côté de la courbe eft tiré à chacune de
fes extrémités en fens contraire, par deux puiffances
qui agiffent fuivant la direction de ce côté. Or
pour qu’il y ait équilibre, il faut que les deux puif-
jances foient égales : égalant donc ces deux puiffances
enfemble , on aura l’équation de la chaînette.
Voyez un plus long détail dans les ouvrages cités. Il
nous fuffit ici d’avoir expofé le principe. Si une courbe
eft preffée en chaque point par une puiffance qui
foit perpendiculaire à la courbe, on trouvera par ce
principe que pour qu’il y ait équilibre , il faut que
chaque puiffance foit en raifon inverfe du rayon de
la développée de la courbe, au point oit la puiffance BU , A Plufieurs auteurs ont trouve qu’une voûte, pour
être'en équilibre, devoit avoir la même figure que
la. chaînette. En effet , imaginons cette voûte en équilibre
, comme compofée de petites fpheres folides
qui fe touchent, ôc joignons les centres de ces fphé-
res par des lignes droites ; imaginons enfuite que la
diredion de la pefanteur de ces fpheres change tout-
à-coup , & fe faffe en fohs contraire ; ôc que les fphe-
res foient liées enfemble par des fils ou autrement,
de maniéré qu’elles ne pjfifjjent pas obéir à l’impul-
ïion verticale de la pefanteur : il eft vifible que l’équilibre
ne fera point troublé, puifque des puiffances
qui font en équilibre continuent d’y être , lorfque
fans changer ces puiffances, on ne fait que leur donner
à toutes des diré&ions contraires. Il eft vifible de
plus que dans ce cas la voûte deviendra une chaînette
dont les piés droits de la voûté fçront les points fixes
, ôc qu’il n’y aura d’autre différence que dans la
irenverfement de la figure : donc la courbe de la
chaînette eft la même que celle de la voûte. Voye^
V o ût e. (O)
‘ * C haînette fe dit, cke{ les Bourreliers, d’une
partie du hârnois des chevaux de carroffe, qui con-
fifte en une bande de cuir double, affez étroite, dont
on joint les deux extrémités enfemble par une boucle.
La chaînette fe paffe dans le.poitrail, & eft affu-
jettie au timon : elle a trois ufages, le premier eft de
fervir'à reculer le carroffe , le fécond eft d’empêcher
les chevaux de s’écarter du timon , & le troi-
ftemé eft dé foûtenir le timon. Voyt{ A , figure première
'dû Bourrelier. Voye%_ H ARN OIS , POITRAIL ,
TlMONl
* CHAÎNETTE., Qpàint dé) en terme de Brodeur, foit
'à Vaiguille, foit au métier, eft une çfpece d’ornement
courant , qui’forme-une forte de lac continu, & s’exécute
de1 là maniéré fuivantë. i° . Au métier (voyé^
ffl. du Chaîneiter) : .fichez votre aigurllle de la main
droite de deffous en-dëffus en a ; arrêtez en-deffus
avec les doigts de la main gauche une longueur quelconque
a b du fil ; refichez votre aiguille dans le même
.pointa de deffus «en-deffous, ôc -ramenez - la de
deffous en-deffus au point é , entre les deux côtés ôc
en-dedans de la boucle.$ a£ , ôc vous aurez fait un
premier point de chaînette au métier. Vous ferez le
fécond précifément de la même maniéré. Arrêtez en-
deffus avec les doigts de la main gauche, une portion
b d du fil égale à la portion a b; fichez votre aiguille
de deffus en-deffous au point c; ramenez-la
de deffous en-deffus au point e , de maniéré que la
diftance ce foit égale à la diftance a c , & que le point
e foit entre les deux côtés ôc en-dedans de la boucle
d c d , ôc vous aurez un fécond point de chaînette.
Arrêtez avec les doigts de la main gauche une portion
d f du fil égale à la portion bd ; fichez votre aiguille
de deffus en-deffous au point e; ramenez-la de
deffous en-deffus au point g , de maniéré que la distance
eg foit égale à la diftance c e , ôc que le point
g foit entre les deux côtés ôc en-dedans de la boucle
f e f , ÔC vous aurez un troifieme point de chaînette;
ôc ainfi de fuite.
z°. A l'aiguille. L e point de chaînette ne fe fait guere
autrement à l’aiguille. Tenez votre étoffe ou toile de
la main gauche ; fichez de la droite votre aiguille en
a de deffous en-deffus ; arrêtez avec le pouce de la
main gauche une portion a b du f il, ôc la tenez ferrée
contre l’étoffe ; fichez votre aiguille de deffus en-
deffous au même point a ; ramenez-la de deffous en-
deffus au point c , entre les côtés ôc en-dedans de la
boucle abc d e , Ôc vous aurez un premier point. Arrêtez
avec le pouce contre votre étoffe une portion
ce du fil ; fichez votre aiguille de deffus en-deffous ,
foit au point c , foit au point é , un peu au-deffus du
point c , mais pareillement entre les côtés & en-dedans
de la boucle a b c d a , ôc ramenez-la de deffous
en-deffus au point f , de maniéré que. c f foit égal à
c a entre les côtés ôc en-dedans de la boucle c a fd ,
ôc ainfi de fuite, vous aurez un fécond poin t, un
troifieme, 6*c.
Nous avons fait nos points très-grands dans la
figure, afin qu’on conçût diftinftement la maniéré
dont ils s’exécutent ; mais en broderie ils font très-
petits. La beauté du point de chaînette , le feul pref-
que qui fe pratique dans la broderie en laine, con-
fifte a faire fes boucles abc b , e d e d , e f g f , ôcc.
bien égales, & ni trop lâches ou grandes, ni trop
ferrées ou petites. Il faut proportionner fon travail
au deffein qu’on exécute, & à la matière qu’on employé.
Ce point fe fait en laine, en foie , en fil, en
fais d’argent & d’or, & on en conduit la fuite à discrétion.
■
* C haînette , en terme d’Eperonnier, fe dit des
petites chaînes qu’on place au nombre de deux dans
le bas d’un mords pour en contenir les branches, &
les empêcher de s’écarter l’une de l’autre. Voye{ I ,
fig. z z . Planche de VEperonnier.
C haîne tte , terme de Rubanier; c’eft une efpece
de petit tiffu de foie qu’on fait courir fur toute la
tête de la frange. Voyelles diclionn. du Commerce &
de Trévoux.
* CHAINON, f. m. c’eft ainfi qu’on appelle les
parties dont une chaîne eft compofée»', celles à l’extrémité
defquelles feulement elle a de la flexibilité:;
enforte que fi l’on difpofoit une chaîne fur. la circonférence
d’un grand cercle inferit ou circonfcrit,
la chaîne formerait dedans ou hors de ce cercle lin
polygone d’autant de côtés que la chaîne aurait de
chaînons ;■ ÔC chacun de ces chaînons feroit un côté
du polygone, ôc tangente ou .corde.du cercle;
CHA1NOUQUAS, (Géog. mod.) peuple d’Afrique
, dans la Caffrerie.
* CHAIR & VIANDE ,fyn. (Gram.) s’employer
l’un ôc l’autre pour défigner une certaine portion de
fubftance animale ; mais le mot viande., d it M. l ’abbé
Girard , porte avec lui l ’idée d’aliment, ôc le mot
chair défigne un rapport à la compofition phyfique
d’une partie de l’animai. Nous ajoûterons que chair
ne fe dit que des parties molles (voyeç C hair , arti-
cle d'Anatomie) ; ôc que viande au contraire fe dit
d’une portion de fubftance animale mêlée de parties
folides ôc-de parties dures, comme il paraît parle
proverbe, il n'y a point de viande faits Osi Viande fe
prend encore d’une façon plus générale & plus abf-
traite que chair ; car on dit de la chair-dé poulet, de
perdrix, de lievte, ÔCC, & de toutes céSchairs, que
c e font des viandes : mais on ne dit p&s de là viande
■ de poulet de perdrix, ô£c. ce qui vien t peut-être de
ce qu’anciennement viande ÔC alimènt'éVoient fyno-
nymes. En effet, toute viande fe mange, & il y a
des chairs qui ne fe mangent pas. Ori fiit viande dé
boucherie , ÔC non chair de boucherie. Voyeç V iande ,
voye^ Bo u ch er . Et quand on d i t , ' voilà de belles
chairs, & voilà, de belles v ian d e son entend encore
deux chofes fort differentes ; la première de ces ex-
preffions peut être l’éloge d’uné jolie femme; &
l’autre eft celle d’un bon morceau de boeuf ou de
veau non cuit.
- C hair , f. f. en Anatomie , eft la partie1 du corps
animal, uniforme, fibreufe, molle, & pleine de
fang ; celle qu’on peut regarder comme la compofi-
tion ôc la liaifon de la plûpàrt des autres-patties du
corps.:
Par le mot cA/wV, on entend proprement les parties
du corps oü les vaiffeaux fanguins font fi petits;
qu’ils ne.retiennent que la quantité de farig néceffai-
re pour conferver leur couleur rouge; ; v •
Les anciens diftinguoient cinq différentes fortes
de chair : la première, mufcûleufe, fibreufe, ou fif-
tulaire, telle qu’eft la fubftance du cbèur;, ôc celle
des autres mufeles. Voyeç Mu s c l e , Fi b r e , &c.
La fécondé, parenchymateufe, comme la: choir des
poumons, du foie , & de la rate. Voye^ Parenchym
e , Ra t e , &c. La troifieme, la chair dès vifeeres,
comme celle del’eftomac & d e s inteftins. Voye^ Inte
s t in s . La quatrième, glanduleufe-, comme celle
des mammelles, du pancréas, Oc. Voyeç Mammel-
les , Pa n cr é as , Oc. Et la cinquième, fpongieufe,
comme la chair des gencives, du gland , des levres,
&c. Voye^ Spon gieu x * G land , 6*c.
Les modernes n’admettent qu’une forte de chair,
celle qui forme les mufeles, & qui eft compofée de
petits tuyaux ou vaiffeaux qui contiennent du fang :
ainfi les parties charnues & -les parties mufculeufes
du corps font la même ch ofe, félon eux. Foyer
Mu sc le.
Quelquefois cependant ils donnent le nom de chair
aux glandes : en ce cas, pour la diftinguer, ils l’appellent
chair glanduleufe. Voyeç G lande.
A l’égard des parenchymes, on a trouvé qu’ils
font toute autre chofe que ce que les anciens pen-
foient. Les poumons ne font qu’un affemblage de vé-
iicules membraneufes , que l ’air dilate & gonfle.
Voye^ Poumons. Le coeur eft un véritable mufcle
compofé des mêmes parties que les autres. Voyet^
C oeur. Le foie eft un affemblage de glandes oit la
bile fe fépare.- Voye[ Fo ie . La rate eft un amas de
véficules remplies de fang ; & les reins font comme
le foie un affemblage de glandes qui fervent à la fe-
crétion de l ’urine. Voye^ Ra te & Rein. ( L )
* La chair peut être de l’objet du chimifte & du
médecin : mais alors elle eft moins confidérée comme
une partie animale, que comme un aliment de
l’homme ; comme chair , que comme viande. Voyeç
V iande.
C hair mufculeufequarrèe , caro mufculofa quadrata,
en Anatomie, eft le nom que Fallope & Spigelius
donnent à un mufcle qu’on appelle plus communément
le court palmaire. Voye^ Pa lm a ir e . ( L )
* C hair , ( Hift. anc. O mod. ) les Pythagoriciens
n’en mangeoient point : le feul doute qu’il y ait fur
ce fait, ne concerne que le plus ou le moins de généralité
de cette défenfe. Il y en a qui prétendent
qu’elle n’étoit que pour les parfaits ; ceux qui s’é-
Tome I I I»
tant élevés au plus fubiime degré de îâ théorie»
ètoient comptes an nombre des difciples éfotériques*
D autres^ ajoutent qu’il étoit même permis en fureté
de confcienCe à ces derniers de toucher quelquefois
àla chair des animaux facrifiés. Voici la raifon qu’on
lit dans Séneque,-du fcrupule des Pythagoriciens*
‘Omnium-inter omnia CQgnationem tfiè ÿ G ahorumeom-
nurCium in alias atque alias formas tranftuntiüm ; nul*
tarfi dn'imam intente , nec cejfare quidem, nifi temporé
èSciguo , dum in aliud corpus transfunditur. Intérim,
feeltris hominibus■ O-parrïcidii met uni fecifje , cum pof-
fifit 'in parentis anïmam infeii incurrere , & ferré mor-
fuve yiolare in qüO'-'cognatus aliquis fpiritus hofpïtare-
îferV ‘G’eft-à-dire, à-peri-près, que les âmes circulant
fans cefle d’un corps dans un autre, ces philofophes
craignoient que Pâme de quelques-uns de leurs pa-
•rens ne leur tombât fous la dent, s’ils fe hafardoient
à manger de la chair des animaux. Voye^ Varticle
ABSTINENCE;
Les Hébreux s’abftèfloient de la chair de Certains
animaux, parce qu’ils la croyoient impure. S. Paul
dit que plufieurs fidèles fè faifoient un crime de
manger de la chair des animaux confacrés aux idoles
; mais il ajoûte que tout eft pur pour ceux qui
-forit purs.
• Oh raconte de certains peuples fauvages,- qu’ils
n’ont aucune répugnance pour la chair humaine ;
qu’ilsmaqgent leurs ennemis; qü’ils mangent leurs
■ amis même tué$ à lag'uèrre; qu’ils:'fe nourriffent
des criminels condamnés à la mort-; & qu’ils croyent,
en mangeant leurs peres quand ils font v ieu x, les
refpe&er beaucoup mieux, qu’en les laiffant mourir
& qu’en les inhumant : ces barbares s’imaginent
que leur corps eft un tombeau beaucoup plus honorable
pour eu x , que le foin de la terre ;• ôc qu’il vaut
mieux que la chair des peres'ferve d’alifnent aux en-
fans , que d’être la pâture des vers. -
* C à air , fe dit, dans VEcriture-J,'ointe, de l’homme
vivant, ou même dé tous les animaux vivans;
la fin de toute chair efi arrivée en ma prèferice : des parties
deftinées à la génération ; que Vhommc fage fé pare
de fes chairs la femtm libertine : du péché pour
lequel Dieu fit pleuvoir le feu du ciel ; ils ont juivi
une chair étrangère.'
C ha ir s’emploie àuflî, tn Théologie, 'en pàrlaht
des myfteres dè l’Jncârnatibn & de l’euchâriftie.
Le Verbe s’eft fait chair, Verbum caro factum eft.
Voye^ In c ar n a t io n . 7 *
L’Eglifo catholique Croit que dans le facremertt
de Peuchariftie, le pain eft réellement changé en
la chair de Jefus-Chrift, & que c ’eft la même chair
ou le même corps qui eft né de la Vierge M arie, qui
a fouffert fur la croix. Voye^ T rànsü bstant ia -
t io n .
La réfurreftion de la chair eft un article de foi.
Voye{ Résu rrec tio n.
C h a ir , dans un fens moral, fo dit de la concu-
pifcence qui fe foulève ôc fe révolte contre la raifon
: caro concupifcit adverfus fpiritum : en ce fons
elle eft oppofée à Pefprit ou à la grâce ; ôc ces deux
mots , efprit ôc chair,, font très-ufités dans les épî-
tres des apôtres, poilr lignifier la grâce ôc la concü-
pifcence.
C hair défigne encore, en Théologie morale, le
péché de luxure ; on dit Y oeuvre de chair, pour les
péchés oppofés à la ehafteté. ( G )
C h a ir , couleur de chair, (en Peinture. ) eft une
teinte faite avec du blanc ôcdu rouge. Il fe prend
aufîi pour carnation. L’on dit : voilà de belles chairs ,
le peintre fait de la chair, les chairs font maltraitées
dans le tableau : toutes ces façons de parler s’entendent
des carnations, qui ne font en effet que- l’ex-
preffion de la chair. ( R ■)
C h a ir ., en Fauconnerie ; -être bien à la chair, eft
B i j