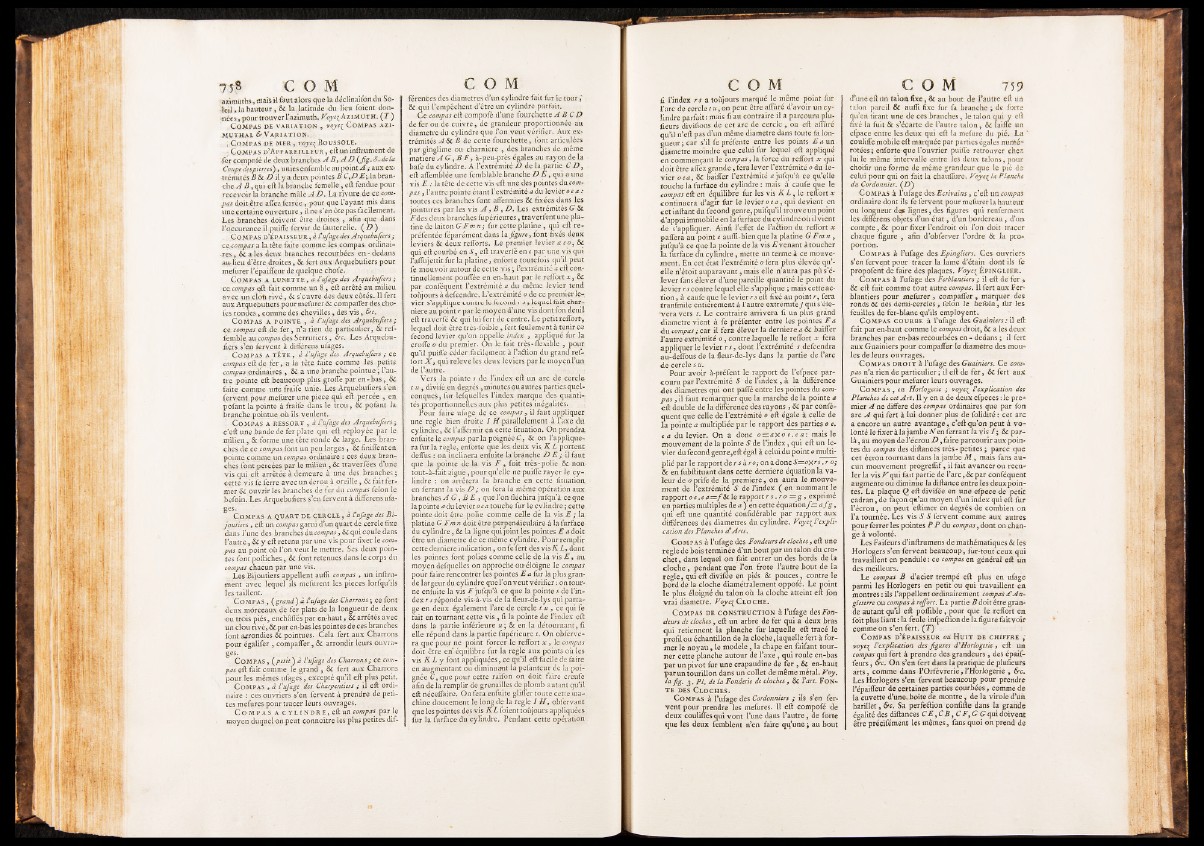
75-$ C O M
azimüths, mai^s il faut alors que la déclinaifôn du So- '
4ejl ,1S hauteur, & la , latitude du lieu foient don-
Giécsr, pour trouver l’azimuth. V jye^AziMUTH. ( T )
C ompas de v a r ia t io n , voye[ C ompas a z i -
MUth al & V a r ia t io n .
( C ompas de MER^ roy«{ Boussole,
; C ompas d’A p pare illeur, eftuninftrument de
fer compolé de deux branches A B , A D (fig . 8 . delà
Coupe des pierres'), unies ensemble au point A ; aux extrémités
B & D il y a-deux pointes B C,DE\. la bran-
-che A B , qui eft la branche femelle, eft fendue pour
receypir la branche mâle A D . La rivure.de ce comptas
doit être allez ferrée, pour que l’ayant mis dans
une certaine ouverture, il ne s’en ôte pas facilement.
Les branches doivent être droites , afin que dans
l’occurence il puiffe fervir de fauterelle. ( D )
C ompas d’épaisseur , à l'ufage des Arquebufiers ;
ce-compasa la tête faite comme les compas ordinair
e s , & a lés.deux branches recourbées en-dedans
au-üeu d’être droites, & fert aux Arquebufiers pour
mefurer l’épaiffeur de quelque chofe.
C ompas A lunette , a. l'ufage des Arquebufiers;
ce.compas qH fait comme un 8 * eft arrêté au milieu
avec unclôù r iv é , & s’çuvre des deux côtés. Il fert
aux Arquebufiers pour mefurer & compaffer des.cho-
fes rondes, comme des chevilles, des v is , &c.
C ompas A poin te , à L'ufage des Arquebufiers ;
ce rompus eft.de f e r , n’a rien de particulier, & ref-
femblg au compas des Serruriers, &c. Les Arquebufiers
s’en fervent à différens.ufages. r ]
. C ompas a t ê te , 'à L'ufage des. Arquebufiers ; ce
compas eü. de fe r ,-a la tête, faite comme les petits
compas ordinaires , & a une branche pointue ; l’autre
pointe eft beaucoup plus groffe par en-bas, &
faite comme une fraife unie. Les Arquebufiers s’en
fervent pour mefurer une piece qui eft percée , en
pofant la pointe à fraife dans le trou, & pofant la
branche pointue où ils veulent.
C ompas A ressort , à L'ufage des Arquebufiers ;
c’eft une bande de fer plate qui eft reployée par le,
milieu, & forme une tête ronde & large. Les branches
de ce compas,iont un peu larges, & finiffenten
pointe comme un compas ordinaire : ces deux branches
font percées par le milieu , & traverfees d’une
vis qui eft arrêtée à demeure à une des. branches ;
cette vis fe ferre avec un écrou à oreille , & fait fermer
& ouvrir les branches de fer du compas félon le
befoin. Les Arquebufiers s’en fervent à différensufa-
gés.C
om pas a quart de cercle , à Vufage des Bijoutiers
, eft un compas garni d’un quart de cercle fixe
dans Lune des branchés du compas, & qui coule dans
l’autre, & y eft retenu par une vis pour fixer le compas
au point où l’on.veut le mettre. Ses deux pointes
font poftiches , & font retenues dans le corps du
compas chacun par une vis. . .
Les Bijoutiers appellent aufli compas , un infiniment
avec lequel ils mefurent les pièces lorfqu’ils
les. taillent. ' ,
COMPAS , (grand) à Vufage des Charrons ; cefont
deux morceaux de fer plats de la longueur de deux
■ ou trois piés, enchâffés par en-haut, & arrêtés avec
un clou rivé, & par en-bas les pointes de ces branches
font arrondies & pointues. Cela fert aux Charrons
pour égalifer , compaffer, & arrondir leurs ouvrages.
COMPAS, (petit) à l'ufage des Charrons; ce compas
eft fait comme le grand , & fert aux Charrons
pour les mêmes ufages, excepté qu’il eft plus petit.
COMPAS , à L'ufage des Charpentiers ; il eft ordinaire
c ces ouvriers s’en fervent à prendre de petites
mefurespour tracer leurs ouvrages.
C o m p a s a c y l i n d r e , eft un compas par le
moyen duquel on peut connoître les plus petites dif-
C O M
férentes des diamètres d’un cylindre fait fur le tour >
& .qui l’empêchent d’être un cylindre parfait.
Ce compas eft compofé d’une fourchette A B C D
de fer ou de cuivre, de grandeur proportionnée au
diamètre du cylindre que l’on veut vérifier* Aux extrémités
A&c B de cette fourchette, font articulées
par ginglime ou charnière , des branches de même
matière A G , B F , à-peu-près égales au rayon de la
bafe du cylindre. A l’extrémité D de la partie C D ,
eft affemblée une femblable branche D E , qui a une
vis E : la tête de cette vis eft une des pointes du compas
, l’autre pointe étant l’extrémité a du levier oe a :
toutes ces branches font affermies & fixées dans les
jointures par les vis A , B ,D . Les extrémités G &
Ades. deux branches fupérieures, traverfent une platine
de laiton G F m n; fur cette platine , qui eft re-
préfentée féparément dans la figure, font fixés deux
leviers & deux refforts. Le premier.levier a e o , &
qui eft courbé en S , eft traverfé en e par une vis qui
l’affujettitfur la platine, enforte toutefois qu’il peut
fe mouvoir autour de cette vis ; l’extrémité a eft continuellement
pouffée en en-haut par le refîort x , &
par conféquent l’extrémité a du même levier tend
toujours à defeendre. L’extrémité o de ce premier le-,
vier s’applique contre le fécond r s , lequel fait charnière
au point r par le moy en d’une vis dont fon deuil
eft traverfé & qui lui fert de centre. Le petit reffort*,
lequel doit être très-foible , fert feulement à tenir ce
fécond levier qu’on appelle index , appliqué fur la
croffeo du premier. On le fait très-flexible , pour
qu’il puiffe céder facilement à l’aâion du grand reffort
X , qui releve les deux leviers par le moyen l’un
de l’autre.
Vers la pointe s de l’index eft un arc de cercle
t u , divifé en degrés , minutes ou autres parties quelconques
, fur lefquelles l’index marque des quantités
proportionneUes aux plus petites inégalités.
Pour faire ufage de ce compas ,, il faut appliquer
une réglé bien droite 1 fit parallèlement à l'axe du
cylindre, & l’affermir en cette fituation. On prendra
enfuite le compas par la poignée Ç, & on l’appliquera
fur la réglé, enforte que les. deux vis. K L portent
deffus : on inclinera enluite la'branche D E ; il faut
que :1a pointe de la vis F , foit très-polie & non
tout-à-fait aiguë, pour qu’elle ne puiffe rayer le cy lindre
: on arrêtera la branche en cette fituation
en ferrant la vis D i on fera la même opération aux
branches A G ,B E , que l’on fléchira jufqu’à ce que
la pointe a du levier oea touche fur le cylindre ; cette
pointe doit être polie comme celle de la vis Ê ; la
platine G Fmn doit être perpendiculaire à la furface
du cylindre, & la ligne qui joint les pointes E a doit
être un diamètre de ce même cylindre. Pour remplir
cette derniere indication, on fe fert des vis A! L, dont
les pointes font polies comme celle de la vis E , au
moyen defquelles on approche owéloigne le compas
pour faire rencontrer les pointes E a fur la plus grande
largeur du cylindre que l’on veut vérifier ; on tourne
enfuite la vis F jufqu’à ce que la pointe j de l’index
r i réponde vis-à-vis de la fleur-de-lys qui partage
en deux également l’arc de cercle t u , ce qui fe
fait en tournant cette v i s , fi la pointe de l’index eft
dans la partie inférieure m; & en la détournant, fi
elle répond dans la partie fupérieure t. On obferve-
ra que pour ne point forcer le reffort x , le compas
doit être en* équilibre fur la réglé aux points où les
vis A Z, y font appliquées, ce qu’il eft facile de faire
en augmentant ou diminuant la pefanteur de la poignée
C, que pour cette raifon on doit faire creufe
afin de la remplir de grenailles de plomb autant qu’il
eft néceffaire. On fera enfuite gliffer toute cette m a-.
chine doucement le long de la réglé 1 H , obfervant
que les pointes des vis A L foient toujours appliquées
fur la uvrface du cylindre, Pendant cette opération
C O M
fi l’index r i a toujours marqué le même point fur
l’arc de cercler«,on peut être affûré d’avoir un cylindre
parfait : mais fi au contraire il a parcouru plu-
fieurs divifions de cet arc de cercle , on eft affûré
qu’il n’eft pas d’un même diamètre dans toute fa longueur
; car s’il fe préfente entre les points E a un
diamètre moindre que celui fur lequel eft appliqué
en commençant le compas, la force du reffort x qui
doit être affez grande, fera lever l’extrémité o du levier
oea, & baiffer l’extrémité « jufqu’à ce qu’elle
touche la furface du cylindre : mais à caufe que le
compas eft en équilibre fur les vis A L , le reffort x
continuera d’agir fur le levier o ea , qui devient en
cet inftant du fécond genre, puifqu’il trouve un point
d’appui immobile en la furface du cylindre où il vient
de s’appliquer. Ainfi l’effet de l’a&ion du reffort x
paffera au point e aufli-bien que la platine G F m n ,
jufqu’à ce que la pointe de la vis E venant à toucher
la furface du cylindre, mette un terme à ce mouvement.
En cet état l’extrémité o fera plus élevée qu’elle
n’étoit auparavant, mais elle n’aura pas pu s’élever
fans élever d’une pareille quantité le point du
levier rs contre lequel elle s’applique ; mais cette action
, à caufe que le levier rs eft fixé au point r, fera
tranfmife entièrement à l’autre extrémité ƒ qui s’éle-
'vera vers t. Le contraire arrivera fi un plus grand
diamètre vient à fe préfenter entre les pointes A «
du compas; car il fera élever la derniere a & baiffer
l ’autre extrémité o , contre laquelle le reffort # fera
appliquer le levier r s , dont l’extrémité s defeendra
au-deffous de la fleur-de-lys dans la partie de l’arc
de cercles a.
Pour avoir à-préfent le rapport de l’efpace parcouru
par l’extrémité S de l’index , à la différence
des diamètres qui ont paffé entre les pointes du compas
, il faut remarquer que la marche de la pointe a
eft double de la différence des rayons, & par conféquent
que celle de l’extrémité o eft égale à celle de
la pointe a multipliée par le rapport des parties o e.
ta du levier. On a donc o x ca x o e .e a: mais le
mouvement de la pointe S de l’index, qui eft un levier
du fécond genre,eft égal à celui du point o multiplié
par le rapport de r s à r o; on a donc Sx=-oxrs. r o;
& en fubftituant dans cette derniere équation la valeur
de o prife de la première, on aura le mouvement
de l’extrémité S de l’index ( en1 nommant le
rapport o e .e a x z f & le rapport r s ,r o — g , exprime
en parties multiples de a ) en cette équationƒ = a f g ,
qui eft une quantité confidérable par rapport aux
différences des diamètres du cylindre. Voye^ l'explication
des Planches eCArts.
C ompas à l’ufage des Fondeurs de cloches, eft une
réglé de bois terminée d’un bout par un talon du crochet
, dans lequel on fait entrer un des bords de la
cloch e, pendant cjue l’on frote l’autre bout de la
réglé, qui eft divifee en piés & pouces, contre le
bord de la cloche diamétralement oppofé. Le point
le plus éloigné du talon où la cloche atteint eft fon
vrai diamètre. Voye^ C lo ch e .
C ompas de co n stru c t io n à l’ufage des iw i-
deurs de cloches, eft un arbre de fer qui a deux bras
qui retiennent la planche fur laquelle eft tracé le
profil ou échantillon de la cloche,laquelle fert à former
le noyau, le modèle, la chape en faifant tourner
cette planche autour de l’a x e , qui roule en-bas
par un pivot fur une crapaudine de fer , & en-haut
par un tourillon dans un collet de même métal. Voy.
la fig. 3. PI, de la Fonderie de cloches, & l'art. Font
e des C lo ch e s .
C ompas à l’ufage des Cordonniers ; ils s’en fei>
vent pour prendre les mefures. U eft compofé de
deux couliffes qui vont l’une dans l’autre, de forte
que les deux femblent n’en faire qq’une ; au bout
C O M 759
cfunéeftun talon fixe, êc au bout de l’autre efi urt
talon pareil & aufli fixe fur fa branche ; de forte
qu’en tirant une de ces branches, le talon qui y eft
fixé la fuit & s’écarte de l’autre talon, & laifle un
efpace entre les deux qui eft la mefure du pié. La '
couliffe mobile eft marquée par parties égales numérotées;
enforte-que l’ouvrier puiffe retrouver chez
lui le même intervalle entre les deux talons, pour
choifir une forme de même grandeur que le pié de
celui pour qui on fait la chauffure. Voye^ la Planche
du Cordonnier. (D )
C ompas à l’ufage des Ecrivains, c’eft urt compas
ordinaire dont ils fe fervent pour mefurer la hauteur
ou longueur de* lignes, des figures qui renferment
les différens objets d’un é ta t, d’un bordereau, d’un
compte, &c pour fixer l’endroit où l’on doit tracer
chaque figure , afin d ’obferver l’ordre & la proportion.
C ompas à l’ufage des Epingliers. Ces ouvriers
s’en fervent pour tracer la lame d’étain dont ils fe
propofent de faire des plaques. Voye{ Épingl ier.
C ompas à l’ufage des Ferblantiers ; il eft de fer *
& eft fait comme tout autre compas. Il fert aux Fer-1
blantiers pour mefurer, compaffer, marquer des
ronds & des demi-cercles, félon le befoin, fur les
feuilles de fer-blanc qu’ils employent.
C ompas cour be à l’ufage des Guainiers: il eft
fait par en-haut comme le compas droit, & a les deux
branches par en-bas recourbées en - dedans ; il fert
aux Guainiers pour compaffer le diamètre des moules
de leurs ouvrages.
C ompas d r o it à l’ufage des Guainiers. Ce compas
n’a rien de particulier ; il eft de fe r , & fert aux
Guainiers pour mefurer leurs ouvrages.
C ompas , en Horlogerie ; voye%_ Vexplication des
Planches de cet Art. Il y en a de deux efpeces : le premier
A ne différé des compas ordinaires que par fon
arc A qui fert à lui donner plus de folidité : cet arc
a encore un autre avantage, c’eft qu’on peut à vo lonté
le fixer à la jambe N en (errant la vis I ; & par-
là , au moyen de l’écrou D , faire parcourir aux pointes
du compas des diftances très - petites ; parce que
cet écrou tournant dans la jambe M , mais fans aucun
mouvement progreflif, il fait avancer ou reculer
la vis A"qui fait partie de l’arc, & par conféquent
augmente ou diminue la diftance entre les deux pointes.
La plaque Q eft divifée en une efpece de petit
cadran, de façon qu’au moyen d’un index qui eft fur
l’écrou, on peut eftimer en degrés de combien on
l’a tournée. Les vis 5 S fervent comme aux autres
pour ferrer les pointes A P du compas, dont on change
à volonté.
Les Faifeurs d’inftrumens de mathématiques & les
Horlogers s’en fervent beaucoup, fur-tout ceux qui
travaillent en pendule: ce compose n général eft un
des meilleurs.
Le compas B d’acier trempé eft plus en ufage
parmi les Horlogers en petit ou qui travaillent en
montres : ils l’appellent ordinairement compas d'Angleterre
ou compas à reffort. La partie B doit être grande
autant qu’il eft poflible , pour que le reffort en
foit plus liant : la feule infpeâion de la figure fait voir
comme on s’en fert. (T ) .
C ompas d’épaisseur ou Hu it de chiffre
voye{ l'explication des .figures d'Horlogtrie, eft un
compas qui fert à prendre des grandeurs , des épaif-
feurs, ère. On s’en fert dans la pratique de plufieurs
arts, comme dans l’Orfèvrerie,l’Horlogerie , &c.
Les Horlogers s’en fervent beaucoup pour prendre
l’épaiffeur de certaines parties courbées , comme de
la cuvette d’une, boîte de montre, de la virole d’un
barillet, &c. Sa perfe&ion confifte dans la grande
égalité des diftances C E , C B ,C F ,G G qui doivent
être précifément les mêmes, fans quoi on prend de
h
!
1