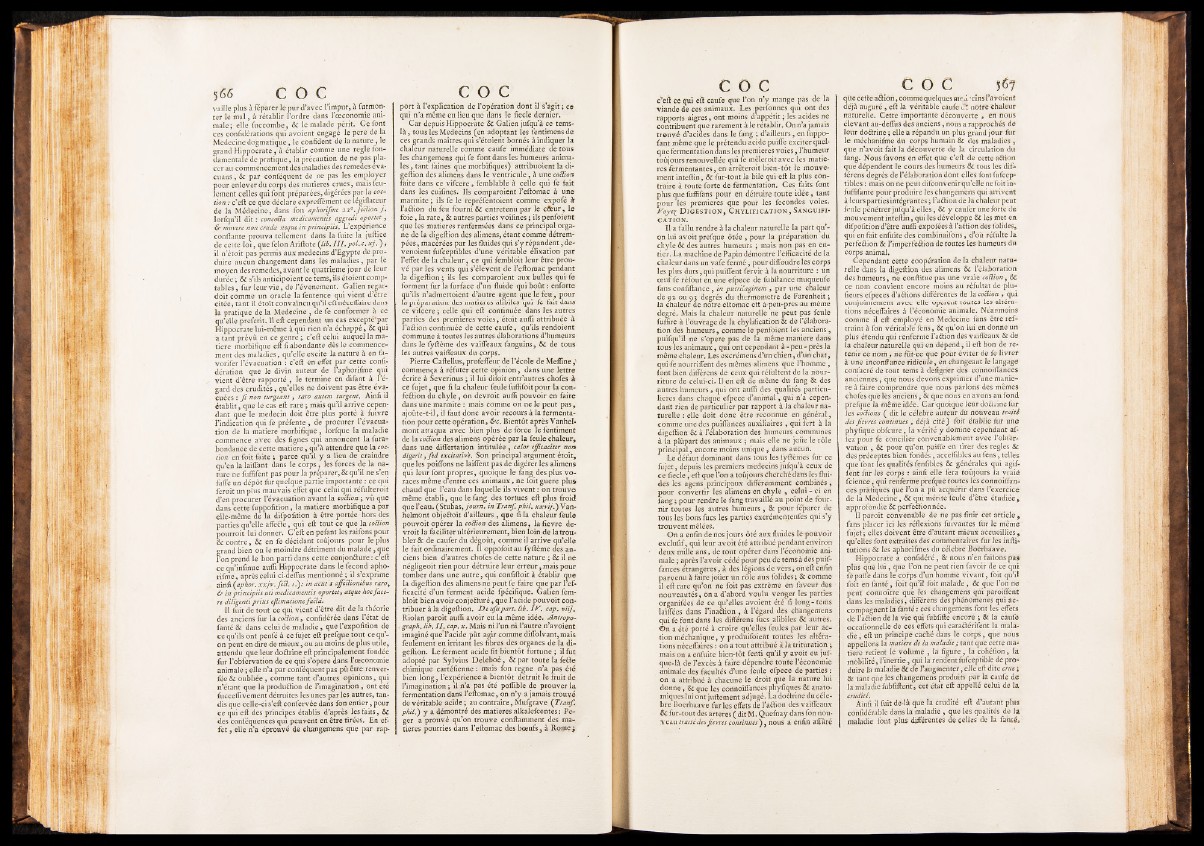
vaille plus à féparer le pur d’avec l’impur, à furmon-
ter le mal, à rétablir l’ordre dans l’oeconomie animale;
elle fuccombe, & le malade périt. Ce font
ces confidé rations qui avoient engagé le pere de la
Medecine dogmatique, le confident de la nature, le
grand Hippocrate , à établir comme une réglé fondamentale
de pratique, la précaution de ne pas placer
au commencement des maladies des remedes é va-
cuans, & par conféquent de ne pas les employer
pour enlever du corps des matières crues, mais feulement
celles qui font préparées, digérées par la coc-
tion : c’eft ce que déclare expreflement ce légiflateur
de la Médecine, dans fon apkorifmc x z e.feciion j .
lorfqu’il dit : concocta medicamentis aggredi oporut,
& movere non cruda neque in principiis. L’expérience
confiante prouva tellement dans la fuite la juftice
de cette lo i, que félon Ariftote (Jib. I I I . pol.c. x j.') ,
il n’étoit pas permis aux médecins d’Egypte de pro-^
duire aucun changement dans les maladies, par le
moyen des remedes, avant le quatrième jour de leur
durée ; 6c s’ils anticipoient ce tems, ils étoient comptables
, fur leur v ie , de l’évenement. Galien regar-
doit comme un oracle la fentence qui vient d’être
citée, tant il étoit convaincu qu’il eft néceffaire dans
la pratique de la Medecine , de fe conformer à ce
qu’elle prefcrit. Il eft cependant un cas excepté*par
Hippocrate lui-même à qui rien n’a échappé, 6c qui
a tant prévu en ce genre ; c’eft celui auquel la matière
morbifique eft fi abondante dès le commencement
des maladies, qu’elle excite la nature à en fa-
vorifer l’évacuation : c’eft en effet par cette confédération
que le divin auteur de l’aphorifme qui
vient d’être rapporté , le termine en difant à l ’égard
des crudités, qu’elles ne doivent pas être évacuées
: f i non turgeant , raro autem turgent. Ainfi il
établit, que le cas eft rare ; mais qu’il arrive cependant
que le médecin doit être plus porté à fuivre
l’indication qui fe préfente, de procurer l’évacuation
de la matière morbifique, lorfque la maladie
commence avec des lignes qui annoncent la fura-
bondance de cette matière, qu’à attendre que la coc-
tion en foit faite ; parce qu’il y a lieu de craindre
qu’en la biffant dans le corps , les forces de la na^
ture ne fuffifent pas pouf la préparer, & qu’il ne s’en
faffe un dépôt fur quelque partie importante : ce qui
feroit un plus mauvais effet que celui qui réfulteroit
d’en procurer l’évacuation avant la cociion ; vu que
dans cette fuppofition, la matière morbifique a par
elle-même de la difpofition à être portée hors des
parties qu’elle affette, qui eft tout ce que la cociion
pourrait lui donner. C ’eft en pefant les raifons pour
& contre, & en fe décidant toujours pour le plus
grand bien ou le moindre détriment du malade, que
l’on prend le bon parti dans cette conjoncture : c’eft
ce qu’infinue aufli Hippocrate dans le fécond apho-
rifme, après celui ci-deffus mentionné ; il s’exprime
. ainfi (apkor. xxjv. fiel, i .); in acut’s affectionibus raro,
& in principiis uti medicamentis oporut, atque hocface-
rc diligenti prius eflimatione facta.
Il fuit de tout ce qui vient d’être dit de la théorie
des anciens fur la cociion, confidérée dans l’état de
fanté & dans celui de maladie, que l’expofition de
ce qu’ils ont penfé à ce fujet eft prefque tout ce qu’on
peut en dire de mieux, ou au moins de plus utile,
attendu que leur doCtrine eft principalement fondée
fur l’obfervation de ce qui s’opère dans l’oeconomie
animale ; elle n’a par conféquent pas pû être renver-
fée 6c oubliée , comme tant d’autres opinions, qui
n’étant que la production de l’imagination, ont été
fucceflivement détruites les unes parles autres, tandis
que celle-ci s’eft confervée dans fon entier, pour
ce qui eft des principes établis d’après les faits, 6c
des conféquences qui peuvent en être tirées. En effet
, elle n’a éprouvé de changemens que par rapport
à l’explication de l’opération dont il s’agit ; ce
qui n’a même eu lieu que dans le fiecle dernier.
Car depuis Hippocrate 6c Galien jufqu’à ce tems-
là , tous les Médecins (en adoptant les fentimens de
ces grands maîtres qui s’étoient bornés à indiquer la
chaleur naturelle comme caufe immédiate de tous
les changemens qui fe font dans les humeurs animales
, tant faines que morbifiques) attribuoient la di-
geftion des alimens dans le ventricule, à une cociion
faite dans ce vifeere, femblablè à celle qui fe fait
dans les cuifines. Ils comparoient l’eftomac à une
marmite ; ils fe le repréfentoient comme expofé àr
l’aétion du feu fourni 6c entretenu par le c&u r, le
foie, la rate, & autres parties voifines ; ils penfoient
que les matières renfermées dans ce principal organe
de la digeftion des alimens, étant comme détrempées,
macérées par les fluides qui s’y répandent, de-
venoient fufceptibles d’une véritable élixation par
l’effet de la chaleur, ce qui fembloit leur être prouv
é par les vents qui s’élèvent de l’eftoraac pendant
la digeftion ; ils les comparoient aux bulles qui fe
forment fur la furface d’un fluide qui boût : enforte
qu’ils n’admettoient d’autre agent que le feu , pour
la préparation des matières àlibiles qui fe fait dans
ce vifeere ; celle qui eft continuée dans les autres
parties des premières voies, étoit aufli attribuée à
l ’aétion continuée de cette caufe, qu’ils rendoient
commune à toutes les autres élaborations d’humeurs
dans le fyftème des vaiffeaux fanguins, 6c de tous
les autres vaiffeaux du corps.
Pierre Caftellus, profeffeur de l ’école de Mefline
commença à réfuter cette opinion, dans une lettre
écrite à Severinus ; il lui difoit entr’autres chofes à
ce fujet, que fi la chaleur feulefufiifoitpour la confection
du ch yle, on devroit aufli pouvoir en faire
dans une marmite : mais comme on ne le peut pas ,
ajoûte-t-il, il faut donc avoir recours à la fermentation
pour cette opération, &c. Bientôt après Vanhel-
mont attaqua avec bien plus de force le fentiment
de la cociion des alimens opérée par la feule chaleur,
dans une differtation intitulée , calor èfficaciter non
digerit y ftd excitativè. Son principal argument étoit,
que les poiffons ne laiffent pas de digérer les alimens
qui leur font propres, quoique le fang des plus voraces
même d’entre ces animaux, ne foit guere plus
chaud que l’eau dans laquelle ils vivent : on trouve
même établi, que le fang des tortues eft plus froid
que l’eau. (Stubas,/<w/z. in Tranf. phil. xxvij.) Van-
helmont objeâoit d’ailleurs , que fi la chaleur feule
pouvoit opérer la cociion des alimens, la fievre devroit
la faciliter ultérieurement, bien loin de la troubler
& de caufer du dégoût, comme il arrive qu’elle
le fait ordinairement. Il oppofoit au fyftème des anciens
bien d’autres chofes de cette nature ; 6c il ne
négligeoit rien pour détruire leur erreur, mais pour
tomber dans une autre, qui confiftoit à établir que
la digeftion des alimens ne peut fe faire que par l’efficacité
d’un ferment acide fpécifique. Galien fembloit
bien avoir conje&uré, que l’acide pouvoit contribuer
à la digeftion. Deufupart. lib. IF . cap. viij.
Riolan paroît aufli avoir eu la même idée. Antropo-
. graph, lib. II. cap. x. Mais ni l’un ni l’autre n’avoient
imaginé que l’acide pût agir comme diffolvant,mais
feulement en irritant les fibres des organes de la digeftion.
Le ferment acide fit bientôt fortune ; il fut
adopté par Sylvius Deleboé, 6c par toute la fette
chimique cartéfienne : mais fon régné n’a pas été
bien long, l’expérience a bientôt détruit le fruit de
^’imagination ; il n’a pas été poflible de prouver la
fermentation dans l’eftomac, on n’y a jamais trouvé
de véritable acide; au contraire, Mufgrave ( Tranf
phil.') y a démontré des matières alkalefcentes : Pe-
ger a prouvé qu’on trouve conftamment des matières
pourries dans l’eftomac des boeufs, à Rome f
C D C
c’eft ce qui eft caufe que l’on n’y mange pas de la
viande de ces animaux. Les . perfonnes qui ont des
rapports aigres, ont moins d’appétit ; les acides ne
contribuent que rarement à le rétablir. On n’a jamais
trouvé d’acides dans le fang ; d’ailleurs, en ftippo-
fant même que le prétendu acide puiffe exciter quelque
fermentation dans les premières voies, l’humeur
toujours renouvellée qui fe mêlerait avec les matières
fermentantes, en arrêteroit bien-tôt le mouvement
inteftin, & fur-tout la bile qui eft la plüs contraire
à toute forte de fermentation. Ces faits font
plus que fuflifans pour en détruire toute id ée, tant
pour lès premières que pour les fécondés voies.
Foyc^ D ig e s t io n , C h y l if ic a t io n ,S anguific
a t io n .
Il a fallu rendre à la chaleur naturelle la part qu’on
lui avoit prefque ôtée y pour la préparation du
chyle & des autres humeurs ; 'mais non .pas en entier.
La machine de Papin démontre l’efficacité de la
chaleur dans un vafe fermé, pour diffoudre les corps
les plus durs, qui puiffent fèrvir à la nourriture : un
ceuf fe réfout en une efpece de fubftance muqueufe
fans confiftance, in putrilagintm , par une chaleur
de 92 ou 93 degrés du thermomètre de Farënheit ;
la chaleur de notre eftomac eft à-peu-près au même
degré. Mais la chaleur naturelle fie peut pas feule
fuffirë à l’Ouvrage de la chylification & de l’élaboration
des humeurs, comme le penfoient les anciens,
puifqu’il ne s’opère pas dè la même maniéré dans
tous les animaux, qui ont cependant à-peu-près la
même chaleur. Les excrémens d’ünchien, d’un chat,
qui fe nourriffent des mêmes alimens qué l’homme j
font bien différens de cëux qui r éfü'ltent de la nourriture
de celui-ci. Il en eft de même dit fang & des
autres humeurs , qui ont aufli des qualités particulières
dans chaque efpece d’animal, qui n’a cependant
rien de particulier par rapport à la chaleur naturelle
: elle doit donc être reconnue eh général,
comme une des puiffances auxiliaires , qui fert à la
digeftion 6c à l’élaboration des humeurs communes
à la plûpart des animaux ; mais elle ne joiie le rôle
principal, encore moins uniqtië, dans aucun.
Le défaut dominant dans toits les lÿftèmes fur ce
fujet, depuis les premiers medècïn's jufqu’à cëux de
ce fiecle, eft que l’on a toujours Cherché dàhs lès fluides
les agens principaux différemment combinés,
pour convertir les alimens en chyle , cèîüi - c i en
fang ; pour rendre le fartg travaillé au point de fournir
toutes les autres humeurs , & pour féparer de
tous les bons fucs les parties êxcrémenteufës qui s’y
trouvent mêlées.
On a enfin de nos jours ôté aux fluides lé-pouvoir
exclufif, qui leur avoit été attribué pendant environ
deux mille ans, de tout opérer dans récohomiè animale
; après l’avoir cédé pour pèu de téms à dès pùif-
fances étrangères , à des légions de Vers, on èft enfin
parvenu à faire joiier un rôle aux félidés ; & comme
il eft rare qu’on ne foit pas extrême en faveur dès
nouveautés, On a d’abord voulu Venger les parties
organifées de ce qu’elles avoient été fi long - tems
laiffées dans l’inaétion , à l’égard dés changemens
qui fe font dans les différens fucS àlibiles 6c autres.
On a été porté à croire qu’elles féulés par leur action
méchanique, y prodüifoient toutes les altérations
néceffaires : on a tout attribué à la trituration ;
mais on a enfuite bien-tôt fenti qu’il y avoit èu juf-
que-là de l’excès à faire dépendre toute l’économie
animale des facultés d’une feule efpece de parties :
on a attribué à chacune le droit que la nature lui
donne, 6c que les connoiffahees phyfiqués 6c anatomiques
lui ont juftement adjugé. La dodtriné du célébré
Boerhaave fur les effets dè l’aCtion des vaiffeaux
6c fur-tout des arteres ( dit M. Quefnay dans fon nouveau
traité des fievres continues ) , nous a enfin affûré
C O C 0Î
qlte cette aCtioh, comme quelques me.â'cînsl’avoient
déjà auguré , eft la véritable caufe ut notre Chaleur
naturelle. Cette importante découverte , en nous
élevant ati-déffus des anciens, nous a rapprochés de
leur doftrine ; elle a répandu un plus grand jour fur
le méchanifriie du corps humain 6c des maladies ,
que n’avoit fait la découverte de la circulation dit
lang. Nous favons en effet qUe c’eft de cette aétiort
que dépendent le cours des humeurs 6c tous les différens
degrés de l’élaboration dont elles font fufcepi
tibles : mais on ne peut difeonvenir qu’elle ne foit ina
fuflifanre pour produire les changemens qui arrivent
à leurs parties intégrantes; l’aCtion de la chaleur peut
feule pénétrer jufqu’à elles, & y caufer une forte de
mouvement inteftin, qüi les développe 6c les met en
difpofition d’être aufli expofées à l’adtion des folidës,
qui en fait enfuite des combinaifohs, d’où réfiilte la
perfection & l’imperfedtion de toutes les humeurs du
corps animal.
Cependant cette coopération de la chaleur natu-*
relie dans la digeftion des alimens 6c l’élaboration
des humeurs, në conftituepas une vraie cociion, 6c
ce nom convient encore moins au réfultat de plu-
fieurs efpeces d’adtions différentes de la cociion, qui
conjointement avec elle opèrent toutes les altérations
néceffairës à l’économie animale. Néanmoins
comme il eft employé en Medecine fans être ref-
traint à fon véritable fëfis, 6c qu’on lui en donne un
plus étendu qtii renfermé l’aCtion dés vaiffeaux & de
la chaleùr naturelle qüi en dépend, il eft bon de retenir
ce nom , ne fut-ce que poür éviter de fe livrer
à' une inconftance ridicule, en changeant le langage
confâcré de tout tems à defigrier des cohnoiflances
anciennes ; que nous devons exprimer d’une maniéré
à faire comprendre quë nous parlons des mêmes
chofès quê lès anciens, & que nous en avons au fond
prefque la même idéê. Car quoique leur doCtrine fur
les collions ( dit le célèbre aufetrr dû nouveau traité
dés fièvres continues , déjà cité) foit établie fur une
phyfique obfcurè, là vérité y domine cependant af-
fez pour fè concilier convenablement avec l’obfêr-
vatiOn , & pour qu’on puiffe en tirer des réglés 6c
des préceptes bien fondés, acceffibles au fens, telles
que font les qualités fenfibles & générales qui agif-
fent fui- les corps : ainfi elle fera toûjours la vraie
fcience, qui renferme prefqûè toutes les connoilfan-
cés pratiqués qué l’on a pû acquérir dans l’exercice
de la Médecine, 6c qui mérite feule d’être étudiée,
approfondie 6c perfectionnée.
Il paroît convenable de ne pas finir cet article »
fans placer ici les réflexions fiiivahtès lut le même
fujet ; elles doivent être d’autant mieux accueillies ,
qu’ellès font extraites des commentaires fur les infti-
tutioris 6c les aphôrifmes du célébré Boerhàavei
Hippocrate a confidéré, & nous n’en faifôns pas
plus que lu i, que l’on ne peut rien favoif de ce qui
fé paire dans le corps d’un homme vivant, foit qu’il
foit en fanté , foit. qu’il foit malade, & que l’on ne
peut con’noître que les changemens qüi paroiffènt
dans les maladies, différens des phénomènes qui accompagnent
la fàhté : ces changemens font les effets
de l’aétiort dè la vie qui fubfifte encore ; & la Càufe
occafionnelle de ces effets qui caraôérifent la maladie
eft un principe caché dans lé corps, qué nous
appelions la matière de la maladie ; tant que cette matière
retient le volume , la figure, la cohéfion, la
mobilité, l’inertie, qui la rendentfufcèptible de produire
la maladie & de l’augmènter, elle eft dite crue ;
& tant qùé les changemens produits par la caufe de
la maladie fubfiftent, cet état eft appfellë celui de la
crudité,
Ainfi il fuit dè-là que la crudité eft d’autant pliis
confidérable dans la1 maladie , que les qualités dé la
maladie font plus différentes de celles de là fahtéi