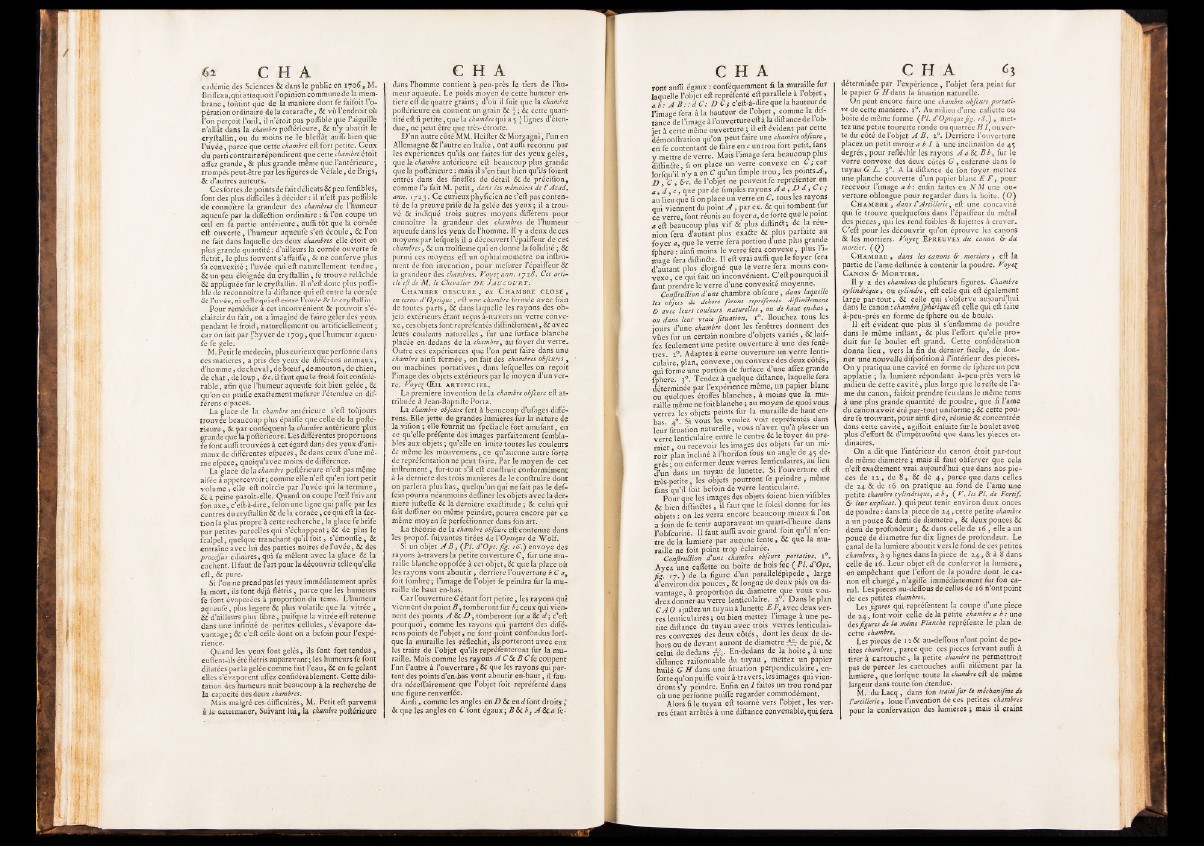
'cadëmïe des Sciences & dans le public eft 1706., M.
Briffeau,qtiî attaquoit l’opinion commune de la membrane
, loâtint que de la maniéré dont fe faifoit l’opération
ordinaire de la catarafte, & vu l’endroit où
l ’on perçoit l’oeil, il n’étoit pas poffible que l’aiguille
n’allât dans la chambre poftérieure, & n’y abattît le
■ eryftallin, ou du moins ne le bleffât auffi bien que
l ’u vé e, parce que cette chambre eft fort petite. Ceux
«du parti contraire répondirent que cette chambre étoit
.affez grande, & plus grande meme que l’antérieure,
trompés peut-être par les figures de Véfale, de Brigs,
& d’autres auteurs.
•Ces fortesvde points de fait délicats & peu fenfibles,
font des plus difficiles à décider : il n’eft pas poffible
‘de connoître la grandeur des chambres de l’humeur
aqueufe par la diffeôion ordinaire : fi l’on coupe un
oe il en fa partie antérieure, auffi-rôt que la cornée
«fl ouverte, l’humeur aqueufe s’en écoule, & l’on
ne fait dans laquelle des deux chambres elle étoit en
plus grande quantité : d’ailleurs la cornée ouverte fe
flétrit, le plus fouvent s’affaiffe, & ne conferve plus
fa convexité ; l’Uvée qui eft naturellement tendue,
& un peu éloignée du eryftallin, fe trouve relâchée
& appliquée fur le eryftallin. Il n’eft donc plus poflible
de reconnoître la diftance qui eft entre la cornée
& I’u vée, ni celle qui eft entre l’uvée & le eryftallin.
Pour remédier a cet inconvénient & pouvoir s’éclaircir
du fait, on a imaginé de faire geler des yeux
pendant le froid, naturellement ou artificiellement ;
car on fait par •l’hyver de 1709, que l’humeur aqueufe
fe gele.
M. Petit le médecin, plus curieux que perfonne dan s
ces matières, a pris des yeux de différens animaux,
d’homme, de cheval, de boeuf, de mouton, de chien,
de chat, de loup, Oc. il faut que le froid foit confidé-
rable, afin que l’humeur aqueufe foit bien gelée, &
qu’on en puiffe exactement mefurer l’étendue en différens
efpaces.
La glace de la chambre antérieure s’eft toujours
trouvée beaucoup plus épaiffe que celle de la poftérieure,
& par conféquent la chambre antérieure plus
grande que la poftérieurè. Les différentes proportions
fe font auffi trouvées à cet égard dans des yeux d’animaux
de différentes efpeces, & dans ceux d’uqe même
efpece, quoiqu’avec moins de différence.
La glace de la chambre poftérieure n’eft pas même
aifée à appercevoir ; comme elle n’eft qu’en fort petit
volume, elle eft noircie par l’uvée qui la termine,
& à peine paroît-elle. Quand on coupe l’oeil fuivant
fon axe , c’eft-à-dire, félon une ligne quipaffe par les
centres du eryftallin & de la cornée, ce qui eft la fec-
tion la plus propre'à cette recherche, la glace fe brife
par petites parcelles qui s’échappent; &c de plus le
icalpel, quelque tranchant qu’il foit, s’émouffe, &
entraîne avec lui des parties noires del’uvée, & des
procejfus ciliaires, qui fe mêlent avec la glace & la
cachent. Il faut de l’art pour la découvrir telle qu’elle
e f t , & pure. # ?
Si Ton ne prend pas les yeux immédiatement après
la mort, ils font déjà flétris, parce que les humeurs
fe font évaporées à proportion du tems. L’humeur
aqueufe, plus legere & plus volatile que la vitrée ,
& d’ailleurs plus libre, puifque la vitrée eft retenue
dans une infinité de petites cellules, s’évapore davantage
; & c’eft celle dont on a befoin pour l’expérience.
Quand les yeux font gelés, ils font fort tendus ,
euffent-ils été flétris auparavant ; les humeurs fe font
dilatées par la gelée comme fait l’eau, & en fe gelant
elles s’évaporent affez confidérablement. Cette dilatation
des humeurs nuit beaucoup à la recherche de
la capacité des deux chambres.
Mais malgré ces difficultés, M. Petit eft parvenu
à la ücierriuner. Suivant lui # la çhambre poftérieure
dans l’homme contient à-peu-près le tiers de l’humeur
aqueufe. Le poids moyen de cette humeur entière
eft de quatre grains ; d’où il fuit que la chambre
poftérieure en contient un grain & ÿ ; & cette quantité
eft fi petite, que la chambre qui a 5 { lignes d’étendue,
ne peut être que très-étroite.
D ’un autre côté MM. Heifter & Morgagni, l’un en
Allemagne & l’autre en Italie, ont auffi reconnu par
les expériences qu’ils ont faites fur des yeux gelés,
que la chambre antérieure eft beaucoup plus grande
que la poftérieure : mais il s’en faut bien qu’ils foient
entrés dans des fineffes de détail & de précifion,
comme l’a fait M. petit, dans les mémoires de VAcad,
ann. 7723. Ce curieux phyficien ne s’ eft pas.conten-
té de la preuve prife de la gelée des yeux ; il a trouv
é & indiqué trois autres moyens différens poiir
connoître la grandeur des chambres de. l’humeur
aqueufe dans les yeux de l’homme. Il y a deux de ces
moyens par lefquels il a découvert l’épaiffeur de ces
chambres, & un troifieme qui en donne la folidité ; &C
parmi ces moyens eft un ophtalmometre ou inftru-
ment de fon invention, pour mefurer l’épaiffeur &
la grandeur des chambres. Voye^ann. tjz.8, Cet article
eft de M. le Chevalier D E J A V C O U R T .
C hambre o b s c u r e , ou C hambre c l o s e ,
en terme d'Optique, eft une chambre fermée avec foin
de toutes parts, dans laquelle les rayons des objets
extérieurs étant reçus à-travers un verre convex
e , ces objets fontxepréfentés diftin&ement, & avec
leurs couleurs naturelles , fur une fur face blanche
placée en-dedans de la chambre, au foyer du verre.
Outre ces expériences que l’on peut faire dans une
chambre ainfi fermée, on fait des chambres obfcures ,
ou machines portatives, dans lefquelles on reçoit
l’image des objets extérieurs par le moyen d’un verre.
Voye^ÇSAL ARTIFICIEL.
La première invention de la chambre obfcure eft attribuée
à Jean-Baptifte Porta.
La chambre obfcurefert à beaucoup d’ufages différens.
Elle jette de grandes lumières fur la nature de
la yifion ; elle fournit un fpeftacle fort amufant, en
ce qu’elle préfente des images parfaitement fembla-
bles aux objets ; qu’elle en imite toutes les couleurs
de même les mouvemens, ce qu’aucune autre forte
de repréfentation ne peut faire. Par le moyen de cet
inftrument, fur-tout s’il eft conftruit conformément
à la derniere des trois maniérés de le Conftruire dont
on parlera plus bas, quelqu’un qui ne fait pas le defi-
fein pourra néanmoins deffiner les objets avec la derniere
jufteffe & là derniere exa&itude ; & celui qui
fait deffiner ou même peindre, pourra encore par ce
même moyen fe perfectionner dans fon art.
La théorie de la chambre obfcure eft contenue dans
les propof. fuivantes tirées de Y Optique de Wolf.
■ Si un objet A B , (PL d’Opt.fig. /(T.) envoyé des
rayons .à-travers la petite ouverture C, fur une muraille
blanche oppofée à cet objet, & que la place où
les rayons vont aboutir, derrière l’ouverture b C a,
foit fombre ; l’image de l’objet fe peindra fur la mu-,
raille dè haut en-bas.
Car l’ouverture C étant fort petite, les rayons qui
viennent du point B , tomberont fur b; ceux qui viennent
des points A & D , tomberont fur a & d; c’eft
pourquoi , comme les rayons qui partent des différens
points de l’objet, ne font point confondus lorf-
que la muraille les réfléchit, ils porteront avec eux
les traits de l’objet qu’ils repréfenteront fur la muraille.
Mais comme les rayons A C Oc B C fe coupent
l’un l’autre à l’ouverture, & que les rayons qui partent
des pointsd’en-bas vont aboutir en-haut, il faudra
néceffairement que l’objet foit repréfenté dans
une figure renverfée.
Ainfi, comme les angles en D & en d font droits
& que les angles en C font égaux; B Oc b, A de a fis
font auffi égaux : conféepemment fi la muraille fur
laquelle l’objet eft reprélenté eft parallèle à l’o b jet,
a b : A E : : d C : D C; c’eft-à-dire que la hauteur de
i’iniage fera à la hauteur de l’objet, comme H
tance de l’image àl’ouvqrture eftà la diftance de 1 objet
à cette même ouverture ; il eft évident par cette
démonftration qu’on peut faire une chambre obfcure,
en fe contentant de faire en c un trou fort petit, tans
y mettre de verre. Mais l’image fera beaucoup plus
diftinae, fi on place un verre convexe en C ; car
lorfqu’il n’y a en C qu’un fimple trou, les points.* ,
D , C , &c. de l ’objet ne peuvent fe repréfenter en
a ' d , c , que par de fimples rayons A a ,D d , C e ;
ait lieu que fi on place un verre en C, tous les rayons
qui viennent du point A , par ex. & qui tombent fur
ce verre, font réunis au foyer a, de forte quele point
a eft beaucoup plus v i f & plus diftintt ; & la réunion
fera d’autant plus exatte & plus parfaite au
foyer a, que le verre fera portion d’une, plus grande
fphere : ainfi moins le verre fera convexe, plus 11-
mage fera diftinae. Il eft vrai aufli que le foyer fera
d’autant plus éloigné que le verre fera moins conv
e x e , ce qui fait un inconvénient. C ’eft pourquoul
faut prendre le verre d’une convexité moyenne.
ConftriiSion d’une chambre obfcure, dans laquelle
les objets de dehors feront repréfenlis diJIinScmcnt
& avec leurs couleurs naturelles, ou de haut çn-bas ,
ou dans leur vraie fituation, 1°. Bouchez tous M
jours d’une chambre dont les fenêtres donnent des
vues fur un certain nombre d’objets varies , & laif-
fez feulement une petite ouverture à une des fenêtres.
z°. Adaptez à cette ouverture un verre lenticulaire,
plan, convexe, ou convexe des deux côtés,
qui forme une portion de furface d’une affez grande
fphere. 3°. Tendez à quelque diftance, laquelle fera
déterminée par l’expérience même, un papier blanc
Ou quelques étoffes blanches, à moins que la muraille
même ne foitblanche ; au moyen de quoi vous
verrez'les objets peints fur la muraille d é fa u t en-
bas 40 Si vous les voulez voir repréfentés dans
leur fituation naturelle, vous n’avez qu’à placer un
Verre lenticulaire entre le centre 8c le foyer du premier
ou recevoir les images des objets fur un miroir
plan incliné à l ’horifon fous un angle de 45 deT
grés H enfermer deux verres lenticulaires, au heu
ï u n ’ dans un tuyau de lunette. Si l’ouverture^ eft
très-petite, les objets pourront fe peindre, meme
fans qu’il foit befoin de verre lenticulaire.- - _
Pour que les images des objets foient bien vifibles
& bien diftinaes, il faut que le foleil donne fur les
objets : on les verra encore beaucoup mieux fi l’on
a foin de fe tenir auparavant un quart-d’heure dans
l’obfcurité. Il faut auffi avoir grand foin qu’il n’entre
de la lumière par aucune fente, 8c que la muraille
ne foit point trop éclairée.__ ; .
ConftruBion dune chambre obfçurç portative. 1 .
A yez une caffetfe ou boîte de boivfee ( PI. d'Opt.
fiS- B ) de la figure d’un para llélépipèdelarge
d’environ dix pouces, 8c longue de dejix piés ou davantage,
à proportion du diamètre que vous voudrez
donner au verre lenticulaire. l° . Dans le plan
C A O ajuftez pn tuyau à lunette E F , avec deux verres
lenticulaires ; ou bien mettez l’image à ünè petite
diftance du tuyau avec trois verfes lenticulaires
convexes des deux côtés, dont lès deux de dehors
ou de devant auront de diamètre,— de pié, 8c
celui de dedans f^ . En-dedans de la boîte, à une
diftance raifonnâble du tuyau , mettez un papier
huilé G H dans une fituation perpendiculaire, en-
forte qu’on puiffe voir à-travers, les images qui viendront
s’y peindre. Enfin en / faites un trou rond par
ob une perfonne puiffe regarder commodément.
Alors fi le tuyau eft tourné vers l’objet, les verres
étant arrêtés à une diftance convenable, qui fera
déterminée pàr l’expérience, l’objet fera peint fur
le papier G H dans la fituation naturelle.
On peut encore faire une chambre obfcure portative
de cette maniéré. i° . Au milieu d’une caffette ou
boîte de même forme (PL d-'Optique fig. /<?.), mettez
une petite tourette ronde ou quarrée H /, ouverte
du côté de l’objet A B. x°. Derrière l’ouverture
placez un petit miroir a b I à ime inclinaifon de 45
degrés, pour réfléchir les rayons A a & B b f fur le
verre convexe des deux côtés G , enfermé dans le
tuyau G L. 30. A la diftance de fon foyer mettez
une planche couverte d’un papier blanc E F , pour
recevoir l’image a b: enfin faite? en N M une ouverture
oblongue pour regarder dans la boîte. (O )
C h am b r e , dans C Artillerie, eft une concavité
qui fe trouve quelquefois dans l’épaiffeur du métal
des pièces, qui les rend foibles & fujettes à crever.
C ’eft pour les découvrir qu’on éprouve les canons
& les mortiers, f^oye^ Épreuves du canon & du
mortier. (Q )
C hambre , dans les canons & mortiers , eft la
partie de l’ame deftinée à contenir la poudre. V?ye£
C anon & Mo r t ie r .
Il y a des chambres de plufieurs figures. Chambre
cylindrique , ou cylindre, eft celle qui eft également
large par-tout, & celle qui s’obferve aujourd’hui
dans le canon : chambre fpherique eft celle qui eft faite
à-peu-près en forme de fphere ou de boule.
Il eft évident que plus il s ’enflamme de poudre
dans le même inftant, & plus l’effort qu’elle produit
fur le boulet eft grand. Cette confidération
donna lieu , vers la fin du dernier fiecle, de donner
une nouvelle difpofition à l’intérieur des pièces.
On y pratiqua une cavité en forme de fphere un peu
applatie ; la lu^mere répondant à-peu-près vers le
milieu de cette cavité, plus large que le refte de l’ame
du canon, faifoit prendre feu dans le même tems
à une plus grande quantité de poudre, que fi l’ame
du canon avoit été par-tout uniforme ; & cette poudre
fe trouvant, pour ainfi dire, réunie & concentrée
dans cette ca vité, agiffoit enfuite fur le boulet avec
plus d’effort ôc à’impétuofité que dans les pièces ordinaires.
On a dit que l’intérieur du canon étoit par-tout
de même diamètre ; mais il faut obferver que cela
n’eft exactement vrai aujourd’hui que dans nos pièces
de 1 z , de 8 , & de 4 , parce que dans celles
de 24 & de 16 on pratique au fond de l ’ame une
petite chambre cylindrique, a b, ( F . les PL de Fortif.
& leur explicat. ) qui peut tenir environ deux onces
de poudre : dans la piece de 24, cette petite chambre
a un pouce & demi de diamètre, & deux pouces &
demi de profondeur ; & dans celle de 16 , elle a un
pouce de diamètre fur dix lignes de profondeur. Le
canal de la lumière aboutit vers le fond de ces petites
chambres:, à 9 lignes dans la piece de 24, & à 8 dans
celle de 16. Leur objet eft de conferver la lumière,
-en empêchant que l’effort de la poudre dont le canon
eft chargé, n’agiffe immédiatement fur fon canal.
Les pièces au-deffous de celles de 16 n’ont point
de ces petites chambres.
Les figures qui repréfentent la coupe d’une piece
de 24, font voir celle de la petite chambre a b: une
des figures de la même Planche repréfente le plan de
cette chambre.
Les pièces de 12 & au-deffous n’ont point de petites
chambres, parce que ces pièces fervant auffi à
tirer à cartouche, la petite chambre ne permettroit
pas de percer les cartouches auffi aifément par la
lumière, que lorfque toute la chambre eft de même
largeur dans toute fon étendue. ^
M. du Lacq , dans fon traité fur le méchanlfme de
l'artillerie, loue l’invention de ces petites chambres
pour la confervation des lumières ; mais il craint