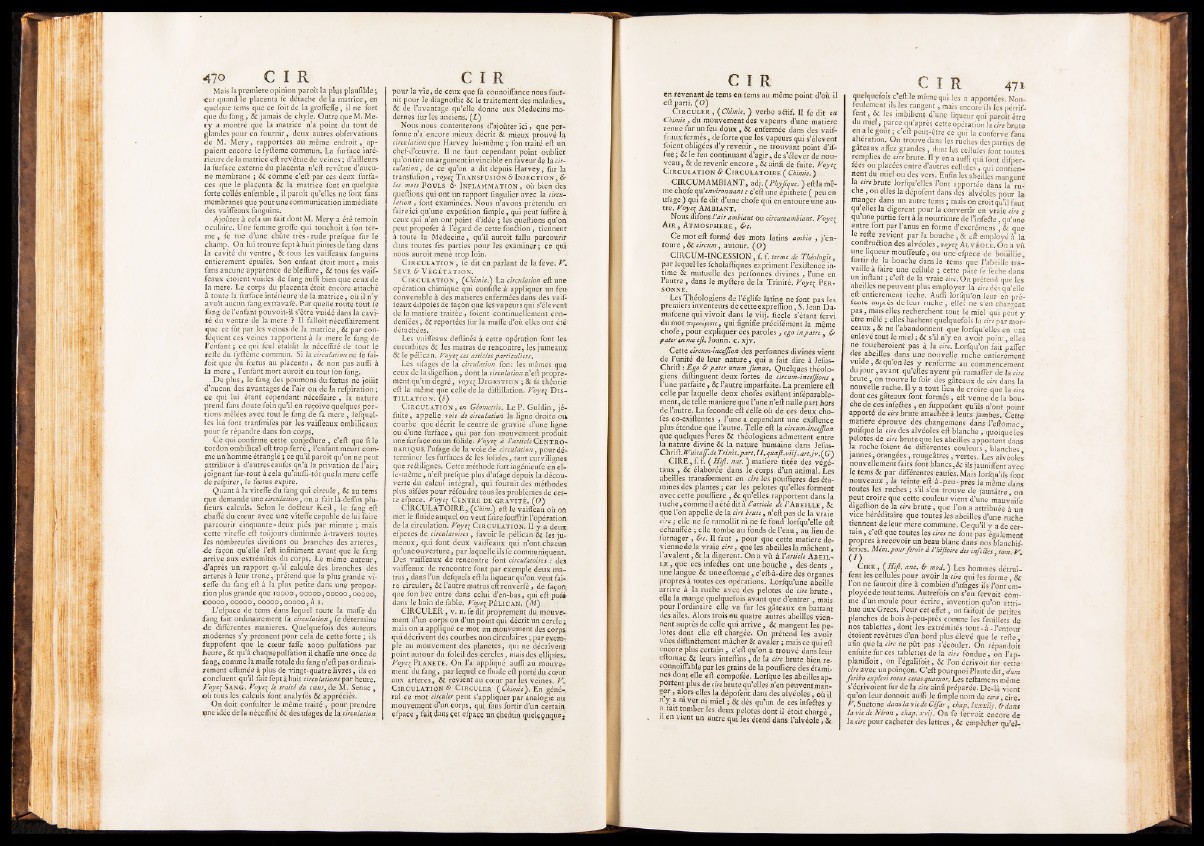
Mais la première opinion paroît la plus plaulible ;
*:ar quand le placenta fe détache de la matrice, en
quelque tems que ce foit de la groffeffe, il ne fort
que du fang, 8c jamais de chyle. Outre que M. Me-
r y a montré que la matrice n’a point au tout de
glandes pour en fournir, deux autres obfervations
(de M. Mery, rapportées au même endroit, appuient
encore le fyftème commun. La furface intérieure
de la matrice eft revêtue de veines ; d’ailleurs
la furface externe du placenta n’eft revêtue d’aucune
membrane ; 8c comme c’eft par ces deux furfa-
ces que le placenta 8c la matrice font en quelque
forte collés enfemble, il paroît qu’elles ne font fans
membranes que pour une communication immédiate
des vaiffeaux fanguins.
Ajoutez à cela un fait dont M. Mery a été témoin
oculaire. Une femme grolfe qui touchoit à fon terme
, fe tue d’une chute très - rude prefque fur le
champ. On lui trouve fept à huit pintes de fang dans
la cavité du ventre, & tous les vaiffeaux fanguins
entièrement épuifés. Son enfant étoit mort, mais
fans aucune apparence de bleffure, & tous fes vaiffeaux
étoient vuides de fang auffi bien que ceux de
la mere. Le corps du placenta étoit encore attaché
à toute la furface intérieure de la matrice, où il n’y
avoit aucun fang extravafé. Par quelle route tout le
fang de l’enfant pouvoit-il s’être vuidé dans la cavité
du ventre de la mere ? Il falloit nécessairement
que ce fut par les veines de la matrice, 8c par conséquent
ces veines rapportent à la mere le fang de
l ’enfant ; ce qui feul établit la néceffité de tout le
rcffe du fyftème commun. Si la circulation ne fe fai-
foit que du foetus au placenta, & non pas auffi à
la mere, l’enfant mort auroit eu tout fon fang.
De plus, le fang des poumons du foetus ne joiiit
d’aucun des avantages de l’air ou de la refpiration ;
c e qui lui étant cependant néceffaire , la nature.
prend fans doute foin qu’il en reçoive quelques portions
mêlées avec tout le fang de fa mere, lefqueh
les lui font tranfmifes par les vaiffeaux ombilicaux
pour fe répandre dans fon corps.
Ce qui confirme cette conjefture , c’eft que fi le
Cordon ombilical eft trop ferré, l’enfant meurt comme
un homme étranglé ; ce qu’il paroît qu’on ne peut
attribuer à d’autres caufes qn’à la privation de l’air;
joignant fur-tout à cela qu’auffi-tôrquela mere ceffe
de relpirer, le foetus expire.
Quant à la vîteffe du fang qui circule, 8c au teins
que demande une circulation, on a faitlà-deffus plusieurs
calculs. Selon le dofteur K e i l , le fang eft
chaffe du coeur avec une vîteffe capable de lui faire
parcourir cinquante-deux piés par minute ; mais
cette vîteffe eft toujours diminuée à-travers toutes
les nombreufes divifions ou branches des arteres,
d e façon qu’elle l’eft infiniment avant que le fang
arrive aux extrémités du corps. Le même auteur,
d ’après un rapport qu’il calcule des branches des
arteres à leur tronc, prétend que la plus grande v îteffe
du fang eft à la plus petite dans une proportion
plus grande que io o o o , ooooo, ooooo, ooooo,.
©oooo, ooooo, ooooo, ooooo, à i .
L’efpace de tems dans lequel toute la maffe du
fang fait ordinairement fa circulation, fe détermine
de différentes maniérés. Quelquefois des auteurs
modernes s’y prennent pour cela de cette forte ; ils
jfuppofent que le coeur faffe zooo pulfations par
heure, 8c qu’à chaquepulfation il chaffe une once de
fang, comme la maffe totale du fang n’eft pas ordinairement
eftimée à plus de vingt-quatre livrés, ils en
concluent qu’il fait fept à huit circulations par heure.
Voye[ Sa n g . Voytç le traité du coeur9 de M. Senac ,
©ù tous les calculs font analyfés 8c appréciés.
On doit confulter le même traité , pour prendre
$ne idée delà néceffité 8c désufages de la circulation
pour la v ie , de ceux que fa connoiffance nous fournit
pour le diagnoftic 8c le traitement des maladies,
8c de l’avantage qu’elle donne aux Médecins modernes
fur les anciens. (£)
Nous nous contenterons d’ajouter ic i, que per-
fonne n’a encore mieux décrit & mieux prouvé la
circulation que Harvey lui-même ; fon traité eft un
chef-d’oeuvre. Il ne faut cependant point oublier
qu’on tire un argument invincible en faveur de la circulation
, de ce qu’on a dit depuis Harvey, fur la
transfufion, voye^ T ransfusion & Inject io n , &
les mots Pouls & Infl am m at ion , où bien des
queftions qui ont un rapport fingulier avec la circulation
, font examinées. Nous n’avons prétendu en
faire ici qu’une expofition fimple, qui peut fuffire à
ceux qui n’en ont point d’idée ; les queftions qu’on
peut propofer à l’égard de cette fonction, tiennent
à toute la Medecine, qu’il auroit ■ fallu parcourir
dans toutes fes parties pour les examiner; ce qui
nous auroit mené trop loin.
C ir c u l a t io n , fe dit en parlant de la feve. V «
Seve & V é g é t a t io n .
C ir c u l a t io n , (Chimie.) La circulation eft une
opération chimique qui conîifte à appliquer un feu>
convenable à des matières enfermées dans des vaiffeaux
difpofés de façon que les vapeurs qui s’élèvent
de la matière traitée, foient continuellement con-
denfées, 8c reportées fur la maffe d’où elles ont été
détachées.
Les vaiffeaux deftinés à cette opération font les
cucurbites 8c les matras de rencontre, les jumeaux
8c le pélican. Voye^ ces articles particuliers.
Les ufages de la circulation font les mêmes que
ceux de laaigeftion, dont la circulation n’eft proprement
qu’un degré, voye^ D igest ion ; 8c fa théorie
eft la même, que celle de la diftiilation. Voye{ D ist
il l a t io n . (b)
C ir c u l a t io n , en Géométrie. Le P. Guldin, jé-
fuite, appelle voie de circulation la ligne droite ou
courbe que décrit le centre de gravité d’une ligne,
ou d’une furface , qui par fon mouvement produit
une furface ou un folide. Voye{ à P article Ç en tro -»
bariquè l’ufage de la voie de circulation, pour déterminer
les furfaces 8c les folides, tant curvilignes
que re&ilignes. Cette méthode fort ingénieufe en elle
même , n’eft prefque plus d’ufage depuis la découverte
du calcul intégral, qui fournit des méthodes
plus aifées pour réfoudre tous les problèmes de cette
efpece. Voye^ C entre de g r a v it é . (O)
CIRCULATOIRE,JChim,) eft le vaiffeaù où on
met le fluide auquel on veut faire fouffrir l’opération
de la circulation. Voye^ C ir c u l a t io n . II y a deux
efpeces de circulatoires, favoir le pélican 8c les jumeaux,
qui font deux vaiffeaux qui n’ont chacun
qu’une ouverture, par laquelle ils fe communiquent.
Des vaiffeaux de rencontre font circulatoires : des.
vaiffeaux de rencontre font par exemple deux matras
, dans l’un defquels eft la liqueur qu’on veut faire
circuler, 8c l’autre matras eft renverfé, de façon
que fon bec entre dans celui d’en-bas, qui eft pof4
dans le bain de fable. Vqye^ Pé l ic a n . (M)
CIRCULER, v . n, fe dit proprement du mouvement
d’un corps ou d’un point qui décrit un .cercle ;
mais on a appliqué ce mot au mouvement des corps
qui décrivent des courbes non circulaires ; par exemple
au mouvement des planètes, qui ne décrivent
point autour du foleil des cercles, mais des ellipfes.
Voye^ Plane te. On l’a appliqué auffi au mouvement
du fang, par lequel ce fluide eft porté du coeur
aux arteres, 8c revient au coeur par les veines. V.t
C ir cu la t io n & C irculer ( Chimie). En géné-1
ral ce mot circuler peut s’appliquer par analogie au
mouvement d’un corps, qui, fans fortir d’un certain
efpace ? f«ûç dans çet efpaçeun chemin quelconque 2
en revenant de tems en tems au même point d’où il
eft parti. (O)
C irculer , ( Chimie. ) verbe aâif. Il fe dit en
Chimie, du mouvement des vapeurs d’une matière
tenue fur un feu doux, 8c enfermée dans des vaiffeaux
fermés, de forte que les vapeurs qui s’élèvent
foient obligées d’y revenir, ne trouvant point d’if-
fue ; 8c le feu continuant d’agir, de s’élever de nouveau,
& de revenir encore, 8c ainfi de fuite. Voye^
C ir c u l a t io n & C ir cu la to ir e ( Chimie. ') ,■
CIRCUMAMBIANT, adj. ( Phyjîque. ) eft la même
chofe qu’environnant : c ’eft une épithete ( peu en
ufage ) qui fe dit d’une chofe qui en entoure une autre.
Voye{ Am b ian t .
Nous difons l'air ambiant ou circumambiant, Voyeç
A i r , A tm osphère , &c>
C e mot eft formé des mots latins ambio , j’entoure
, 8c circüm, autour. (O )
CIRCUM-INCESSION, f. f. terme de "Théologie,
par lequel les fcholaftiques expriment l’exiftence intime
& mutuelle des perfonnes divines , l’une en
l’autre , dans le myftere de la Trinité. Voye{ Person
ne.
Les Théologiens de l’églife latine ne font pas les
premiers inventeurs de cette expreffion, S Jean Da-
mafeene qui vivoit dans le viij. fiecle s’étant fervi
du mot mp/Kisptffiç 9 qui fignifie précifément la même
chofe, pour expliquer ces paroles , ego in pâtre , &
pater in me ejl, Joann. c. xj v.
Cette circum-incejjion des perfonnes divines vient
de l’unité de leur nature, qui a fait dire à Jefus-
Chrift : Ego & pater unumfumus. Quelques théologiens
diftinguent deux fortes de circum-incejjîons ,
l ’une parfaite , 8c l’autre imparfaite. La première eft
celle par laquelle deux chofes exiftent inféparable-
ment, de telle maniéré que l ’une n’eft nulle part hors
de l’autre. La fécondé eft celle où de ces deux chofes
co-exiftentes , l’une a cependant une exiftence
plus étendue que l’autre. Telle eft la circum-incejjion
que quelques Peres 8c théologiens admettent entre
la nature divine 8c la nature humaine dans Jefus-
Chrift. Wuitajf.de Trinit.part.il. quoejl.viij. art.jv.ÇG)
CIRE , f. f. ( Hijl. nat. ) matière tirée des végétaux
, 8c élaborée dans le corps d’un animal. Les
abeilles transforment en cire les pouffieres des étamines
des plantes ; car les pelotes qu’elles forment
avec cette pouffiere , 8c qu’elles rapportent dans la
ruche, comme il a été dit à T article de /’A be ille , 8c
que l’on appelle de la cire brute, n’eft pas de la vraie
cire ; elle ne fe ramollit ni ne fe fond lorfqu’elle ëft
échauffée ; elle tombe au fonds de l’eau, au lieu de
furnager , &c. Il faut , pour que cette matière devienne
de la vraie cire, que les abeilles la mâchent,
l’avalent, & la digèrent. On a vu à Varticle A be ille
, que ces infe&es ont une bouche , des dents ,
une langue 8c uneeftomac, c’eft-à-dire des organes
propres à toutes ces opérations. Lorfqu’une abeille
arrive à la ruche avec des pelotes de cire brute,
elle la mange quelquefois avant que d’entrer , mais
pour l’ordinaire elle va fur les gât.eaux en battant
des aîles. Alors trois ©u quatre autres abeilles viennent
auprès de celle qui arrive, 8c mangent les pelotes
dont elle eft chargée. On prétend les avoir
vues diftin&ement mâcher & avaler ; mais ce qui eft
encore plus certain, c’eft qu’on a trouvé dans leur
eftomac 8c leurs inteftins , de la cire brute bien re-
connoiffable par les grains de la pouffiere des étamines
dont elle eft compofée. Lorfque les abeilles apportent
plus de cire brute qu’elles n’en peuvent manger
, alors elles la dépofent dans des a lvéolés, où il
n y a m ver ni miel ; 8c dès qu’un de ces infeftes y
a tait tomber les deux pelotes dont il étoit chargé,
u en vient un autre qui les étend dans l’alvéole, 8c
quelquefois c ’eft le même qui les a apportées. Non-
leulement ils les rangent, mais encore ils les pétrifient,
6c les imbibent d’une liqueur qui paroît être
du miel, parce qu’après cette opération la cire brute
en a le goût ; c’eft peut-être ce qui la conferve fans
alteration. On trouve dans les ruches des parties de
gâteaux affez grandes , dont les cellules font tontes
remplies de cire brute. Il y en a auffi qui font difper-
lees ou placées entre d’autres cellules, qui contiennent
du miel ou des vers. Enfin les abeilles mangent
la cire brute lorfqu’elles l’ont apportée dans la ruche
, ou elles la dépofent dans des alvéoles pour la
manger dans un autre tems ; mais on croit qu’il faut
qu’elles la digèrent pour la convertir en vraie cire ;
qu une partie fert à la nourriture de l’infeéle, qu’une
autre fort par l’anus en forme d’excrémens , 8c que
le refte revient par la bouche, 8c eft employé à la
conftruûion des alvéoles, voyeç Alv éo l e . On a vu
une liqueur mouffeufe, ou une efpece de bouillie,
fortir de la bouche dans le tems que l ’abeille travaillez
faire^une cellule ; cette pâte fe feche dans
un mftant ; c eft de la vraie cire. On prétend que les
abeilles ne peuvent plus employer la cire dès qu’elle
eft entièrement feche. Aufli lorfqu’on leur en préfente
auprès de leur ruche , elles ne s’en chargent
pa s, mais elles recherchent tout le miel qui peut y
être mêlé ; elles hachent quelquefois la cire par mor-
, ce au x, 8c ne l’abandonnent que lorfqu’elles en ont
enlevé tout le miel ; & s’il n’y en avoit point, elles
ne toucheroient pas à la cire. Lorfqu’on fait paffer
des abeilles dans une nouvelle ruche entièrement
vuide, 8c qu on les y renferme au commencement
du jou r, avant qu’elles ayent pû ramaffèr de la cire
brute , on trouve le foir des gâteaux de cire dans la
nouvelle ruche. Il y a tout lieu de croire que la cire.
dont ces gâteaux font formés , eft venue de la bouche
de ces infeâes , en fuppofant qu’ils n’ont point
apporte de cire brute attachée à leurs jambes.'Cette
matière éprouve des diangemens dans l’eftomac,
puifque la cire des alvéoles eft blanche , quoique les
pelotes de cire brute que les abeilles apportent dans
la ruche foient de différentes couleurs , blanches
jaunes, orangées, rougeâtres » vertes. Les alvéoles
nouvellement faits font blancs, & ils jauniffent avec
lç tems 8c par différentes:caufes.Mais lorfqu’ils font
nouveaux | la teinte eft à-peu-près la même dans
toutes les ruches ; s’il s’en trouve de jaunâtre, on
peut croire que cette couleur vient d’une mauvaife
digeftion de la cire brute, que l’on a attribuée à un
vice héréditaire que toutes les abeilles d’une ruche
tiennent de leur mere commune. Ce qu’il y a de certain
, c’eft que toutes les cires ne font pas également
propres à recévoir un beau blanc dans nos blanchif-
feries. Mém.pour fervir à Thijloire des infectes, tom. V ,
C ire , (Hijl. anc. & mod. ) Les hommes détrui-
fent les cellules pour avoir la cire qui les forme &
l’on ne fauroit dire à combien d’ufages ils l’ont em-
ployée de tout tems. Autrefois on s’en fer voit comme
d’un moule pour écrire, invention qu’on attribue
aux Grecs. Pour cet effet, ori faifoit de petites
planches de bois à-peu-près comme les feuillets de
nos tablettes, dont les extrémités tout - à - l’entour
étoient revêtues d’un bord plus élevé que le refte '
afin que la cire ne pût pas s’écouler. On répandoit
enfuite fur-Ces tablettes de la cire fondue, on l’ap-
planiffoit, on legalifoit, 8c l’on écrivoit fur cette
cire avec un poinçon. C ’eft pourquoi Plaute dit, dum
feribo explevi totas cerasquatuor. Les teftamens même
s’écrivoient fur de la cire ainfi préparée. De-Ià vient
qu’on leur donnoit auffi le fimple nom de cera, cire.
V. Suetone dans la vie de Céfar, chap. Ixxxiij. & dans
la vie de Néron , chap. xvij. On fe fervoit encore de
la cire pour cacheter des lettres, & empêcher qu’el