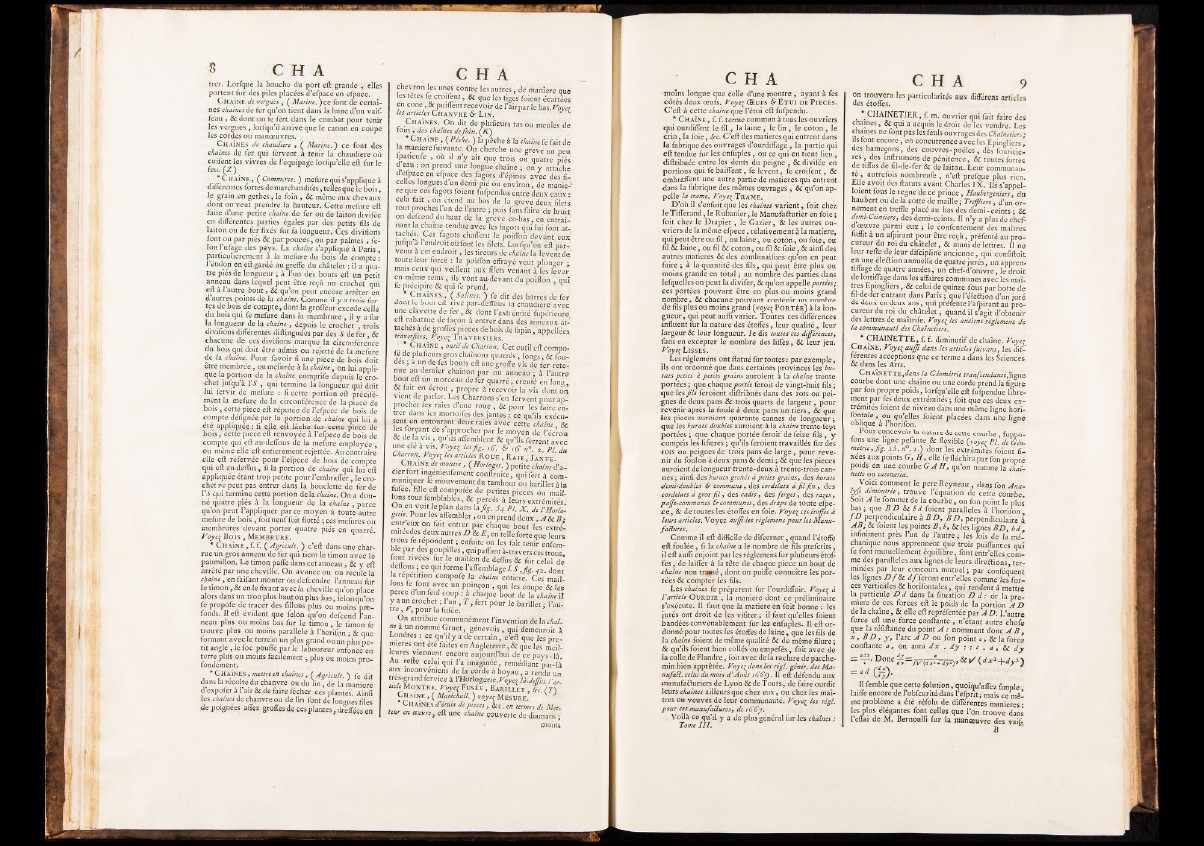
trer. Lorfque la bouche du port eft grande , elles
portent fur des piles placées d’efpace en efpace.
C haîne de vergues , ( Marine. ) ce font de certaines
chaînes deferqu’on tient dans la hune d’un vaif-
feau , & dont #n fe fert dans le combat pour tenir
les vergues * lorfqu’il arrive que le canon en coupe
les cordes ou manoeuvres.
C haînes de chaudière , ( Marine.') ce font des
chaînes de fer qui fervent à tenir la chaudière oii
cuifent les vivres de l’équipage lorfqu’elle eft fur le
feu. ( Z )
. 'Chaîne , ( Commerce. ) mefure qui s’applique à
différentes fortes de marchandifes, telles que le bois,
le grain .en gerbes, le foin , & même aux chevaux
dont on veut prendre la hauteur. Cette mefure eft
faite d’une petite chaîne de fer ou de laiton divifée
en différentes parties égales par des petits fils de
laiton ou de fer fixés fur fa longueur. Ces divifions
font Ou par piés & par pouces, ou par palmes , félon
l’ufage- des pays. La chaîne s’applique à Paris ,
particulièrement à la mefure du bois de compte :
l ’étalon en eft gardé au greffe du châtelet : il a quatre
piés de longueur ; à l’un des bouts eft un petit
anneau dans lequel peut , être reçu un crochet qui
eft à l’autre bout, & qu’on peut encore arrêter en
d’autres , points de la chaîne. Comme il y a trois fortes
de bois de compte, dont la groffeur excede celle
du bois qui fe mefure dans la membrure , il y a fur
la longueur de la chaîne , depuis le crochet , trois
divifions différentes diftinguées par des S de fe r , &
chacune de ces divifions marque la circonférence
du bois qui doit être admis ou rejetté de la thefure
de la chaîne. Pour fa voir fi une piece de bois doit
être membrée, oumefurée à la chaîne, on lui applique
la portion de la chaîne comprife depuis le crochet
jufqu’à VS , qui termine la longueur qui doit
lui fervir de mefure : • fi cette portion eft précifé-
ment la mefure de la circonférence de la piece de
bois , cette piece eft réputée de l ’efpece de bois de
compte défi^née par la portion de chaîne qui lui a
ete appliquée : fi elle eft lâche fur cette piece de
b o is , cette piece eft renvoyée à l’efpece de bois de
compte qui eft au-deffous de la mefure employée ,
ou même elle eft entièrement rejettée. Au contraire
elle eft réfervée pour l’efpece de bois de compte
qui eft au-deffus, fi la portion de chaîne qui lui eft
appliquée étant trop petite pour l’embraffer, le crochet
ne peut pas entrer dans la bouclette de fer de
l ’*î qui termine cette portion delà chaîne. On a donné
quatre piés à la longueur de la chaîne , parce
qu’on peut l’appliquer par ce moyen à toute autre
mefure de bois , foitneuf foit flotté ; ces mefures ou
membrures devant porter quatre piés en quarré.
Voye^ B o i s , Membrure.
* C haîne , f. f. ( Agricult. ) c’eft dans une charrue
un gros anneau de fer qui tient le timon avec le
paumillon. Le timon paffe dans cet anneau, & y eft
arrêté par une cheville. On avance ou on recule la
chaîne, en faifant monter ou defcendre l’anneau fur
le timon, & en le fixant avec la cheville qu’on place
alors dans un trou plus haut ou plus bas, félon qu’on
fe propofe de tracer des filions plus ou moins profonds.
Il eft évident que félon qu’on defcend l’anneau
plus ou moins bas fur le timon, le timon fe
trouve plus ou moins parallèle à l’horifon ; & que
formant avec le terrein un plus grand ou un pluspe-
tit angle , le foc pouffé par le laboureur enfonce en
terre plus, ou moins facilement, plus ou moins pro- ,
fondément. r
* C haînes, meure en chaînes, {Agricult. ) fe dit
dans la récolte du chanvre ou du lin , de la maniéré
d’expofer à l’air de de faire fécher ces plantes. Ainfi
1es.ckalncs de chanvre ou de lin font de longues files
de poignées allez greffes de ces plantes, dreffées en
cheyron les unes contre lés autres, de manière que
les têtes fe croifent, & que les tiges foient écartées
en » n e , & puiffent recevoir de B M W W
la iirfic&r'CHANVRE & L in. -
I H | On dit de plufieurs tas où meules de
rom , des chaînes de foin. (K )
. * C lî A!* r ? yiapêeheà la céu&tféfaitde’
la1 maniéré fuïvànte: On cherche une greVëun peu
Ipatieufe , oh il n’y ait que trois ou quatre piés
deau : on prend mie longue chaîne : on y attache
d efpace en efpace des fagots d’épines avec des ficelles
longues d’un derfii-pié ou enviroh, de manie-?
re que ces fagots foient fufpendus entre deux eaüx ;
cela fait , on etend au bas de la greve deux filets
tout proches l’un de l’aiitre ; puis fans faire de bruit
on defc.end^ du haut de la grève én-bas, en entraînant
la chaîne tendue avec les fagots qui lui font attaches^.
Ces fagots chaffent lé poiffon devant eux
jufqu a l’endroit où font les filets. Lorfqu’on éft parvenu
à cet endroit, les tireurs de chaîne la lèvent de
toute leur force : le poiflon effrayé yeut plonger j.
mais ceux qui veillent aux fil’efs venant à les lever
en même teins, ils vont au-devant du poiffon , qui
fe précipité & qui fe prend. ‘
* C haînes , ( Salines. ) fe dit des barres de fer
dont le bout eft rivé par-deffous la chaudière1 avec,
une clavette de fe r , & dont l’extrémité fupérieure
eft rabattue de façon à entrer dans des anneaux attaches
à de groffes piecés de bois de fapin, a.ppellèes
tràverjiers.Foye^ T raversiers.
? C haîne ? outil de Charron. Cet outil eft cômpo-
fe^de plufieurs gros chaînons quarrés, longs, & fondés
; à un de fes bouts eft Une groffé yis de fer retenue
au dernier chaînon par un anneâü ; à l’autre
bout eft un morceau de fer quarré, creiifé en long '
& fait en ecrou , propre à recevoir la'vis dont on
vient de parler. Les Charrons s’en fervent pour ap-
prochefTés faiës xPuf» refue, & fiéSr lés foire èn-
trer dans les mortoifçs des.iaawiiA ce' qu’ils exécutent
en entourant deux raies rvTcr eêtte:Âîatne
les forçant de s apprdcliet par le moyèn de l’é à b ù
& de la vis., qu ils affemblent & qu’ils ferrent avec
une.cle'a vis. K ^ e C le s fg p g : & ,G rP: u .P ! Au
Charron. Voyellesariîdis R ôXJe , Raie , Jante
. C ? A1? E 9 ™mre, (Horloger. ) petite chaîne A’a-
cier fort mgenieufement conftruite, q u ite rt'lcom
■ H i mouvement du tambour bu barillet à l*
fufee. Elle eft compofee de petites pièces du maillons
tous femblables, & percés à leurs extrémités •
° n. S B B S p1“ dans m g m pi. g gg 8 ü h
gerie. Pour les affembler , on en prend deux , A & B '
entr eux on fifit entrer par chaque bout les extrémités
des deux autres D 8 cÉ,e n telleforte que leurs
trous fe repondent ; enfuite on les fait tenir enfemble
par desgoupillesyquipaffantà-traverscestrous,
font rivees fur le maillon de deffus & fur celui de
deflous ; ce qui forme l’affeâiblage £ .? ,& , 4*. dont
la répétition coinpofc la chaîne entière. Ces maillon.?
le font avec un poinçon , qui les coupe & le s
perce d un feul coup : à chaque bout de la chaîne il
y a un crochet ; l’u n , T , fert pour le barillet ; Tau-
t re , F , pour la fufée.
On attribue communément l’invention de la choie
ne à un nomme Gruet, génévois , qui demeuroit à
Londres : ce c[u’il y a de certain, c’eft que les premières
ont ete faites en Angleterre, & que les meilleures
viennent encore aujourd’hui de ce pays- là.
Au refte celui qui l’a imaginée, remédiant par-ià
aux inconveniens de la corde à boyau, a rendu un
très-grand fer vice à VVloûo^ene. Foyer là-deffhs l'ar-
^ M ontr e. Foye^ Fu sée, Ba rillet , &c.(T)
C haîne , ( Maréchall, ) voyeç Mesure.
* C haînes A’éeüis de piecés, &c. en termes de Metteur
en oeuvre, eft une chaîne couverte de diamahs ;
moins
•moins longue que celle d’une montre , ayant à fes
-côtés deux oeufs. Voyez OEufs & Etu i de Pièc es.
-C’eft à cette chaîne que l’étui eft fufpendu.
* C haîne , f. f. terme commun à tous les ouvriers
<pii ourdiffent le f i l , la laine , le lin , le coton , le
crin, la foie, &c. C ’eft des matières qui entrent dans
la fabrique des ouvrages d’ourdiffage , la partie qui
eft tendue fur les enfuples, ou ce qui en tient lieu,
diftribuée entre les dents du peigne , & divifée en
portions qui fe baiffent, fe lèvent, fe croifent, &
embraffent une autre partie de matières qui entrent-
<lans la fabrique des mêmes ouvrages , & qu’on appelle
la trame. Foye^ T rame.
D ’où il s’enfuit que les chaînes varient, foit chez
leTifferand, le Rubanier, le Manufaéhmer en foie ;
foit chez le Drapier , le Gazier, & les autres ouvriers
de la même efpece, relativement à la matière,
qui peut être ou f il, ou laine, ou coton, ou foie, ou
fil & laine, ou fil & coton, ou fil & foie , & ainfi des
autres matières & des combinaifons qu’on en peut
faire ; à la quantité des fils, qui peut être plus ou
moins grande en total ; au nombre des parties dans
lefquelles on peut la divifer, & qu’on appelle portées;
ces portées pouvant être en plus ou moins grand
nombre, & chacune pouvant contenir un nombre
de fils plus ou moins grand (voye^ Po rté e ) à la longueur,
qui peut aufli varier. Toutes ces différences
influent lur la nature des étoffes, leur qualité, leur
largeur & leur longueur. Je dis toutes ces différences9
fans en excepter le nombre des liffes, & leur jeu.
Foyei L isses.
Les réglemens ont ftatué fur toutes : par exemple,
ils ont ordonné que dans certaines provinces les bu-
rats petits à petits grains auroient à la chaîne trente
portées ; que chaque portée feroit de vingt-huit fils ;
que les fils feroient diftribués dans des rots ou peignes
de deux pans & trois quarts de largeur, pour
revenir après la foule à deux pans un tiers, &-que
le s pièces auroient quarante cannes de longueur ;
que les burats doubles auroient à la chaîne trente-fept
portées ; que chaque portée feroit de feize fils , y
compris les lifieres ; qu’ils feroient travaillés fur des
-rots ou peignes de trois pans de large, pour revenir
du foulon à deux pans & demi ; & que les pièces
-auroient de longueur trente-deux à trente-trois cannes
; ainfi des burats grenés à petits grains, des burats
demi-doubles & communs , des cordelats à fil fin , des
xordelats à gros f i l , des cadis , des forges, des ra^es,
pajfo-communes & communes, des draps de toute efpec
e , & de toutes les étoffes en foie. Foye^ ces étoffes à
leurs articles. V oyez auffi les réglemens pour les Manufactures.
Comme il eft difficile de difeerner, quand l’étoffe
eft foulée, fi la chaîne a le nombre de fils preferits,
il eft auffi enjoint par les réglemens fur plufieurs étoffes
, de laiffer à la tête de chaque piece un bout de
■ chaîne non tramé, dont on puiffe connoître les portées
& compter les fils.
Les chaînes fe préparent fur l’ourdiffoir. Foye^ d
farticle O urdir , la maniéré dont ce préliminaire
s’exécute. Il faut que la matière en foit bonne : les
jurés ont droit de les vifiter ; il faut qu’elles foient
bandées convenablement fur les enfuples. Il eft ordonné
pour toutes les étoffes de laine, que les fils de
la chaîne foient de même qualité & de même filure ;
& qu’ils foient bien collés ou empefés, foit avec de
la colle de Flandre, foit avec de la raclure de parchemin
bien apprêtée. Foye^ dans les régi, génér. des Ma-
nufacl. celui du mois d'Août i66 ÿ . Il eft défendu aux
manufacturiers de Lyon & de Tours , de faire ourdir
leurs chaînes ailleurs que chez eux, ou chez les maîtres
ou veuves de leur communauté. Foye^ les régi,
pour ces manufacturesf de
Voilà ce qu’il y a de plus général fur les chaînes :
Tome I I I .
ôn trouvera les particularités aux différens articles
des étoffes.
OEA IN ETIER, f. m. ouvrier qui fait faire des
chaînes, & qui a acquis le droit de les vendre. Les
chaînes ne font pas les feuls ouvrages des Ckaînetiers;
ils font encore, en concurrence avec les Epingliers ,
des hameçons, des couvres-poêles , dès fouricie-
re s , des inftrumens de pénitence, & toutes fortes
de tiffus de fil-de-fer 8c de laiton. Leur communauté
, autrefois nombreufe , n’eft prefque plus rien.
Elle avoit des ftatuts avant Charles IX . Ils s’appel-
loient fous le régné de ce prince, Haubergeniers, du
haubert ou de la cotte de maille ; Treffiiers, d’un ornement
en tréfilé place au bas des demi-ceints ; 8c
demi-Ceintiers, des demi-ceints. Il n’y a plus de chefi
d’oeuvre parmi eux ; le confentement des maîtres
fuffit à un afpirant pour être reçfi, préfenté au procureur
du roi du châtelet, 8c muni de lettres. Il ne
leur refte de leur difeipline ancienne, qui confiftoit
en une éleâion annuelle de quatre jurés, un appren*
tiffagede quatre années, un chef-d’oeuvre, le droit
de lottiffage dans les affaires communes avec les maî-:
très Epingliers, 8c celui de quinze fous par botte de
fil-de-fer entrant dans Paris ; ‘que l’éle&ion d’un juré
de deux en deux ans, qui préfente l’afpirant au procureur
du roi du châtelet, quand il s’agit d’obtenir
des lettres de maitrife. Foye^ les anciens réglemens de
la communauté des Chaînetiers.
------ H — JJ “ "«MW ƒ •*. V lit Lu y 1C3 UUferentes
acceptions que ce terme a dans les Sciences
& dans les Arts.
C hAinETT.£,</<z/zj la Géométrie tranfeendante,ligne
courbe dont une chaîne ou une corde prend la figure
par fon propre poids, lorfqu’elle eft fufpendue librement
par fes deux extrémités ; foit que ces deux extrémités
foient de niveau dans une même ligne hori-
fontale ou qu’elles foient placées dans une ligne
oblique a I horifon. '
Pour concevoir la nature de cette courbe , fuppo-
fôns une ligne pefanfe 8c flexible (yoye^ PI. de Géo-
metrie, fig. a i . n ° .z .) dont les extrémités foient fixées
aux points G, H , elle fe fléchira par fon propre
poids en une courbe G A H , qu’on nomme la chaînette
ou catenaria.
V o iü comment le pereReyneau, dans fon Ana-
lyfi démontrée, trouve l’équation de'cette courbe
Soit,^ îe Commet de la courbe , ou fon point le plus
bas ; que B D h bd foient parallèles à l’horijon
f D perpendiculaire h. B D , B D , perpendiculaire 1
A B ; &foient les points B , b , & le s lignes B D , b d .
infiniment près l’un de l’aiitre ; les' lois de la mé-
chanique nous apprennent que trois puiffançës qui
le font mutuellement équilibre, font eiifr’elleï com-
me des parallèles aux lignes de leurs directions, terminées
par lèur concours mutuel; par conféquent
les lignes D f S c d f feront entr’elles comme les forces
Verticales & horifontales, qui .tendent à mettre
la particule D d dans la lituation D d : or là première
de ces forces eft le ^Ôlds de la portion A D
de la chaîne, & elle eft repréfentee par A D . L’autre
force eft une force conftante , n’étant autre chofe
que la'réiiftànce du point A : nommant donc A B .
u , B D , y ,T a r e A D ou,fon point c , & la force
confiante a , on aura â x ..d y : : c . d , 8c dy
Donc W i * * 1 + ^ ?)
- C s ) • -
Il femble que cette folution, quoiqu’affez fimple '
laiffe encore de l’obfcurité dans l’efprit ; mais ce même
problème a été réfolu de différentes maniérés :
les plus élégantes font celles que l’on trouye dans
l’effai de M. Bernoulli fur la manoeuvre des vaif-
1