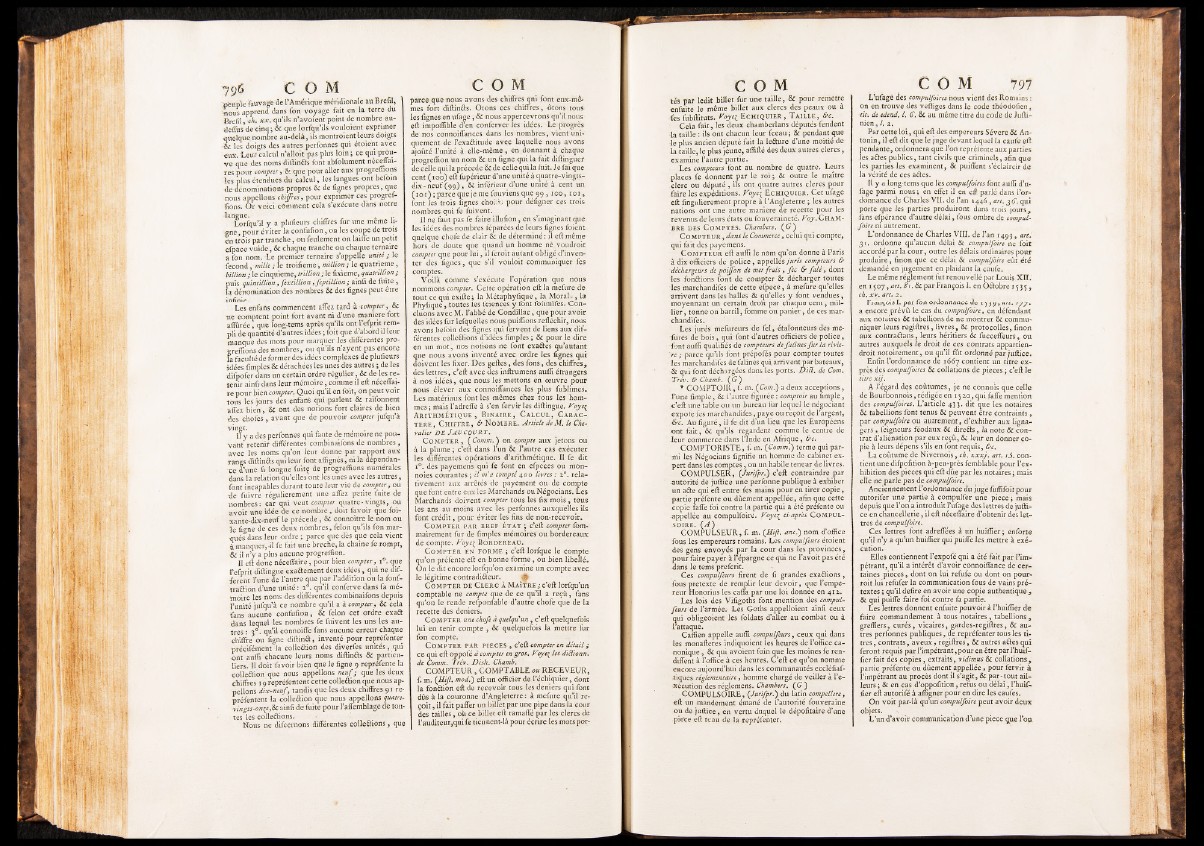
79^ C O M
peuple faüvagê de l’Amérique méridioflale au Brefil,
mous apprend dans ion voyage fait en la terre du
Sr-efil, ch. qu’ils n’avoient point de nombre au-
deffusdecinq; & que lorfqu’ils voulorént exprimer
quelque nombre au-delà, ilsmontraient leurs doigts
-& les doigts des autres perfonnes qui étoient avec
eux. "Leur calcul n’alloit pas plus loin ; ce qui prouv
e que des noms-diftin&s font abfolument néceffai-
res pour compter, & que pour aller -aux progreffions
le s plus étendues du calcul, les langues ont befoin
de-dénominations propres & de fignes propres, que
nous appelions chiffres, pour exprimer ces progressons.
Or voici comment cela s’exécute dans notre
langue. .
Lorfqu’il y a plufieurs chiffres fur une même lign
e , pour éviter la confuiion, on les coupe de trois
en trois par tranche, ou feulement on laiffe un petit
cfpace vuide, & chaque tranche ou chaque ternaire
a Ion nom. Le premier ternaire s’appelle unité ; le
fécond, mille ; le troifieme , million; le quatrième,
billion; le cinquième, trillioh; le fixieme, quatrillion;
puis quintillion , fixtillion , Jeptillion ; ainii de Alite ,
la dénomination des nombres & des fignes peut être
infinie.
Les enfans commencent affez tard a compter, 6c
■ ne comptent point fort avant ni d’une maniéré fort
allurée, que long-tems après qu’ils ont l’elprit rempli
de quantité d’autres idées ; foit que d’abord il leur
manque des mots pour marquer les différentes progreffions
des nombres, ou qu’ils n’ayent pas encore
la faculté de former des idées complexes de plufieurs
idées fimples 6c détachées les unes des autres ; de les
difpofer dans un certain ordre régulier, 6c de les retenir
ainfi dans leur mémoire, comme il eft néceffai-
rc pour bien compter. Quoi qu il en foit, on peut voir
tous les jours des enfans qui parlent 6c raifonnent
affez bien, & ont des notions fort claires de bien
des chofes, avant que de pouvoir compter jufqu’à
vingt. ' t
Il y a des peffonnès qui faute de mémoire ne pouvant
retenir différentes combinaifons de nombres ,
avec les noms qu’on leur donne par rapport aux
rangs diftinfts qui leur font affignés, ni la dépendanc
e d’une fi longue fuite de progreffions numérales
dans là relation qu’elles ont les unes avec les autres,
font incapables durant toute leur v ie de compter , ou
de fuivre régulièrement une affez petite fuite de
nombres: car qui veut compter-quatre-vingts, ou
avoir une idée de ce nombre , doit favoir que foi-
-xante-dix-neuf le précédé, 6c connoître le nom ou
le ligne de ces deux nombres, félon qu’ils fon marqués
dans leur ordre ; parce que dès que cela vient
â manquer,-il fe fait une breche, la chaîne fe rompt,
& il n’y a plus aucune progreffion.
Il eft donc néceffaire, pour bien compter, i°. que
l’efprit diftingue exactement deux idées, qui ne different
l’une de l’autre que par l’addition ou la fouf-
tra&ion d’une unité : i° . qu’il conferve dans fa mémoire
les noms des différentes combinaifons depuis
l’unité jufqu’à ce nombre qu’il a à compter, 6c cela
fans aucune confufion, &c félon cet ordre exa£t
dans lequel les nombres fe fuivent les uns les autres
: 3°. qu’il connoiffe fans aucune erreur chaque
chiffre ou ligne diftinâ, inventé pour repréfenter
précifément la colieûion des diverfes unités, qui
ont auffi chacune leurs noms diftin&s 6c particuliers.
Il doit favoir bien que le figne 9 repréfente la
colledion que nous appelions neuf; que les deux
chiffres 19 repréfentent cette collection que nous appelions
dix-neuf, tandis que les deux chiffres 91 repréfentent
la collection que nous appelions quatre-
vingts-on^e,6c ainfi de fuite pour Paffeniblage de toutes
les collections. ■ , ■
Nous ne difeernons différentes collections, que
C O M
parce que nous avons des chiffres qni font eux-mê*
mes fort diftin&s. Otons ces chiffres, ôtons tous
les fignes en ufàge, 6c nous appercevrons qu’il nous
eft impoffible d’en conferver les idées. Le progrès
de nos connoiffances dans les nombres, vient uniquement
de l’exaCtitude avec laquelle nous avons
ajouté l’unité à elle-même, en donnant à chaque
progreffion un nom 6c un figne qui la fait diftinguer
de celle qui la précédé 6c de celle qui la fuit. Je fai que
cent ( 100) eft fupérieur d’une unité à quatre-vingts-
dix - neuf ( 9 9 ) , 6c inférieur d’une unité à cent un
(101) ; parce que je me fouviens que 9 9 , 100, 101,
font les trois fignes choilis pour défigner c e s trois
nombres qui fe fuivent.
Il ne faut pas fe faire illufion, en s’imaginant que
les idées des nombres féparées de leurs fignes foient
quelque chofe de clair 6c de déterminé : il eft même
hors de doute que quand un homme nè. voudrôit
compter que pour lu i, il feroit autant obligé d’inventer
des fignes, que s’il vouloit communiquer fes
comptes.
Voilà comme s’exécute l’opération que nous
nommons compter. Cette opération eft la mefiîre de
tout ce qui exifte ; la Métaphyfique, la Morale, la
Phyfique, toutes les fciences y font foûmifes. Concluons
avec M. l’abbé de Condillac, que pour avoir
des idées fur lefquelles nous puiffions réfléchir, nous
avons befoin des fignes qui fervent de liens aux différentes
collerions d’idées fimples ; 6c pour le dire
en un mot , nos notions ne font exa&es qu’autant
que nous avons inventé avec ordre les fignes qui
doivent les fixer. Dès geftes, des fons, des chiffres,
des lettres, c’eft avec des inftrumens auffi étrangers
à nos idées, que nous les mettons en oeuvre pour
nous élever aux connoiffances les plus fublimes.
Les matériaux font les mêmes chez tous les hommes;
mais l’adreffe à s’en fervir les diftingue. Foye^
Ar it h m é t iq u e , Bin a ir e , C a l c u l , C a r a c t
è r e , C hif fre, & Nombre. Article de M. le Chevalier
DE J AU COU RT.
C o m p t e r , ( Comm. j on çpmpte aux jetons ou
. à la plume ; c’eft dans l’un 6c l’autre cas exécuter
les différentes opérations d’arithmétique. Il fe dit
i°. des payemens qui fe font ên efpec.es ou mon-
noies courantes ; il nia Compté 400 livres : z°. relativement
aux arrêtés de payement ou de compte
que font entre eux les Marchands ou Négocians. Les
Marchands doivent compter tous les fix mois, tous
les ans au moins avec les perfonnes auxquelles ils
font crédit, pour éviter les fins de non-recevoir.
C ompter par bref é tAt ; c’eft compter fom-
mairement fur de fimples mémoires ou bordereaux
de compte. Voye{ Bordereau.
C om p ter en forme ; c’eft lorfque le compte
qu’on préfente eft en bonne forme, ou bien libellé.
On le dit encore lorfqu’on examine un compte avec
le légitime contradicteur. 0
C ompter de C lerc à Ma îtr e ; c’eft lorfqu’un
comptable ne compte que de ce qu’il a reçu, fans
qu’on le rende refponl'able d’autre chofe que de la
recette des deniers.
C ompter une chofe àquelqiiun, c’eft quelquefois
lui èn tenir compte , 6c quelquefois la mettre fur
fon compte.
C ompter par PIECES , c’eft compter en détail ;
ce qui eft oppofé à compter en gros. Fyye{ les diclionn.
de Comm. Trév. Dish. Chamb.
COMPTEUR, COMPTABLE ou RECEVEUR,
f. m. (Hijl. mod.j eft un officier de l’échiquier, dont
la fon&ion eft de recevoir tous les deniers qui font
dûs à la couronne d’Angleterre : à mefure qu’il reçoit
, il fait paffer un billet par une pipe dans la cour
des tailles, oii ce billet eft ramaffé par les clercs de
l’auditeur,qui fe tiennent-là pour écrire les mots por-
C O M
tés par ledit billet fur une taille, & pour remetre
«nfuite le même billet aux clercs des peaux ou à
fes fubftituts. Voye5; Ech iq u ie r , T a il l e , & c.
Cela fait, les deux chamberlans députés fendent
la taille : ils ont chacun leur fceau; & pendant que
le plus ancien député fait la le&ure d’une moitié de
la taille, le plus jeune, affilié des deux autres clercs,
examine l’autre partie.
Les compteurs font au nombre de quatre. Leurs
places fe donnent par le roi ; & outre le maître
clerc ou député , ils ont quatre autres clercs pour
faire les expéditions. Voye{ Ech iqu ier . Cet ufage
eft fingulierement propre à l ’Angleterre ; les autres
nations ont une autre maniéré de recette pour les
revenus de leurs états ou fouveraineté. Foy. C h am ère
des C om p te s . Chambers. ( G j
C ompteur , dans le Commerce , celui qui compte,
qui fait des payemens.
C ompteu r eft auffi le nom qu’on donne à Paris
û dix officiers de police, appellés jurés compteurs &
déchargeurs de poijfon de mer frais, fec & falé , dont
les fondrions font de compter & décharger toutes
les marchandifes de cette efpece, à mefure qu’elles
arrivent dans les halles & qu’elles y font vendues,
moyennant un certain droit par chaque cent-, millier
, tonne ou barril, fomme ou panier, de ces marchandifes.
Les jurés mefureurs de fel, étalonneurs des mè-
fures de bois, qui font d’autres officiers de police,
font auffi qualifiés de compteurs de falinesfur La rivière
; parce qu’ils font prépofés pour compter toutes
les marchandifes de farines qufarrivent par bateaux,
& qui font déchargées dans les ports. Dicl. de Corn.
Trev. & Chamb. (G j
* COMPTOIR, f. m. (Coni.j a deux acceptions,
l ’une fimple, &: l’autre figurée : comptoir au fimple,
c ’eft une table ou un bureau fur lequel le négociant
expofe fes marchandifes, paye ou reçoit de l’argent,
&c. Au figuré, il fe dit d’un lieu que les Européens
ont fait, 6c qu’ils regardent comme le centre de
leur commerce dans l’Inde en Afrique, &c. .
COMPTORISTE, f. m. (Comm.’) terme qui parmi
les Négocians fignifie un homme de cabinet expert
dans les comptes, ou un habile teneur de livres.
COMPULSER, (Jurifpr.j c’eft contraindre par
autorité de juftice une perfonne publique à exhiber
un a&e qui eft entre fes mains pour en tirer copie,
partie préfente ou dûement appellée, afin que cette
copie faffe foi contre la partie qui a été prefente ou
appellée au compulfoire. Foyeç ci-après C ompul-
so ir e . (A j
COMPULSEUR, f. m. (Hift. anc.j nom d’office
fous les empereurs romains. Les compulfeurs étoient
des gens envoyés par la cour dans les provinces,
pour faire payer à l’épargne ce qui ne l’avoit pas été
dans le tems preferit.
Ces compulfeurs firent de fi grandes exafiions,
fous pretexte de remplir leur devoir, que l’empereur
Honorius les caffa par une loi donnée en 41a.
Les lois des Vifigoths font mention des compul-
feurs de l’armée.- Les Goths appelaient ainfi ceux
qui obligeoient les foldats d’aller au combat ou à
l’attaque.
Caffien appelle auffi compulfeurs, ceux qui dans
les monafteres indiquoient les heures de l’office canonique
, & qui a voient foin que les moines fe ren-
diffent à l’office à ces heures. C ’eft ce qu’on nomme
encore aujourd’hui dans les communautés eccléfiaf-
tiques réglementaire, homme chargé de veiller à l’exécution
des réglemens. Chambers. (G )
COMPULSOIRE, (Jurifpr.j du latin compellere,
eft un mandement émané de l’autorité fouveraine
ou de juftice, en vertu duquel le dépofitaire d’une
pièce eft tenu de la repréfenter.
C O M 7 9 ?
L’tifagè des compulfoires nous vient des Romains î
bn en .trouve des veftiges dans le code théodofien,
de. de edend. I. 6. &C au même titre du code de Jufti-
nien, l. 2.
Par cette lo i, qui eft des empereurs Sévere & An-
tonin, il eft dit que le juge devant lequel la caufe eft
pendante, ordonnera que l’on repréfente aux parties
les aftes publics, tant civils que criminels, afin que
les parties les examinent, & puiffent s’éclaircir de
la vérité de ces ailes.
Il y a long-tems que lès compulfoires font auffi d’u-
fage parmi nous ; en effet il en eft parlé dans l’ordonnance
de Charles VII. de l’an 1446, art. 3 G. qui
porte que les parties produiront dans trois jours,
-fans efpérance d’autre délai, fous ombre de compulfoire
ni autrement.
L’ordonnance de Charles VIII. de l’an 1493, art.
.31. ordonne qu’aucun délai & compulfoire ne foit
accordé par la cour, outre les délais ordinaires pour
produire, finon que ce délai & compulfoire eût été
demandé en jugement en plaidant la caufe.
Le même réglement fut renouveilé par Louis X IL
en 1507, art. 81.&C par François I. en OHobre 1535,
ch. xv. art. 2.
François I. par fbri ordonnance de 1539, art. tyy.
a encore prévû le cas du compulfoire, en défendant
aux notaires & tabellions de ne montrer & communiquer
leurs regiftres, livres, & protocolles, finon
aux contraflans, leurs héritiers 6c fucceffeurs, ou
autres auxquels le droit de ces contrats appartien-
droit notoirement, ou qu’il fût ordonné par juftice.
Enfin l’ordonnance de 1667 contient un titre exprès
des compulfoires 6c collations de pièces ; c’eft le
titre xij.
A l’égard des coutumes, je ne connois que celle
de Rourbonnois, rédigée en 15 zo , qui faffe mention
des compulfoires. L’article 433. dit que les notaires
& tabellions font tenus & peuvent être contraints ,
par compulfoire ou autrement, d’exhiber aux lignagers
, feigneurs féodaux & direfls, la note & contrat
d’aliénation par euxreçû, & leur en donner copie
à leurs dépens s’ils en font requis, &c.
La coutume de Nivernois, ch. x x x j. art. iS. contient
une difpoiition à-peu-près femblable pour l’exhibition
des pièces qui eft due par les notaires ; mais
elle ne parle pas de compulfoire.
Anciennement l’ordonnance du jugé fuffifoit pour
autorifer une partie à compulfer une piece ; mais
depuis que l’on a introdtiit l’ufage des lettres de juftice
en chancellerie, il eft néceffaire d’obtenir des lettres
de compulfoire.
Ces lettres font adreffées à un huiffier; enforte
qu’il n’y a qu’un huiffier qui puiffe les mettre à exécution.
Elles contiennent î’expofé qui a été fait par l’impétrant,
qu’il a intérêt d’avoir connoiffance de certaines
pièces, dont on lui refufe ou dont on pour-
roit lui refufer la communication fous de vains prétextes
; qu’il defire en avoir une copie authentique,
& qui puiffe faire foi contre fa partie.
Les lettres donnent enfuite pouvoir à I’huiffier de
faire commandement à tous notaires, tabellions ,
greffiers, curés, vicaires, gardes-regiftres, & autres
perfonnes publiques, de repréfenter tous les titres
, contrats, aveux, regiftres, & autres ailes qui
feront requis par l’impétrant, pour en être par l’huif-
fier fait des copies, extraits, vidimus & collations,
partie préfente ou dûement appellée , pour fervir à
l’impétrant au procès dont il s’agit, & par-tout ailleurs
; & en cas d’oppofition, refus ou défai, l’huif-
fier eft autorifé à affigner pour en dire les caufes.
On voit par-là qu’Uri compulfoire peut avoir deux
objets.
L’un devoir communication d’une piece que l’on