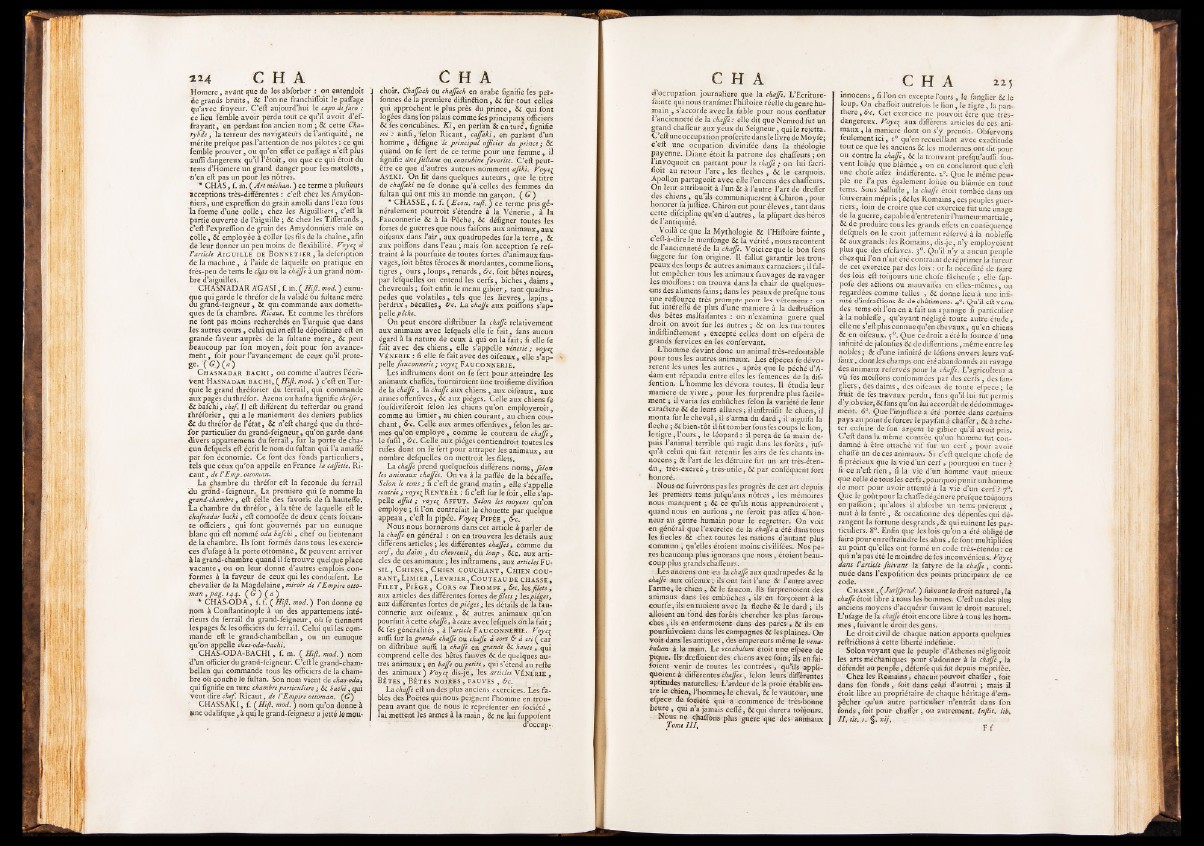
Homere, avant qüe de les abforbër : on entendolt
de grands bririts., 6c l’on ne franchiffoit le paffage
qu’avec frayeur/Ç’ëft aujourd’hui le capo difaro :
ce lieu fëmble avoir .perdu tout ce qu’il avoit d’é’f-
frayarft, en perdant fon ancien rioûï ; & cette Chà-
tybde, ' la terreur dès navigateurs de l ’antiquité, ne
mérite prefque pas l ’attention de nos pilotes : ce qui
femble prouver, ou qu’en effet ce paffage n’éft plus
àtifli dangereux qu’il rétôit-, où qüe ce qui étoit du
teins d’Homere un grand danger pour les matelots,
n’en eff pas un pour les nôtres.
* CHAS, f. m. ( Artmcchan. ) ce terme a plüfieurs
^acceptions très-différentes : c’efl chez les Amydon-
ftiers, une expreffioh dû grain amolli dans l’eau fous
'la forme d’une colle ; chez les Aiguilliers, c’eft la
partie ouverte de l’aiguille ; 6c chez les Tifferands,
t ’eft l’expréflion de grain des Amydonriiers mife en
Colle, & employée à Coller lès fils de la chaîne, afin
de leur donner un peu moins de flexibilité. f ’oye^ -à
l'article A igu il le de B o nnetier , 1a defcription
de la machine, à l’aide de laquelle on pratique en
frès-peu de tems le clms ou la chdfft à un grand nombre
d’aiguilles.
CHASNADAR ÂGASI, f. m. ( Hifi. mod, ) eunu-
ue qui garde le thréfor de la validé Ou fultane mete
u grand-feigneur., & qui commande aux doméfti-
ques de fa chambre. Ricaut. Et comme les thréfors
ne font pâS moins recherchés en Turquie que dans
les autres cours, celui qui en eft le dépofitaire eft en
grande faveur auprès de la fultane mere, & peut
Beaucoup par fon moyen, foit pour fon avancement
, foit pour l’avancement de ceux qu’il proteg
e ( G ) ( « ) H
C hasnadar ÈAcHi , ou comme d autres 1 écrivent
Hasnadar b a ch i , ( Hifi. mod. ) c’eft en Turquie
le grand thréforiet du ferrail, qui commande
aux pages du thréfor. Azena ou hafna lignifie thréfor,
& bafchi, chef. Il eft différent du tefterdar ou grand
îhréforier, qui a le maniement des deniers publics
& du thréfor de l’éfàt, 6c n’eft chargé que du thréfor
particulier du grand-feigneur, qu’on garde dans
divers appartenons du ferrail, fur la porte de chacun
desquels eft écrit le nom du fultan qui Ta amaffé
pâr fon économie. Ce font des fonds particuliers,
tels que ceux qu’on appelle en France la caffetie. Ri-
c a u t , de l'Emp. ottoman.
La chambre du thréfor eft la fécondé du ferrail
idu grand - feigneur. La première qui fe nomme la
grand-chambre , eft celle des favoris de fa hauteffe.
La chambre du thréfor, à la tête de laquelle eft le
chafnadar bachi , eft cômpofée de deux cents foixan-
te officiers, qui font gouvernés par un eunuque
blanc qui eft nommé oda bafchi, chef Ou lieutenant
de la chambre. Ils font formés dans tous les exercices
d’ufage à la porte ottomane, 6c peuvent arriver
à la grand-chambre quand il fe trouve quelque place
vacante, ou on leur donne d’autres emplois conformes
à la faveur de ceux qui les cônduifent. Le
chevalier de la Magdelaine, miroir de CEmpire ottoman
, pag. 144. ( G ) ( a )
* CHAS-ODA, f. f. ( Hifi. mod. ) l’on donne ce
nom à Conftantinople à un des appartenons intérieurs
du ferrail du grand-feigneur, oît fe tiennent
les pages 6c les officiers du ferrail. Celui qui les commande
eft le grand-chambellan, ou un eunuque
qu’on appelle chas-oda-bachi.
. CHAS-ODA-BACHI, f. m. ( Hifi. mod.') nom
d’un officier du grand-feigneur. C’eft le grand-chambellan
qui commande tous les officiers de la chambre
oh couche le fultan. Son nom vient de chas-oda,
qui lignifie en turc chambre particulière ; 6c bachi, qui
veut dire chef. Ricaut, de l'Empire ottoman. (G)
CHASSAKI, f. {Hifi. mod. ) nom qu’on donne à
*me odalifque, à qui le grand-feigneur a jette le mouchoir.
Chaffiach ou chaffitch en arabe fignifie les peî»
fonnes de la première diftin&ion, 6c fur-tout celles
qui approchent le plus près du .prince, 6c qui font
logées dans fon palais comme les principaux officiers
& fe s concubines. K i , en perfan& en turc, fignifie
roi ': ainfi, ‘felôn Ricaut., caffiaki, en parlant d’un
homme , défigne 'le.principal officier du,prince; 6ç
quand on fe iert de ce terme pour une femme, il
fignifie une.fûlïdne ou Concubine favorite. ’C ’eft peut-
être cë que d’àütres auteurs-nomment afeki. Foye^
As-EKi. On lit dans quelques auteurs, que le titre
de chaffiaki ne fe donne qu’à -celles des femmes du
fultan qui Ont mis âu monde un garçon. ( G )
*'CHASSE, f. f. {Econ. rufi.,) ce terme pris généralement
pourrait s’étendre à la Vénerie, à la
Fauconnerie & à la ‘Pêche, & déftgner toutes les
fortes de guërres que nousfaifons aux animaux, aux
oifeaûx dans l’a ir , aux quadrupèdes fur la terre , &
aux poiffôns dans l’eau ; mais fon acception fe ref-
traint à la pourfuite de toutes fortes d’animaux fau-
vageS, foit bêtes féroces & mordantes, comme lions,
tigrés, ours , lôups, renards, &c. foit bêtes noires,
par lefquelles on entend les cerfs, biches, daims ,
chevreuils ; foit enfin le menu g ibier, tant quadrupèdes
que volatiles, tels que les lievres, lapins ,
perdrix , bècaffes^ &c. La chaffie aux poiffons s’ap-
pell e.péche.
On peut encore diftribuer la chaffie relativement
aux animaux avec lefquels elle fe fait , fans aucun
égard à la nature de ceux à qui on la fait; fi elle fe
fait avec des chiens, elle s’appelle vénerie ; voyeç
V énerie : fi elle fe fait avec desoifeaux, elle s’appelle
fauconnerie ; voye{ Fauconn eri e.
Les inftrumens dont on fe fert pour atteindre les
animaux chàffés, fourniraient Une troifieme divifion
de la chaffie , l a chaffie aux chiens, aux oifeaux, aux
armes offenfives, 6c aux pièges. Celle aux chiens fe
foufdiviferoit félon les chiens qu’on employeroir,
comme au limier, au chien courant, au chien couchant
, &c. Celle aux armes offenfives, félon les armes
qu’on employé, comme le couteau de chaffie ,
le fum , &c. Celle àiix pièges contiendroit toutes les
rufès dont on fe fert pour attraper les animaux, au
nombre defquelles on mettroit les filets.
La chaffie prend quelquefois différens noms, félon
les animaux chaffiés. On va à la paffée de la béeaffe.
Selon le tems ; fi c’eft de grand matin , elle s’appelle
rentrée ; voye^ Rentrée : fi c’eft fur le foir, elle s’appelle
affût ; voye^ AfEu t . Selon les moyens qu’on
employé ; fi l’on contrefait la chouette par quelque
appeau, c’eft la pipée. Foye^VivÉE , &c.
Nous nous bornerons dans cet article à parler de
la chaffie en général : on en trouvera les détails aux
différens articles ; les différentes chaffiés, comme du
cerf, du daim , du chevreuil, du loup, 6cc. aux articles
de ces animaux ; les inftrumens, aux articles Fus
il , C hiens , C hien c o u c h a n t , C hien çou-r
r a n t , L imier , L evrier , C o uteau de chasse ,
Fil e t , Pie g e , C ors ou T r o m p e , &c.\esfilets,
aux articles des différentes fortes de filets ; les pièges,
aux différentes fortes de pièges; l(es détails de la fauconnerie
aux oifeaux , & autres animaux qu’on
pourfuit à cette chaffie , à ceux avec lefquels ôn la fait ;
&c fes généralités , à l'article Fauconnerie. Foye^
aufli fur la grande chaffie ou chaffie d cors & à cri { car
on diftribue aufli la chaffie en grande & haute , qui
comprend celle des bêtes fauves 6c de quelques autres
animaux ; en baffe ou petite, qui s’étend au refte
des animaux) Foye^ dis-je, les articles VÉNERIE ,
Bêtes , Bêtes noires , fauves , bc. ' ,
La chaffie eft un des plus anciens exercices. Les fables
des Poètes qui nous peigpent l’homme en troupeau
avant que de nous le repréfenter en fociété ,
lui mettent les armes à la main, & ne lui fuppofent
d’occup-.
^’occupation journalière que la chaffie. L’Ecrituré-
fainte qui nous tranfmet l’hiftoire réelle du genre humain
, s accorde avec la fable pour nous conftater
l ’ancienneté de la chaffie: elle dit que Nemrodfut un
grand chaffeur aux yeux du Seigneur, qui le rejetta.
C ’eft une occupation profcrite dans le livre de Moyfe;
c ’efl: une ocupation divinifée dans la théologie
payenne. Diane étoit la patrone des chaffeurs ; on
l ’invoquoit en partant pour la chaffie ; on lui facri-
fioit au retour l’a r c , les fléchés , & le carquois.
Apollon partageoit avec elle l’encens des chaffeurs.
On leur attribuoit à l’un & à l’autre l’art de dreffer
des chiens , qu’ils communiquèrent à Chiron , pour
honorer fa juftice. Chiron eut pour éleves, tant dans
cette difcipline qu’en d’autres, la plûpart des héros
de l’antiquité.
^ Voilà ce que la Mythologie & l’Hiftoire fainte ,
c eft-a-dire le menfonge & la vérité , nous racontent
de 1 ancienneté de la chaffie. Voici ce que le bon fens
fuggere fur fon origine. Il fallut garantir les troupeaux
des loups 6c autres animaux carnaciers ; il fallut
empecher tous les animaux fauvages de ravager
les moiffons : on trouva dans la chair de quelques-
uns des alimens fains ; dans les peaux de prefque tous
une reffource très prompte pour les vêtemens : on
fut intéreffé de plus d’une maniéré à la deftruâion
des ^ betes malfaifantes : on n’examina guere quel
droit on avoit fur les autres ; 6c on les tua toutes
indiftin&ement , excepté celles dont on efpéra de
grands fervices en les confervant.
- L’homme devint donc un animal très-redoutable
pour tous les autres animaux. Les efpeces fe dévorèrent
les unes les autres , après que le péché d’Adam
eut répandu entre elles les femences de la dif-
fention. L’homme les dévora toutes. Il étudia leur
maniéré de v iv r e , pour les. furprendre plus facilement
; il varia fes embûches félon la variété de leur
caraûere & de leurs allures ; ilinftruifit le chien, il
monta fur le cheval, il s’arma du dard , i f aiguifa la
fléché 6c bien-tôt il fit tomber fous fes coups le lion,
le tigre, l’ours, le léopard : il perça dé fa main depuis
l’animal terrible qui rugit dans les forêts, juf-
qu’à celui qui fait retentir les airs de fes chants inno
cens ; & l’art de les détruire fut un art très-étendu
, très-exercé , très-utile , 6c par conféquent fort
honoré.
Nous ne fuivrons pas les progrès de cet art depuis
les premiers tems jufqu’aux nôtres , les mémoires
nous manquent ; 6c ce qu’ils nous apprendroient,
quand nous en aurions , ne ferait pas affez d’honneur
au genre humain pour le regretter. On voit
en général que l’exercice de la chaffie a été dans tous
les fiecles 6c chez toutes les nations d’autant plus
commun , qu’elles étoient moins eivilifées. Nospe-
res beaucoup plus ignora ns que nous, étoient beaucoup
plus grands chaffeurs..
,Lés anciens ont eu la chaffi aux quadrupèdes 6c la
chaffie aux oifeaux1;'ils ont fait l’une & l’autre avec
l’arme, le chien , 6c le faucon. Ils furprenoient des
animaux dans les embûches , ils en forçoient à la
C0urfe , its! enluoient avec la fléché &rle dard ; ils
alloient au: fond des forêts chercher les plus farouches
, ils én enfermoient dans des pafcs , 6c ils en
pourfuivoient dans les campagnes & lesplaines. On
voit dans les antiques , des empereurs même le vena-
hulum h ln main. Le vendbulunt étoit une efpeeê de
piqué. Ils' dreffoient des; chiens avec foin ; ils en fai-
foient venir de toutes les contrées , qu?ils appli-
quoient à‘ différentes chaffiés, félon leurs différentes
aptitudes naturelles; L’ardeur de la proie établit en-
tre le chien, l’homme;, lé cheval, 6c le vautour, une
efpece de. fociété qui a commencé de très-bonne
heure , qui n’a jamais ceffé, 6c qui durera toujours.
• Nous nç chaffons plus guere que des animaux
Tome ///, 1
innocens, fl l’on en excepte l’ours , le fanglier 6c le
loup. On chaffoit autrefois le lion, le tigre, la panthère
, &c. Cet exercice ne pouvoit être que très-
dangereux. Foye^ aux différens articles de cès, animaux
, la maniéré dont on s’y prenoit. Obfervons
feulement i c i , i° qu’en recueillant avec exaôitude
tout ce que les anciens 6c les modernes ont dit pour
ou contre la chaffie, 6c la trouvant prefqu’aufli fou-
vent loüee que blâmée , on en conclurait que c’eft
une chofe affez indifferente. z°. Que le même peuple
ne l’a pas également loiiée ou blâmée en tout
tems. Sous Sallufte, la cluiffe etoit tombée dans un
fouverain mépris ; & le s Romains, ces peuples guerriers,
loin de croire que cet exercice fût une image
de la guerre, capable d’entretenir l’humeur martiale,
6c de produire tous les grands effets en conféquence
defquels on le croit juftement réfervé à la nobleffe
6c aux grands: les Romains, dis-je, n’y employoient
plus que des efclaves. 30. Qu’il n’y a aucun peuple
chezqui l’on n’ait été contraint deréprimer la fureur
de cet exercice par des lois : b r la néceflité de faire
des lois eft toûjours une chofe fâcheufe ; elle fyp-
pofe des aâions ou mauvaifes en elles-^mêmes, ou
regardées comme telles , 6c donne lieu à une infinité
d’infraûions 6c de châtimens. 40. Qu’il eft venu
des tems oii l’on en a fait un apanage fi particulier
à la nobleffe, qu’ayant négligé toute autre étude ,
elle ne s’eft plus connue qu’en chevaux, qu’en chiens
6c en oifeaux. 50. Que ce droit a été la fource d’un«
infinité de jaloufies 6c de diffentions ,même entre les
nobles; & d’une infinité de léfions envers leurs vaf-
faux, dont les champs ont été abandonnés au ravage
des animaux refervés pour la chaffie. L’agriculteur a
vu fes moiffons confommées par des cerfs , .des fan-
gliers , des daims, des oifeaux de toute efpece ; le
fruit de fes travaux perdu, fans .qu’il lui fût permis
d’y^obvier, & fans qu’on lui accordât de dédommage-:
ment. 6°. Que l’injuftice a été portée dans certains
pays au point de forcer lepayfan à chàffer, 6c à acheter
enfuite de fon argent le gibier qu’il avait pris.
C eft dans la même contrée qu’un homme fut condamné
à être attaché v if fur un cerf , pour avoir
ehaffé un de ces animaux. Si c’eft quelque chofe de
fi précieux que la vie d’un cerf , pourquoi en tuer }
fi ce n’eft rien , f ila vie d’un homme vaut mieux
que celle de tous les cerfs, pourquoi punir uuhomme
de mort pour avoir attenté à la vie d’un ce r f’? 70.
Que le goût pour la chaffe dégénéré prefque toujours
en paftion; qu’alors il abforbe un. tems précieux ,
nuit à là fanté , 6c occafionne des dépenfes qui dérangent
la fortune desgrands ,& qui ruinent les particuliers.
8°. Enfin que les lois qu’on a été obligé de
faire pour en reftraindre les abus , fe font multipliées
au point qu’elles ont formé un code très-étendu : cé
qui n’a pas été le moindre de fes inconvéniens; Foye£
dans l'article fuivant la fatyr-e de la chaffie , continuée
dans l’expofition des points principaux de ce
code.
C hasse ,{Jurifprud. ) fuivantledroit naturel, la
chaffie étoit libre à tous les hommes. C ’eft un des plus
anciens moyens d’acquérir fuivant le droit naturel.
L’ufage de la chaffie étoit encore libre à tous les hommes
, fuivant le droit des gens.
Le droit civil de chaque nation apporta quelques
reftriftions à cette liberté indéfinie.
Solon voyant que le peuple' d5Athènes négligeoit
les arts méchaniques pour s’adonner à la chaffie. l a
défendit au peuple, défenfè qui fût depuis méprifée.
Chez les Romains, chacun'pouvoit chaffer , foit
dans fon fonds, foit dans celui d’autrui ; mais il
étoit libre au .proprié taire de chaque héritage d’em-
pécher qu’un autre particulier n’entrât dans fon
fonds, foit pour chaffer, ou autrement. Inflit. H b.
I l.t it . i, § , xij.
F f