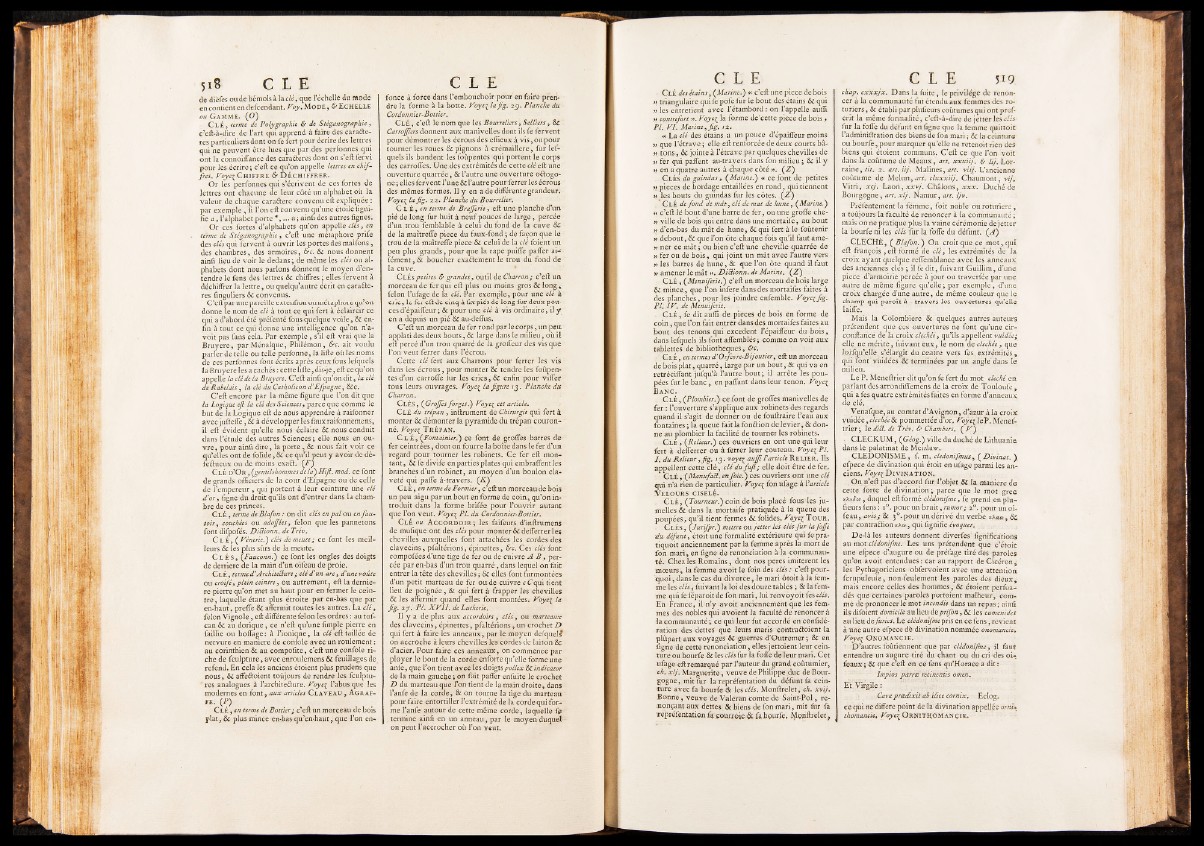
de dièfes ou de bémols à la clé, que l’échellé du mode
en contient en defeendant. Viy. Mode , & Echelle
ou Gamme. (O)
C l É, terme de Polygraphie & de Stèganographie,
c’eft-à-dire de l’art qui apprend à faire des caraâe-
res particuliers dont on fe lert pour écrire des lettres
qui ne peuvent être lues que par des perfonnes qui
ont la connoiffance des cara&eres dont on s’eft fervi
pour les écrire ; c’eft ce qu’on appelle lettres en chiffres.
Voyt{ C hiffre & D échiffrer.
Or les perfonnes qui s’écrivent de ces fortes de
.lettres ont chacune de leur côté un alphabet où la
valeur de chaque caraftere convenu eft expliquée :
par exemple , fi l’on eft Convenu qu’une étoile figni-
fie a y l’alphabet porte * ,... a; ainfi des autres fignes.
Or ces fortes d’alphabets qu’on appelle clés, en
terme de Stèganographie, c’eft une métaphore prife
des clés qui fervent à ouvrir les portes desmaifons,
des chambres, des armoires, &c. & nous donnent
ainfi lieu de voir le dedans ; de même les clés ou alphabets
dont nous parlons donnent le moyen d’entendre
le fens des lettres & chiffres ; elles fervent à
déchiffrer la lettre, ou quelqu’autre écrit en caractères
finguliers & convenus.
C ’eftpar une pareille extenfion oumétaphore qu’on
donne le nom de clé à tout ce qui fert à éclaircir ce
qui a d’abord été préfenté fous quelque v o ile, & enfin
à tout ce qui donne une intelligence qu’on n’a-
voit pas fans cela. Par exemple, s’il eft vrai que la
Bruyere, parMénalque, Philémon, &c. ait voulu
parler de telle ou telle perfonne, la lifte où les noms
de ces perfonnes font écrits après ceux fous lefquels
la Bruyere les a cachés : cette lifte, dis-je, eft ce qu’on
appelle la. clé de la Bruyere. C’eft ainfi qu’on dit, la clé
de Rabelais, la clé du Catholicon d'Efpagne, &c.
C’eft encore par la même figure que l’on dit que
la Logique efi la clé des Sciences, parce que comme le
but de la Logique eft de nous apprendre à raifonner
avec jufteffe, & à développer les fauxraifonnèmens,
il eft évident qu’elle nous éclaire & nous conduit
dans l’étude des autres Sciences ; elle nous en ouv
re , pour ainfi dire, la porte, ôc nous fait voir ce
qu’elles ont de folide, & ce qu’il peut y avoir de défectueux
ou de moins exaêt. (F )
C lÉ d’Or , (gentilshommes de la) Hiß. mod. ce font
de grands officiers de la cour d’Elpagne ou de celle
de l’empereur , qui portent à leur ceinture une clé
tPor, ligne du droit qu’ils ont d’entrer dans la chambre
de ces princes.
C lÉ , terme de Blafon : on dit clés en pal ou enfau-
toir, couchées ou adojfèes, félon que les pannetons
font difpofés. Diclionn. de Trév.
C l é , ( Vénerie.) clés de meute; ce font les meilleurs
& les plus sûrs de la meute.
C l é s , ( Fauconn.) ce font les ongles des doigts
de derrière de la main d’un oifeau de proie.
C lÉ, terme d*Architecture ; clé d'un arc, d'une voûte
ou croifé, plein ceintre, ou autrement, eft la dernière
pierre qu’on met au haut pour en fermer le ceintre
, laquelle étant plus étroite par en-bas que par
en-haut, preffe & affermit toutes les autres. La clé,
félon Vignole, eft.différente félon les ordres : au tof-
can & au dorique, ce n’eft qu’une fimple pierre en
faillie ou boffage: à l’ionique, la clé eft taillée de
nervure en maniéré de confole avec un roulement :
au corinthien & au compofite, c’eft une confole riche
de fculpture, avec enroulemens & feuillages de^
refend. En cela les anciens étoient plus prudens que
nous, & affe&oient toujours de rendre les fculptu-
*res analogues à l’architeôure. Voye^ l’abus que les
modernes en font, aux articles C lave au , A graff
e . (P )
C lé f en terme de Bottier; c’eft un morceau de bois
plat, & plus mince en-bas qu’en-haut, que l’on enfonce
à force dans l’embouchoir pour en faite pfeii*
dre la forme à la botte. Voye^la fig. 2^. Planche du
Cordonnier-Bottier.
C lÉ , c’eft le nom que les Bourreliers, Selliers, &
CarroJJiers donnent aux manivelles dont ils fe fervent
pour démontrer les écrous des eflieux à v is , ou pour
tourner les roues & pignons à crémaillère, fur lefquels
ils bandent les foûpentes qui portent le corps
des carroffes. Une.des extrémités de cette clé eft une
ouverture quarrée, & l’autre une ouverture oétogo-
ne ; elles fervent l’une & l’autre pour ferrer les écrous
des mêmes formes. Il y en a de différente grandeur.
Voye£ la fig. 22.. Planche du Bourrelier.
C l é y en terme de Brajferie, eft une planche d’un
pié de long fur huit à neuf pouces de large, percée
d’un , trou femblable à celui du fond de la cuve Sc
de la maîtreffe piece du faux-fond ; de façon que le
trou de la maîtreffe piece & celui de la clé foient un
peu plus grands, pour que la râpe puiffe paffer ai-''
l'ément, & boucher exactement le trou du fond de
la cuve.
C lÉs petites & grandes, outil As Charron; c’eft un
morceau de fer qui eft plus ou moins gros & long *
félon l’ufage de la clé. Par exemple, pour une clé A
cric, le fer eft de cinq à fixpiés de long fur deux pouces
d’épaiffeur ; & pour une clé à vis ordinaire, il y
en a depuis un pié & au-deffus. .
C’eft un morceau de fer rond par le corps , un peu
applati des deux bouts, & large dans le milieu, où il
eft percé d’un trou quarré de la groffeur des vis que
l ’on veut ferrer dans l’écrou.
Cette clé fert aux Charrons pour ferrer les vis
dans les écrous, pour monter & tendre les foûpentes
d’un carroffe lur les crics, & enfin pour viffer
tous leurs ouvrages. Voye^ la figure 13. Planche du
Charron.
C lÉS , ( Groffes forges.) Voye£ cet article.
C lé du trépan, inftrument de Chirurgie qui fert à
monter & démonter la pyramide du trépan couronné.
Voye^ T répan.
C l é , (Fontainier.) ce font de groffes barres de
fer ceintrées, dont on fourre la boîte dans le fer d’un
regard pour tourner les robinets. Ce fer eft montant,
& fe divife en parties plates qui embraffentles
branches d’un robinet, au moyen d’un boulon cla-
veté qui paffe à-travers. (K )
C le , en terme de Formier, c’eft un morceau de bois
un peu aigu par un bout en forme de coin , qu’on introduit
dans la forme brifée pour l’ouvrir autant
que l’on veut. Voye? PI. du Cordonnier-Bottier.
C lé ou A c c o r d o ir ; les faifëurs d’inftrumens
de mufique ont des clés pour monter & defferrer les
chevilles auxquelles font attachées les cordes des
clavecins, pfaltérions, épinettes, &c. Ces clés font
compofées d’une tige de fer ou de cuivre A B , percée
par en-bas d’un trou quarré, dans lequel on fait
entrer la tête des chevilles ; & elles font furmontées
d’un petit marteau de fer ou de cuivre c C qui tient
lieu de poignée, & qui fert à frapper les chevilles
& les affermir quand elles font montées. Voye[ la
fig. z j . PL. X V I I . de Lutherie.
Il y a de plus aux accordoirs , clés, ou marteaux
des clavecins, épinettes, pfaltérions, un crochet D
qui fert à faire les anneaux, par le moyen defquel£
on accroche à leurs chevilles les cordes de laiton èc
d’acier. Pour .faire ces anneaux, on commence par
ployer le bout de la corde enforte qu’elle forme une
anfe, que l’on tient avec les doigtspollex & indicator
de la main gauche ; on fait paffer enfuite le crochet
D du marteau que l’on tient de la main droite, dans
l’anfe de la corde, & on tourne la tige du marteau
pour faire entortiller l’extrémité de la corde qui for-' '
me l’anfe autour de cette même corde, laquelle fe
termine ainfi en un anneau, par le moyen duquel
on peut l’accrocher où l’on Y*ut.
- C l É des étains, (Marinei ) « c’eft une piece de bois
>> triangulaire quilépofe fur le bout des étains & qui
» les entretient avec l’étambord : on l’appelle aufli
» contrefort ». Voye^ la forme de'cette piece de bois ,
PL VI. Marine, f ig . 12 *
« La clé des étains a un pouce d’épaiffeur moins
» que l’étrave ; elle eft renforcée de deux courts bâ-
» tons, & jointe à l’étrav.e par quelques chevilles de
» fer qui paffent au-travers dans fon milieu ; & il y
» en a quatre autres à chaque côté ». (Z )
. C l É s du guindas , (Marine.) « ce font de petites
» pièces de bordage entaillées en rond, qiii tiennent
» les bouts du guindas fur les cotes. (Z )
C l é de fond de mât, clé de mat de hune, (Marine.)
« c’eft lé bout d’une barre de fer, ou une groffe che-
» ville de bois qui entre, dans une mortaife, au bout
» d’en-bas du mât de hune, & qui fert à le foûtenir
» débout, & que l’on ôte chaque fois qu’il faut ame-
» ner ce mât ; ou bien c’eft une cheville quarrée de
» fer ou de bois , qui joint un mât avec l’autre vers
» les barres de hune, & que l’on ôté quand il faut
» amener le mât ». Diclionn. de Marine. (Z )
Clé , (Menuiferie.) c’eft un morceau de bois large
& mince, que l’on inféré dans des mortaifes faites à
des planches, pour les joindre enfemble. Voye^fig.
P L IV . de Menuiferie.
. C l é , fe dit aufli de pièces de bois en forme de
coin, que l’on fait entrer dans des mortaifes faites au
Bout des tenons qui excédent Pépaiffeur du bois,
dans lefquels ils font affemblés ; comme on voit aux
tablettes de bibliothèques, &c.
ClÉ , en termes d'Orfevre-Bijoutier, eft un morceau
de bois plat, quarré, large par un bout, & qui va en
retréciffant jufqu’à l’autre bout ; il arrête les poupées
fur le banc, en paffant dans leur tenon. Voye£
Ba n c . C l é , (Plombier.) ce font de groffes manivelles de
fer : l’ouverture s’applique aux robinets des regards
quand il s’agit de donner ou de fouftraire l’eau aux
fontaines ; la queue fait lafonCtion de levier, & donne
au plombier la facilité de tourner les robinets.
C l é -, (Relieur.) ces ouvriers en ont une qui leur
fert à defferrer ou à ferrer leur couteau. Voye{ PI.
I . du Relieur, fig. 13. voyeç auffi Carticle R elier. Ils
appellent cette c lé , clé du fujt; elle doit être de fer.
Clé , (Manufacl, en foie.) ces ouvriers ont Une clé
qui n’a rien de particulier. Voyeç fonufage à Y article
.Velours cise lé. C l é , (Tourneur.) coin de bois placé’ fous'les jumelles
& dans la mortaife pratiquée à la queue des
poupées, qu’il tient fermes & folides, Voye^ T our. C l É S , (Jurifpr.) mettre ou jetter lés clés fur la fôjfè
du défunt, étoit une formalité extérieure qui fe pra-
tiquoit anciennement par la femme après la mort de
fon mari, en figne de renonciation à la communauté.
Chez les Romains, dont nos peres imitèrent les
moeurs ’, la femme avoit le foin des clésc c’eft pourquoi
, dans le cas du divorce, le mari ôtoit à là femme
les clés, fuivant la loi des douze tables ; & la femme
qui fe féparoit de fon mari, lui ren vôyoit fes clés.
En France, il n’y avoit anciennement que les femmes
des nobles qui a voient la faculté de renoncer à
la communauté ; ce qui leur fut accordé en confidé-
ration des dettes que leurs maris cofitraâoient la
plûpàrt aux voyages & guerres d’Outremer; & en
figne de cette renonciation, elles jettoient leur ceinture
ou bourfe & 1 es clés fur la foffé de leur mari. Cet
ufage eft remarqué par l’auteur du grand coûtümier,
ch. xlj. Marguerite, veuve de Philippe düc de Bourgogne,
mit fur la repréfentation du défunt fa ceinture
avec fa bourfe & les clés. Monftrelet, ch. xvij.
Bonne, veuve de Valeran comte de Saint-Pôl, renonçant
aux dettes & biens de fon mari, mit fur fa
repréfentation fa courroie & fa bourfe, Monftrelet,
> chap. c x x x jx . Dans la fuite, le privilège de renoncer
à la communauté fut étendu aux femmes des roturiers
, & établi par plufieurs coûtumes qui ont pref-
; crit la même formalité, c’eft-à-dire de jetter les clés
fur la foffe du défunt en figne que la femme quittoit
f l’adminiftration des biens de fon mari ; & la ceinture
ou bourfe, pour marquer qu’elle ne retenoit rien des
biens qui étoient communs. C’eft ce que l’on voit
dans la coûtume de Meaux, art. x x x ï i j. & Uj. Lorraine,
tit. 2 . a r t.iij. Malines, art. viij. L’ancienne
coûtüme de Melun, art. c lx x x iij. Chaumont, vij,
Vitri, x c j. Laon, x x v j. Châlons, x x x . Duché de
Bourgogne, art. x l j . Namur, art. Ijv.-
Préfentement la femme, foit noble ou roturière,
a toûjours la faculté de renoncer à la communauté ;
mais on ne pratique plus la vaine cérémonie de jetter
la bourfe ni les clésTur la foffe du défunt. (A)
CLECHÉ, ( Blafon. ) On croit que ce mot, qui
eft françois , eft formé de c lé , les extrémités de la
croix ayant quelque reffemblance avec les anneaux
des anciennes clés ; il fe dit, fuivant Guillim, d’une
piece d’àrmoirie percée à jour ou traverfée par une
autre de même figure qu’elle ; par exemple, d’une
croix chargée d’une autre, de même couleur que le.
champ qui paroît à - travers les ouvertures qu’elle
laiffe.
Mais la Colombiere & quelques autres auteurs
prétendent que ccs ouvertures ne font qu’une cir-
conftancé de la croix clechéé, qu’ils appellent vuidèe;
elle ne mérité, fuivant eux , le nom de clechée , que
JoHqu’ellè. s’élargit du centre vers fes, extrémités ,
qui font vuidées & terminées par un angle dans le
riiilieU.
Le P. Meneftrier dit qu’on fe fert du mot clechc en
parlant des arrondiffemens de la croix dé Toüloufe ,
qui a fes quatre extrémités faites en forme d’anneaux
de clé.
Vénàfque, au comtat d’Avignon, d’azur à la croix
vuidéè, clechée & pommettée dor. Voÿé^XéP. Meneftrier
; le dict. de Trév. & Chambers. ( V )
■ CLECKUM, (Géog.) ville du duché de Lithuanie
dans le palatinat de Mcizlaw.
. CLEDONISME, f. m. cledonifmus, ( Divinat. )_
efpece dé divination qui étoit en ufage parmi les anciens,
Voye^ Divination.
, Or\ n’eft pas d’accord fur l’objet & la maniéré de
cette forte de divination; parce que le mot <*rec
' y.Xtéov, duquel eft formé clédonifme, fe prend en plufieurs
lens : i°. pour un bruit, rumor; z°. pour un oifeau,
avis; & 30. pour un dérivé du verbe 6c
par contraction kXü> , qui lignifie évoquer.
De-là les auteurs donnent diverfes; lignifications
au mot clédonifme. Les uns prétendent que c’étoit
une efpece d’augure ou de préfage tiré dés paroles
qu’on avoit entendues : car au rapport de Cicéron ;
lés Pythagoriciens obfervoient avec une attention
fcrupuleufe, non-feulement les paroles des dieux,
mais encore celles des hommes, & étoient perfua-
dés que certaines paroles portoient malheur , comme
de prononcer le mot incendie dans un repas ; ainfi
ilsdifoient domicile aülïeü.deprifon, & les eumenides
au lieu dê furies. Le clédonifme pris en ce fens, revient
à une autre efpece dè divination nommée onomancie•
Voye^ Q nomancie.
- : D ’autres foûtiennent que par clédonifme; il faut
entendre un augure tiré dit chant ou du crLdes oi-
feaux ; & que c’eft én c e ferts qu’Horaeè a dit :
■ Impios pàrrce rètifiéntis omen.
Et Virgile :
Cava pradixit ab ilice cornix. . Eclog.
1 ce qui ne différé point de la divination appellée orni\
J thomancie, ORNITHOMANCIE.