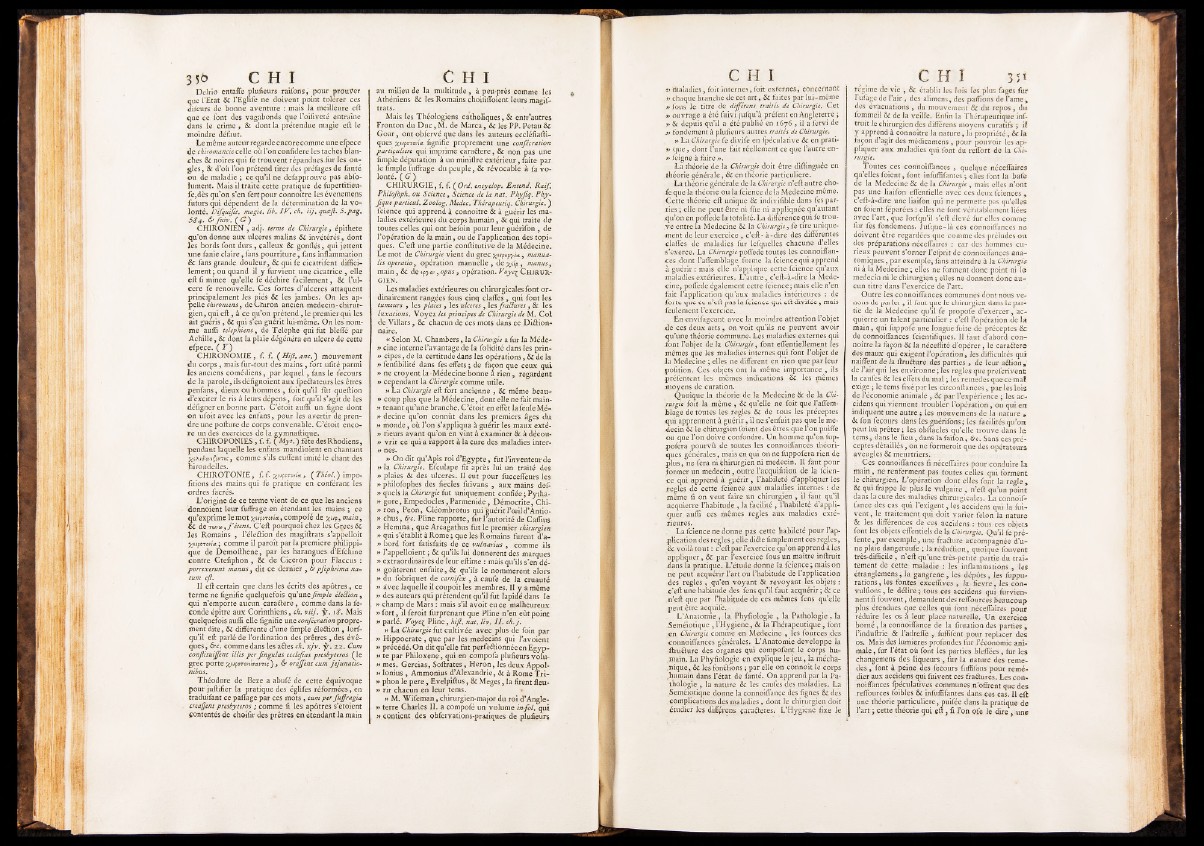
Delrio entaffe plufieurs raifons, pour prouver
que l’Etat & l’Eglife ne doivent point tolerer ces
difeurs de bonne aventure : mais la meillèure eft
que ce font des vagabonds que l’oifiveté entraîne
dans le crime > & dont la prétendue magie eft le
moindre défaut.
Le même auteur regarde encore comme une efpece
de chiromanc 'u celle oit l’on confidere les taches blanches
& noires qui fe trouvent répandues.fur les ongles,
& d’où l’on prétend tirer des préfages de fanté
ou de maladie ; ce qu’il ne defapprouve pas abfo-
lument. Mais il traite cette pratique de fupertitieu-
fe,dès qu’on s’en fert pour connoitre les évenemens
futurs qui dépendent de la détermination de la vo lonté.
Difquifit. magic, lib. IK. ch. iij. quaft. 5. pag.
584. & fuiv. ( G )
CHIRONIEN , adj. terme de Chirurgie, épithete
qu’on donne aux ulcérés malins & invétérés, dont
les bords font durs, calleux & gonflés, qui jettent
une fanie claire, fans pourriture, fans inflammation
& fans grande douleur, & qui fe cicatrifent difficilement
; ou quand il y furvient une cicatrice , elle
eft fi mince qu’elle fe déchire facilement, & l’ul-
cere fe renouvelle. Ces fortes d’ulceres attaquent
principalement les piés & les jambes. On les appelle
chironiens, deChiron ancien médecin-chirurgien,
qui e f t , à ce qu’on prétend, le premier qui les
ait guéris , & qui s’en guérit lui-même. On les nomme
auffi telephiens, de Telephe qui fut bleffé par
Achille, & dont la plaie dégénéra en ulcéré de cette
efpece. ( T )
CHIRONOMIË, f. f. {Hift* anc.') mouvement
«du corps, mais fur-tout des mains, fort ufité parmi
les anciens comédiens, par leque l, fans le fecoiirs
de la parole, ilsdéfignoient aux fpeâateurs les êtres
penfans, dieux ou hommes , foit qu’il fut queftion
cl’exciter le ris à leurs dépens, foit qu’il s’agît de les
défigner en bonne part. C’étoit auffi un ligne dont
on ufoit avec les enfans, pour les avertir de prendre
une pofture de corps convenable. C ’étoit encore
un des exercices de la gymnaftique.
CHIROPONIES, f. f. (M yt.) fête des Rhodiens,
pendant laquelle les enfans mandioient en chantant
%eX/<T'owfo'mç, comme s’ils euffent imité le chant des
hirondelles.
CHIROTONIE, f. f. xupoToviec y ( Théol. ) importions
des mains qui fe pratique en conférant les
ordres facrés.
L’origine de ce terme vient de ce que les anciens
donnoient leur fuffrage en étendant les mains ; ce
qu’exprime le mot x tlpc‘T0V‘a , compofé de x up9 main,
& de tuva , j ’étens. C ’eft pourquoi chez les Grecs &
les Romains , l’éleôion des magiftrats s’appelloit
xnporovia ; comme il paroît par la première philippi-
que de Demofthene, par les harangues d’Efchine
contre Ctefiphon , & de Cicéron pour Flaccus :
porrexerunt manus, dit ce dernier , & pfephrima nutum
eft.
Il eft certain que dans les écrits des apôtres, ce
terme ne fignifîe quelquefois qu’une fimple élection,
qui n’emporte aucun caraftere, comme dans la fécondé
épître aux Corinthiens, ch. v iij. ÿ . 18. Mais
quelquefois auffi elle lignifie une confécration proprement
dite, & differente d’une fimple éleâion , lorf-
qu’il eft parlé de l’ordination des prêtres, des évêques,
&c. comme dans les aftes ch. xjv. ÿ . 22. Cum
confituiffent illis per Jingulas ecclejias presbyttros ( le
grec porte ^«/poTov»Vamf ) , & orajjent cum jejunatio-
nibus.
Théodore de Beze a abufé de cette équivoque
pour juftifier la pratique des églifes réformées, en
traduifant ce paffage par ces mots, cum per fuffragia
creaffent presbyteros ; comme fi les apôtres s’étoient
contentés de choifir des prêtres, en étendant la main
au milieu de la multitude, à peu-près comme les
Athéniens & les Romains choififToient leurs magiftrats.
Mais les Théologiens catholiques, & entr’autres
Fronton du D u c , M. de Marca, & les PP. Petau &
G oa r, ont obfervé que dans les auteurs eccléfiafti-
ques x^poTwi* fignifîe proprement une confécration
partiçuliere qui imprime caraûere, & non pas une
fimple députation à un miniftre extérieur, faite par
le fimple fuffrage du peuple, & révocable à fa volonté.
( G )
CHIRURGIE, f. f. ( Ord, encyclop. Entend. Raif
Pkilofoph. ou Science, Science de la nat. Phyftq. Phy-
fique particul. Zoolog. Medec. Thérapeutiq. Chirurgie. )
fcience qui apprend à connoître & à guérir les ma-
ladies extérieures du corps humain, & qui traite de
toutes celles qui ont befoin pour leur guérifon , de
l’opération de la main, ou de l’application des topiques.
C’eft une partie conftitutive de la Médecine.
Le mot de Chirurgie vient du grec xupvpyi*, manua-
lis operatio, opération manuelle, d e x*‘p , manus,
main, & de tpyov, opus, opération. Voye^ C hirurgien.
Les maladies extérieures ou chirurgicales font ordinairement
rangées fous cinq claffes , qui font les
tumeurs , les plaies , les ulcérés , les fractures, & les
luxations. Voyez les principes de Chirurgie de M. Coi
de Villars, &: chacun de ces mots dans ce Didion-
naire.
« Selon M. Chambers, la Chirurgie a fur la Méd.e-*
» eine interne l’avantage de la folidité dans les prin-
» cipes, de la certitude dans les opérations, & delà
» fenfibilité dans fes effets ; de façon que ceux qui
» ne croyent la • Médecine bonne à rien, regardent
» cependant la Chirurgie comme utile.
» La Chirurgie eft fort ancienne , & même beau-
» coup plus que la Médecine, dont elle ne fait main-
» tenant qu’une branche. C ’étoit en effet la feule Mé-
» decine qu’on connût dans les premiers âges du
» monde, oii l’on s’appliqua à guérir les maux exté-
» rieurs avant qu’on en vînt à examiner & à déequ-
» vrir ce qui a rapport à la cure des mâladies inter-
» nés.
» On dit qu’Apis roi d’Egypte, fut l’inventeur de
» la Chirurgie. Efculape fît après lui un traité des
» plaies & des ulcérés. Il eut pour fucceffeurs les
» philofophes des fiècles fuivans , aux mains def-
>> quels la Chirurgie fut uniquement confiée ; Pytha-
» gore, Empedocles, Parmenide, Démocrite, Chi-
» ro n , Peon, Cléombrotus qui guérit l’oeil d’Antio-
» chus, &c. Pline rapporte, fur l’autorité de Caffius
» Hemina, que Arcagathus fut le premier chirurgien
» qui s’établit à Rome ; que les Romains furent d’a-
» bord fort fatisfaits de ce vulnarius , comme ils
» l’appelloient ; & qu’ils lui donnèrent des marques
» extraordinaires de leur eftime : mais qu’ils s’en dé-
» goûtèrent enfuite, & qu’ils le nommèrent alors
» du fobriquet de carnifex , à caufe de la cruauté
» avec laquelle il coupoit les membres. Il y a même
» des auteurs qui prétendent qu’il fut lapidé dans le
» champ de Mars : mais s’il avoit eu ce malheureux
» fort, il feroit furprenant que Pline n’en eût point
» parlé. Voye%_ Pline, hift. nat. Uv. I I . ch. j .
» La Chirurgie fut cultivée avec plus de foin par
» Hippocrate, que par les. médecins qui l’avoient
» précédé. On dit qu’elle fut perfeétionnée en Egyp-
» te par Philoxene, qui en compofa plufieurs volu-
» mes. Gercias, Softrates, Héron, les deux Appol-
» lonius , Ammonius d’Alexandrie, & à Rome T ri-
» phon le pere, Evelpiftus, & Meges, la firent fleu-
» rir chacun en leur tems.
» M. Wifeman, chirurgien-major du roi d’Angle-
» terre Charles II. a compofé un volume infol. qui
» contient, des obfervations-pratiques de plufieurs
fiiaîadies, foit internes, foit externes, cotlcefrtafit
» chaque branche de cet art, & faites par lui-même
» fous le titre de différens traités de Chirurgie. Cet
*> ouvtage a été fuivi iufqu’à préfent en Angleterre ;
»» & depuis qu’il a été publié en 1676 , il a fervi de
» fondement à plufieurs autres traités de Chirurgie.
» La Chirurgie fe divife en fpéculative & en prati-
w ‘que, dont l’une fait réellement ce que l’autre en-
» feigne à faire ».
•La théorie de la Chirurgie doit être diftinguée en
théorie générale, & en théorie particulière.
La théorie générale de la Chirurgie n’eft autre eho-
fe que la théorie ou la fcience de la Medecine même.
Cette théorie eft unique & indivifible dans fes parties
i elle ne peut être ni fûe ni appliquée qu’autant
.qu’on en poffede la totalité. La différence qui fe trou-
,ve entre la Medecine & la Chirurgie, fe tire uniquement
de leur exercice , c’eft - à - dire des différentes
claffes de maladies fur lefquelles chacune d’elles
s ’exerce. La Chirurgie poffede toutes les connoiffan-
ces .dont l’affemblage. forme la fcience qui apprend
à guérir : mais elle n’applique cette fcience qu’aux
maladies extérieures. L’autre, c’eft-à-dire la Medecine,
poffede également cette fcience; mais elle n’en
fait l’application qu’aux maladies intérieures : de
forte que ce n’eft pas la fcience qui eft divifée, mais
feulement l’exercice.
En envifageant avec la moindre attention l’objet
de ces deux arts, on voit qu’ils ne peuvent avoir
qu’une théorie commune» Les maladies externes qui
font l’objet de la Chirurgie, font effentiellement les
mêmes que les maladies internes qui font l’objet de
la Medecine ; elles ne different en rien que par leur
pofition. Cès objets ont la même importance , ils
préfehtent les mêmes indications & les mêmes
.moyens de curation.
Quoique la théorie de la Medecine & de la Chirurgie
foit la même , & qu’elle ne foit que. l’affemblage
de toutes les réglés & de tous les préceptes
qui apprennent à guérir, il ne s’enfuit pas que le me-
xlecin & le chirurgien foient des êtres que l’on puiffe
ou que l’on doive confondre. Un homme qu’on fup-
pofera pourvû de toutes les connoiffances théoriques
générales, mais en qui on ne fuppofera rien de
plus, ne fera nifchirurgien ni médecin. Il faut pour
former un médecin, outre l’acquifition de la feien-
ice qui apprend à guérir, l’habileté d’appliquer les
.réglés de cette fcience aux maladies internes : de
même fi on veut faire un chirurgien , il faut qu’il
acqitierre l’habitude , la facilité , l’habileté d’appliquer
auffi ces mêmes réglés aux maladies extérieures.
. La fcience ne donne pas cette habileté pour l’application
des réglés ; elle diâe Amplement ces réglés,
& voilà tout : c’eft par l’exercice qu’on apprend à les
appliquer, & par l’exercice fous un maître inftruit
flans la pratique. L’étude donne la fcience ; mais on
ne peut acquérir l’art ou l’habitude dè l’application
des réglés , qu’en' voyant & revoyant les objets :
c’eft une habitude des fens qu’il faut acquérir ; & ce
n’eft que par l’habitude de ces mêmes fens qu’elle
peut être acquife.
L ’Anatomie , la Phyfiologie , la Pathologie , la
.Séméiotique , l’Hygiene, & la Thérapeutique, font
en Chirurgie comme en Medecine , les fources des
connoiffances générales. L’Anatomie développe la
ftruûure des organes qui compofent le corps hu-
rmain. La Phyfiologie en explique le jeu , la mécha-
.nique, & les fondions ; par elle on connaît le corps
„humain dans l’état de fanté. On apprend par la Pathologie
, la nature & les caufes des maladies. La
Séméiotique donne la connoiffance des ligne,s & des
, complications des maladies , dont le chirurgien doit
étudier les diffçrens caraderes. L’Hygiene fixe le
régime de viè , & établit les lois les plus fagés fur
I ufage de l’a i r , des alimens, des pallions de l’ame %
des évacuations , du mouvement & du repos, du
fommeil & de la veille. Enfin la Thérapeutique inl-
truit le chirurgien des différens moyens curatifs ; if
y apprend à connoître la nature, la propriété, & la
façon d’agir des médicamens , pour pouvoir les appliquer
aux maladies qui font du reffort de la Chirurgie.
Toutes ces connoiffances , quelque néceffaires
qu’elles foient, font infuffifantes ; elles font la bafe
de la Medecine & de la Chirurgie , mais elles n’ont
pas fine liaifon effentielle avec ces deux fciences ,
c’eft-à-dire une liaifon qui ne permette pas qu’elles
en foient féparées : elles ne font véritablement liées
avec l’art, que lorfqu’il s’eft élevé fur elles comme
fur fes fondemens. Jufque-là ces connoiffances ne
doivent être regardées que comme des préludes ou
des préparations néceffaires : car des hommes curieux
peuvent s’orner l’efprit de connoiffances anatomiques
, par exemple, fans atteindre à la Chirurgie
ni à la Medecine ; elles ne forment donc point ni le
nïedecin ni le chirurgien ; elles ne donnent donc aucun
titre dans l’exercice dé l’art.
Outre les cpnnoiffances communes dont nous venons
de parler, il faut que le chirurgien dans la partie
de la Medecine qu’il fe propofe d’exercer, ac-
quierre un talent particulier : c’eft l’opération de la
main, qui fuppofe une longue fuite de préceptes &:
de connoiffances feientifiques. Il faut d’abord connoître
la façon & la nécemté d’opérer, le caraûere
des maux qui exigent l’opération, les difficultés qui
naiffent de la ftru&ure des parties , de leur aétion „
de l’air qui les environne ; les réglés que preferivent
la caufes & les effets.du mal ; les remedes que ce mat
exige ; le tems fixé par les circonftances, par les lois
de l’économie animale , & par l’expérience ; les ac-
cidens qui viennent troubler l’opération, ou qui en
indiquent une autre ; les moüvemens de la nature >
& fon feeo.urs dans les guérifons ; les facilités qu’on
peut lui prêter ; les obftacles qu’elle trouve dans le
tems, dans le lieu, dans la fanon, &c. Sans ces préceptes
détaillés , on ne formeroit que des opérateurs
aveugles & meurtriers.
; Ces connoiffances fi néceffaires pour conduire la
main , ne renferment pas toutes celles qui forment
le chirurgien. L’opération dont elles font la réglé ,
& qui frappe le’ plus-Ie vulgaire , n’eft qu’un point
dans la cure des maladies chirurgicales. La connoiffance
des cas qui l’exigent, les accidens qui la fui-
vent, le traitement qui doit varier félon la nature
& les différences de ces accidens : tous ces objets
font les objets effentiels de la Chirurgie. Qu’il fe préfente,
par exemple, une frafture accompagnée d’une
plaie dangereufe ; la rédu&ion, quoique fou vent
très-difficile , n’eft qu’une très-petite partie du traitement
de cette maladie : les inflammations , les
étranglemens, la gangrené , les dépôts, les fuppu-
rations, les fontes excçffives 9 la fieyre, les con-
vulfions , le délire ; tous ces accidens qui furvien-
nent fi fouvent, demandent des reffources beaucoup
plus étendues que celles -qui font néceffaires pour
réduire les os à leur place naturelle. Un exercice
borné, la connoiffance de la fituation des parties ,
l’induftrie & l’adreffe , fuffifent pour replacer des
os. Mais des lumières profondes fur l’économie animale
, fur l’état où font les parties bleffées , lur les
changèmens des liqueurs , fur la nature des remedes
, font à peine des fecours fuffifans pour remédier
aux accidens qui fui vent ces fraâures. Les connoiffances
fpéculatives communes n’offrent que des
reffources foibles & infuffifantes dans ces cas. Il eft
une théorie particulière, puifée dans la pratique de
l’art ; cette théorie qui e ft , fi l’on ofe le dire, une