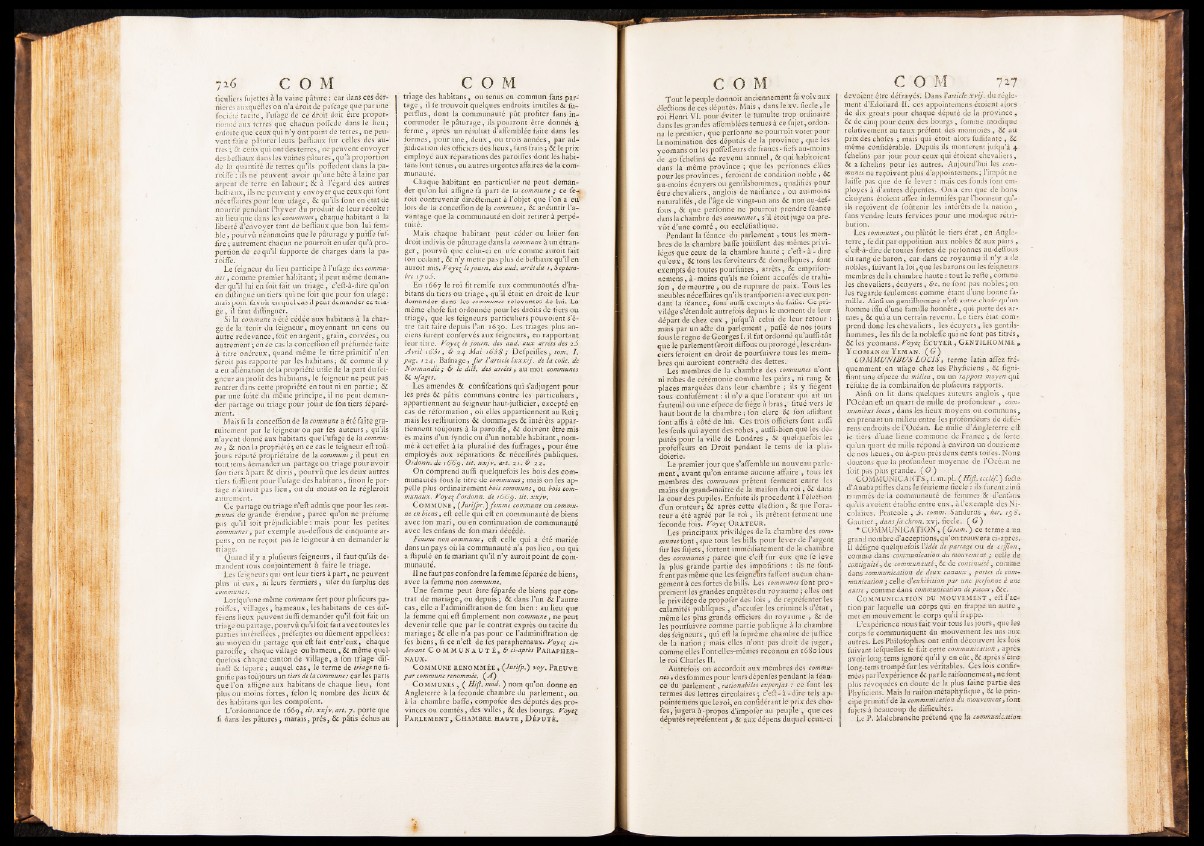
ticuliers Sujettes à la vaine pâture : car dans ces dernières
auxquelles on n’a droit de pafeage que par une
focicté tacite, l’ufage de ce droit doit être proportionné
aux terres que chacun polie de dans le lieu;
enloi te que ceux qui n’y ont point de terres, ne peuvent
faire pâturer leurs beftiaux fur celles des autres;
& ceux qui onrides terres, ne peuvent envoyer
des beftiaux d^ns les vaines pâtures, qu ’à proportion
de la quantité efe terres qu’ils poffedent dans la pa-
roifle : ils ne peuvent avoir qu’une bête à laine par
arpent de tèrre en labour; & à l’égard des autres
beftiaux, ils ne peuvent y envoyer que ceux qui font
néceffaires,pour leur ufage, & qu’ils font en état de
nourrir pendant l’hyvér du produit de leur récolte:
an lieu que dans les communes, chaque habitant a la
liberté d’envoyer tant de beftiaux que bon lui fem-
ble, pourvu néanmoins que le pâturage y puiffe fuf-
fire ; autrement chacun ne pourroit en ufer qu’à proportion
de ce qu’il fupporte de charges dans la pa-
rôiffe.' ' .......
Le fei»neur du lieu participe à l’ufage ùes communes
, comme premier habitant; il peut même demander
qu’il lui en foit fait un triage, c’eft-à-dire qu’on
en diftinguëun tiers qui ne foit que pour fon ufage:
mais pôur favoir en quel cas il peut demander ce triag
e , il faut diftinguer.
, Si la commune a été cédée aux habitans à la charge
de la tenir du feignêvtr, moyennant un cens ou
autre redevance, foit en argent, grain, corvées, ou
autrement ; en ce cas la conceflion eft préfumée faite
à titre onéreux, quand même le titre primitif n’en
feroit pas rapporté par les habitans; & comme il y
a eu aliénation de la propriété utile de la part du fei-
gneur au profit des habitans, le feigneür ne peut pas
rentrer dans cette propriété en tout ni en partie ; 8c
par une -fuite? du m'ente principe, il ne peut demander
partage ou triage pour jouir de fon tiers féparé-
ment. ^ ;
Mais fi la conceflion de la commune a été faite gratuitement
par le feigneür ou par fes auteurs, qu’ils
n’ayent donné aux habitans que l’ufage de la commune
, & non la propriété} en ce cas le leigneur eft toujours
réputé propriétaire de la commune ; il peut en
tout tems demander un partage ou triage pour avoir
fon tiers à part 8c divis, pourvû que les deux autres
fiers fuffiient pour l’ufage des habitans, linon le partage
n’aùroit pas lieu, ou du moins on le régleroit
autrement.
Ce partage ou triage n’eft admis que pour les communes
de grande étendue, parce qu’on ne préfume
pas qu’il loit préjudiciable : mais pour les petites
communes, par exemple au-deflous de cinquante ar-
pens, on ne reçoit pas le leigneur à en demander le
triage. H
Quand il y a plufieurs feigneurs, il faut qu’ils demandent
tous conjointement à faire le triage.
Les feigneurs qui ont leur tiers à part, ne peuvent
plus ni eux, ni leurs fermiers, ufer du furplus des
communes.
Lorfqu’une même commune fert pour plufieurs pa-
roiffes, villages , hameaux, les habitans de ces dif-
férens lieux peuvent àufli demander qu’il foit fait un
triage ou partage, pourvû qu’il foit fait avec toutes les
parties intéreffées , préfentes oudûement appeliées:
au moyen du partage qui eft fait entr’eux, chaque
paroifie, chaque village ou hameau, & même quelquefois
chaque canton de village, a fon triage dif-
tinft 6l léparé ; auquel ca s, le terme de triage ne lignifie
pas toujours un tiers de la commune: car les parts
que l’on afligne aux habitans de chaque lieu, font
plus ou moins fortes, félon lq nombre des lieux 8c
des habitans qui les compofent.
L’ordonnance de 1669, fit. xxjv. art. y . porte que
fi dans les pâtures, marais, prés, 8c pâtis échus au
triage des habitans, ou tenus en commun fans partage
, il le trouvoit quelques endroits inutiles & fu-
perflus, dont la communauté pût profiter fans incommoder
le pâturage, ils pourront être donnés à
ferme , après un rétultàt d’affemblée faite dans les
formes, pour une, deux, ou trois années, par adjudication
des ofticiers des lieux, lans frais ; 8c le prix
employé auX réparations des paroifles 'dont lès habitans
font tenus, ou autres urgentes affaires de la communauté.
Chaque habitant en particulier ne peut demander
qu’on lui afligne fa part de la commune ; ce fe-A
roit contrevenir directement à l’objet que l’on a eiF
lörs de la conceflion de la commune, ÔC anéantir l’a—
väntage que la communauté en doit retirer à perpétuité.
Mais chaque habitant peut céder ou louer fon
droit indivis de pâturage dans la commune à un étranger,
pourvû que celui-ci en ufe comme auroit fait
Ion cédant, 8c n’y mette pas plus de beftiaux qu’il en
auroit mis-. Voye^ le journ. des aud. arrêt du 1. Septembre
\yoS.
En 1667 le roi fit remife aux communautés d’ha-
bitans du tiers ou triage, qu’il étoit en droit de leur
demander dans les communes relevantes de lui. La
même chofe fut ordonnée pour les droits de tiers ou
triage, que les feigneurs particuliers pouvoient s’être
fait faire depuis l’an 1630. Les triages plus anciens
furent confervés aux feigneurs, en rapportant
leur titre. Voye[ le journ. des aud. aux arrêts des zS
Avril è 24 Mai t65S } Defpeiffes, tom. J.
pag. 124. Bafnage, fur l 'article Ixxxij. de la. coût, de
Normandie ; & le dicl. des arrêts, au mot communes
8c ufages.
Les amendes & confifcations qui s’adjugent pour
les prés 8c pâtis communs contre les particuliers ,
appartiennent au feigneür haut-jufticier, excepté en
cas de réformation, où elles appartiennent au Roi ;
mais les reftitutions 8c dommages 8c intérêts appartiennent
toûjours à la paroifle, 8c doivent être mis
ès mains d’un fyndic ou d’un notable habitant, nommé
à cet effet à la pluralité des fuffrages, pour être
employés aux réparations 8c néceflités publiques.
Ordonn. de t&Gg. tit. xxjv. .art. 21. & 22-.
On comprend auflï quelquefois les bois des communautés
fousle titre de communes; mais on les appelle
plus ordinairement bois communs, ou bois communaux.
Voye{ l'ordonn. de y G&ÿ. tit. xxjv.
COMMUNE, (Jurifpr.) femme commune ou commune
en biens , eft celle qui eft en communauté de biens
avec fon mari, ou en continuation de communauté
avec les enfans de fon mari décédé.
Femme non commune, eft celle qui a été mariée
dans un pays où la communauté n’a pas lieu, ou qui
a ftipulé en le mariant qu’il n’y auroit point de communauté.
11 ne faut pas confondre la femme féparée de biens,
avec la femme non commune.
Une femme peut être féparée de biens par contrat
de mariage, ou depuis ; 8c dans l ’un & l’autre
cas, elle a l’adminiftration de fon bien : au lieu que
la femme qui eft Amplement non commune, ne peut
devenir telle que par le contrat exprès ou tacite du
mariage ; 8c elle n’a pas pour ce l’adminiftration de
fes biens, fi ce n’eft de fes paraphernaux. Voye^ ci-
devant C o m m u n a u t é , & ci-après P a r a p h e r n
a u x .
C o m m u n e r e n o m m é e , (Jurifp.) voy. P r e u v e
par commune renommée. CA')
C o m m u n e s , ( Hiß. mod. ) nom qu’on donne en
Angleterre à la fécondé chambre du parlement, ou
à la chambre baffe, compofée des députés des provinces
ou comtés, des villes, 8c des bourgs. Voye£
P a r l e m e n t , C h a m b r e h a u t e , D é p u t é .
Tout le peuple donnoit anciennement Ci voix aux
élevions de ces députés. Mais , dans le xv. fiecle ♦ le
roi Henri VI. pour éviter le tumulte trop ordinaire
dans les grandes affemblées tenues à ce fujet, ordonna
le premier , que perfonne ne pourroit voter pour
la nomination des députés de la province, que les
ycomans ou les poffeffeurs de francs-fiefs au-mqins
de 40 fchelins de revenu annuel, & qui habitoient
dans la même province ; que les perfonnes élûes
pour les provinces, feroient de condition noble , 8c
au-moins écuyers ou gentilshommes, qualifiés pour
être chevaliers, anglois de naiffance , Ou au*moins
naturalifés, de l’âge de vingt-ain ans 8c non au-def-
fous^, & que perfonne ne pourroit prendre féance
dans la chambre des communes, s’il étoit juge ou prévôt
d’une comté, ou eccléfiaftique.
Pendant la féance du parlement, tous les membres
de la chambre baffe joiiiffent des mêmes privilèges
que ceux de la chambre haute' ; c’eft-à -d ire
qu’eu x, & tous les ferviteurs 8c domeftiques, font
exempts de toutes pourfirifes , arrêts, 8c emprifon-
nemens, à-moins qu’ils ne foiènt accufés de trahi-
fon , de meurtre, ou de rupture de paix. Tous les
meubles néceffaires qu’ils tranfporter.t avec eux pendant
la féance, font aufli exempts de faifie. Ce privilège
s’étendoit autrefois depuis le moment de leur
départ de chez eux , jufqu’à celui de leur retour :
mais par un a&e du parlement, paffé de nos jours
fous le régné de Georges I. il fut ordonne qu auffi-tot
que le parlement feroit diffous ou prorogé, les créanciers
feroient en droit de pourfuivre tous les membres
qui auroient contracte dés dettes.
Les membres de la chambre des communes n’ônt
ni robes de cérémonie comme les pairs , ni rang &
places marquées dans leur chambre ; ils y fiegent
tous confulément : il n’y â que l’orateur qui ait un
fauteuil 6u une efpece de fiége à bras, fitué vers le
haut bout de la chambre ; fon clerc 8c fon afliftant
font aflis à côté de lui. Ces trois officiers font aufli
îes feuls qui ayent des robes , aufli-bien que les députés
pour la ville de Londres , & quelquefois les
profeffeurs en Droit pendant le tems de la plai-
dôiërie.
Le premier jour que s’affemble un nouveau parlement,
avant qu’on entame aucune affaire , tous les
membres des communes prêtent ferment entre les
mains du grand-maître de la maifon du ro i, 8c dans
la cour des pupiles. Enfuite ils procèdent à Féle&ion
d’un orateur; 8c après cette éie&ion, & que l’orateur
a été agréé par le r o i , ils prêtent ferment une
fécondé fois. Voye%_ Orateur.
Les principaux privilèges de la chambre des communes
Corit, que tous les bills pour lever de l ’argent
fur les fujets, fortent immédiatement de la chambre
des communes ; parce que c’eft fur eux que fe leve
la plus grande partie des impofitions : ils ne foiif-
ffent pas même que les feigneurs faffent aucun changement
à ces fortes de bills. Les communes font proprement
les grandes enquêtes du royaume ; elles ont
le privilège de propofer des lois , de repréfenter les
calamités publiques , d’accufer les criminels d’é ta t,
même les plus grands officiers du royaume , 8c de
les pourfuivre comme partie publique à la chambre
dés feigneurs, qui eft la fuprème chambre de juftice
de la nation ; mais elles n’ont pas droit de juger,
comme elles l’ont elles-mêmes reconnu en 1680 fous
le roi Charles II.
Autrefois on accordoit aux membres des communes
, dès fommes pour leurs dépenfes pendant la féance
du parlement, rationabiles exptnfas : ce font les
termes dés lettres circulaires; e’e ft-à -dire tels ap-
pointemens que le roi, en confidérant le prix des cho-
fes, jugera à-propos d’impofer au peuple , que ces
députés reprélèntent, & aux dépens duquel ceux-ci
dévoient être défrayés. Dans l’article xvij. du réglement
d’Edoiiard II. ces appointemens étoient alors
de dix groats pour chaque député de la province,
& de cinq pour ceux des bourgs , foinme modique
relativement au taux préfent des monnoies , & au
prix des chofes ; mais qui étoit alors fuffifant.e , 5c
même confidérable. Depuis ils montèrent jufqu’à 4
fchelins par jour pour ceux qui étoient chevaliers,
& 1 fchelins pour les autres. Aujourd’hui les communes
ne reçoivent plus d’appointemens; l’impôt ne
laiffe pas que de fe lever : mais ces fonds font employés
à d’autres dépenfes. On a cru que de bons
citoyens étoient affez indemnifés par l’honneur qu’ils
reçoivent de foûtenir les intérêts de la nation ,
fans vendre leurs fervices pour une modique rétribution.
Les communes, ou plûtôt le tiers état, en Angleterre
, fe dit par oppofition aux nobles & aux pairs ,
c’eft-à-dire de toutes'fortes de perfonnes au-deffous
du rang de baron, car dans ce royaume il n’y a de
nobles, fuivant la loi, que les barons ou les feigneurs
membres de la chambre haute : tout le refte, comme
les chevaliers, écuyers, &c. ne font pas nobles;on
les regarde feulement comme étant d’une bonne famille.
Ainfi un gentilhomme n’eft autre chofe qu’un
homme iffu d’une famille honnête, qui porte des armes
, & qui a un certain reveriu. Le tiers état comprend
donc les chevaliers, les écuyers, les gentilshommes
, les fils de la nobleffe qui ne font pas titrés,
8c les ycomans. Voye^ É c u y e r , G e n t i l h o m m e t
Y c o m a n o « Y e m a n . .( G )
COMMUNIBUS LOC IS, terme latin affez fréquemment
en ufage chez les Phyficiens , 8c lignifiant
une efpece de milieu, ou un rapport moyen qui
réfulte de la combinaifon de plufieurs rapports.
Ainfi on lit dans quelques auteurs anglois , que
l’Océan eft un quart de mille de profondeur , com-
munibus locis, dans les lieux moyens ou communs,
en prenant un milieu entre les profondeurs de difte-
rens endroits de l’Océan. Le mille d’Angleterre eft;
le tiers d’une lieue commune de France ; de forte.
qu’un quart de mille répond à environ un douzième
de nos lieues, ou à-peu-près deux cents toiles. Nous-
doutons que la profondeur moyenne de l’Océan ne
foit pas plus grande. ( 0 )
COMMUNICANTS, i. m. pl. ( Hijl. eccléf. ) fecte-
d’Anabaptiftes dans le feizieme fiecle : ils furent ainfi
nommés'de la communauté de femmes & d’enfans
qu’ils avoient établie entre eux., à l’ exemple des Ni-
colaites. Prateole , à), comm. Sanderus , her. i()8.
Gautier, dans fa chron. xvj. fiecle. ( G )
* COMMUNICATION, ( Gram?) ce terme a un
grand nombre d’acceptions, qu’on trouvera ci-après.^
11 défigne quelquefois Vidée de partage ou de ccfjîon,
comme dans communication du mouvement ; celle de
continuitéde communauté, 8c de continuité, comme
dans communication dé deux canaux , portes de com->
muni cation ; celle à!exhibition par une perfonne à une
autre , comme dans communication de pièces, &c.
C o m m u n ic a t io n d u m o u v e m e n t , eft l’actio
n p a r laquelle un corps qui en frappe.un autre ,
met en mouvement le corps qu’il frappe.
L’expérience nous fait voir tous les jours, que les
corps fe communiquent du mouvement les uns aux.
autres. Les Philofophes ont enfin découvert les lois
fuivant lefquelles fe fait cette communication, après
avoir long-tems ignoré qu’il y en eût, &_aprèss’être;
long-tems trompé far les véritables. Ces lois .confirmées
par l’expérience 8c parle raifonnement.,ne font
plus révoquées en doute de la plus faine partie des
Phyficiens. Mais la raifon métaphyfiqtie, 8c le principe
primitif de la communication du mouvement, font
fujets à beaucoup de difficultés.
Le P. M-alebranche prétend que la communication