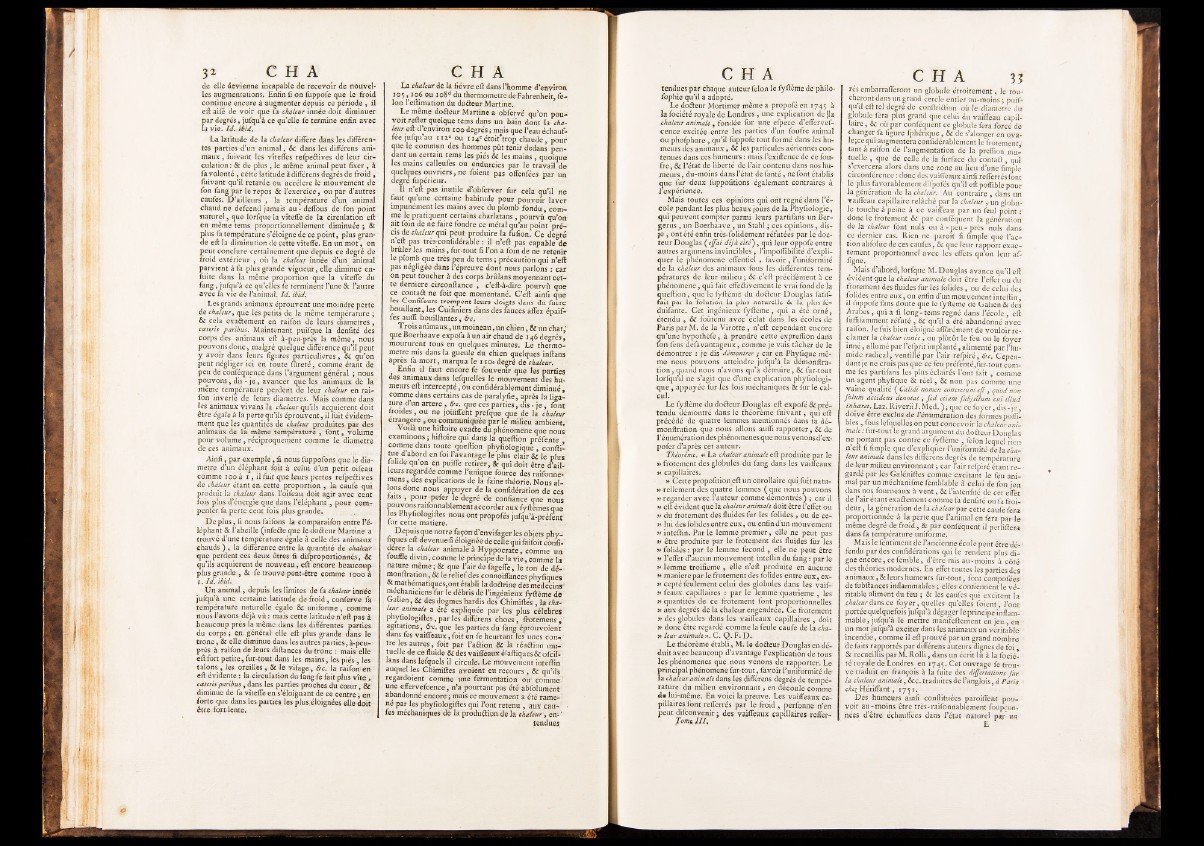
de elle devienne incapable de recevoir de nouvelles
augmentations. Enfin fi on fiippofe que le froid
continue encore à augmenter depuis ce période , il
eft aifé de voir que 1a chaleur innée doit diminuer
par degrés, jufqu’à ce qu’elle fe termine enfin avec
la vie. Id. ibid.
La latitude de la chaleur différé dans les différentes
parties d’un animal, & dans les différens animaux
, fuivant les vîteffes refpeftives de leur circulation
: & de plus , le même animal peut fixer, à
fa volonté, eetté latitude à différens degrés de froid,
fuivant qu’il retarde ou accéléré le mouvement de
fon fang par le repos & l’exercice, 911 par d’autres
caufes. D ’ailleurs , là température d’un animal
chaud ne defcend jamais au - défions de fon point
naturel, que loFfque la vîtefle de la circulation eft
en même tems proportionnellement diminuée ; &
plus fa température s’éloigne de ce point, plus grande
eft la diminution de cette vîteffe. En un mot, on
peut conclure certainement que depuis ce degré de
froid extérieur , oit la chaleur innée d’un animal
parvient à fa plus grande Vigueur, elle diminue en-
fuite dans la même proportiqn que la vîtefle du
fang, jufqu’à ce qu’elles fe terminent l’une & l’autre
avec la vie de l’animal. Id. ibid. ■
Les grands animaux éprouvent une moindre perte
de chaleur y que les petits de la même température ;
& cela exactement en raifon de leurs diamètres,
cæteris paribus. Maintenant puifque la denfité des
corps des animaux eft à-peù-près la même, nous
pouvons donc, malgré, quelque différence qu’il peut
y avoir dans leurs figures particulières., & qu’on
peut négliger ici en toute fureté, comme étant de
peu de conféquence dans l’argument général ; nous
pouvons, dis - je , avancer que les animaux de la
même température perdent de leur chaleur en rai-
fon inverfe de leurs diamètres. Mais comme dans
les animaux vivans la chaleur qu’ils acquièrent doit
être égale à la perte qu’ils éprouvent, il fuit évidemment
que les quantités de chaleur produites par des
animaux de la même température , fon t, volume
pour voluine, réciproquement comme le. diamètre
de ces animaux.
Aipfi, par exemple, fi nous fuppofons, que le diamètre
d’un éléphant fpit à celui d’un petit oifeau
comme 100 à 1 , il fuit que leurs pertes refpeftives
de chaleur étant en. cette proportion , la caufe qui
produit la chaleur dans l’oifeau doit agir avec ce.nt
fois plus d’énergie que dans l’éléphant, pour compenser.
fa perte cent fois, plus grande.
De plus, fi nous faifons la comparaifôn entre l’éléphant
& l’abeille (infeûe que le do&eur Martine a
trouvé d’une température égale à pelle des animaux >
chauds ) , la différence entre la quantité de chaleur
que perdent ces deux êtres fi difproportionnés, &
qu’ils acquièrent de nouveau, eft encore beaucoup
plus grande , & fe trouve pent-être comme 1000 à
I. Id'. ibid..
Un animal, depuis, les limites de fa chaleur innée
jufqu’à une certaine latitude de froid, confèrve fa
température naturelle égale & uniforme , comme
nous L’avons déjà vû : mais cette latitude n’èft pas à
beaucoup près la même dans les différentes parties-
du corps ; en. général elle eft plus grande dans le
tronc, & elle diminue dans les autres parties, à-peu-
près. à raifon de leurs diftances du tronc : mais elle
eft fort petite, fur-tout dans les mains, les piés, lès
talons-, les. oreilles, & le vifage , &c. la raifon1 en
eft évidente : la. circulation du fang fe fait plus vite ,
ccueris paribus, dans les parties proches du coeur &
diminue de fa. vîtefle en s’éloignant de ce centre ; en
forte que dansles.partiea les plusiloignées elle doit
être fortlente.
JLa chaleur de là fievre eft dans Phomme d'environ
105,106 ou 108^ du thermometrede Fahrenheit, -félon
l’eftimation du dofteur Martine.
Le même dofleur Martine a obfervé qu’on pouv
a it refter quelque tems dans un bain dont la chaleur
ett d’environ ioo degrés ; mais que l’eau échauffée
jufqu’au 112= ou 114e étoit'trop chaude, pour
que ie commun des hommes pût tenir dedans pendant
un certain tems les piés & les m ains, quoique
les .mains calleufes ou endurcies par le travail de
quelques ouvriers, ne foient pas offenfées par un
degré fupérieur.
Il n’eft pas inutile d’obferver fur cela qu’il ne
faut qu’une certaine habitude pour pouvoir laver
impunément les mains avec du plomb fondu, comme
le pratiquent certains charlatans, pourvu qu’on
ait foin de ne faire fondre ce métal qu’au point précis
de chaleur qui peut produire la tufion. Ce degré
n’eft pas très-confidérable : il n’eft pas capable de
brûler les mains, fur-tout fi l’on a foin de ne retenir
le plomb que très peu de tems ; précaution qui n’eft
pas négligée dans l’épreuve dont nous parlons : car
on peut toucher à des corps brûlans moyennant cette
derniere circonftance , c’eft-à-dire pourvu que
ce contafr ne foit que momentané. G’eft ainfi que
les Confifeurs trempent leurs doigts dans du fucre
bouillant, les Cuifiniers dans des lauces affez épaif-
fes' aufli bouillantes, &c.
Trois animaux, un moineau, un chien, & un chat,'
que Boerhaave expofa à un air chaud de 146 degrés ,
moururent tous en quelques minutes. Le thermomètre
mis dans la gueule du chien quelques inftans
après fa mort, marqua le 1 10e degré de chaleur.
Enfin il faut encore fe fouvenir que les parties
des animaux dans lefquelles le mouvement des humeurs
eft intercepté, ou confidérablement diminué,
comme dans certains cas de paralyfie, après la liga-
turp d’un artere , &c. que ces parties, dis - j e , font
froides, ou ne joüiffeht prefque que de la chaleur
étrangère , ou communiquée par le milieu ambient.
Voilà une hiftoire exafre du phénomène que nous
examinons ; hiftoire qui dans la queftion préfente
comme dans toute queftion phyfiologique , confti-
tue d’abord en foi l’avantage le plus clair & le plus
iolide qu on ep puifle retirer, & qui doit être d’ailleurs
regardée comme Punique fource des raifonne-
mens, des explications de la faine théorie. Nous allons
donc nous appuyer de là confidération de ces
faits , pour pefer le degré de confiance que nous
pouvons raifonnablement accorder aux fyftèmes que
les phyfiologiftes nous ont propofés jufqu’à-préfent
lur cette matière. .
Depuis que notre façon d’envifager les objets phy-
fiques eft devenue fi éloignée de celle qui faifoit confia
derer la chaleur animale à Hyppocrate , comme un
fouffle divin, comme le principe de la v ie , comme là
nature même ; & que l’air de fàgeffe, le ton de dé-
monftration , & le relief des connoiffancesphyfiques
& mathématiques,ont établi la dofrrine des médecins'
mechaniciens fur le débris de l’ingénieux fyftème de
Galien, & des dogmes hardis des Chimiftes , la chaleur
animale a été expliquée par les plus célébrés
phyfiologiftes, par les différens chocs, froteriiens , '
agitations , &c. que les parties du fang éprouvoient
dans fes vaiffeaux, foit en fe heurtant lès unes con- '
tre les autres, foit par l’adion & là réaftibn mutuelle
de ce fluide & des vaiffeaux élaftiques & ofeif-
Ians dans lefquels il circule. Le mouvement inteftin
auquel les Chimiftes avoient eu recours , & qu’ils
regardaient comme une fermentation ou* comme
une effervefcence, n’a pourtant pas été abfolument
abandonné encore ; mais ce mouvement a été ramené
par les phyfiologiftes qui l’ont retenu , aux eau- *
fes méchaniques de la production, de la chaleur, en-*
tendues
tendues pat chaque auteur félon le fyftème de philo-
fophie qu’il a adopté.
Le dodeur Mortimer même a propofé en 1745 à
la fociété royale de Londres, une explication de |la
chaleur animale , fondée fur une efpece d’effervef-
cence excitée entre les parties d’un foufre animal
ou phofphore, qu’il fuppofe tout formé dans les humeurs
des animaux, & les particules aériennes contenues
dans ces humeurs : mais l’exiftence de ce foufre,
& l ’état de liberté de l’air contenu dans nos humeurs
, du-moins dans l’état de fanté, ne font établis
que fur deux fuppofitions également contraires à
l ’expérience.
Mais toutes ces opinions qui ont régné dans l’école
pendant les plus beaux jours de la Phyfiologie,
qui peuvent compter parmi leurs partifans un Ber-
gerus , un Boerhaave , un Stahl ; ces opinions, dis-
je , ont été enfin très-folidement réfutées par le docteur
Douglas ( ejfai déjà cité) , qui leur oppofe entre
autres argumens invincibles, l’impofîibilité d’expliquer
le phénomène effentiel , fa voir , l’uniformité
de la chaleur des animaux fous les différentes températures
de leur milieu ; & c’eft précifémcnt à ce
phénomène, qui fait effectivement le vrai fond de la
queftion, que le fyftème du dofreur Douglas fatif-
fait par la folutiorç la plus naturelle & la plus fé-
duifante. Cet ingénieux fyftème, qui a été orné,
étendu , & foûtenu avec éclat dans les écoles de
Paris par M. de la Viro tte, n’eft cependant encore
qu’une hypothèfe, à prendre cette expreffion dans
fon fens defavantageux, comme je vais tâcher de le
démontrer : je dis démontrer ; car en Phyfique même
nous pouvons atteindre jufqu’à la démonftra-
tion, quand nous n’avons qu’à détruire, & fur-tout
lorfqu’il ne s’agit que d’une explication phyfiologique
, appuyée fur les lois méchaniques & lur le calcul
.L
e fyftème du dofreur Douglas eft expofé & prétendu
démontré dans le théorème fuivant, qui eft
précédé de quatre lemmes merftionnés dans l'a dé-
monftration que nous allons aufli rapporter, & de
l’énumération des phénomènes que nous venons d’ex-
pofer d’après cet auteur.
• Théorème. « La chaleur animale eft produite par le
» frotement des globules du fang dans les vaiffeaux
» capillaires.
» Cette propofition eft un corollaire qui fuit natu-
» Tellement des quatre lemmes ( que nous pouvons
» regarder avec l’auteur comme démontrés ) ; car il
» eft évident que la chaleur animale doit être l’effet ou
» du frotement des fluides fur les folides, ou de ce-
» lui des folides entre eux, ou .enfin d’un mouvement
» inteftin. Par le lemme premier, elle ne peut pas
» être produite par le frotement des fluides fur les
» folidés : par le lemme fécond , elle ne peut être
» l’effet d’aucun mouvement inteftin du fang : par le
» lemme troifieme , elle n’eft produite en aucune
» maniéré par le frotement des folides entre eux, ex-
» cepté feulement celui des globules dans les vaif-'
» féaux capillaires : par le lemme quatrième les
» quantités de ce frotement font proportionnelles
» aux degrés de la chaleur engendrée. Ce frotement
» des globules dans les vaiffeaux capillaires , doit
» donc être regardé comme la feule caufe de la cha-
» leur animale ». C. Q. F. D .
Le théorème établi, M. la dofreur Douglas en déduit
avec beaucoup d’avantage l’explication de tous'
les phénomènes que nous venons de rapporter. Le
principal phénomène fur-tout, favoir l’uniformité de
la chaleur animale dans les différens degrés de température
du milieu environnant, en découle comme
d» lui-même. En voici la preuve. Les vaiffeaux capillaires
font refferrés par le froid , perfonne n’en
peut difeonvenir; des vaifleaux capillaires refler-
Jomt I I I ,
tes embarrafleront un globule étroitement, le toucheront
dans un grand cercle entier au-moins ; puif-
qu il eft tel degre de conftrifrion où le diamètre du
globule fera plus grand que celui du vaifleau capillaire
, & où par conféquent ce globule fera forcé de
changer fa figure fphérique, & de s’alonger en ova-
le;ce qui augmentera confidérablement le frotement
tant à raifon de l’augmentation de la preffion mutuelle
, que de celle de la furface dti contafr, qui
s’exercera alors dans une zone au lieu d’une fimple
circonférence : donc des vaiffeaux ainfi refferrés font
Iê plus favorablement difpofés qu’il eft poflible pour
la génération de la chaleur. Au contraire , dans un
vaifleau capillaire relâché par la chaleur, un globule
touche à peine à ce vaifleau par un feul point :
donc le frotement & par conféquent la génération
de la chaleur font nuis ou à - peu - près nuis dans
ce dernier cas. Rien ne paroît fi fimple que l’action
abfolue de ces caufes, & que leur rapport exactement
proportionnel avec les effets qu’on leur af-
figne.
^ Mais d’abord, lorfque M. Douglas avance qu’il eft
évident que la chaleur animale doit être l’effet ou du
frotement des fluides fur les folides , ou de celui des
folides entre eux, ou enfin d’un mouvement inteftin,
il fuppofe fans doute que le fyftème de Galien & des
Arabes, qui a fi long - tems régné dans l’éco le, eft
fuffifamment réfuté , & qu’il a été abandonné avec
raifon. Je fuis bien éloigné affûrément de vouloir réclamer
la chaleur innée, ou plûtôt le feu ou le foyer
inné, allumé par l’efprit implanté, alimenté par l’humide
radical, ventillé par l’air refpiré, &c. Cependant
je ne crois pas que ce feu préfenté,fur-tout comme
fes partifans les plus éclairés l’ont fait , comme
un agent phyfique & ré e l, & non pas comme une
vaine qualité ( Calidi nomen concreturn efi , quod non
folum accidens dénotât, fed etiam fubjectum cui illud
inkaret. Laz. R iverii J. Med. ) ; que ce foy er, dis - je ,
doive être exclus de l ’énumération des formes pofli-
bles, fous lefquelles on peut concevoir la chaleur ani-‘
male : fur-tout le grand argument du dofteur Douglas
ne portant pas contre ce fyftème , félon lequel rien
n’eft fifimplç que d’expliquer runiformité delà chaleur
animale dans les différens degrés de température
de leur milieu environnant ; car l’air refpiré étant regardé
par les Galéniftes comme excitant le feu animal
par un méchanifme femblable à celui de fon jeu
dans nos fourneaux à vent, & l’intenfité de cet effet
de l’air étant exa&ement comme fa denfité ou fa froideur
, la génération de la chaleur par cette caufe fera
proportipnnée à la perte que l’animal en fera p a rle
même degré de froid, & par conféquent il perfiftera
dans fa température uniforme.
Mais le fentiment de l’ancienne école peut être dé-'
fendu par des confidérations qui le rendent plus digne
encore, ce femble, d’être mis au-moins à côté 1
des théories modernes. En effet toutes les parties des
animaux ,& leurs humeurs fur-tout, font compofées
de fubftances inflammables ; elles contiennent le v éritable
aliment du feu ; & les caufes qui excitent la
chaleur dans ce fo y e r , quelles qu’elles foient, l’ont
portée quelquefois jufqu’à dégager le principe inflammable
, jufqu’à le mettre manifeftement en jeu en I
un mot jufqu’à exciter dans les animaux un véritable ’
incendie, comme il eft prouvé par un grand nombre
de faits rapportés par différens auteurs dignes dé fo i,
& recueillis par M. R olli, dans un écrit lû à la fociété
royale de Londres en 1745. Cet ouvrage fe trouve
traduit en françois à la fuite des dijfertâtions fur
la chaleur animale, & c . traduites de l’anglois , à Paris a
ckei Hériffant, 1751.
Des humeurs ainfi conftituées paroiffent pouvoir
au-moins être très-raifonnablement foupçon-
nées d’être, éçhauffées dans l’état naturel par un