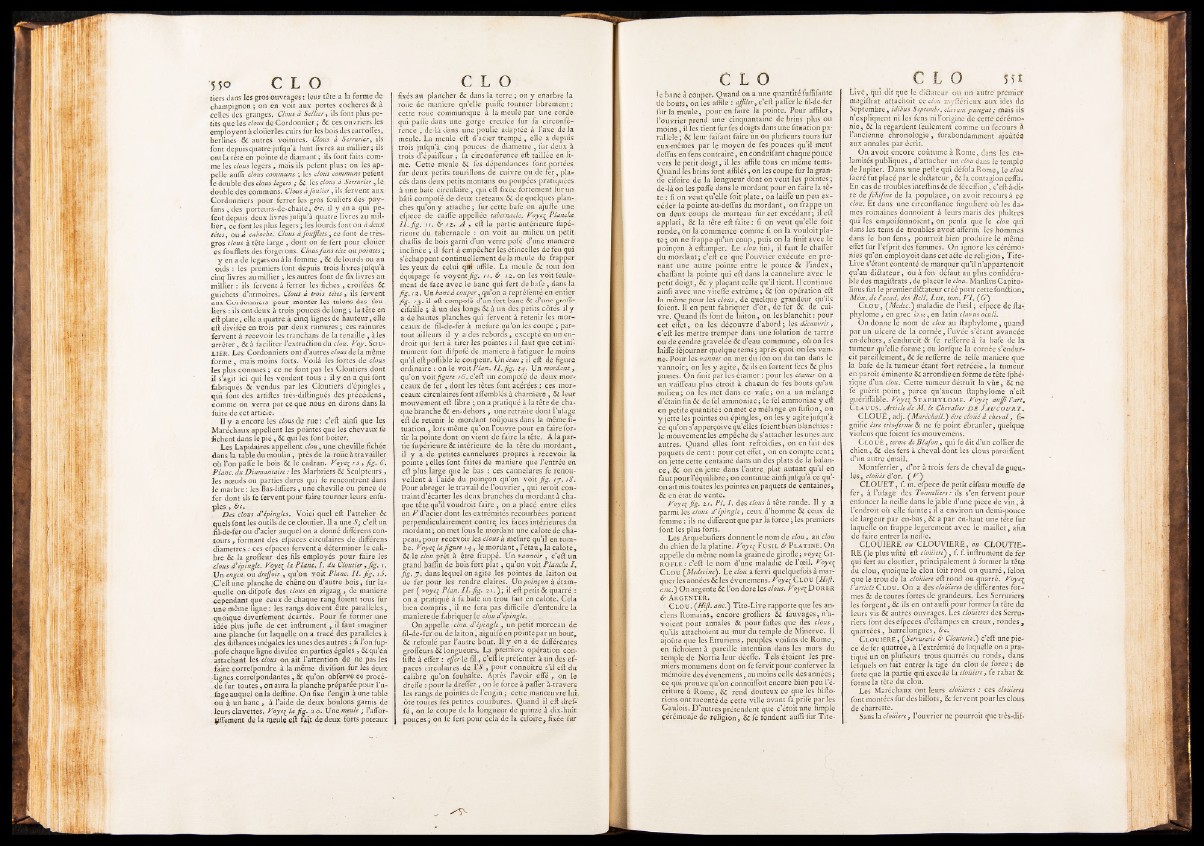
55° C L O
tiers dans les gros ouvrages : leur tête a la forme de
champignon ; on en voit aux portes cocheres &.à
celles des granges. Clous à Sellier, ils font plus petits
que les clous de Cordonnier ; & ces ou vriers les
employent à cloiierles cuirs fur les bois descarroffes,
berlines & autres voitures. Clous à Serrurier, ils
font depuis quatre jufqu’à huit livres au millier ; ils
ont la tête en pointe de diamant ; ils font faits comme
les clous légers, mais ils pefent plus : on les appelle
auffi clous communs ; les clous communs pefent
Je double des clous légers ; & les clous à Serrurier, le
double des communs. Clous à foulier, ils fervent aux
Cordonniers pour ferrer les gros fouliers des pay-
fans , des porteurs-de-chailè, &c. il y en a qui pefent
depuis deux livres jufqu’à quatre livres au millier
, ce font les plus légers ; les lourds font ou à deux
têtes, ou à caboche. Clous à foujflets, ce font de très-
gros clous à tête large , dont on fe lert pour clouer
es foufflets des forgerons. Clous fàns tête ou pointes ;
y en a de légers ou à la fomme , & de lourds ou au
oids : les premiers font depuis trois livres jufqu’à
cinq livres au millier ; les autres font de fix livres au
millier : ils fervent à ferrer les fiches , croifées &
guichets d’armoires. Clous à trois têtes , ils fervent
aux Cordonniers pour monter les talons des fou-,
liers : ils ont deux à trois pouces de long ; la tête en
eft plate, elle a quatre à cinq lignes de hauteur, elle
eft divifée en trois par deux rainures ; ces rainures
fervent à recevoir les tranchans de la tenaille , à les
arrêter, & à faciliter l’extrafrion du clou. Voy. Soulie
r . Les Cordonniers ont d’aiitres clous de la même
forme , mais moins forts. Voilà les fortes de clous
les plus connues ; ce ne font pas les Cloutiers dont
il s’agit ici qui les vendent tous : il y en a qui font,
fabriqués & vendus par les Cloutiers d’épingles,
qui font des artiftes très-diftingués des précédens,
comme on verra par ce que nous en dirons; dans la
fuite de cet article.
Il y a encore les clous de rue : c’eft ainfi que les
Maréchaux appellent les pointes que les chevaux fe
fichent dans le pié qui .les font boiter,
Les Lapidaires appellent clou, une cheville fichée
dans la table du moulin, près de la roiie à travailler
où l’on paffe le bois & le cadran. Voye^ rs ,fig. 6.
Plane, du Diamantaire : les Marbriers & Sculpteurs ,
les noeuds ou parties dures qui fe rencontrent dans
le marbre: les Bas-liffiers , une cheville ou pince de
fer dont ils fe fervent pour faire tourner leurs enfu-
p le s , &ç... _ .
Des clous d'épingles. Voici quel eft l’attelier &
quels font les outils de ce cloutier. Il a une Sj c’eft un
fil-de-fer ou d’acier auquel on a donné différens contours
, formant des efpaces circulaires de différens
diamètres : ces efpaces fervent à déterminer le calibre
& la groffeur des fils employés pour faire les
•clous d'épingle. Voye^ la Plane. I. du Cloutier , fig. i.
Un engin ou dreffbir, qu’.on voit Plane. IL fig. /5.
.Ç ’eftune planche de chêne ou d’autre bois, lur laquelle
on difpofe des clous en zigzag , de maniéré
cependant que ceux de chaque rang foient tous fur
une même ligne : les rangs doivent être parallèles,
quoique diverfement écartés. Pour fe former une
idée plus jufte de cet infiniment , il faut imaginer
une planche fur laquelle on a tracé des parallèles à
des diftances inégales les unes des autres : fi l’on fup-
.pofe chaque ligne divifée en parties égales, & qu’en
attachant les clous on ait l’attention de ne pas les
faire çorrefpondre à la même divifion fur les deux
•lignes correfpondantes , & qu’on obferve ce procé-
. dé fur toutes, on aura la planche préparée pour l’u-
. fage auquel onia deftine. On fixe l’engin à une table
ou à un banc , à l’aide de deux boulons garnis de
. leurs clavettes. Voyez la fig. 20. Une meule ; l’affor-
$iffement de la njeule eft fait de deux forts poteaux
C L O
fixés âu plancher & dans la terre ; on y enarbre la
roiie de maniéré qu’elle puiffe tourner librement :
cette roiie communique à la meule par une corde
qui paffe dans une gorge creufée fur fa circonférence
, de-là dans une poulie adaptée à l’axe de la
meule. La meule eft d’acier trempé , elle a depuis
trois jufqu’à cinq pouces de diamètre , fur deux à
trois d’épaiffeur ; fa circonférence eft taillée en lime.
Cette m.ëule & fes dépendances font portées
fur deux petits tourillons de cuivre ou de fe r , placés
dans deux petits montans ou poupées pratiquées
à une bafe circulaire , qui eft fixée fortement fur un
bâti compofé de deux tréteaux & de quelques planches
qu’on y attache ; fur cette bafe on ajufte une
efpece de caiffe appellée tabernacle. Voye{ Planche.
IL fig. 11. & iz. A , eft la partie antérieure fupé-
rieure du tabernacle : on voit au milieu un petit,
chaffis de bois garni d’un verre pofé d’une maniéré
inclinée ; il fert à empêcher les étincelles de feu qui
s’échappent continuellement de la meule de frapper
les yeux de celui qtfi affile. La meule & tout fou
équipage fe v o y en tfig. 1 1 .& 12. on les voit feulement
de face avec le banc qui fert de bafe, dans la
fig. / 2. Un banc à couper, qu’on a repréfenté en entier
fig. ig . il eft compofé d’un fort banc & d’une groffe
cifaille ; à un des longs & à un des petits côtés il y
a de hautes planches qui fervent à retenir les morceaux
de fil-de-fer à mefure qu’on les coupe ; partout
ailleurs il y a des rebords , excepté en un endroit
qui fert à tirer les pointes : il faut que cet inf-
trument foit difpofé de maniéré à fatiguer le moins
qu’il eftpoffible le coupeur. Un étau; il eft de figure
ordinaire : on le voit Plan. 11. fig. 14. Un mordant,
qu’on voit figure 1 (f.c’eft un compofé de deux morceaux
de fer , dont les têtes font ac.érées : ces morceaux
circulaires font affemblés à charnière , & leur
mouvement eft libre ; on a pratiqué à la tête de chaque
branche & en-dehors , uneretraite dont l’ufage
eft de retenir le mordant toûjours dans la même fi-
tuation , lors même qu’on l’ouvre pour en faire for-
tir la pointe dont on vient de faire la tête. A la partie
fupérieure & intérieure de la tête du mordant,
il y a de petites cannelures propres à recevoir la
pointe ; elles font faites de maniéré que l’entrée en
eft plus large que le bas : ces cannelures fe renouvellent
à l’aide du poinçon qu’on voit fig. ly . 18.
Pour abréger le travail de l’ouvrier, qui feroit contraint
d’écarter les deux branches du mordant à chaque
tête qu’il voudroit faire , on a placé, entre elles
un ^ d ’acier dont les extrémités recourbées portent
perpendiculairement contre, les faces intérieures du
mordant ; on met fous le mordant une calote de chapeau,
pour recevoir les clous à mefure qu’il en tombe.
Voye^la figure 14 , le mordant, l’étau, la calote,
& le clou prêt à être frappé. .Un vannoir , c’eft un
grand baffin de bois fort p la t, qu’on voit Planche I .
fig. y . dans lequel on agite les pointes de laiton ou
de fer pour les rendre claires. Un poinçon à,étam-r
per ( voye{ Plan. IL fig. 21. ) ; il eft petit & quarré :
on a pratiqué à fa bafe un trou fait en calote. Cela
bien Compris , il ne fera pas difficile d’entendre la
maniéré de fabriquer le clou-d'épingle.
On appelle clou, d'épingle , un petit morceau de
fil-de-fer'ou de laiton, aiguifé en pointe par un bout,
& refoulé, par l’autre bout. Il y en a de différentes
groffeurs & longueurs. La première opération con-
fiffe à effer : efjer- le fil ., c’eft le préfenfer à un des efpaces
circulaires de. 1’*? , pour connoître s’il eft du
calibre qu’on fouhaite. Après l’avoir efle , on le
dreffe : pour le dreffer, on le force à paffer à-travers
les rangs de pointes de l’engin ; cette manoeuvre lui,
ôte toutes .fes petites courbures. Quand il eft dreff
f é , on le coupe de la .longueur de quinze à dix-huit
pouces; on fe fert pour cela de la cifoire, fixée lur
■ ^
C L O C L O 5 ? 1
lé banc k couper. Quand On a une quantité luffifarlte
de bouts, on les affile : affiler, c’eft paffer le fil-de-fer
für la meule, pour en faire la pointe. Pour affiler,
l’ouvrier prend une cinquantaine de brins plus ou
moins, il les tient fur (es doigts dans une fitnation parallèle
; & leur faifant faire un ou plufieurs tours lur
eux-mêmes par le moyen de fes pouces qu’il meut
deffus en fens contraire, èn conduifant chaque pouce
vers lé petit doigt, il les affile tous en même terns*
Quand les brins font affilés, on les coupe fur la grande
cifoire de la longueur dont on veut les pointes;
de-là on les paffe dans le mordant pour en faire la tête
: fi on veut qu’elle foit plate, on laiffe un peu excéder
la pointe au-deffus du mordant, on frappe un
ou deux coups de marteau fur cet excédant ; il eft
applati, & là tête eft faite : fi on veut qu’elle foit
ronde, on la commence comme fi on la vouloit plate
; on ne frappe qu’un coup, puis on la finit avec le
poinçon à eftamper. Le cloïi fini, il faut le chaffer
du mordant ; c’eft ce que l’ouvrier exécute en prenant
une autre pointe entre le pouce & l’index,
chaffant la pointe qui eft dans la cannelure avec le
petit doigt, &• y plaçant celle qu’il tient. Il continue
ainfi avec une vîteffe extrême; & fon opération eft
la mêmepour les clous, de quelque grandeur qu’ils
foient. Il en peut fabriquer d’o r , de fer & de cuivre.
Quand ils font de laiton , on les blanchit : pour
cet effet, on les découvre d’abord ; les découvrir;
c ’eft les mettre tremper dans une folution de tartre
ou de cendre gravelée & d’eau commune, oh on les
laiffe féjourner quelque tems ; après quoi on les vanne.
Pour les vanner on met du fon ou du tan dans le
vannoir; on les y agite, & ils en fortent fecs & plus
jaunes. On finit par les étamer : pour les étarner on a
un vaiffeau plus étroit à chacun de fes bouts qu’au
milieu ; on les met dans ce vafe; on a un mélange
d’étain fin & de fel ammoniac ; le fel ammoniac y eft
en petite quantité : on met ce mélange en fufion, on
y jette les pointes ou épingles, on les y agite jufqu’à
ce qu’on s’apperçoive qu’élles foient bien blanchies :
le mouvement les empêche de s’attacher les unes aux
autres. Quand elles font refroidies, on en fait des
paquets de cent : pour cet effet, on en compte cent ;
on jette cette centaine dans un des plats de la balanc
e , & on en jette dans l’autre, plat autant qu’il en
faut pour l’équilibre ; on continue ainfi jufqu’à ce qu’on
ait mis toutes les pointes en paquets de centaines,
& en état de vente.
Voye[ fig. 21. PI. 1. des clous k tête ronde. Il y a
parmi les clous d’épingle, ceux d’homme & ceux de
femme : ils ne different que par la force ; les premiers
font les plus forts.
Les Arquebufiers donnent le nom de clou, nu clou
du chien de la platine. Vlye^ Fu sil & Pla t in e . On
appelle du même nom la graine de girofle; voye^ Girofle
: c’eft le nom d’une maladie de l’oeil. Voye£
C lou (Medecine). Le clou afervi quelquefois à ma roquer
les années & les évenemens. V?yei C lou (Hifi.
anc.') On argente &c l’on dore les clous. Voyes^D orer
6* A rgenter.
C lo u . (Hifi. anc.) Tite-Live rapporte que les anciens
Romains, encore groffiers ôî l'auvages, n’a-
voient pour annales & pour faites que des clous,
qu’ils attachoient au mur du temple de Minerve. Il
ajoute que lesEtruriens, peuples voifins de Rome,
en fichoient à pareille intention dans les murs du
temple de Nortia leur déeffe. Tels étoient les premiers
monumens dont on fe fervit.pour conferver la
mémoire des évenemens, au moins celle des années ;
ce qui prouve qu’on connoiffoit encore bien peu l’écriture
à Rome, &c rend douteux ce que les hifto-
riens ont raconté de cette ville avant fa prife par les
Gaulois. D ’autres prétendent que c’étoit une fimple
cérémonie de religion, & fe fondent auffi fur T ite-
Live , qui dit que le di&ateur ou un autre pfemief
magiftrat attachoit ce clou myftérieux aux ides de
Septembre, idibus Septembr. clàvum püngat; mais ils
n’expliquent ni les fens ni l’origine de cette cérémo*
nie, & la regardent feulement comme un fecours à
l’ancienne chronologie, furabondamment ajoutée
aux annales par écrit.
On avoit encore coutume à Rome, dans les calamités
publiques, d’attacher un clou dans le temple
de Jupiter. Dans une pefte qui défola Rome, le clotl
facré fut placé par le difrateur, & la contagion ceffa*
En cas de troubles inteftins & de féceffion, c’eft-à-di*
re de fchifme de la populace, on avoit recours à ce
clou. Et dans une circonftance finguliere où les dames
romaines donnoient à leurs maris des philtres
qui les empoifonnoient, on penfa que le clou qui
dans les tems de troubles avoit affermi les hommes
dans le bon fens, pourroit bien produire lé même
effet fur l’efprit des femmes. On ignore les cérémo*
nies qu’on employoit dans cet âéte de religion, Tite-
Live s’étant contenté de marquer qu’il n’appartenoit
qu’au dictateur, ou à fon défaut au plus confidéra-
ble des magiftrats, de placer le clou. Manlius Capito-
linus fut le premier diftateur créé pour cette fonûion.'
Mèm. de l'acad. des Bell. Lett. tom. VI. (G)
C lou , (Medec.) maladie de l’oeil ; efpecé de fta*_
phylome, en grec tMi, en latin clavus oculi.
On donne le nom de clou au ftaphylome, qitand
par un ulcéré de la cornée, l’uvée s’étant avancée
en-dehors, s?endurcit & fe refferre à la bafe de la
tumeur qu’elle forme ; ou lorfque la cornée s’endurcit
pareillement, & fe refferre de telle maniéré que
la bafe de la tumeur étant fort rétrécie, la tumeur
en paroît éminente & arrondie en forme de tête fphé-
rique d’un clou. Cette tumeur détruit la vû e, ne
fe guérit point, parce qu’aucun ftaphylome n’eft
guériffable. Voye%_ St a ph y l om E. Voye^ auffi l'artm
C L A V U S . Article de M. le Chevalier D E J A U COU R T .
CLOU É , adj. (JMaréehallé) être cloué à cheval, lignifie
être très-ferme & ne fe point ébranler, quelque
violens que foient fes mouvemens.
C loué , terme de B lafon, qui fe dit d’un collier de
chien, & des fers à çheval dont les clous paroiffent
d’un autre émail.,
Montferrier, d’or à trois fers de cheval de gueules,
cloués ■
CLOU E T , f. m. elpece de petit exfeau moufle de
fer, à l’ufage des Tonneliers: ils s’en fervent pour
enfoncer la neille dans le jable d’une piece de v in , à
l’endroit où elle fuinte ; il a environ un demi-pouce
de largeur par en-bas, & a par en-haut une tête fur
laquelle on frappe legerement avec le maillet, afin
de faire entrer la neille.
CLOÜIERE ou CLOUyiERE, ou CLOUTIE-
RE (le plus ufité eft cloüiere) , f. f. infiniment de fer.
qui fert au cloutier, principalement à former la tête
du clou, quoique le clou foit rond ou quarré, félon
que le trou de la cloüiere eft rond ou quarré. Voye£
l ’article C l o u . On a des eloiiieres de différentes formes
& de toutes fortes de grandeurs. Les Serruriers
les forgent, & ils en ont auffi pour former la tête de
leurs vis & autres ouvrages. Les cloüieres des Serruriers
font desefpeces d’eftampes en creux, rondes,
quarrées, barrelongues, &c.
C loüiere , (Serrurerie & Clouterie.) c’eft une pièce
de fer quarrée, à l’extrémité de laquelle on a pratiqué
un on plufieurs trous quarrés ou ronds, dans
lefquels on fait entrer la tige du clou de force ; de
forte que la partie qui excede la cloüiere, fe rabat &
forme la tête du clou.
Les Maréchaux ont leurs cloüieres : ces cloüieres
font montées fur des billots, & fervent pour les clous
de charrette.
Sans la cloüiere, l’ouvrier ne pourroit que très-dif