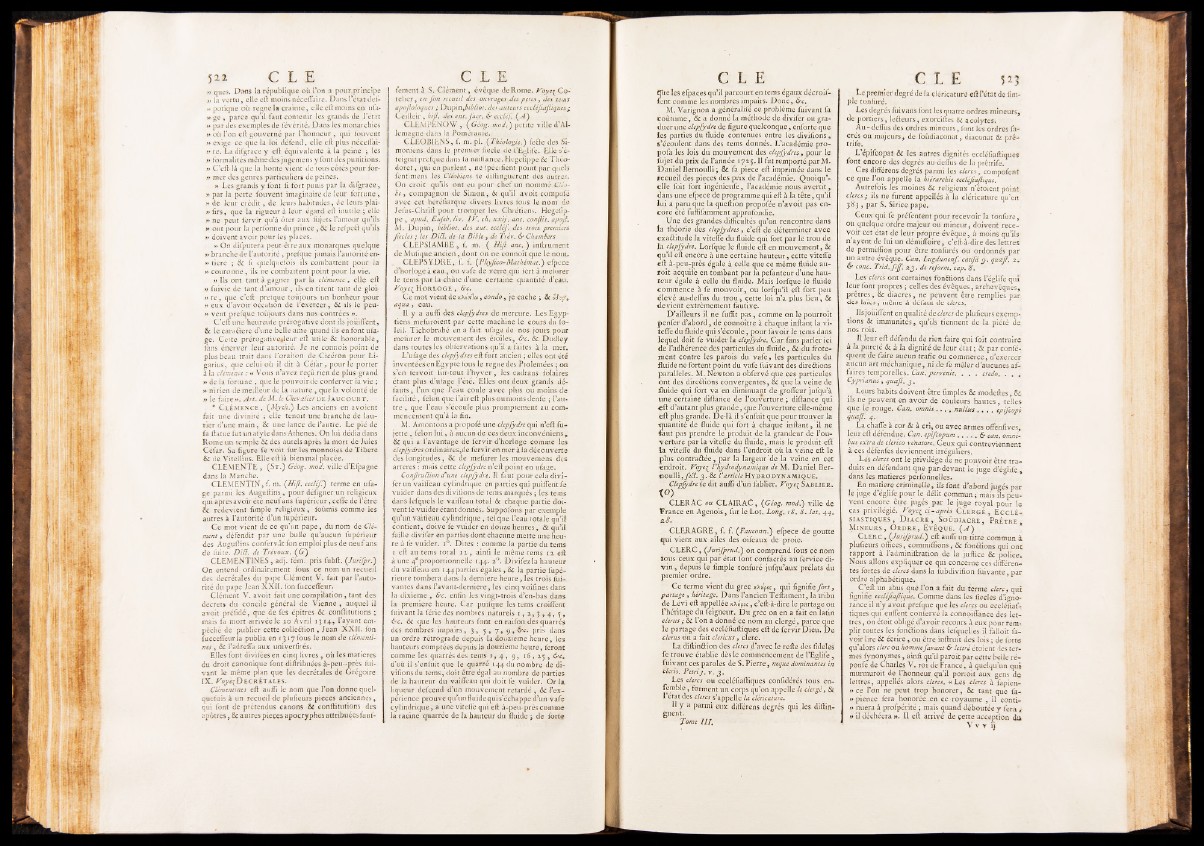
» ques. Dans la république où l’on a pour.principe
» la vertu, elle eft moins néceffaire. Dans l’état def-
» potique où regne la crainte, elle eft moins en ufa-
» ge , parce qu’il faut contenir les grands de l’état
» par des exemples de (évérité. Dans les monarchies
» où l’on eft gouverné par l’honneur , qui fouvent
» exige ce que la loi défend, elle eft plus nécellai-
» re. La dil'grace y eft équivalente à la peine ; les
» formalités même des jugemens y font des punitions.
» C ’eft-là que la honte vient de tous côtés pour for-
» mer des genres particuliers de peines.
» Les grands y font fi fort punis par la difgrace,
» par la perte fouvent imaginaire de leur fortune ,
» de leur crédit, de leurs habitudes, de leurs plai-
» lirs, que la rigueur à leur égard eft inutile ; elle
» ne peut fervir qu’à ôter aux fujets l’amour qu’ils
» ont pour la perfonne du prince, 6c le refped qu’ils
» doivent avoir pour les places.
» On difputera peut-être aux monarques quelque
» branche de l'autorité , prefque jamais l’autorité en-
» tiere ; 6c fi quelquefois ils combattent pour la
» couronne, ils ne combattent point pour la vie.
» Ils ont tant à gagner par la clémence , elle eft
» fuivie de tant d’amour , ils en tirent tant de gloi»
» r e , que c’eft pretque toujours un bonheur pour
» eux d’avoir occafion de l’exercer, 6c ils le peu-
» vent prefque to u jo u r s dans nos contrées ».
C ’eft une heureule prérogative dont ils joiiiffent,
& le caradere d’une belle ame quand ils en font ula-
ge. Cette prérogative*leur eft utile 6c honorable,
fans énerver leur autorité. Je ne connois point de
plus beau trait dans l’oraifon de Cicéron pour Li-
garius, que celui où il dit à Cé la r , pour le porter
à la clémence : « Vous n’avez reçu rien de plus grand
» de la fortune , que le pouvoir de conferver la vie ;
» ni rien de meilleur de la nature , que la volonté de
» le faire». Art. de M. le Chevalier de Ja UCOURT.
* C l ém en c e , (AfytA.) Les anciens en avoient
fait une divinité ; elle tenoit une branche de laurier
d’une main, & une lance de l’autre. Le pié de
fa ftatue fut un alyle dans Athènes. On lui dédia dans
Rome un temple 6c des autels après la mort de Jules
Céfar. Sa figure fe voit fur les monnoies de Tibere
6c de Vitellius. Elle eft ià bien mal placée.
CLEMENTE , (St .) Géog. mod. ville d’Efpagne
dans la Manche.
CLEMENTIN, f. m. (Hiß. eccléj.!) terme en ufa-
ge parmi les Auguftins, pour défigner un religieux
qui après avoir été neuf ans fupérieur, ceffe de l’être
St redevient limple religieux, foûmis comme les
autres à l’autorité d’un fupérieur.
Ce mot vient de ce qu’un pape, du nom de Clément
, défendit par une bulle qu’aucun fupérieur
des Auguftins confervât fon emploi plus de neuf ans
de fuite. Dicl. de Trévoux. (G)
CLEMENTINES , adj. fém. pris fubft. ( Jurifpr.)
On entend ordinairement fous ce nom un recueil
des décrétales du pape Clément V . fait par l’autorité
du pape Jean XXII. fon fucceffeur.
Clément V. avoir fait une compilation , tant des
decrets du concile général de Vienne , auquel il
avoit préfidé, que de fes épîtres 6c conftitutions ;
mais fa mort arrivée le 20 Avril 1314, l’ayant empêché
de publier cette colledion , Jean XXII. fon
fucceffeur la publia en 1317 fous le nom de clémentines
, 6c l’adreffa aux univerfirés.
Elles font divifées en cinq livres , où les matières
du droit canonique font diftribuées à-peu-près fui-
vant le même plan que les décrétales de Grégoire
IX. ^t>ye{DECRÉTALES.
Clémentines eft aufli le nom que l’on donne quelquefois
à un recueil de plufieurs pièces anciennes,
qui font de prétendus canons 6c conftitutions des
apôtres, 6c autres pièces apocryphes attribuées fauffement
à S. Clément, évêque de Rome. Voyt7 Co-
telier, en fon recueil des. ouvrages des per es , des tans
apofloloqucs ; Guplnfibliot. det auteurs eccléf afliques •
Ceilleir , hijl. des ant.Jacr.,& eccléf (A )
CLEMPENOW , ( Géog. mod. ) petite ville d’Allemagne
dans la Poméranie.
CLÉOBIENS, f. m. pl. ( Théologie.) fede des Si-
moniens dans le premier fiecle deTEglife. Elle s’éteignit
prefque dans là naillance. Hegefippe 6c Thco-
doret, qui en parlent, ne Ipécifient point par quels
fentimens les Cléobiens le diftinguerent des autres.
On croit qu’ils ont eu pour chef un nommé Cléa-
be , compagnon de Simon, & qu’il avoit compofé
avec cet héréfiarque divers livres fous le nom de
Jefus-Cnrift pour tromper les Chrétiens. Hegefippe
, apud. Eujeb.liv. IP . ch. x x ij. ant. conflit, apofl.
M. Dupin, bibliot. des aut. eccléf. des trois premiers
fiecles • les Dicl. de la Bible , de T/év. & Chambers
CLEPSIAMBE, f. m. ( Hijl anc. ) inftrument
de Mufique ancien, dont on ne connoît que le nom.
. CLEPSYDRE, f. f. (Phyfco-Mathémat.) efpece
d’horloge à eau, ou vafe de verre qui fert à melurer
le tems par la chute d’une certaine quantité d’eau.
Voye^ Horloge , &c.
Ce mot vient de xAeVJ«, condo, je cache ; & ûS'oy,
aqua , eau.
Il y a aufli des clepfydres de mercure. Les Egyptiens
mefuroient par cette machine le cours du fo-
leil. Tichobrahé en a fait ufage de nos jours pour
melurer le mouvement des étoiles, &c. 6c Dudley
dans toutes les obfèrvations qu’il a faites à la mer.
L ’ufage des clepjydres eft fort ancien ; elles ont été
inventées en Egypte fous le régné des Ptolemées ; ou
s’en lervoit fur-tout l’h y v e r , les cadrans folaires
étant plus d’ulàge l’été. Elles ont deux grands défauts
, l’un que l’eau coule avec plus ou moins de
facilité, félon que l’air eft plus oumoins denfe ; l’autre
, que l’eau s’écoule plus promptement au commencement
qu’à la fin.
M. Amontons a propofé une clepfydre qui n’eft fu-
jette , félon lu i, à aucun de ces deux inconvéniens,
6c qui a l’avantage de fervir d’horloge comme les
clepfydres ordinaires,de fervir en mer à la découverte
des longitudes, & de mefurer les mouvemens des
arteres : mais cette clepfydre n’eft point en ufage.
Conflruclion d'une clepfydre. Il faut pour cela divifer
un vaiffeau cylindrique en parties qui puiffentfe
vuider dans des divifions de tems marqués ; les tems
dans lefquels le vaiffeau total & chaque partie doivent
fe vuider étant donnés. Suppofons par exemple
qu’un vailfeau cylindrique, tel que l’eau totale qu’il
contient, doive fe vuider en douze heures-, & qu’il
faille divifer en parties dont chacune mette une heure
à fe vuider. i°. Dites : comme la partie du tems
1 eft au tems total i z , ainfi le même rems 12 eft
à une 4e proportionnelle 144. 20. Divifezla hauteur
du vaiffeau en 144 parties égales , 6c la partie fupé-
rieure tombera dans la derniere heure, les trois fui-
vantes dans l’avant-derniere, les cinq voifines dans
la dixième , &c. enfin les vingt-trois d’en-bas dans
la première heure. Car puifque les tems croiffent
fuivant la férié des nombres naturels 1 , 2 , 3 , 4 , 5»
&c. 6c que les hauteurs font en raifon des quarrés
des nombres impairs, 3 , 5 , 7 , 9 , &c. pris dans
un ordre rétrograde depuis la douzième heure, les
hauteurs comptées depuis la douzième heure, feront
comme les quarrés des tems 1 , 4 , 9, 16, 25 , &c.
d’où il s’enfuit que le quarré 144 du nombre de divisons
du tems, doit être égal au nombre de parties
de la hauteur du vaiffeau qui doit fe vuider. Or la
licjueur defeend d’un mouvement retardé , 6c i’ex-
perience prouve qu’un fluide quis'échappe d’un vafe
cylindrique, a une vîteffe qui eft à-peu-près comme
la racine quarrée de la hauteur du fluide ; de forte
Gîte les efpaces qu’il parcourt en tems égaux décroif-
lent comme les nombres impairs. Donc, &c.
M. Varignon a généralife ce problème fuivant fa
coutume, 6c a donné la méthode de divifer ou graduer
une clepfydre de figure quelconque, enforte que
les parties du fluide contenues entre les divifions,
s’écoulent dans des tems donnés. L’académie pro-
pofa les lois du mouvement des clepfydres, pour le
fujet du prix de l’année 1725. Il fut remporté par M.
Daniel Bernoulli ; & fa piece eft imprimée dans le
recueil des pièces des prix de l’académie. Quoiqu’elle
foit fort ingénieufe, l’académie nous avertit,
dans une efpece de programme qui eft à la tête, qu’il
lui a paru que la queftion propofée n’avoit pas encore
été fuffifamment approfondie.
Une des grandes difficultés qu’on rencontre dans
la théorie des clepjydres, c’eft de déterminer avec
exaditude la vîteffe du fluide qui fort par lè trou de
la clepfydre. Lorfque le fluide eft en mouvement, &
qu’il eft encore à une certaine hauteur, cette vîteffe
eft à-peu-près égale, à celle que ce même fluide au-
ïoit acquife en tonïbant par fa pefanteur d’une hauteur
égale à celle du fluide. Mais lorfque le fluide
commence à fe mouvoir, ou lorfqu’il eft fort peu
élevé au-deffus du trou , cette loi n’a plus lieu, &
devient extrêmement fautive»
D ’ailleurs il ne fuffit pas, comme on le poürroit
penfer d’abord, de connoître à chaque inftant la vîteffe
du fluide qui s’écoule, pour favoir le tems dans
lequel doit fe vuider la clèpfydre. Car fans parler ici
de l ’adhérence des particules du fluide, & du frote-
ment contre les parois du v a fe , les particules du
fluide né fortent point du vafe fuivant des diredions
parallèles. M. Newton a obferyé que ces particules
ont des diredions convergentes, 6c que la veine de
fluide qui fort va en diminuant de groffeur jufqu’à
üne certaine diftance de l’ouverture ; diftance qui
«ft d’autant plus grande, que l’ouverture elle-même
èft plus grande. De-là. il s’enfuit que pour trouver la
quantité de fluide qui fort à chaque inftant, il ne
faut pas prendre le produit de la grandeur de l’ouverture
par la vîteffe du fluide, mais le produit eft
la vîteffe du fluide dans l’endroit où la veine eft le
plus côntradée, par la largeur de la veine en cet
endroit. Vqye^ l'hydrodynamique de M. Daniel Ber-
<tiO\\ÏÏ\, fect. g . 6c l'article HYDRODYNAMIQUE.
Clepfydre le dit aufli d’un fablier. Foyt{ Sablier»
t ° )
. CLËRÀC ou CLA IR A C, {Géog. mod.') ville de
France en Agenois, fur le Lot. Long, 18. 8. lat. 44.
u.8.
CLERAGRE, f. f. (Faucànn.) efpece dê goutte
qui vient aux aîles des oifeaux de proie»
C L ER C , (Jurifprud.) on comprend fous ce nom
tous ceux qui par état font confacrés au fervice divin
, depuis le Ample tonfuré jufqu’aux prélats du
premier ordre»
Ce terme vient du grec y.X»poç, qui lignifie fo r t,
partage, héritage. Dans l’ancien îeftament, la tribu
de Lévi eft appdlée xX»poç, c’eft-à-dire le partage Ou
l’héritage du feigneur. Du grec on en a fait en latin
clerus; 6c l’on a donné ce nom au clergé, parce que
le partage des eccléfiaftiques eft de fervir Dieu. De
clerus ôn a fait cleritus, clerc. ■
La diftinâion des clercs d’avec le refte des fideles
fe trouve établie dès le commencement de l’Eglife,
fuivant ces paroles dé S. Pierre, neque dominantes in
tleris. Pétrij.v. J .
Les clercs ou eccléfiaftiques confidérés tous en-
femble, forment un corps qu’on appelle le clergé, &
1 état des clercs 's’appelle la cléricature.
Il y a parmi eux difîerens degrés qui , les diftin-
guent.
Tome III,
Le premier degré de la cléricature eft l’état de Ample
tQnfuré.
Les degrés fuivans font les quatre ordres mineurs,
de portiers, leéleurs, exorciftes 6c acolytes»
Au - deffus des ordres mineurs, font les ordres fa-
erés ou majeurs, de foùdiaconat, diaconat & prê-
trife. 1
L ’épifcopat & les autres dignités eccléfiaftiques
font encore des degrés au-deflus de la prêtrife.
Ces différens degrés parmi les clercs, compofent
ce que l’on appelle la hiérarchie eccléf aflique.
Autrefois les moines 6c religieux n’étoient point
clercs; ils ne furent appellés à la cléricature qu’en
383 , par S. Sirice pape.
Ceux qui fe préfentent pour recevoir la tonfure,
ou quelque ordre majeur ou mineur, doivent recevoir
cet état de leur propre évêque, à moins qu’ils
n’ayent de lui un démiffoire, c’eft-à-dire des lettres
de permiflion pour être tonfurés ou ordonnés par
un autre évêque. Can. Lugdunenf, caüfâ g . quoef. 2*'
& conc. Trid.ftffi 23 . de réform. cap. 8.
Les clercs ont certaines fondions dans l’églife qui
leur font propres ; celles des évêques, archevêques,
prêtres, 6c diacres, ne peuvent être remplies par
des laïcs, même à défaut de clercs.
Ils joiiiffent en qualité de clercs de plufieurs exemptions
& immunités, qu’ils tiennent de la piété de
nos rois.
Il leur eft défendu de rien faire qui foit contraire
à la pureté & à la dignité de leur état ; & par confé-
quent de faire aucun trafic ou commerce, d’exercer
aucun art méchanique, ni de fe mêler d ’aucunes a f faires
temporelles. Can. pervenit. . . . credo. . . .
Cyprianus , quoef . g .
Leurs habits doivent être fimples 6c modeftes, 6c
ils ne peuvent en avoir de couleurs hautes, telles
que le rouge. Can. omnis. . , . nullus . . . . epifeopi
quoef. 4.
La chaffe a cor & à cri. Ou avec armes offenfives,
leur eft defendue. Can. epifeopum. . . . . G can. omnibus
extra de clerico vehatore. Ceux qui contreviennent
à ces défenfes deviennent irréguliers.
Les clercs ont le privilège de ne pouvoir être traduits
en défendant que par-devant le juge d’é<*life.,
dans les matières perfonnelles.
En matière criminelle, ils font d’abord jugés par
le juge d’églife pour le délit commun ; mais ils peuvent
encore être jugés par le juge royal pour le
cas privilégié. Voye^ ci-apres C l e r g é , Ec c l é s
ia s t iq u e s , D ia c r e , So u d ia cr e , Pr ê t r e ,
Min eu r s , Ord r e , Evêqu e, (^f)
Clerc , (Jurifprud.) eft aufli un titre commun à
plufieurs offices, commiflions, 6c fondions qui ont
rapport à l’adminiftration de la juftice 6c police.
Nous allons expliquer ce qui concerne ces différentes
fortes de clercs dans la lubdivifion fuivante, par
ordre alphabétique.
C ’eft un abus que l’on a fait du terme clerc, qui
fignifie eccléf aflique. Comme dans les fiecles d’ignorance
il n’y avoit prefque que les clercs ou eccléfiaG
tiques qui euflent conlervé la connoiffance des lettres,
on étoit obligé d’avoir recours à eux pour remplir
toutes les fondions dans lefquelies il falloit favoir
lire 6c écrire, ou être inftruit des lois ; de forte
qu’alors clerc ou homme favaru & lettré étoient des termes
fynonymes, ainfi qu’il paroit par cette belle ré-
ponfe de Charles V. roi de France, à quelqu’un qui
murmuroit de l’honneur qu’il portoit aux gens de
lettres, appellés alors clercs. «Les clercs à fapien-
» ce I’On ne peut trop honorer, 6c tant que fa-
» pience fera honorée.en ce royaume , il conti-
» nuera à profpérité ; mais quand déboutée y fera .
» il déchéera ». Il eft arrive de cette acception du