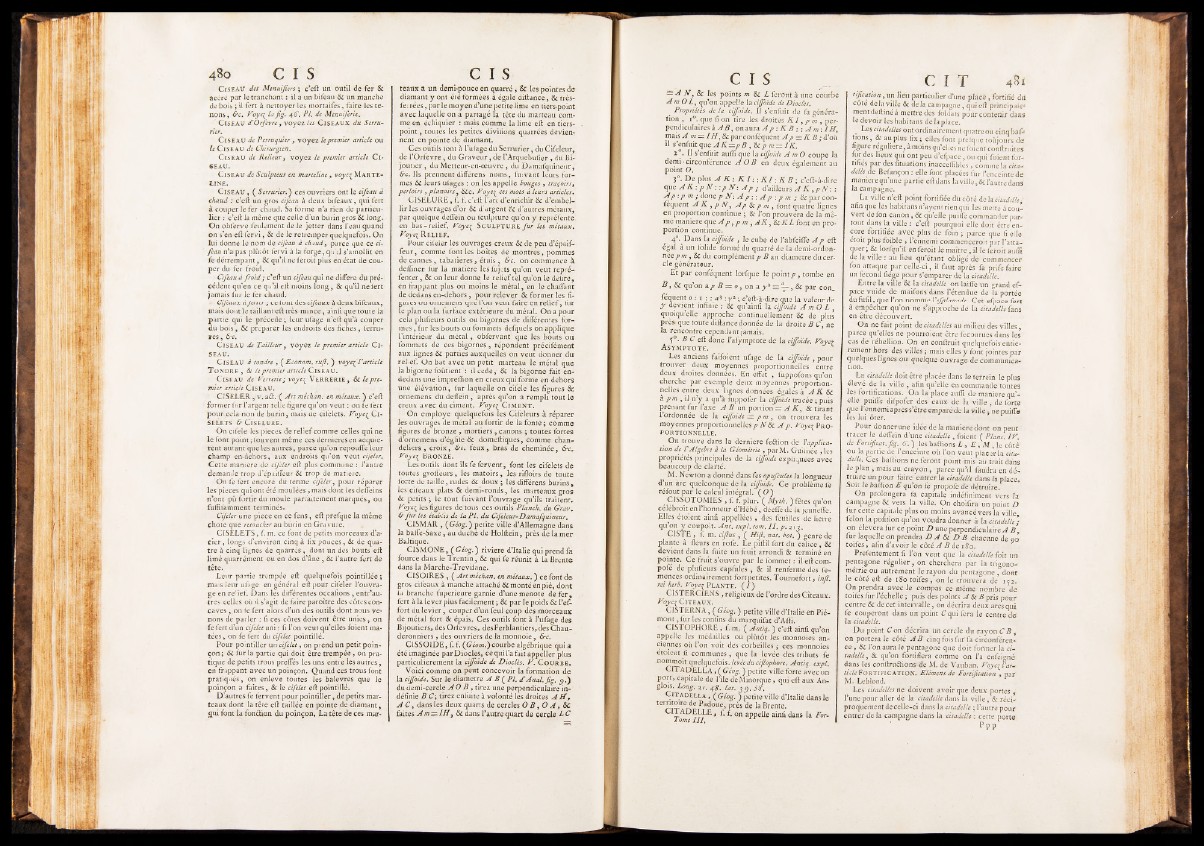
480 C I S
C iseau des Menuijitrs ; c’eft un outil de fer &
acéré par le tranchant : il a un bifeau ôc un manche
de bois ; il fert à nettoyer les mortaifes, faire les tenons
, &c. Voye^ La fig. 46'. PL. de Menuiferie.
' ClSEAU d'Orfèvre , voyez Les C iseaux du Serrurier
.C
lSEAU de Perruquier, voyez Le premier article ou
le ClSEAU de Chirurgien.
C iseau de Relieur, voyez le premier article C l SEAU.
ClSEAU de Sculpteur en marteline, voye^ Marte-
LINE.
C iseau , ( Serrurier.) ces ouvriers ont le cifeau à
chaud : c’eft: un gros cifeau à deux bifeaux, qui fert
à couper le fer chaud. Sa forme n’a rien de particulier
: c’eft la même que celle d’un burin gros Ôc long.
On obferve feulement de le jetter dans l’eau quand
on s’en eft fervi, & de le retremper quelquefois. On
lui donne le nom de cifeau à chaud, parce que ce ci-
feau n’a pas plutôt fervi à la forge, qu'il s’amollit en
fë dérrempant, ôc qu’il ne feroit plus en état de couper
du fer froid.
Cifeau à froid ; c’ eft un cifeau qui ne différé du précédent
qu’en ce qu’il eft moins lon g , & qu’il ne lert
jamais fur le fer chaud.
Cifeaux à ferrer ; ce lônt des cifeaux à deux bifeaux,
mais dont le taillant eft très mince, ainfi que toute la
partie qui le précédé ; leur ufage n’eft qu’à couper
. du bois, & préparer les endroits des fiches, ferrure
s , &c.
ClSEAU de Tailleur, voyez le premier article Cl-
SEA U.
ClSEAU à tondre , CE conom. rufl. ) voyefF article
TONDRE , & le premier article ClSEAU.
ClSEAU de yerrerie; voye^ VERRERIE, ÔC le premier
article ClSEAU.
CISELER, v . aû. ( Art méchan. en métaux. ) c’eft
former fur l’argent telle figure qu’on veut : on le lert
pour-.cela non de burin, mais de cifelets. Voye{ Cl-
selets & C iselure.
On cifele les pièces de relief comme celles qui ne
le font point ;louvent même ces dernieresen acquièrent
autant que les autres, parce qu’on repouffe leur
champ en-dehors, aux endroits qu’on veut cifeler.
Cette maniéré de cifeler eft plus commune : l’autre
demande trop d’épaiffeur ÔC trop de matière.
On fe fert encore du terme cifeler, pour réparer
les pièces qui ont été moulées »mais dont les deffeins
n’ont pu fortir du moule parfaitement marqués, ou
fuffilamment terminés.
Cifeler une piece en ce fens, eft pfefque la même
choie que retoucher au burin en Gravure.
CISELETS, f. m. ce font de petits morceaux d’ac
ie r , longs d’environ cinq à fix pouces, & de quatre
à cinq lignes de quarrés, dont un des bouts eft
limé quarrément ou en dos d’âne, Ôc l’autre fert de
tête.
Leur partie trempée eft quelquefois pointillée ;
mais leur ulage en général eft pour cifeler l’ouvrage
en relief. Dans les différentes occafions, entr’au-
tres celles où il s’agit de faire paroître des côtes concaves
,,on fe fert alors d’un des outils dont nous venons
de parler : fi ces côtes doivent être unies, on
fe fert d’un cifelet uni : fi l’on veut qu’elles foient matées,
on fe lert du cifelet pointillé.
Pour pointiller un cifelet, on prend un petit poinçon
; ôc fur la partie qui doit être trempée, on pratique
de petits trous preffés les uns entre les autres,
en frappant avec un poinçon. Quand ces trous font
pratiqués, on enleve toutes les balevres que le
poinçon a faites, & le cifelet eft pointillé.
D ’autres fe fervent pour pointiller, de petits marteaux
dont la tête eft taillée en pointe de diamant,
gui font la fonction du poinçon, La tête de ces mar-
C I S
teaux a un demi-pouce en quarré, & les pointes de
diamant y ont été formées à égale diftance, ôc très-
leirées, parle moyen d’une petitelime en tiers-point
avec laquelle on a partagé la tête du marteau comme
en échiquier : mais comme la lime eft en tiers-
point , toutes les petites divilions quarrées deviennent
en pointe de diamant.
Ces outils lbnt à l’ulage du Serrurier, du Cifeleur,
de l’Orfevre, du Graveur, de l’Arquebulier » du Bijoutier
, du Metteur-en-ceuvre, du Damafquineur,
&c. Ils prennent différens noms, fuivant leurs formes
Ôc leurs ufages : on les appelle bouges , traçoirs,
perloirs, planoirs, & c . Voye{ ces mots à leurs articles.
CISELURE, f. f. c’eft l’art d’enrichir ôc d’embellir
les ouvrages d’or ÔC d'argent ôc d’autres métaux,
par quelque deffein ou iculpture qu’on y repréfente
en bas-relief. Voye^ S cu l p tu r e fur les métaux.
Vofe^ R elief.
Pour cifeler les ouvrages creux ôc de peu d’épaif-
feur, comme font les boîtes de montres, pommes
de cannes, tabatières, étuis , &c. on commence à
deflxner fur la matière les fujets qu’on veut repré-
fenter, ôc on leur donne le relief tel qu’on le déliré,
en frappant plus ou moins le métal, en le chaffant
de dedans en-dehors, pour relever & former les figures
ou ornemens que l’on veut faire en relie f, fur
le plan ou la furface extérieure du métal. On a pour
cela plufieurs outils ou bigornes de différentes formes
, fur les bouts ou fommets defquels on applique
l’intérieur du métal, obfervant que les bouts ou
fommets de ces bigornes, répondent précifément
aux lignes ôc parties auxquelles on veut donner du
relief. On bat avec un petit marteau le métal que
la bigorne foûtient : il cede,- & la bigorne fait en-
dedans une impreflion en creux qui forme en-dehors
une élévation, lur laquelle on cifele les figures &
ornemens du delfein, après qu’on a rempli tout le
creux avec du ciment. Voye^ C im e n t .
On employé quelquefois les Cifeleurs à réparer
les ouvrages de métal au fortir de la fonte ; comme
figures de bronze , mortiers, canons ; toutes fortes
d’ornemens d’églilè ôc domeftiques, comme chandeliers
, croix, &c. feux, bras de cheminée, &c.
f^oyei Bronze.
Les outils dont ils fe fervent, font les cifelets de
toutes groffeurs, les matoirs , les rifloirs de toute
lorte de taille, rudes ôc doux ; les différens burins ,
les cifeaux plats & demi-ronds, les marteaux gros
& petits ; le tout fuivant l’ouvrage qu’ils traitent.
Foye{ les figures de tous ces outils Planch. du Grav.
& J'ur les établis de la PI. du Cifeleur-Damafquineur.
CISMAR , {Géog. ) petite ville d’Allemagne dans
la balle-Saxe, au duché de Holftein, près de la mer
Baltique.
CISMONE, ( Géog. ) riviere d’Italie qui prend fa
fource dans le Trentin , Ôc qui fe réunit à la Brente
dans la Marche-Trevilane.
CISOIRES , ( Art méchan. en métaux. ) ce font de
gros cifeaux à manche attaché ôc monté en pié, dont
la branche füperieure garnie d’une menote de fe r ,
fert à la lever plus facilement ; ôc par le poids ôc l’e f fort
du levier, couper d’un feul coup des morceaux
de métal fort & épais. Ces outils font à l’ufage des
Bijoutiers^ des Orfèvres, des Ferblantiers, des Chau-
deronniers , des ouvriers de la monnoie, &c.
CISSOIDE, f. f. (Géom. ) courbe algébrique qui a
été imaginée parDioclès, ce qui l’a fait appeller plus
particulièrement la ciffoïde de Dioclès. V. C ourbe.
Voici comme on peut concevoir la formation de
la cijfoide. Sur le diamètre A B (PI. d'Anal.fig. j>.)
du demi-cercle A O B , tirez une perpendiculaire indéfinie
A C , dans les deux quarts de cercles O B ,0 A , ôc
faites Amxz. IH , ôc dans l’autre quart de cercle L C
B Cy tirez enfuite à volonté les droites A H ,
C I S
“ A -V, & les points m ôc L feront à line courbe
Am O L , qu’on appelle la ciffoïde de Dioclès.
Propriétés de la ciffoïde. Il s’enfuit de fa génération
, i°. que fi on tire les droites K l , p m , perpendiculaires
à A B , on aura A p: K B : : Am: IH,
mais A m = IH,ÔC par conféquent A p = K B; d’oii
il s’enfuit que A K = p B ,ÔC p m — 1 K.
x°. Il s’enfuit aufli que la cijjoïde Am O coupe la
demi-circonférence A O B en deux également au
point O.
3°. De plus A K : K I : : K I : K B ; c’eft-à-dire
que A K: p N : :p N: A p ; d’ailleurs A K ,p N: :
A p :p m ; donc p N : A p : :A p :p m ; ÔC par con-
fequent A K , p N, Ap & p m , font quatre lignes
en proportion continue ; & l’on prouvera de la même
maniéré c{ueAp,pm, A K , ô c K L font en proportion
continue.
4°* Dans la ciffoïde , le cube de l’abfciffe A p eft.
egal à un folide formé du quarré de la demi-ordon-r
née pm , Ôc du complément p B au diamètre du cercle
générateur.
Et par conféquent lorfque le point p , tombe en
B , Sc qu’on apB = z o , on a y 2 = ^- ,ôc par eôn_
féquent 0 : 1 : : «1 ;y* ; c’eft-à-dire que la valeur de
y devient infinie : ÔC qu’ainfi la cijfoide A m O L ,
quoiqu’elle approche continuellement ôc de plus
près que toute diftance donnée de la droite B C , ne
la rencontre cependant jamais.
50. B C eft donc l’afymptote de la ciffoïde. Voye?
A s ym p t o t e .
Les anciens faifoient ufage de la ciffoïde , pour
trouver deux moyennes proportionnelles entre
deux droites données. En effet , fuppofons qu’on
cherche par exemple deux moyennes proportionnelles
entre deux lignes données égales à A K 6c
^ pm , il n y a qu’à luppofer la ciffoïde tracée ; puis
prenant fur l’axe A B un portion = A K , & tirant
l’ordonnée de la ciffoïde = pm , on trouvera les
moyennes proportionnelles p N é e A p. Vbye{ Proportionnelle.
On trouve dans la derniere feûion de l’application
de VAlgèbre à la Géométrie , parM. Guilnée , les
propriétés principales de la cijfoide expliquées avec
beaucoup de clarté,
M. Newton a donné dans fes opufcules la longueur
d’un arc quelconque de la ciffoïde. Ce problème fe
réfout par le calcul intégral. ( O )
; CISSOTOMIES , f. f. plur. ( Myth. ) fêtes qu’on
Célébroit en l’honneur d’Hébé, déeffe de la jeuneffe.
Elles étoient ainfi appellées , des feuilles de lierre
qu’on y coupoit. Ant. expi. tom. I I . p. 213.
CISTE , î. m. dflus , ( Hiß. nat. bot. ) genre de
plante à fleurs en rofe. Le piftil fort du calice , &
devient dans la fuite un fruit arrondi & terminé en
pointe. Ce fruit s’ouvre par le fommet : il eft com-
pofe de plufieurs Capfules , & il renferme des fe-
mences ordinairement fortpetites. Tournefort, infl.
rei herb. Voye£ Plante. ( ƒ )
CISTERCIENS, religieux de l’ordre des Cîteaux.-
Voyei ÇlTEÀUX.
CISTERNA, ( Géog. ) petite ville d’Italie en Piémont
,fur les confins du marquifat d’Afti.
CISTOPHORE, f. m. ( Antiq. ) c’eft ainfi qu’on
appelle les médailles ou plutôt les monrtoies an-»-
ciennes où l’on voit des corbeilles ; ces monnoies
etoient fi communes, que la levée des tributs fe
nommoit quelquefois, levée du eißophore. Antiq expl
CITADELL A , ( Géog. ) petite ville forte avec un
port, capitale de l’île deMinorque, qui eft aux An-
glois. Long. x i. 48. lat. 58.
C itade lla t (Géog. ) petite ville d’Italie dans le
territoire de Padoue, près de la Brente.
CIÏ AD ^ } jE » 1 H on appelle ainfi dans la For-
Tome III.
C I T 4 81
tificatioh, un lieu particulier d’une placé , fortifié dit
coté delà ville & delà campagne, qui eft principale*
mentdeftineà mettre des foldats poiir contenir dans
le devoir les habitans de la place.
Les citadelles ont ordinairement quatre ou cinq bafi*
fions, & au plus fix; elles font pretque toûjours de
figure régulière, à moins qu’elles ne foient conftruites
lur des lieux qui ont peu d’efpace, ou qui foient fortifies
par des fituations inacceflibles * commeia cita-*
delle f e Befançon : elle font placées fur l’enceinte de
maniéré qu’une partie eft dans la ville, & l’autre dans
la campagne.
La Ville n’eft point fortifiée du côté de 1 iàitadellci
afin que les habitans n’ayent rien qui les merte à couvert
de fon canon, 6c qu’elle puifl'e commander par-
t0l,t dans la ville : c’eft pourquoi elle doit être encore
fortifiée avec plus de foin ; parce que fi elle
étoit plus foible , l’ennemi commenceroit par l’attaquer;
& lorfqu’il en feroit le maître, il le feroit aufli
de la ville : au lieu qu’étant obligé de commencer
fon attaque j?ar celle-ci, il faut après fa prife faire
un fécond fiege pour s’emparer de la citadelUi
Entre la ville & la citadelle on laiffe un grand ef-
pace vuide de maifons' dans l’étendue de la portée
dufufil, que l’on nomme Yefplanade. Cet efpace fert
à empêcher qu’on ne s’approche de la citadelle fans
en être découvert.
On ne fait point de citadelles au milieu des v illes,
parce qu’elles ne pourroient être fecourues dans les
cas de rébellion. On en conftruit quelquefois entièrement
hors des villes ; mais elles y font jointes par
quelques lignes ou quelque ouvrage de communication.
La citadelle doit être placée dans le tefrein le plus
eleVe de la ville , afin qu’elle en commande toutes
les fortifications. On la place aufli de maniéré qu’elle
puiffe dilpofer des eaux de la ville , de forte
que -l'ennemi après s’être emparé de la ville -, ne puiffe
les lui ôter.
Polir donner une idée de là maniéré, dont oh peut
tracer le deffein d’une citadelle , foient ( Plane. IP .
de Fortifient.fig. G. ) les baftionsX, E ,M , le côté
ou la partie de l’enceinte où l’on veut placer la citadelle.
C es baftions ne feront point mis au trait dans
le plan 3 mais au crayon , parce qu’il faudra en détruire
un pour faire entrer la citadelle dans là place.
Soit le baftion E qu’on fe propofe de détruire.
On prolongera fa capitale indéfiniment vers là
campagne 6c vers la ville* On choifira un point D
fur cette capitale plus ou moins avancé vers la ville
félon la pofition qu’on voudra donner à la citadelle }
on élevera fur ce point D une perpendiculaire^ B
fur laquelle on prendra D A ÔC D B chacune de 9a
toifes, afin d’avoir le côté A B de 180.
Prefentement li l’on veut que l i citadelle fait un
pentagone régulier, on cherchera par la trigonométrie
ou autrement le rayon du pentagone , dont
le côté eft de 180 toifes , on le trouvera de 152.
On prendra avec le compas ce même nombre de
toifes fur l’échelle ; puis des points A & B pris pour
centre & de cet intervalle, on décrira deux arcs qui
fe couperont dans un point C qui fera le centre de
la citadelle.
Du point C on décrira tin cercle du rayon C B ,
on portera le côté A B cinq fois fur fa circonférenc
e , & l’on aura le pentagone que doit former la citadelle,
& qu’on fortifiera comme on l’a enfeigné
dans les conftru&ions-fte M. de Vauban. Voye^l'ar~
ticle Fo r t if ic at io n . Elément de Fortification , par
M. Leblond. ,
Les citadelles ne doivent avoir que deux portes ,
l’une pour aller de la citadelle dans la v ille , & réci-
I proquement de celle-ci dans la citadelle ; l’autre pour
entrer de la campagne dans la citadelle : cette porte
p PP