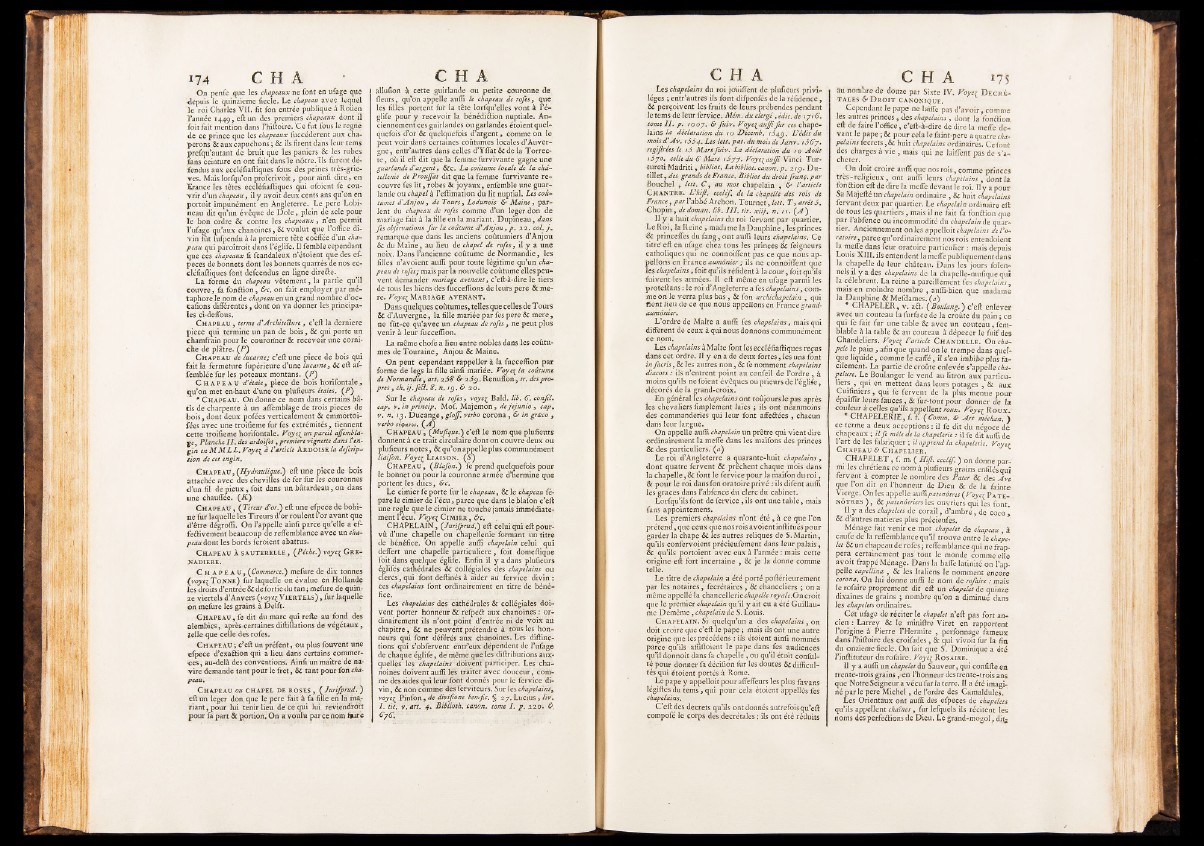
i? 4 L n A
On penfe .que les chapeaux ne font en uiàge que
depuis le quinzième fiecle. Le chapeau avec lequel
le roi Charles VII. fit foii entrée publique à Roiien
l ’année 1449, un des . premiers chapeaux dont il
Toit fait mention dans fhiütoire. Ce fut fous le régné
de ce prince que les chapeaux fuccéderent aux chaperons
& auxcapuchons ; & ils firent dans leur tems
prefqu’autant de bruit que les paniers & les robes
fans ceinture en ont fait dans le nôtre, lis furent défendus
aux ecdéfiaftiques fous des peines très-grie-
ves. Mais Iorfqu’onprofcrivoit., pour ainfi dire., en
France les têtes ecdéfiaftiques qui ofoient fe couvrir
d’un chapeau , il y avoit deux cents ans qu’on en
portoit impunément en Angleterre. Le .pere Lobi-
neau dit qu’un évêque de Dole, plein de zele pour
le bon ordre & contre les chapeaux , n’en permit
l ’ufage qu’aux chanoines, & voulut que l’office divin
fut lufpéndu à la première fête coëffée d’un chapeau
qui paroîtroit dans l’égliïe. Il femble cependant
que ces ckapeaux fi fcandaleux n’étoient que des ef-
peces de bonnets dont les bonnets quartés de nos ec-
cléfiaftiques font defcèndüs en ligne dire&e.
La forme du chapeau vêtement, la partie qu’il
couvre, fa fonction, &c, on fait employer par métaphore
le nom de chapeau en un grand nombre d’oc-
cafions différentes, dont on va donner les principales
ci-deffous.
C hapeau , terme d'Architecture, c’eft la derniere
piece qui termine un pan de bois, & qui porte un
chamfrain pour le couronner & recevoir une corniche
de plâtre. (P )
C hapeau de lucarne; c’eft une piece de bois qui
fait la fermeture fupérieure d’une lucarne, & eft af-
femblée fur les poteaux montans. {P )
C h a p ea u £ était, piece de bois horifontale ,
qu’on met en-haut d’une ou plufieurs étaies. (P )
* C hapeau. On donne ce nom dans certains bâtis
de charpente à un affemblage de trois pièces de
bois, dont deux pofées verticalement & emmôrtôi-
fées avec une troifieme fur fes extrémités, tiennent
cette troifieme horifontale. Voye{ un pareil ajftmbla-
ge, Planche I I . des ardoifes , première vignette dans Cengin
en M M L L . Voye{ à Varticle ARDOISE la defcrip-
lion de cet engin.
C hapeau , (Hydraulique.) eft une piece de bois
attachée avec des chevilles de fer fur les couronnes
d’un fil de pieux, foit dans un batardeau, ou dans
une chauffée. (Æ)
C hapeau , ( Tireur tTor.) eft une efpece de bobine
fur laquelle les Tireurs d’or roulent l’or avant que
d’être dégroffi. On l’appelle ainfi parce qu’elle a effectivement
beaucoup de reffemblance avec un chapeau
dont les bords feroient abattus.
C hapeau à sauterelle , {Pêche.') voye^G re-
NADIERE.
C h a p e a u , ( Commerce.) mefure de dix tonnes
(voyci T onne) fur laquelle on évalue en Hollande
les droits d’entrée & de fortie du tan ; mefure.de quinze
viertels d’Anvers (yoye^ V ier tel s) , fur laquelle
on mefure les grains à Delft.
C hapeau , fe dit du marc qui refte au fond des
alembics, après jcertaines diftillations de végétaux,
telle que celle dés rofes.
C hapeau ; c’eft un préfent, ou plus fouvent une
efpece d’exaCtion qui a lieu dans certains commerces
, au-delà des conventions; Ainfi un maître de navire
demande tant pour le fret, & tant pour fon chapeau.
C hapeau ou ch apel de roses ,. ( Jurifprud. )
eft un leger don, que le pere fait à fa fille en là ma,-
riant, pour lui tenir lieu de ce qui lui reviendroit
pour fa part & portion. On a voulu par ce nom üùre
allufion à cette guirlande ou petite couronne de
fleurs, qu’on appelle aufli te chapeau de rofes, que
les filles portent fur la tête lorfqu’elies vont à l’é—
glife pour y recevoir la bénédiction nuptiale. Anciennement
ces guirlandes ougarlandes étoient quelquefois
d’or & quelquefois d’argent , comme on lé
peut voir dans certaines coûtumes locales d’Auvergne,
entr’autres dans celles d’Y ffa t& d e la Torrec-
te , oit il eft dit que la femme furvivànte 'gagne une
guarlande d.'argent, & c . La coutume locale de la châtellenie
de Proujfat dit que la femme furvivànte recouvre
Tes li t , robes & joyaux, enfemble une guarlande
ou chapel à l’eftimation du lit nuptial. Les cou-
turftes d’Anjou, de Tours, Lodunois 6* Maine, parlent
du chapeau de rofes comme d’un leger don de
mariage fait à la fille en la mariant. Dupirteau, dans
fes obfervations fur la coutume d'Anjou, p. XX. col. j .
remarque que dans les anciens coûtumiers d’Anjou
& du Maine, âu lieu de chapel de rofes, il y a une
noix. Dans l’ancienne coûtume de Normandie, les
filles n’avoient aufli pour toute légitime qu’un chapeau
de rofes; mais par la nouvelle coutume elles peuvent
demander mariage avenant, c’eft-à-dire le tiers
de tous les biens des fuccéflions de leurs pere & me-
ré. Voye^ Maria&e avenant.
D ans quelques coûtumes, telles que celles de T ours
& d’Auvergne, la fille mariée par fes pere & mere ,
ne fût-ce qu’avec un chapeau de rofes , ne peut plus
venir à leur fucceflion.
La même chofe a lieu entre nobles dans les coûtumes
de Touraine, Anjou & Maine.
On peut cependant rappeller à la fucceflion par
forme de legs la fille ainfi mariée. Vsyeç la coûtume
dt Normandie, art. x68 & xôc>. Renufîon, tr. des propres
, ch. ij.fcél. 8. n. 1 g . & xo>
Sur le chapeau de rofes, voyez Bald. lib. G. confl.
cap. V. in princip. Mof. Majemon, de jejunio , cap.
v. n. 13. Dücange, glojf. verbo corona, 6* in grceco ,
verbo ettpctvoi. {A )
C hapeau , (Mufique.) c’eft le nom que plufieurs
donnent à ce trait circulaire dont on couvre deux ou
plufieurs notes, & qu’on appelle plus communément
liaifon. Voye{ LIAISON. ( 5")
Chapeau , (Blafon.) fe prend quelquefois pour
le bonnet ou pour la couronne armée d’hermine que
portent les ducs, &è.
Le cimier fe porte fur le chapeau, & le chapeau fé-
pare le cimier de l’écu, parce que dans le blafon c’eflt
une réglé que le cimier ne touche jamais immédiatement
l’écu. Voye{ ClMlÈR, &c.
CHAPELAIN, ( Jurifprud.) eft celui qui eft pour-
vû d’üne chapelle ou chapellenie formant un titré
de bénéfice. On appelle aufli chapelain celui qui
deffert une chapelle particulière, foit domeftique
foit dans quelque églile. Enfin il y a dans plufieurs
églifès cathédrales & collégiales des chapelains ou
clercs, qui font deftinés à aider au fervice divin :
ces chapelains font ordinairement en titre de bénéfice.
Les chapelains des cathédrales & collégiales doivent
porter honneur & refpeft aux chanoines : ordinairement
ils n’ont point d’entrée ni de voix au
chapitre, & ne peuvent,prétendre à tous les honneurs
qui font déférés aux chanoines. Les distinctions1
qui s’obfervent entr’eux dépendent de l’ufage
de chaque églife, dé même que les diftributions auxquelles
les chapelains doivent participer. Les chanoines
doivent aufli lés traiter avec douceur, comme
des aides qui leur font donnés pour le fervice divin
, & non comme desTerviteurs. Sur lès chapelains,
voyeç.Pinfon, de divifione benefic. § xy. Lucius , liv.
I. tii. y, art, 4. Biblioth. canon, tome I . p. XXQ- £
GyÇ f ' ‘
C H A
Les chapelains du roi joüiffent de plufieurs privilèges
; entr’autres ils font difpenfés de la réfidence,
& perçoivent les fruits de leurs prébendes pendant
le tems de leur fervice. Mém. du clergé, édit, de iy iG .
tome I I . p. loo y. & fu iv. Voye^aufjifur ces chapelains
la déclaration du 10 Décemb. /i.49. L'édit du
mois d'Av.. i3S/f.. Les lett. pat. du mois de Janv. 15 Gy.
regiftrées le 16 Mars'fuiv. La déclaration du 1 o Août
t5yo. celle du G Mars tSyÿ. Voye^auJJi Vinci Tur-
tureti Madriti, bibliôt. Labïbliot. canon, p. x ig . Du-
tillet, des grands de France. Bibliot du droit franç.par
BoucheL , lett. C , au mot chapelain , & l'article
C hantre. L'kifi.- eccléf. de la chapelle des rois de
France, par l’abbé Archon. Tournet, lett. T , arrêt 6.
Chopin , de domàn. lib. I I I , tic. xü j. n. / /. {A )
Il y a huit chapelains du roi fervant par quartier.
Le Roi, la Reine, madame la Dauphine, les princes
& princeffes du fang, ont aufli leurs chapelains. Ce
titre" eft en ufage chez tous les princes & feigneurs
catholiques qui ne connoiffent pas ce que nous appelions
en France aumônier ; ils ne connoiffent que
les chapelains ± foit qu’ils réfident à la cour, foit qu’ils
Tuivent les armées. Il eft même en ufage parmi les
proteftans : le roi d’Angleterre a fes chapelains, comme
on le verra plus bas, & fon archickapelain , qui
fient lieu de-ce que nous appelions en France grand-
aumônier.
L’ordre de Malte a aufli fes chapelains, mais qui
different de ceux à qui nous donnons communément
ce nom.
Les chapelains àMalte font les ecdéfiaftiques reçus
dans cet ordre. Il y en a de deux fortes, les uns font
in facris, & les autres non, & fe nomment chapelains
diacots : ils n’entrent point au confeil de l’ordre , à
moins qu’ils ne foient évêques où prieurs de l’églife,
décorés de la grand-croix.
En général les chapelains ont toujours le pas après
les chevaliers Amplement laïcs ; ils ont néanmoins
des commanderies qui leur font affeûées , chacun
dans leur langue.
On appelle aufli chapelain un prêtre qui vient dire
ordinairement la meffe dans les maifons des princes
& des particuliers, (a)
Le roi d’Angleterre a quarante-huit chapelains,
dont quatre fervent & prêchent chaque mois dans
la chapelle, & font le fervice pour la maifon du roi,
& pour le roi dans fon oratoire privé : ils difent aufli
les grâces dans l’abfence du clerc du cabinet.
Lorfqù’ilsfont de fervice, ils ont une table, mais
fans appointemens.
Les premiers chapelains n’ont été , à ce que l’on
prétend, que ceux que nos rois avoientinftitués pour
garder la chape & les autres reliques de S. Martin,
qu’ils confervoient précieufement dans leur palais,
& qu’ils portoient avec eux à l’armée : mais cette
origine eft fort incertaine , & je la donne comme
telle.
Le titre de chapelain a été porté poftérieurement
par les notaires, fecrétaires, & chanceliers ; on a
même appellé la chancellerie chapelle royale. On croit
que le premier chapelain qu’il y ait eu a été Guillaume
Demême, chapelainàs. S. Louis.
C hapelain. Si quelqu’un a des chapelains, on
doit croire que c’eft le pape ; mais ils ont une autre
origine que lesprécédèns : ils étoient ainfi nommés
parce qu’ils afliftoient le pape dans fes audiences
qu’il donnoit dans fa chapelle , ou qu’il étoit conful-
té pour donner fa décifion fur les doutes & difficultés
qui étoient portés à Rome.
Le pape y appelloit pour affeffeurs les plus favans
légiftes du tems, qui pour cela étoient appellés fes
chapelains.
C’eft des decrets qu’ils ont donnés autrefois qu’eft
compofé le çorps des décrétales : ils ont été réduits
C H A 175
au iiômbre de douze par Sixte IV. Voye^ D é cr étale
s & D r o it canonique.
Cependant le pape ne laiffe pas d’a vo ir , comme
les autres princes, des chapelains , dont la fonction
eft de faire l’office, c’eft-à-dire de dire la meffe devant
le pape ; & pour cela le faint-pere a quatre cha»
pelains fecrets ,& huit chapelains ordinaires. Ce font
des charges à vie , mais qui ne laiffent pas de s’acheter.
On doit croire aufli que nos rois, comme pfinces
très- religieux, ont aufli leurs chapelains , dont la
fonétion eft de dire la meffe devant le roi. Il y a pouf
Sa Majefté un chapelain ordinaire , & huit chapelains
fervant deux par quartier. Le chapelain ordinaire eft
de tous les quartiers, mais il ne fait fa fonction que
par l’abfence ou incommodité du chapelain de quartier.
Anciennement on les appelloit chapelains de l ’oratoire
, parce qu’ordinairement nos rois entendoient
la meffe dans leur oratoire particulier : mais depuis
Louis XIII. ils entendent la meffe publiquement dans
la chapelle de leur château. Dans les jours folen-
nels il y a des chapelains de la chapelle-mufique qui
la célèbrent. La reine a pareillement fes chapelains ,
mais en moindre nombre , aufli-bien que madame
la Dauphine Si Mefdames. (a)
* CHAPELER, v. aû. ( Boulang. ) c’eft enlever
avec un couteau la furface de la croûte du pain ; ce
qui fe fait fur une table & avec un couteau, fem-
blable à la table & au couteau à dépecer le fuif des
Chandeliers. Voye^ l'article C handel le. On cha-
pele Je pain , afin que quand on le trempe dans quel-,
que liquide, comme le caffé, il s’en imbibe plus facilement.
La partie de croûte enlevée s’appelle chapelure.
Le^BouIanger le vend au litron aux particu-
liers , qui en mettent dans leurs potages , & aux
Cuifiniers, qui fe fervent de la plus menue pour
epaiflir leurs fauces, & fur-tout pour donner de la
couleur à celles qu’ils appellent roux. Voyez R o u x .
* CHAPELERIE, f. f. ( Comm. & Art méchan. )
ce terme a deux acceptions : il fe dit du négoce de
chapeaux ; il fe mêle de la chapelerie : il fe dit aufli de
l’art de les fabriquer ; il apprend la chapelerie. Voyez
C hapeau & C hapelier.
CHAPELET, f. m. ( Hifl. eccléf. ) on donne parmi
les chrétiens ce nom à plufieurs grains enfilés qui
fervent à compter le nombre des Pater & des Ave
que l’on dit en l’honneur de Dieu & de la fainte
Vierge. On les appelle av&\patenôtres ( Voyez Pa t e nôtres
) , & patenôtriers les ouvriers qui les font.
Il y a des chapelets de corail, d’ambre, de coco j
& d’autres matières plus précieufes.
Ménage fait venir ce mot chapelet de chapeau à
caufe de la reffemblance qu’il trouve entre le chapelet
& un chapeau de rofes ; reffemblance qui ne frappera
certainement pas tout le monde comme elle
avoit frappé Ménage. Dans la baffe latinité on l’appelle
capellina , & les Italiens le nomment encore
corona. On lui donne aufli le nom de rofaire : mais
le rofaire proprement dit eft un chapelet de quinze
dixaines de grains ; nombre qu’on a diminué dans
les chapelets ordinaires.
Cét ufage de réciter le chapelet n’eft pas fort ancien
: Larrey & le miniftre Viret en rapportent
l’origine à Pierre l’Hermite , perfonnage fameux
dans l’hiftoire des croifades, & qui vivoit fur la fin
du onzième fiêcle. On fait que S. Dominique a été
l’inftituteür du rofaire. Voyeç Rosaire.
Il y a aufli un chapelet du Sauveur, qui confifte en
trente-trois grains /en l’honneur des trente-trois ans
que Notre Seigneur a vécu fur la terre. Il a été imaginé
parle pere Michel, de l’ordre des Camaldules.
Les Orientaux ont aufli des efpeces de chapelets
qu’ils appellent chaînes, fur Iefquels ils récitent les
noms des perfections de Dieu. Le grand-mogol, difc