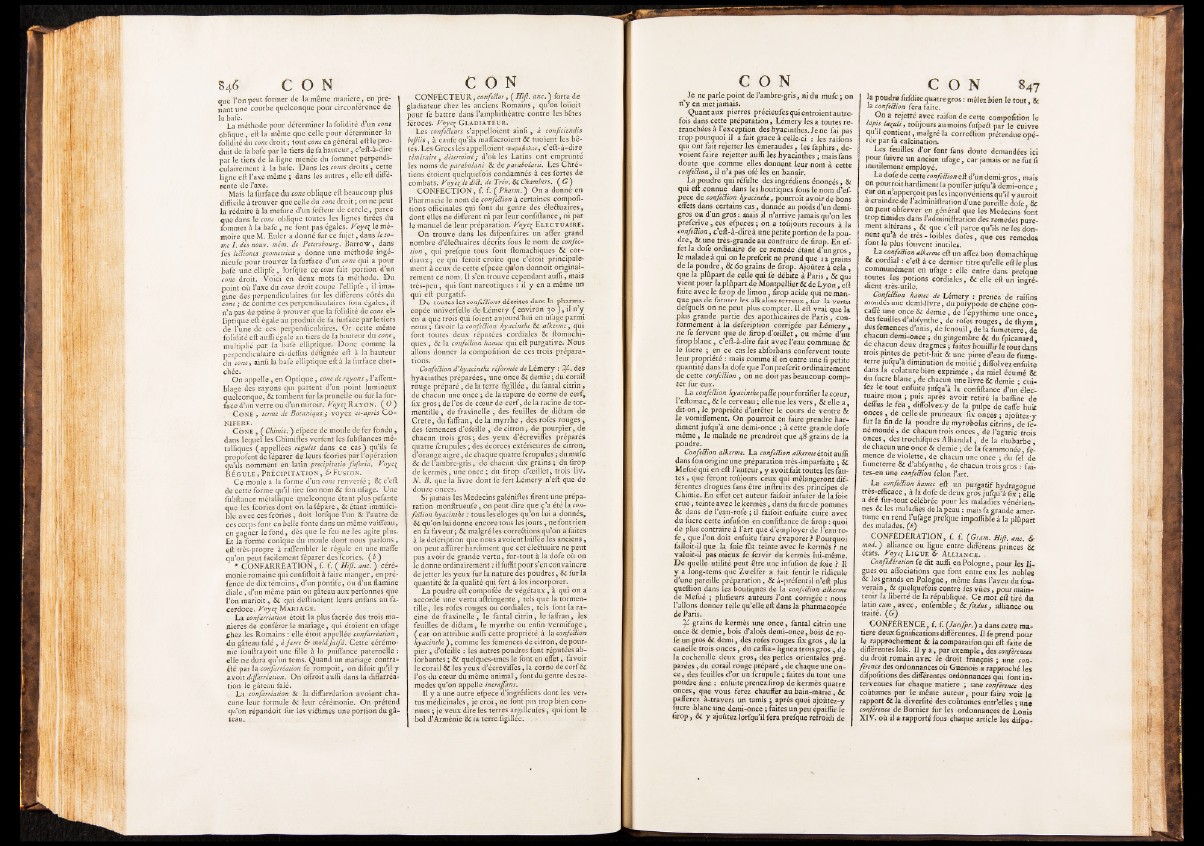
que l’on peut former de la même maniefe, en prenant
une courbe quelconque pour circonférence de
la bafe. 1 ' _ . . . , \
La méthode pour déterminer la folidité d’un cône
oblique, eft la même que celle pour déterminer la
folidité du cône droit ; tout cône en général eft le produit
de fabafe par le tiers de fa hauteur, c ’eft-à-dire
par le tiers de la ligne menée du fommet perpendiculairement
à la bafe. Dans les cônes droits , cette
ligne eft l’axe même ; dans les autres, elle eft différente
de l’axe.
Mais la furface du cône oblique eft beaucoup plus
difficile à trouver que celle du cône droit ; on ne peut
la réduire à la mefure d’un fe&eur de cercle, parce
que dans le cône oblique toutes les lignes tirées du
fommet à la bafe, ne font pas égales. Voye^ le mémoire
que M. Euler a donné fur ce fujet, dans le tome
I. des nouv. mém. de Petersbourg. Barrow, dans
fes lecliones geometricce, donne une méthode ingé-
nieufe pour trouver la furface d’un cône qui a pour
bafe une éllipfe , lorfque ce cône fait portion d’un
cône droit. Voici en deux mots fa méthode. Du
point oit l’axe du cône droit coupe l’ellipfe , il imagine
des perpendiculaires fur les différens côtés du
cône ; 8c comme ces perpendiculaires font égales, il
n’a pas de peine à prouver que la folidité de cône elliptique
eft égale au produit de fa furface par le tiers
de l’une de ces perpendiculaires. Or cette même
folidité eft auffi égale au tiers de la hauteur du cone9
multiplié par la bafe elliptique. Donc comme la
perpendiculaire ci-deffus défignée eft à la hauteur
du cône, ainû la bafe elliptique eft à la furface cherchée.
On appelle, en Optique, cône de rayons , l’affem*
blage des rayons qui partent d’un point lumineux
quelconque, 8c tombent fur la prunelle ou fur la fur-
fa c e d’un verre ou d’un miroir. Voye^R a y o n . (O )
C ô n e , terme de Botanique ; v o y e z ci-après C O NIFERE.
C ô n e , ( Chimie. ) efpece de moule de fer fondu,
dans lequel les Chimiftes verfent les fubftances métalliques
( appellées régules dans ce cas ) qu’ils fe
propofent de féparer de leurs fcories par l’opération
qu’ils nomment en latin precipitatio fuforia. Foye{
R é g u l e i P r é c i p i t a t i o n , & F u s i o n .
Ce moule a la forme d’un cône renverfé ; 8c c’eft
de cette forme qu’il tire fon nom & fon ufage. Une
fubftance métallique quelconque étant plus pefante
que les fcories dont on la fépare, & étant immifci-
ble avec ces fcories , doit lorfque l’un & l’autre de
ces corps font en belle fonte dans un même vaiffeau,
en gagner le fond, dès que le feu ne les agite plus.
Et la forme conique du moule dont nous parlons,
eft très-propre à raflembler le régule en une malle
qu’on peut facilement féparer des fcories. ( b )
* CONFARRÉATION, f. f . ( Hift. anc. ) cérémonie
romaine qui confiftoit à faire manger, en pré-
fence de dix témoins, d’un pontife , ou d’un flamine
diale, d’un même pain ou gâteau aux perfonnes que
l’on marioit, 8c qui deftinoient leurs enfans au fa-
cerdoce. Foye^ Ma r iag e .
La confarréation étoit la plus facrée des trois maniérés
de conférer le mariage, qui étoient en ufage
chez les Romains : elle étoit appellée confarréation,
du. gâteau falé , à fane & molâfalfâ. Cette cérémonie
fouftrayoit une fille à la puiffance paternelle :
elle ne dura qu’un tems. Quand un mariage contrarié
par la confarréation fe rompoit, on difoit qu’il y
avoit diffarréation. On'offroit auffi dans la diffarréa-
tion le gâteau falé.
La confarréation 8c la diffarréation avoient chacune
leur formule 8c leur cérémonie. On prétend
qu’on répandoit fur les vi&imes une portion du gâteau.
CONFÈCTEÜR,confector, (Hift. anc.') forte de
gladiateur chez les anciens Romains, qu’on loiioit
pour fe battre dans l’amphithéatre contre les bêtes
féroces. F'oyeç G l a d i a t e u r »
Les cônfecteurs s’appelioient ainfi, à cohficiendis
beftiis, à caufe qu’ils maflaeroient 8c tuoient les bêtes.
Les Grecs les appelloient >&ap*fio\oi 9 c’eft-à-dire
téméraire, déterminé; d’où les Latins ont emprunté
les noms de parabolani & de parctbolarii. Les Chrétiens
étoient quelquefois condamnés à ces fortes de
combats. Voye£ le dict. de Trév. 8c Chambers. (G)
CONFECTION, f. f. ( Pharm. ) On a donné en
Pharmacie le nom de confection à certaines compofi-
tions officinales qui font du genre des éleêluaires,
dont elles ne different ni par leur confiftance, ni par
le manuel de leur préparation. Foye[ E l e c t u a i r e .
On trouve dans les difpenfaires un affez grand
nombre d’éleétuaires décrits fous le nom de confection,
qui prefque tous font ftômachiques & cordiaux
; ce qui feroit croire que c’étoit principalement
à ceux de cette efpece qu’on donnoit originairement
ce nom. Il s’en trouve cependant auffi, mais
très-peu, qui font narcotiques : il y en a même un
qui eft purgatif.
De toutes les confections décrites dans la. pharmacopée
univerfelle de Lémery (environ 30 ) , il n’y
en a que trois qui foient aujourd’hui en ufage parmi
nous ; favoir la confection hyacinthe 8c alkerme, qui
font toutes deux réputées cordiales & ftomàehi-
ques , 8c la confection hamec qui eft purgative. Nous
allons donner la compofition de ces trois préparations.
Confection d'hyacinthe réformée de Lémery : 'if. des
hyacinthes préparées, une once & demie ; du corail
rouge préparé, de la terre figillée, du fantal citrin ,
de chacun une once ; de la rapure de corne de cerf*
fix gros ; de l’os de coeur de cerf, de la racine de tor-
mentille, de fraxinelle , des feuilles de diftam de
Crete, du faffran, de la myrrhe , des rofes rouges ,
des femences d’ofeille , de citron, de pourpier, de
chacun trois gros; des yeux d’écreviffes préparés
quatre fcrupules ; des écorces extérieures de citron,
d’orange aigre, de chaque quatre fcrupules ; du mufc
8c de l’ambre-gris, de chacun dix grains ; du firop
de kermès, une once; du firop d’oeillet* trois liv.
N. B. que la livre dont fe fert Lémery n’eft que de
douze onces.
Si jamais les Médecins galéniftes firent une préparation
monftrueufe, on peut dire que ç’a été la confection
hyacinthe : tous les éloges qu’on lui a donnés,
8c qu’on lui donne encore tous les jours, ne font rien
en fa faveur ; 8c malgré les correêlions qu’on a faites
à la defcription que nous avoient laiffée les anciens,
on peut affûrer hardiment que cet éleûuaire ne peut
pas avoir de grande vertu, fur-tout à la dofe où on
le donne ordinairement : il fuffit pour s’en convaincre
de jetter les yeux fur la nature des poudres, 8c fur la
quantité & la qualité qui fert à les incorporer.
La poudre eft compofée de végétaux, à qui on a
accordé une vertu aftringente , tels que la tormen-
tille, les rofes rouges ou cordiales, tels font la racine
de fraxinelle , le fantal citrin, le faffran, les
feuilles de di£lam, le myrrhe ou enfin vermifuge ,
( car on attribue auffi cette propriété à la confection
hyacinthe ) , comme les femences de citron, de pourpier
, d’ofeille : les autres poudres font réputées àb-
forbantes ; & quelques-unes le font en effet, favoir
le corail & les yeux d’écreviffes, la corne de cerf &
l’os du coeur du même animal, font du genre des re-
medes qu’on appelle incraffans.
Il y a une autre efpece d’ingrédiens dont les vertus
médicinales, je croi, ne font pas trop bien connues
; je veux dire les terres argilleufes, qui font le
bol d’Arménie 8c ia terre.figillée. . -
le ne parle point de l’ambre-gris, ni du mufc ; on
n’y en met jamais.
Quant aux pierres précieufes qui entroient autrefois
dans .cette préparation, Lémery les a toutes retranchée?
à Fexception des hyacinthes. Je ne fai pas
trop pourguoi il a fait grâce à celle-ci : les raifons
qui ont fait rejetter les émeraudes, les faphirs, dévoient
faire rejetter auffi les hyacinthes ; mais fans
doute que comme elles donnent leur nom à cette
confection, il n’a pas ofé les en bannir.
La poudre qui réfulte des ingrédiens énoncés , &
qui eft connue dans les boutiques fous le nom d’ef-
pece de confection hyacinthe, pourroit avoir de bons
effets dans certains cas, donnée au poids d’un demi-
gros ou d’un gros : mais il n’arrive jamais qu’on les
prefcrive, ces efpeces ; on a toujours recours à la
confection, c’eft-à-dire à une petite portion de la poudre,
& une très-grande au contraire de firop. En effet
la dofe ordinaire de ce remede étant d’un gros,
le malade à qui on leprefcrit ne prend que 12 grains
de la poudre, 8c60 grains de firop. Ajoûtez à ce la ,
que la plupart de celle qui fe débite à Paris , & qui
vient pour la plupart de Montpellier & de Lyon , eft
faite avec le firop de limon, firop acide qui ne manque
pas de faturer les alkalins terreux, fur la vertu
defquels on ne peut plus compter. Il eft vrai que la
plus grande partie des apothicaires de Paris, conformément
à la defcription corrigée par L émery,
ne fe fervent que de firop d ’oe illet, ou même d’un
firop blanc, c’eft-à-dire fait avec l’eau commune .&
le lucre ; en ce cas les abforbans confervent toute
leur propriété : mais comme il en entre une fi petite
.quantité dans la dofe que l’onprefcrit ordinairement
de cette confection, on ne doit pas beaucoup compter
fur eux.
La confection hyacinthe paffe pour fortifier le coeur,
l’eftomac, 8c le cerveau ; elle tue les vers, & elle a ,
dit-on, le propriété d’arrêter le cours de ventre &
le vomiffement. On pourroit en faire prendre hardiment
jufqu’à une demi-once ; à cette grande dofe
même, le malade ne prendroit que 48 grains de la
poudre.
Confection alkerme. La confection alkerme étoit auffi
dans fon origine une préparation très-imparfaite ; 8c
Mefué qui en eft l’auteur, y avoit fait toutes les fautes
, que feront toujours ceux qui mélangeront dif- 1
férentes drogues fans être inftruits des principes de
Chimie. En effet cet auteur faifoit infulèr de la foie
cru e, teinte avec le kermès, dans du fuc de pommes
8c dans de l’eau-rofe ; il faifoit enfuite cuire avec
du lucre cette infufion en confiftance de firop : quoi
de plus contraire à Fart que d’employer de l ’eau-ro-
f e , que l’on doit enfuite faire évaporer ? Pourquoi
falloit-il que la foie fût teinte avec le kermès ? ne I
valoit-il pas mieux fe fervir du kermès lui-même.
De quelle utilité peut être une infufion de foie ? Il
y a long-tems que Zwelfer a fait fentir le ridicule
d’une pareille préparation, & à-préfenril n’eft plus
queftion dans les boutiques de la confection alkerme
de Mefué ; plufieurs auteurs Font corrigée : nous
l’allons donner telle qu’elle eft dans la pharmacopée
de Paris.
i f grains de kermès une once, fantal citrin une
once 8c demie, bois d’aloès demi-once,bois de rôle
un gros & demi, des rofes rouges fix gros , de la
canelle trois onces, du çaffia- lignea trois gros , de
la cochenille deux gros, des perles orientales préparées
, du corail rouge préparé, de chaque une once
, des feuilles d’or un fcrupule ; faites du tout une
poudre fine : enfuite prenez firop de kermès quatre
onces, que vous ferez chauffer au bain-marie, &
pafferez à-trayers un tamis ; après quoi ajoûtez-y
fiicre blanc une demi-once ; faites un peu épaiffir le
firop, 8c y ajoûtez lorfqu’il fera prefque refroidi de
; l a poudre fufditequatre gros : mêlez bien le tout &
i la confection fera faite.
! On a rejeté avec raifon de cette compofition le
j lapis la^uli, toujours au moins fufpeft par le cuivre
| qu il contient1 malgré la correction prétendue opé-
j ree par fa calcination.
Les feuilles d’or font fans doute demandées ici
i pour fuivre un ancien ufage, car jamais or ne fut fi
; inutilement employé.
La dofe de cette confection eft d’un demi-gros, mais
on pourroit hardiment la pouffer jufqu’à demi-onçe ;
car on a ’apperçoit pas les inconvéniens qu’il y auroit
à craindre de Fadminiftration d’une pareille dofe, &
on peut obferver en général que les Médecins font
trop timides dans Fadminiftration des remedes purement
altérans , 8c que c’eft parce qu’ils ne les donnent
qu’à de très - foibles dofes, que ces remedes
font le plus fouvent inutiles.
La confection alkerme eft un affez bon ftomachique
&c cordial : c’eft à ce dernier titre qu’elle eft le plus
communément en ufage : elle entre dans prefque
toutes les potions cordiales, 8c elle eft un ingrédient
très-utile.
Confection hamec de Lémery : prenez de raifins
mondés une demi-livre, du polypode de chêne con-
çaffe une once & demie, de l’épythime une once,
des feuilles d’abfynthe, de rofes rouges, de thym ,
des femences d’anis, de fenouil, de la fumeterre, de
chacun demi-once ; du gingembre & du fpicanard ,
de chacun deux dragmes ; faites bouillir le tout dans
trois pintes de petit-lait & une pinte d’eau de fumeterre
julqu à diminution de moitié ; diffolvez enfuite
dans la colature bien exprimée, du miel écumé &
du fucre b lanc, de chacun une livre & demie ; cui-
fez le tout enfuite julqn’à la confiftance d’un élec-
tuaire mou ; puis apres avoir retiré la baffine de
deffus le fe ii, diffolvez-y de la pulpe de caffe huit
onces , de celle de pruneaux fix onces ; ajoûtez-y
fur la fin de la pondre de myrobolas citrins, de fe-
né mondé, de chacun trois onces, de l’agaric trois
onces, des trochifques Alhandal, de la rhubarbe ,
de chacun une once & demie ; de la fcammonée, fç-
mence de v iolette, de chacun une once ; du fel de
fumeterre 8c d’abfynthe, de chacun trois gros : faites
en une confection félon Fart.
La confection hamec eft un purgatif hydragogué
tres-efficace, à là dofe de deux gros jufqu’à fix ; elle
a ete fur-tout célébrée pour lés maladies vénérien?
nés & les maladies de la peau : mais fa grande amertume
en rend l’ufage prefque impoffible à la plûpart
des malades, (b) r
CONFÉDÉRATION, f. f. (Gram. Hift. anc. &
mod. ) alliance ou ligue entre différens princes &
états. FbyeiLiGVE& Alliance. .
Confédération fe dit auffi en Pologne, pour lès ligues
on affociations que font entre eux les nobles
8c les grands en Pologne, même fans l’ayeu du fou-
verain, & quelquefois contre fes vues, pourmain-
tenir la liberté de la république. Ce mot eft tiré du
latin cum, a v e c , enfemble ; 8c fctdus, alliance ou
traité. (JG)
CONFÉRENCE, f. f. (Jurijpr.) a dans cette matière
deux lignifications différentes. Il fe prend pour
le rapprochement & la comparaifon qui eft faite de
différentes lois. Il y a , par exemple, des conférences
du droit romain avec le droit françois ; une conférence
des ordonnances où Guenois a rapproché les
difpofitions .des différentes ordonnances qui font intervenues
fur chaque matière ; une conférence des
coûtumes par le même auteur, pour faire voit le
rapport & la diverfité des coûtumes entr’elles ; une
conférence de Bornier fur les ordonnances de Louis
XIV. où il a rapporté fous chaque article les difpo