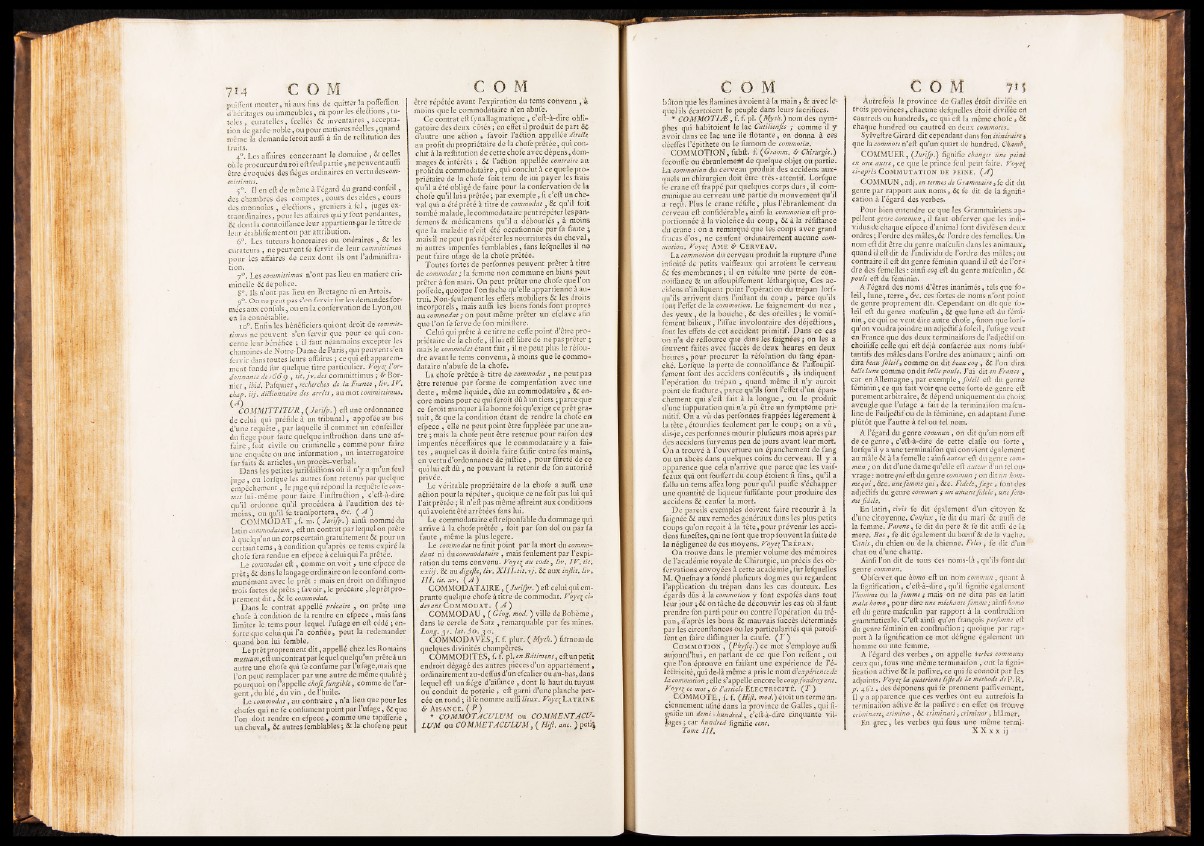
puiffent monter, ni aux fins de quitter la poffeflion I
d’héritages ou immeubles, ni pour les ele&ions , tu- 1
teles , curatelles, (celles 6c inventaires , acceptation
de garde-noble, ou pour matières réelles, quand
même la demande feroit auffi à fin de reftitution des
fruits.
4°. Les affaires concernant le domaine , & celles
où le procureur du roi ell feul partie-, ne peuvent auffi
être évoquées desfiéges ordinaires en vertu des com-
m i t i i m u s •.< • . '• •.;/ . ' j
Il en eft de même à l’égard du grand-confeil,
-des chambres des comptes , cours des aides, cours
des monnoies , éleftions , greniers à fe l, juges extraordinaires
, pour les affaires qui y font pendantes, ;
&c dont la connoiffance leur appartientpar le titre de
leur établiffement ou par attribution.
6°. Les tuteurs honoraires ou onéraires , 6c les
curateurs , ne peuvent fe fervir de leur committimus
pour les affaires de ceux dont ils ont l’adminiftra-
tion. , ■ . '
7°. Les committimus n’ont pas lieu en matière criminelle
& de police.
8°. Ils n’ont pas lieu en Bretagne ni en Artois.
9°. On ne peut pas s’en fervir furies demandes formées
aux confuls, ou en la confervation de Lyon,ou
en la connétablie. a < ■ f-''
io°.. Enfin les bénéficiers qui ont droit de committimus
ne peuvent s’en fervir que pour ce qui con-'
cerne leur bénéfice ; il faut néanmoins excepter les
chanoines de Notre-Dame de Paris, qui peuvent s’en
fervir dans toutes leurs affaires ; ce qui eft apparemment
fondé fur quelque titre particulier. Voye^l'ordonnance
de 16 6 c) , tit. jv . des committimus ; & Bor-
nier, ïbid. Pafquier, recherches de la France , liv. I P .
chap. iij. dictionnaire des arrêts , au mot committimus,
(A)C
OMMITTITUR, ( Jurifp. ) eft une ordonnance
de celui qui préfide à un tribunal, appofée au bas
d’une requête , par laquelle il commet un confeiller
du fiege pour faire quelque.inftruâion dans une affaire
, foit civile ou criminelle , comme pour faire
une enquête ou une information , un interrogatoire
fur faits & articles, un procès-verbal.
Dans les petites jurildi étions oii il n’y a qu’un feul
juge , ou lorfque les autres font .retenus par quelque
empêchement, le juge qui répond la requête fe commet
lui - même pour faire l’inftruâion , c’eft-à-dire
qu’il ordonne qu’il procédera à l’audition des témoins
, ou qu’il fe tranfportera, &c. ( A )
COMMODAT ,f . m. ( Jurifp.') ainfi nommé du
latin commodatum, eft un contrat par lequel on prête
à quelqu’un un corps certain gratuitement & pour un
certain tems, à condition qu’après ce tems expiré la
chofe fera rendue en efpece à celui qui l’a prêtée.
Le commodat eft , comme on v o i t , une efpece de
prêt ; & dans le langage ordinaire on le confond communément
avec le prêt : mais en droit on diftingue
trois fortes de prêts ; favoir, le précaire , leprêtpro-
prement dit, 6c le commodat.
Dans le contrat appellé précaire , on prête une
chofe à condition de la rendre en efpece , mais fans
limiter le. tems pour lequel l’ufage en eft cédé ; en-
fortp que celui qui l’a confiée, peut la redemander
■ quand bon lui lemble.
Le prêtproprement dit, appellé chez les Romains
mutuum^Çc un contrat’par lequel quelqu’un prêteà un
autre une chofe qui fe confume par l’ufage,mais que
l’on peut remplacer par une autre de même qualité ;
pourquoi on l’appelle chofe fungible, comme de l’argent
, du b lé, du vin , de l’huile.
Le commodat, au contraire , n’a lieu que pour les
chofes qui ne fe confument point par l’ufage, 6c que
l’on doit rendre en efpece , comme une tapifferie ,
un cheval, 6c autres femblables ; & la chofe ne peut
être répétée avant l’expiration du tems convenu
moins que le commodataire n’en abufe.
Ce contrat eft fynallagmatique , c’eft-à-dire obligatoire
des deux côtés ; en effet il produit de part 6c
d’autre une aôion , favoir l’aûion appellèé directe.
au profit du propriétaire de la chofe prêtée, qui con*
dut à la reftitution de cette chofe avec dépens, dommages
& intérêts ; 6c l’a&ion appellée contraire au
profit du commodataire, qui conclut à ce quele pro*
priétaire de la chofe foit tenu de lui payer les frais
qu’il a été obligé de faire pour la confervation de la
chofe qu’il lui a prêtée; par exemple, fi c’eft un cheval
qui a. été prêté à titre de commodat, & qu’il foit
tombé malade, le commodataire peut répéter les pan-
femens & médicamens qu’il a débourfés , à moins
que la maladie n’eût été occafionnée par fa faute ;
mais il ne peut pas répéter les nourritures du cheval,
ni autres impenfes femblables, fans lefquelles il no
peut faire ufage de la chofe prêtée.
Toutes fortes de perfonnes peuvent prêter à titre
de commodat; la femme non commune en biens peut
prêter à fon mari. On peut prêter une chofe que l’on
poffede, quoique l’on fache qu’elle appartienne à autrui.
Non-feulement les effets mobiliers 6c les droits
incorporels, mais auffi les biens fonds font propres
au commodat ; on peut même prêter un efclave afin
que l’on fe ferve de fon miniftere.
Celui qui prête à ce titre ne ceffe point d’être propriétaire
de la chofe, il lui eft libre de ne pas prêter ;
mais le commodat étant fait / il ne peut plus le réfoudre
avant le tems convenu, à moins que le commodataire
n’abufe de la chofe.
La chofe prêtée à- titre de commodat, ne peut pas
être retenue par forme de compenfation avec Une
dette, même liquide, due au commodataire, & encore
moins pour ce qui ferôit dû à un tiers ; parce que
ce feroit manquer à la bonne foi qu’exige ce prêt gratuit
, & que la condition étant de rendre la chofe en
efpece , elle ne peut point être fuppléée par une autre
; mais la choie peut être retenue pour raifon des»
impenfes néceffaires que le commodataire y a fai-
i tes , auquel cas il doit-la faire faifir entre fes mains,
en vertu d’ordonnance de juftice , pour fûrèfé de ce
qui lui eft d û , ne pouvant la retenir de fon autorité
privée.
Le véritable propriétaire de la chofe a auffi une
aôion pour la répéter, quoique ce ne foit pas lui qui
l’ait prêtée ; il n’eft pas même aftreint aux conditions
qui avoiefit été arrêtées fans lui.
Le commodataire eftrefponfable du dommage qui
arrive à la chofe prêtée , foit par fon dol ou par fa
faute , même la plus legere.
Le commodat ne finit point par la mort du commo-
dant ni du commodataire , mais feulement par l’expiration
du tems convenu. Voye^ au code, liv, IV. tit,
xxïij. 6c au digefie, liv. X I I I . tit. vj. 6c aux inßit. liv,
I I I . tit. xv. f A )
COMMODAT AIRE, ( Jurifpr. ) eft celui qui emprunte
quelque chofe à titre de commodat. Voye^ ci-
. devant COMMODAT. ( A )
COMMODAU, ( Géog. mod. ) ville de Bohème ,
dans le cercle de Satz , remarquable par fes mines.
Long. g i. lat. So. jo-. f ’
COMMODAVES, f. f. plur. ( Mytk. ) firmom de
quelques divinités champêtres.
COMMODITÉS, f. f. pl. en Bâtiment, eft un petit
endroit dégagé des autres pièces d’un appartément,
ordinairement au-deffus d’un efcalier ou au-bas, dans
lequel eft un fiége d’aifànce , dont le haut du tuyau
ou conduit de poterie, eft garni d’une planche percée
en rond ; ilfie nomme auffi lieux. Voyei Latrine I & Aisance. ( P )
* CO MMO T A CULU M ou COMMENTACU-
LUM. ou COMMETACULUM, ( Hiß. anc. ) petijj
bâton que lès flamines âvoient à la main, & avec lé*
quel ils écartoient le peuple dans leurs facrifices.
* COMMOTIÆ, f. f. pli (Myth.) nom des nymphes
tfui habitoient le lac Cutilienfis ; comme il y
avoit dans ce lac une île dotante, on donna à ces
déeffes l’épithete ou le furnom de commotiie.
COMMOTION, fubft. f. (Grdmm. & Chirurgie.)
fecouffe ou ébranlement de quelque objet ou partie;
La commotion du cerveau produit des accidens auxquels
un chirurgien doit être très-attentif. Lorfque
le crâne eft frappé par quelques corps durs, il communique
au cerveau une partie du mouvement qu’il
a reçû. Plus le crâne réfifte , plus l’ébranlement du
Cerveau eft confidérable ; ainfi la commotion eft proportionnée
à la violence du coup, & à la réfiftance
du crâne : on a remarqué que les coups avec grand
fracas d’o s , ne caufent ordinairement aucune commotion,
Voye%_ Ame & C erveau.
La commotion du cerveau produit la rupture d’une
infinité dé petits vaiffeaux qui arrofent le cerveau
& fes membranes ; il en réfulte une perte de cdii-
noiffance & un affoupiffement léthargique, Ces ac*
cidens n’indiquent point l’opération du trépan lorf-
qu’ils arrivent dans l’inftant du coup, parce qu’ils
font l’effet de la commotion. Le faignement du nez j
des y e iix , de la bouche, 6c des oreilles ; le vomif-
fement bilieux, l’iffue involontaire dés déje&ions,
font les effets de cet accident primitif. Dans ce cas
on n’a de reffource que dans les faignées ; on les a
foüvent faites avec fuccès de deux heures en deux
heures -, pour, procurer la réfolution du fang épan-»
ché. Lorfquê la perte de connoiffance & l’affoupif-
fement font des accidens confécutifs , ils indiquent
l’opération du trépan , quand même il n’y auroit
point de fra&ure > parce qu’ils font l’effet d’un épanchement
qui s’eft fait à la longue, ou le produit
d’une fuppuration qui n ’a pû être un fymptome primitif.
On a vû des perfonnes frappées légèrement à
la tête, étourdies feulement par le coup ; on a v û ,
dis-je, ces perfonnes mourir plufieurs mois après par
des accidens furvenus peu de jours avant leur mort.
Ôn a trouvé à Couverture un épanchement de fang
où un abcès dans quelques coins du cerveau. Il y a
apparence que cela n’arrive que parce que les vaiffeaux
qui ont fouffert du coup étoient fi fins., qu’il a
fallu un tems allez long pour qu’il puifle s’échapper
une quantité de liqueur fuffifante pour produire des
accidens 6c càufer la mort.
De pareils exemples doivent faire recourir à là
fàignée 6c aux remedes généràiix dans les plus petits
coups qu’on reçoit à la tête, pour prévenir les àcci-
dens funeftes, qni ne font que trop fouvent la fuite dé
la négligence de ces moyens. J'by^TRÉPANj
On trouve dans le premier volume des mémoires
de l’académie royale de Chirurgie, un précis des ob-
fervations envoyées à cette académie, fur lefquelles
M. Quefnay a fondé plufieurs dogmes qui regardent
l’application du trépan dans les cas douteux. Les
égards dûs à la commotion y font expôfés dans tout
leur jour ; 6c on tâche de découvrir les cas où il faut
prendre fon parti poür ou contre l’opération du trépan
j d’après les bons & mauvais fuccès déterminés
par les circonftances ôu les particularités qui paroifi
fent en faire diftinguer la caufe. ( T )
C ommotion , (Phyjîq.) ce mot s’emplôye auffi
aujourd’hui, en parlant de ce que l’on reffent, oit
que l’on éprouve en faifant une expérience de l’é-
leftricité, qui de-là même a pris le nom ÿ expérience de
la commotion ; elle s’appelle encore le coup foudroyant.
Foyt{ ce mot, & l'article ÉLECTRICITÉ. (T )
COMMOTE, f. f. (Hift. mod.) étoit un terme anciennement
ufité dans la province de Galles, qui lignifie
un demi - hundred, c’eft-à-dire cinquante villages
; car hundred lignifie cent.
Tome ///.
Autrefois là province de Galles étôit divifée en
trois provinces, chacune delquelles étoit divifée eri
cautreds ou hundréds* ce qui eft la même chofe ; 6t
chaque hundred ou cautred en deux commotes.
Sylveftre Girard dit cependant dans fon itinéraire ;
que la commote n’eft qu’un quart dé hundred. Chamb4
COMMUER, (Jurifp.) lignifie changer une peiné
en une autre, ce que le prince feul peut faire. Foyeç
ci-apûs COMMUTATION DE PEINE. (A )
COMMUN, adj. en termes de Grammaire , fe dit dit
genre par rapport aux noms, 6c fe dit de la fignifi-a
cation à l’égard des verbes;
Pour bien entendre ce que les Grammairiens appellent
genre commun * il faut obferver que les indi*
vidus.de chaque efpece d’animal font divifés en deux
ordres ; l’ordre des mâles, 6c l’ordre des femelles. Un
nom eft dit être du genre mafeulin dans les animaux,
quand il eft dit de l’individu de l’ordre des mâles ; au
contraire il eft dù genre féminin quand il eft de l’ordre
des femelles : ainfi coq eft du genre mafeulin, 6c
poule eft du féminin.
A l’égard des noms d’êtres inanimés, tels que fo-
leil, lune, terre, &c. ces fortes de noms n’ont point
de genre proprement dit. Cependant on dit que fo-
leil eft du genre mafeulin, 6t que lune eft du féminin
, ce qui ne veut dire autre chofe, finon que lorf-
qu’on voudra joindre un adjeftif à foleil, l’ufage veut
en France que des deux terminaifons de l’adjeâif on
choifilfe celle qui eft déjà confacrée aux noms fubf-
tantifs des mâles dans l’ordre des animaux ; ainfi on
dira beau foleil, comme on dit beau coq, 6c l’on dira
belle lune comme on dit belle poule. J’ai dit en France ,
car en Allemagne t par exemple, foleil eft du genre
féminin ; ce qui fait voir que cette forte dé genre eft:
purement arbitraire, 6c dépend uniquement.du choix
aveugle que l’ufage a fait de la terminaifon mafeu-
line de Fadjeââf ou de la féminine, en adaptant l’une
plûtôt que l’autre à tel ou tel nom.
A l’égard du genre commun, On dit qu’un nom eft:
de ce genre, c’eft*à-di(e de cette claffe ou forte ,
lorfqu’il y a une terminaifon qui convient également
au mâle & à la femelle : ainfi auteur eft du genre coin-
. mun ; on dit d’une dame qu’elle eft auteur d’un tel ou-1
vrage; notre qui eft du genre commun ; oh dit un homme
qui 9 6cc. une femme qui , &c. Fidele ,fage , font des
adje&ifs du genre commun ; un amant fidele -, une femme
fidelt'.
Én latiti j tivis fé dit égàlément d’un citoyen &
d’une citoyénne. Conjfux, fe dit du mari 6c auffi dé
la femme. Parens, fe dit du pere & fe dit aiiffi de la
mere. Bos , fe dit également du boeuf & de la v a ch e ..
XJanis, du chien ou de la chienne'. Feles, fe dit d’un '
chat oit d’une chattp.
Ainfi l’on dit de tous ces noms-lâ, qu’ils font du
genre commun-,
Obférvez que libmo eft un hdm commun, quant à
la lignification, c’eft-à-diré, qu’il lignifie également
Yhonime ou la femme ; mais ori né dira pas en latin
mala homô, poür dire uni méchante femme; ainfi homo
eft du génre mafeulin par rapport à là conftru£tion
grammaticale. C ’eft ainfi qu’en françois perfonne eft
du genre féminirl en conftruâion ; quoique par rapport
à la lignification ce mot défignê également un
homme ou une femme.
A l’égard des verbes , dn appelle Verbes communs
ceux qui, fous une même terminaifon , ont la lignification
a&ive 6c la paffive, ce qui fe eonndît par les
adjoints. Voyeç la quatrième lifie de la méthode de P. R.
p. 4<fj2, des déponens qui fe prennent pàffivement;
Il y a apparence que ces verbes ont eu autrefois la
terminaifon attive & la paffive : en effet dn trouve
cnminare. crimino , 6c criminari, criminor , blâmer.
En grec * les verbes qui fous une même termi-
1 X X x x ij