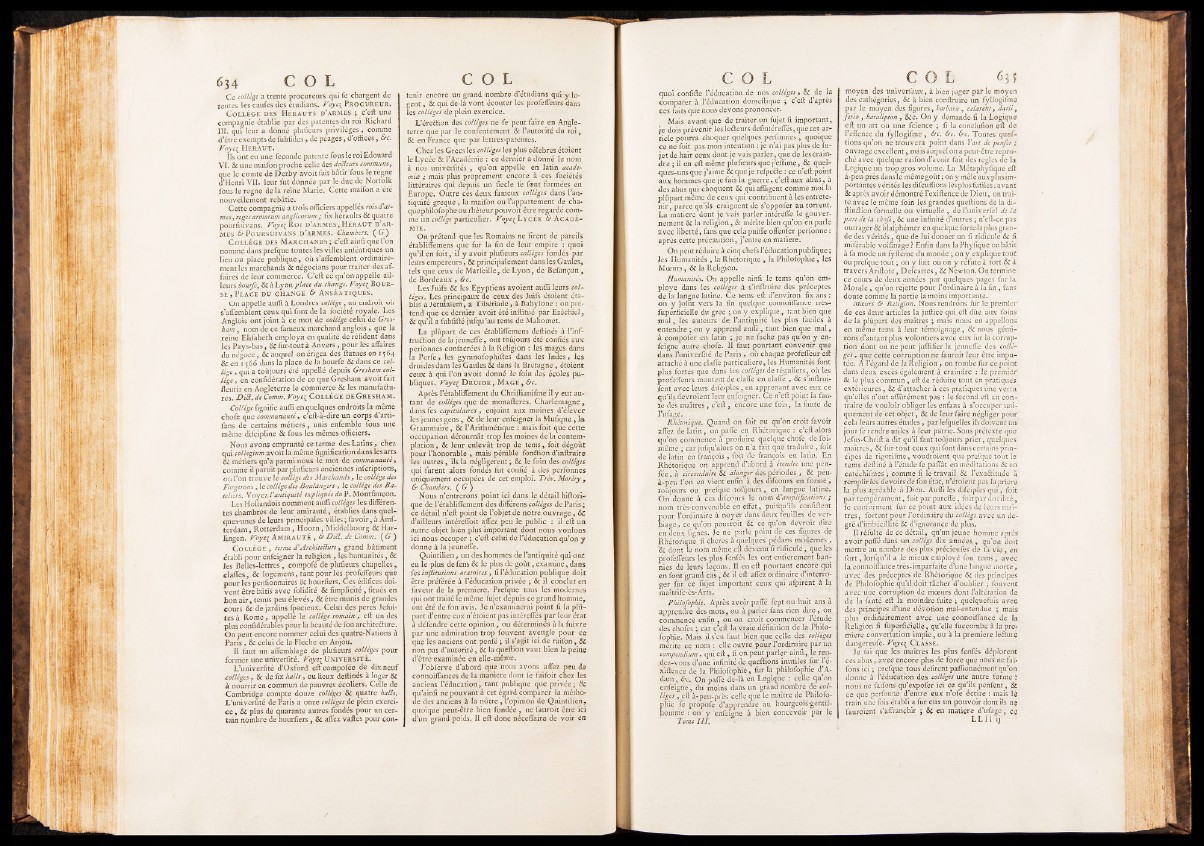
634 C O L
Ce collige a trente procureurs qui fe chargent de
toutes lescaufesdes étudians. Foyez Procureur.
C ollège des Hérauts d’armes ; c’eft une
compagnie établie par des patentes du roi Richard
III. qui leur a donné plufieurs p rivilèges, comme
d’être exempts de fubfides , de péag es, d’offices, &c.
Foyez Héraut.
Ils ont eu une fécondé patente fous le roi Edouard
VI. & une maifon proche celle des dofleurs communs,
que le comte de D erby avoit fait bâtir fous le régné
d’Henri VII. leur fut donnée par le duc de Norfolk
fous le régné de la reine Marie. Cette maifon a été
nouvellement rebâtie.
Cette compagnie a trois officiers appellés rois d'armes,
reges armorum anglicorum ; fix heraults & quatre
pourfuivans. Foyez R o i d’a rm e s , Héraut d’armes
& POURSUIVANS d ’armés. Chambers. (G )
C o llège des Marchands ; c’eft ainfi que l’on
nomme dans prefque toutes les villes anféatiques un
lieu ou place publique, oii s ’alfemblent ordinairement
les marchands & négocians pour traiter des affaires
de leur commerce. C’eft ce qu’on appelle ailleurs
bourfe,6ck Lyon place du change. Foyez BOURSE,
PLACE DU CHANGE 6* AnSÉATIQUES.
On appelle auffi à Londres collige, un endroit où
s’affemblent ceux qui font de la fociété royale. Les
Anglois ont joint à ce mot de collège celui de Gres-
ham, nom de ce fameux marchand an glo is, que la
reine Elifabeth employa en qualité de réfident dans
les P ays-bas, & fur-tout à Anvers, pour les affaires
du n égoce, & auquel on érigea des ftatues en 1564
& en 1566 dans la place de la bourfe & dans ce college
, qui a toujours été appellé depuis Gresham collige
, en confidération de ce que G resham avoit fait
fleurir en Angleterre le commerce & les manufactures.
Dict. de Comm. Foyez COLLÈGE DE GRESHAM.
Collège lignifie auffi en quelques endroits la même
chofe que communauté, c’eft-à-dire un corps d arti-
fans de certains métiers, unis enfemble fous une
même difeipline & fous les mêmes officiers.
Nous avons emprunté ce terme des Latins , chez
qui collegium avoit la même lignification dans les arts
& métiers qu’ a parmi nous le mot de communauté,
comme il paroît par plufieurs anciennes inferiptions,
où l’on trouve le collège des Marchands , le collège des
Forgerons, le collège des Boulangers , le collège des B ateliers.
Voyez l'antiquité expliquée du P. Montfaucon.
Les Hollandois nomment auffi collèges les différentes
çhambres de leur amirauté, établies dans quelques
unes de leurs principales villes ; favoir, à Amf-
terdam, Rotterdam, Hoorn , Middelbourg & Har-
lingen. Foyez Amirauté , & Dict. de Comm. ( G )
Collège, terme d'Architecture, grand bâtiment
établi pour enfeigner la religion , les humanités, &
les Belles-lettres , compofé de plufieurs chapelles,
claffes, & logemens, tant pour les profeffeurs que
pour les penfionnaires & bourfiers. Ces édifices doivent
être bâtis avec folidité & fimplicité, fitués en
bon a ir , tenus peu é lev é s, & être munis de grandes
cours & de jardins fpacieux. Celui des peres Jefui-
te s à Rome , appellé le collège romain , eft un des
‘ plus confidérables pour la beauté de fon architecture.
On peut encore nommer celui des quatre-Nations à
P a r is , & celui de la Fléché en Anjou.
Il faut un affemblage de plufieurs collèges pour
former une univerfité. Foyez Université.
L ’univerfité d’Oxford efteompofée de dix-neuf
collèges, & de fix halls , ou lieux deftinés à loger &
à nourrir en commun de pauvres écoliers. Celle de
Cambridge compte douze collèges & quatre halls.
L ’univerfité de Paris a onze collèges de plein exercic
e , & plus de quarante autres fondés pour un certain
nombre de bourfiers, $c affez vaftes pour çon-
C O L
tenir encore un grand nombre d’étudians qui y logent
, & qui de-là vont écouter les profeffeurs dans
les collèges de plein exercice.
L’éreCtion dès collèges ne fe peut faire en Angleterre
que par le confentement & l’autorité du r o i,
& en France que par lettres-patentes.
Chez les G recs les collèges les plus célébrés étoient
le Lycée & l’Académie : ce dernier a donné le nom
à nos univerfités , qu’on appelle en latin académie
; mais plus proprement encore à ces fociétés
littéraires qui depuis un fiecle fe font formées en
Europe. Outre ces deux fameux collèges dans l’antiquité
greque, la maifon ou l’appartement de cha-
quephilofophe ou rhéteur pouvoit être regardé comme
un collègeparticulier. Foyez L y c é e & A cad ém
ie .
On prétend que les Romains ne firent de pareils
établiffemens que fur la fin de leur empire : quoi
qu’il en fo it, il y avoit plufieurs collèges fondés par
leurs empereurs, & principalement dans les Gaules,
tels que ceux de Marfeille, de L y o n , de Befançon ,
de B o rd e au x , &c.
Les Juifs & les Egyptiens avoient auffi leurs collèges.
Les prineipaùx de ceux des Juifs étoient établis
à Jérufalem, à Tibériade, à Babylone : on prétend
que ce dernier avoit été inftitué par Ezéchiel,
& qu’il a fubfifté jufqu’au tems de Mahomet.
L a plupart de ces établiffemens deftinés à l’inf-
tru&ion de la jeuneffe, ont toûjours été confiés aux
perfonnes confacrées à la Religion : les mages dans
la Perfe, les gymnofophiftes dans les Indes, les
druides dans les G aules & dans la Bretagne, étoient
ceux à qui l’on avoit donné le foin des écoles publiques.
Foyez Druide, Mag e , & c.
Après l’établiffement du Chriftianifme il y eut autant
de collèges que de monafteres. Charlemagne ,
dans fes capitulaires , enjoint aux moines d’élever
les jeunes g en s, & de leur enfeigner la Mufique , la
Grammaire, & l’Arithmétique : mais foit que cette
occupation détournât trop les moines de la contemplation
, & leur enlevât trop de tems, foit dégoût
pour l’honorable , mais pénible fonftion d’inftruire
les autres, ils la négligèrent ; & le foin des collèges
qui furent alors fondés fut confié à d e s perfonnes
uniquement occupées de cet emploi. Trév. Moréry 9
& Chambers. ( G )
Nous n’entrerons point ici dans le détail hiftori-
que de l’établiffement des différens collèges de P a ris;
ce détail n’eft point de l’objet de notre o u v rag e , &
d’ailleurs intéreffoit affez peu le public : il eft un
autre objet bien plus important dont nous voulons
ici nous Occuper ; c’eft celui de l’éducation qu’on y
donne à la jeuneffe.
Quintilien , un des hommes de l’antiquité qui ont
eu le plus de fens & le plus de g oû t, examine, dans
fes injlitutions oratoires , fi l’éducation publique doit
être préférée à l’éducation privée ; & il conclut en
faveur de la première. Prefque tous les modernes
qui ont traité le même fujet depuis ce grand homme,
ont été de fon avis. Je n’examinerai point fi la plû-
part d’entre eux n’étoient pas intéreffés par leur état
à défendre cette opinion, ou déterminés à la fuivre
par une admiration trop fouvent aveugle pour ce
. que les anciens ont penfé ; il s’agit ici de raifon, &
non pas d’autorité, & la queftion vaut bien la peine
d’être examinée en elle-même.
J ’obferve d’abord que nous avons affez peu de
connoiffances de la maniéré dont fe faifoit chez les
anciens l’éducation, tant publique que privée
qu’ainfi ne pouvant à cet égard comparer la méthode
des anciens à la nôtre , l’opinion de Quintilien ,
quoique peut-être bien fondée , ne fauroit être ici
d’un grand poids. Il eft donc néceffaire de voir en
C O L
quoi confifte l’éducation de nos collèges, & de la
comparer à l’éducation domeftique ; c’eft d’après
ces faits que nous devons prononcer.
Mais avant que de traiter un fujet fi important,
je dois prévenir leslefteurs defintéreffés,quecet article
pourra choquer quelques perfonnes , quoique
ce ne foit pas mon intention : je n’ai pas plus de fu-
jet de haïr ceux dont je v ais parler, que de les craindre
; il en eft même plufieurs que j’-eftime, & quelques
uns que j’aime & que je refpefte : ce n’eft point
aux hommes que je fais la guerre, c’eft aux abus, à
des abus qui choquent & qui affligent comme moi la
plûpart même de ceux qui contribuent à les entretenir
, parce qu’ils craignent de s’oppofer au torrent.
L a matière dont je Vais parler intéreffe le gouvernement
& la religion, & mérite bien qu’on en parle
avec liberté, fans que cela puiffe offenfer perfonne ;
après cette précaution, j ’entre en matière.
On peut réduire à cinq chefs l’éducation publique;
les Humanités , la Rhétorique , la Philofophie, les
Moeurs, & la Religion.
Humanités. On appelle ainfi le tems qu’on employé
dans les collèges à s’inftruire des préceptes
de la langue latine. Ce tems eft d’environ fix ans :
on y joint vers la fin quelque connoiffance très-
fuperficielle du grec ; on y explique, tant bien que
m a l, les auteurs de l’antiquité les plus faciles à
entendre ; on y apprend auffi , tant bien que m a l,
à compofer en latin ; j e ne fâche pas qu’on y enfeigne
autre chofe. Il faut pourtant convenir que
dans l’univerfité de Paris , où chaque profeffeur eft
attaché à une claffe particulière, les Humanités font
plus fortes que dans lesj:0//<:g« de réguliers, où les
profeffeurs montent de claffe en clafle , & s’inftrui-
fent avec leurs difciples, en apprenant avec eux ce
qu’ils devroient leur enfeigner. Ce n’eft point la faute
dés maîtres, c’e f t , encore une fo is, la faute de
l’ufage, , '. ^
Rhétorique, Quand ori fait ou qu’on croit favoir
affez de latin , on paffe en Rhétorique : c’eft alors
qu’on commence à produire quelque chofe de foi-
même ; car jufqu’àlors on n’a fait que traduire, foit
de latin en françois , foit de françois en latin. En
Rhétorique on apprend d’abord à étendre une pen-
fé e , à cïrconduire & alonger des périodes , & peu-
à-peu l’on en vient enfin à des difeours en formé ,
toûjours ou prefque toujou rs, en langue 'latine.
On donne à ces difeours le'nom $ amplifications. ;
nom très-convenable en effet, puifqu’ils confident
pour l’ordinaire à noyer dans‘deux feuilles de verbiage?
ce qu’on pourroit & ce qü’ôn devrôit dire
en deux lignes. Je ne parle point d'e ces figures de
Rhétorique, fi cheres à quelques pédans mociernes.,
&L dont le nom même eft devenu fi ridicule,( que les
profeffeurs les plus fenfés les ont entièrement bannies
de leurs leçons. Il en eft pourtant encore qui
en font grand c a s , & il eft affez ordinaire d’intërro-
ger fur ce fujet important ceux qui afpirent à la
maîtrife-ès-Arts.
Philofophie. Après avoir p allé fept ou huit ans à
apprendre des mots , ou à,par 1er fans rien dire, on
commence enfin , -ou on croit commencer l’étude
des chofes ; car c’eft la vraie définition de la Philofophie.
Mais il s’en faut bien que celle des collèges
mérite ce nom : elle ouvre pour l’ordinairerpar un
compendium, qui e f t , fi on peut parler ainfi, le rendez
vous d’une infinité de queftions inutiles fur l’e-
xiftcnce de la Philôfophie, fur fa philofophie d’Adam
, &c. On pafle de-là en Logique : celle qu’on
enfeigne, du moins dans un grand nombre de collèges
, eft à-peu-près celle que le maître de Philofophie
fe propofe d’apprendre au bourgeois-gentilhomme
: o n 'y enfeigne à bien concevoir par le
’ Tome UT.
C O L 6 3 *
moyen des univerfaux, à bien juger par le moyen
des cathégories, & à bien conftruire un fyllogifme
par le moyen des figures, barbdra , celarent, darii,
ferio, baralipton, & c . On y demande fi la Logique
eft Un art ou une fcience ; fi la conclufion eft de
l’effence du fyllogifme, &c. &c. &c. Toutes queftions
qu’on ne trouvera point dans l'art de penfer l
ouvrage excellent, mais auquel on a peut-être reproché
avec quelque raifon d’avoir fait des réglés de la
Logique un ti;op gros volume. La Métaphyfiquè eft
à-peu-près dans le même goût ; on y mêle aux plus importantes
vérités les difeuffions les plus futiles : avant
& après avoir démontré l’exiftence de D ieu , on traite
avec le même foin les grandes queftions de la di-
ftinftion formelle ou virtuelle , de l’univerfel de la
part de La chofe, & une infinité d’autres ; n’eft-ce pas
outrager & blafphémer en quelque forte la plus grande
des vé rité s, que de lui donner un fi ridicule & fi
miférable voifinage ? Enfin dans la Phyfique on bâtit
à fa mode un fyftème du monde ; on y explique tout
ou prefqué tout ; on y fuit ou on y réfuté à tort & à
travers Ariftote, Dexcartes, & Newton. On termine
ce cours de deux années par quelques pages fur la
Morale, qù’on rejette pour l’ordinaire à la fin , fans
doute comme la partie la moins importante.
Moeurs & Religion. Nous rendrons fur le premier
de ces deux articles la juftice qui eft dûe aux foins
de la plûpart des maîtres ; mais nous en appelions
en meme tems à leur témoignage, & nous gémir
rôns d’autant plus volontiers avec eux fur la corruption
dont on ne peut juftifier la jéuneffe des collèges
f que cette corruption rte fauroit leur être imputée.
A i’égard de la Religion, on tombe fur ce point
dans deux excès également à craindre : le premier
& le plus commun, eft de réduire tout en pratiques
extérieures, & d’ attacher à ces pratiques une vertu
qu’elles n’ont affurément pas : le fécond eft au contraire
de vouloir obliger les enfans à s ’occuper uniquement
de cet o bjet, & de leur faire négliger pour
cela leurs autres études, par lefquélles ils doivent un
jour fe rendre utiles à leur patrie. Sous prétexte que
Jefus-Chrift a dit qu’il faut toûjours prier, quelques
maître's, ôc fur-tout ceux qui font dans certains principes
de rigorifme, voudroient que prefque tout le'
tems deftiné à l’étude fe paffât en méditations & en'
catéchifmes comme fi le trava il & l’exaftitude à
remplir les’devoirs de fon état, n’éfOieut pas la priere
la plus agréable à Dieu. Auffi les difciples q u i, foit
par tempérament, foit par pareffe, foit par docilité,
fe conforment fur ce point aux idées de leurs maître
s, fortent pour l’ordinaire du collège avec un degré
d’imbécillité & d’ignorance de plus.
Il réfultè de ce détail, qu’un jeune homme après
avoir paffé dans un collège dix années , qu’on doit
mettre au nombre des plus précieufes de fa v ie , en
fo r t , lorfqu’il a le mieux employé fon tems , avec
la connoiffance très-imparfaite d’une langue morte ,
avec des préceptes de Rhétorique & des principes
de Philofophie qu’il doit tâcher d’oublier ; fouvent
avec une corruption de moeurs dont l’altération de
de la fanté eft la moindre fuite ; quelquefois avec
des principes d’une dévotion mal-entendue ; mais
plus ordinairement avec une connoiffance de la
Religion fi fuperficielle, qu’elle fuccombe à la première
converfation impie, ou à la première leéture
dangereufè. Foyez C lasse.
Je fai que les maîtres les plus fenfés déplorent
ces abus, avec encore plus de force que nous ne fai-
fons ici ; prefque tous défirent paffionnément qu’on
donne à l’éducation des collèges une autre forme i
nous ne faifons qu’expofer ici ce qu’ils penfent, &
ce que perfonne d’entre eux n’ofe écrire : mais lé
train une fois établi a fur eux un pouvoir dont ils ne
fauroient s’affranchir ; ÔC en matière d’ufag e , ce
L L 1 l i j