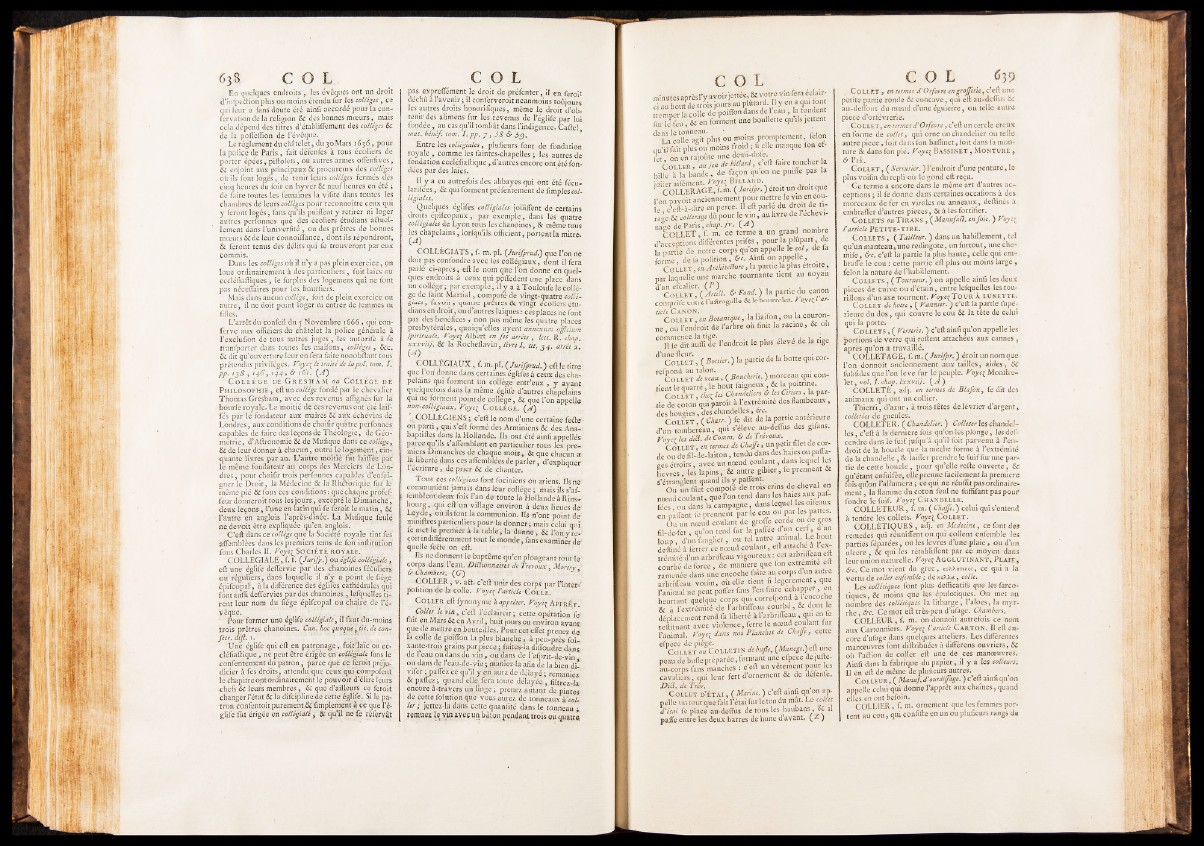
j, «
il f i'
'.HP M a l i
t fM P V iv
En quelques endroits , les évêques ont un droit
d’inlpeéVion plus ou moins étendu fur les collèges, ce
qui leur a fans doute été ainfi accordé pour la con-
lervation de la religion & des bonnes m oeurs, mais
cela dépend des titres d’établiffement des collèges 8c
de la pofieffion de I’évêqüe.
Le réglement du châtelet, d u joM a rs 1636, pour
la police de Paris , fait défenfes à tous écoliers de
porter épées, piftolets, ou autres armes ôffenfives,
8c enjoint aux principaux & procureurs des collèges
où ils font log é s, de tenir leurs collèges fermés dès
cinq heures du foir en hyver & neuf heures en été ;
de faire toutes les femaines la vifite dans toutes les
chambres de leurs collèges pour reConnoître ceux qui
y feront log é s, fâns qu’ils puiffent y retirer ni loger
autres perfonnes que des écoliers étudians actuellement
dans l’univerfité , ou des prêtres de bonnes
moeurs 8c de leur connoiffance, dont ils répondront,
& feront tenus des délits qui fe trouveront par eux
Commis.
Dans les collèges où il n’y a pas plein exercice, on
loue ordinairement à des particuliers, foit laïcs où
eccléfiaftiques , le fürplus des logemens qui ne font
pas néceffaires pour les bourfierS.
Mais dans aucun collège, foit de plein exercice ou
autre, il ne doit point loger ni entrer de femmes ni
filles.
L’ arrêt du confeil du 5 Novembre 1 6 6 6 , qui cort-
ferve aux officiers du châtelet la police générale à
l’exclufion de tous autres ju g e s , les autorife à fe.
tranfporter dans toutes les maifons, collèges, &c.
& dit qu’ouverture leur en fera faite honobftant tous
prétendus privilèges. Voyeç le traité de làpol. tom. I.
pp. 138, 14S’, -1^4,.» ilj g (A ) .............. ..
C o l l è g e de G r e s h a m ou C ollege d è
Philosophie , eft un collège fondé par le chevalier
Thomas Gresham, avec des revenus affignés fur la
bourfe royale. L à moitié de ces revenus ont été laif-
fiës par le fondateur aux maires & auk.échë’vins de
Londres, aux conditions de choifir quatre perfonnes.
capables de. faire des leçons de Théolpgie, de Géométrie
, d’Agronomie 8c de Mufique dans ce collège,
8c de leur donner à.chacun, outre le logement, cinquante
livres par an. L’autre moitié fut laiffée par,
le même fondateur au corps des Mërci'ers de Lon-'
d re s, pour choifir trois perfonnes - capables ' d’enfei-
gner le Droit ,, la Médecine & la Rhétorique fur le
même pié & fo u s Ces conditions : que chaque proie f-
feur donneroit tous les jo u rs , excepte le Dimanche,
deux leçons, l’une en latin qui fe feroit le m atin, 8c
l’autre en anglois l’aprè’s-dînée'. L a Miifique feulé
ne devoit être expliquée qu’en anglois.
C ’eft dans ce collège que la Société royale tint les
affemblées dans les premiers tems de fori inftitütion
fous Charles II. Voye^ So c ié t é ro ya le :
COL L ÉGIALE , f. f. (jurifp.) o u èglife collégiale ,
eft une églife deffervie par des chanoines féculiers
ou réguliers, dans laquelle il ri’y a point defiége
épifcppal, à la différence des eglifes cathédrales qui
fontauffi deffervies par des chanoines, lefquelles tirent
leur nom du fiége épifcopal ou chaire dé l’évêque.
" - _
Pour former une églife collégiale, il faut dü-moins
trois prêtres chanoines. Can. hoc quàque ^til. de coti^
fecr. dijl.i.
Une églife qui eft en p a tr o n a g e fo it'la ïc o u ec-
cléfiaftique, ne peut être érigée en:collégiale fans le
confentement du patron, parce que ce feroit préjudicier
à fes droits, attendu que ceux qui compofént
le chapitre ont ordinairement le' pouvoir d’élire leurs
chefs 8c leurs membres, 8c que d’ailleurs ce feroit
changer l’état & la difcipline de cette églife. Si le patron
confentoit purement. & Amplement a ce que l’é-
glife fût érigée en collégïdti ± 8c qu’il ne fe rçfçryât
pas expreffément le droit de préfenter, il en feroit
déchu à l’avènir ; il conferveroit neanmoins toujours
les autres droits honorifiques, même le droit d’obtenir
des alimens fur les revenus de l’églife par lui
fondée, au cas qu’il tombât dans l’indigence. Caftel
mat. bènèf. tom. I. pp. y , 58 & 5c).
Entre les collégiales, plufieurs font' de fondation
royale , comme les faintes-chapelles ; les autres de
fondation eçcléfiaftique, d’autres encore ont été fondées
par des laïcs.
Il y a eu autrefois des abbayes qui ont été fécu-
larifees, 8c qui forment préfentement de fimples collégiales.
Quelques églifes collégiales joiiiffent de certains
droits epilcopaux, par exemple, dans les quatre
collégiales de Lyon tous les chanoines, & même tous
les chapelains, lorfqu’ils officient, portent la mitrév
( ^ )
CO L L ÉG IA T S , f. m. pl. ( Jurifprud.) que l’on ne
doit pas confondre avec les collégiaux, dont il fera
parle ci-après, eft le nom que l’ort donne en quelques
endroits à ceux qui ppffedent une place dans
un collège ; par exemple,.il y a à Touloufe le collège
de faint Martial, compofé de vingt-quatre collé-
giats; fav o ir, quatre prêtres & vingt écoliers étudians
en d roit, ou d autres laïques : ces places ne font
pas des bénéfices , non pas même les quatre places
presbytéràles, quoiqu’elles ayent annexum officium
Jpiritualc. V?yeç Albert en Jes arrêts , Lut. R. chap.
xxxviij. 8c la Rocheflavin, livre I, tit. 3 4. arrêt 2
M . J
CO L L ÉG IA U X , f. m. pl. ( Jurifprud. ) eft le titre
que 1 on' donne dans certaines églifes à ceux des chapelains
qui forment tin collège entr’eux , y ayant
quelquefois dans la meme églife d’autres chapelains
qui ne forment point de college, & que l’on appelle
non-collégiaux. Voye[ C o llèg e, ( A ) . .
^COLL ÉGIENS ; c’eft le nom d’une certaine feéle •
ou parti ,■ qui s’eft formé des Arminiens 8c des Ana-r
baptiftes dans la Hollande. Ils ont été ainfi appellés-
parce qu’ils s’affemblent en particulier tous les premiers
Dimanches de chaque m o is, & que chacun a
la liberté dans ces affemblées de parler, d’expliquer
l’écriture', de prier 8ç de chanter.
Tous ces collégiens font fociniens oii ariens. Ils ne
conuTuyiiênt jamais dans leur collège ; mais ils s’âf-
femblent deux fois l’an de toute la HollandeàRins-'
bourg, .qui eft un village environ à deïlx lieues de’
L ey de, ou ils font la commuftion. Ils n’ont point de
jiiniftres particuliers pour la donner-; mais celui qui
fe mette premier à la table; la donné , & llon.yre-‘
çoit indifféremment tout le monde, fans examiner de1
quelle feÜe .on eft.
Ils ne donnent le baptême qii’en plongeant tout le
corps .dans 1 eau. Dictionnaires de Trévoux. Mo fer y. ■’
b.Ghamhers. (jG) : J i
CO L L ER , v. aft. c’eft unir des corps par l’inter-'
pofition delà colle. Voye^ T article C olle.
C oller eft fynonyme à apprêter. Voyeç Apprêt.
. Càller le vin, c’eft l’éclaircir; cette opération fe'
fait en Mars & en Avril, huit jours ou envirop ayant
que de mettre en bouteilles, Pour cet effet prenejz: de
là colle de poiffon la plus blancHë, à peu-près foixante
trois grains p a rp ie c e ; faitesda diffoudre dans.
de 1 eau ou dans du v in , ou dans de l’efprit-de-vin
ou dans de l’eau-de-vie ; niàniez-la afin de la bien di-
vifer ; paffézCe qu’il ÿ en aura de délayé ; remaniez
& paffez; quand elle, fera toute délayée., filtrez-la
encore à-travers un linge; prene? autant de pintes
de cette folution que vous aurez de tonneaux àW .
1er ÿ jettez-la dans cette quantité dans le tonneau ;
remuez le vin ayeç un bâton pendant trois ou quatre
minutes aprèsl'y avoir jettée ik votre vin fera éclairci
au bout de trois jours au plutard. Il y en a qui font
tremper la colle de poiffon dans de 1 eau la^ fonden
fur le feu, & en forment une boullette qu ils jettent I M ou moins promptement félon
mfii fait plus ou moins froid ; fi elle manque fon effet
on en rtjoûte une denu-dole m
C o l l e r , aujru de bdlurd, e’eft faire toucher a
bille à la baiide, de façon qu ou ne puiffe pas la
aifémënt. Voya Billard. , . COLLER AGE, f. m. ( Jurifpr. ) étoit un droit que
l’on pavoit anciennement pour mettre le vin en coule
(fen-à-dite en perce. Il eft parle du droit de tirage
&: colltrage dû pour le vin, au livre de 1 echevinaee
de Paris, chup.jv. ( A )
COLLET f. m. ce terme a un grand nombre
d’acceptions différentes prifes , pour la plupart j de
la partie de notre corps qu6n appelle le col, delà
forme, de fa pofition, &c. Ainfi on appelle ,
C ollet en AtcMteüure, la partie la plus étroite,
par laquelle une marche tournante tient au noyau
W O to n d .) la partie du canon
comprife entre l’aftragalle & le bourrelet. Voyt^l ar-
OTC ollet% Botanique, la liaifon, ou la couronne
, ou l’endroit de l’arbre oh finit la racine , & ou
“ S u f f i t ' l’endfoit le plus élevé de la tige
’collet , ( Bottier. ) la partie de la botte qui cor-
refoond au talon.
C ollet * venu, ( Boucherie. ) morceau qui contient
le quarté, le bout faigneux, & lapoitnne,
C O L L E T , cher les Chandeliers & Us Ciners , la partie
de coton qui paraît à l’extrémité des flambeaux,
des bougies , des chandelles , H M H 11
C ollet , f Charr. ) fe dit de la partie anterieure
d’un tombereau, qui s’élève au-deffus des gifans.
rovetUsdia.deComm.erdcTrcvoux. I
C ollet, en termes de Chaffe, un petit filet de corde
ou de fil-de-laiton, tendu dans des haies ou paffa-
ges étroits, avec un nceud coulant, dans lequel les
levres , les lapins, & autre gibier , fe prennent &
S’étranglent quand ils y paffent. . H M H
Ou un filet compofé de trois crins de cheval en
nceud coulant, que l’on tend dans es |H —
fées , ou dans la campagne, dans lequel les oueaux
en paffant fe prennent par le cou ou par les pattes.
Ou un noeud coulant de greffe corde ou de gros
fil-de-fer , qu’on tend fur la paflee d un cei f , d un
loup, d’unfangücr, ou tel autre animal. Le bout
dcllinc à ferrer ce noeud coulant, eft attache à 1 extrémité
d’un arbriffeau vigoureux: cet arbnffeau eft
courbé de force, de manière que fon extrémité elt
ramenée dans une encoche faite au corps d un autre
arbriffeau voifin, oh elle tient li legerement, que
l’animal ne peut paffer fans l’en faire échapper , en
heurtant quelque corps qui correfpond a l encoche
8c à l’extrémité de l’arbriffeau courbé, 8c dont le
déplacement rend fa liberté à l’arbriffeau, qui en fe
reftituant avec violence, ferre le noeud coulant fur
l’animal, toye^ dans ms Planches de Chaffe, cette
efPèoLLETPii gCOLLET.N * hufo, M l »ne
peau de bufle préparée, formant une efpéce de julte-
au-corps fans manches : c’eft un vetement pour les
cavaliers, qui leur fert d’ornement &c de defenfe.
Dict. de Trev. . ,
C ollet d’êtai , ( Marine.) c’eft ainfi qu on appelle
un tour que fait l’étai fur le ton du mât. Le collet
dictai fe place au-deffus de tous les haubans ,& il
paffe entre les deux barres de hune d’avant, ( Z )
C o llet , en termes d'Orfevre engrojjerie, c’eft une
petite partie ronde & concave, qui eft au-deffus &
au-deffoiis du noeud d’une éguierre, ou telle autre
piece d’orfèvrerie.
C o l le t , en termes d'Orfevre, c’eft un cercle creux
en forme de collet, qui orne un chandelier ou telle
autre p iece, foit dans fon baffinet, foit dans fa monture
& dans fon pié. Voye^ Bassinet , Monture ,
& P i é .
C ollet , ( Serrurier. ) l ’endroit d’une penture, le
plus voifin du repli où le gond eft reçu.
C e terme a encore dans le même art d’autres acceptions
; il fe donne dans certaines occafions à des
morceaux de fer en viroles ou anneaux, deftines à
embraffer d’autres pièces, & à les fortifier.
C ollet s ou T Irans , ( Manufacl. en foie. ) Voyei
l'article PETITE-TIRE.
C o lLets , ( Tailleur. ) dans un habillement, tel
qu’un manteau, une redingote, un furtout, une che-
mife, &c. e’eft la partie la plus haute, celle qui em-
braffe le cou : cette partie eft plus ou moins large ,
félon la nature de l’habillement.
C ollet s , ( Tourneur. ) on appelle ainfi les deux
pièces de cuive ou d’étain, entre lefquelles les tourillons
d’un axe tournent. V ayeç T our k lunettei
C o llet de hotte, ( Vannier. ) c’eft la partie fupé-
rieure, du dos, qui couvre le cou & la tête de celui
qui la porte.
C ollet s , ( Verrerie. ) c’eft ainfi qu’on appelle les
portions de verre qui reftent attachées aux cannes ,
après qu’on a travaillé.
COL L ETA G E , f. m. ( Jurifpr. ) étoit un nom que
l’on donnoit anciennement aux tailles, a id e s, &
fubfides que l’on leve fur le peuple. Voye^ Monftre-
le t, vol. I.chap. Ixxviij. ( ^ )
C O L L E T É , adj, en termes de Blafon, fe dit des
animaux qui ont un collier.
T h ierri, d’azur, à trois têtes de lévrier d’argent,
colletées de gueules.
COL L ETER. ( Chandelier. ) Colleter les chandelles
, c’eft à la derniere fois qu’on les plonge, les descendre
dans le fuif jufqu’à qu’il foit parvenu à l’endroit
de la boucle que la meche forme à l’extrémité
de la chandelle, & laiffer prendre le fuif fur une partie
de cette boucle, pour qu’elle refte ouverte, &
qu’étant enfuifée, elle prenne facilement la première
fois qu?on l’allumera ; ce qui ne réuffit pas ordinairement
, la flamme du coton feul ne fuffifant pas pour
fondre le fuif. Voyei C handelle.
CO L L E T EU R , f. m. ( Chaffe. ) celui qui s’entend
à tendre les collets. Voye[ C o l l e t .
COL L ÉTIQU ES , adj. en Medecine, ce font des
remedes qui réunifient ou qui collent enfemble les
parties îeparées, on les levres d’une plaie , ou d’uii
ulcéré , & qui les rétabliffent par ce moyen dans
leur union naturelle. Vijyeç A g g lu t in an t , Plaie j
&c. Ce mot vient du g re c , xoaxjjt/koç, ce qui a la
vertu de coller enfemble ; de koXXa , colle.
Les collétiques font plus defficatifs que les farco-
tiques, & moins que les épulotiques. On met au
nombre des collétiques la litharge, l’aloes, la myrrhe
, &c. Ce mot eft très-peu d’ufage. Chambers.
C O L L EU R , f. m. on donnoit autrefois ce nom
aux Cartonniers. Voye{ l'article C a r to n . Il eft encore
d’ufage dans quelques atteliers. Les différentes
manoeuvres font diftribuées à différens ouvriers, 8c
où l’a&ion de coller eft une de ces manoeuvres.
Ainfi dans la fabrique du papier, il y a les colleurs.
Il en eft de même de plufieurs autres.
C olleur , ( Manu/, d'ourdiffage. ) c’eft ainfi qu’on
appelle celui qui donne l’apprêt aux chaînes, quand
elles en ont befoin.
CO L L IER , f. m. ornement que les femmes portent
au cou, qui confifte çn un ou plufieurs rangs da
mSI