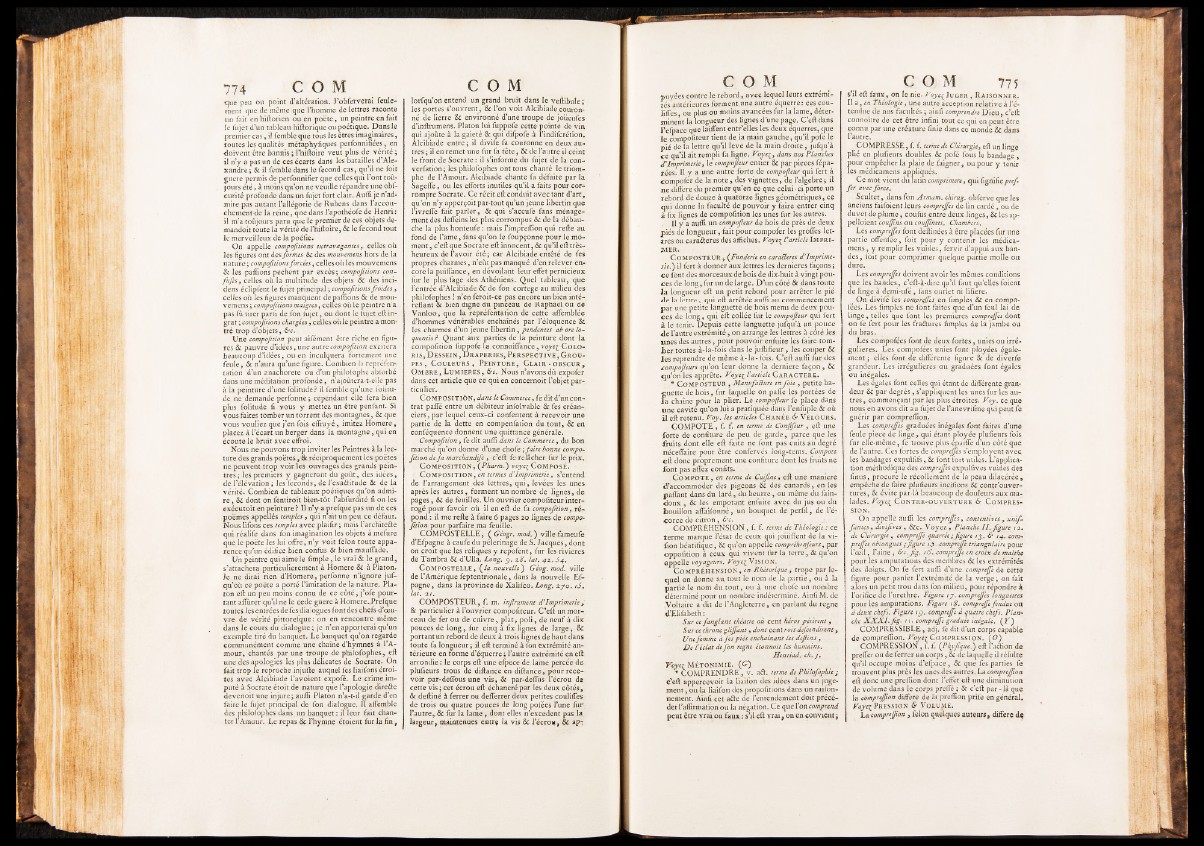
que peu ou point d’altération. J’obferverai feulement
que de même que l’homme de lettres raconte
un fait en hiftorien ou en poëte, un peintre en fait
le fujet d’un tableau hillorique ou poétique. Dans le
premier cas, il femble que tous les êtres imaginaires,
toutes les qualités métaphyfiques perfonnifiées, en
doivent être bannis ; l’hiftoire veut plus de vérité ;
il n’y a pas un de ces écarts dans les batailles d’Alexandre
; & il femble dans le fécond cas, qu’il ne foit
guere permis de perfonnifier que celles qui l’ont toujours
été, à moins qu’on ne veuille répandre une obf-
curité profonde dans un fujet fort clair. Aulïi je n’admire
pas autant l’allégorie de Rubens dansTaccou-
chement-de la reine, qne dans l’apothéofe de Henri :
il m’a toujours paru que le premier de ces objets de-
mandoit toute la vérité de l’hiftoire, & le fécond tout
le merveilleux de la poéfie.
On appelle comportions extravagantes, celles où
les figures ont d es formes & des mouvemens hors de la
nature \-compofitions forcées, celles où les mouvemens
& les pallions pechent par excès ; comportions con-
fufes, celles où la multitude des objets & des inci-
dens éclipfent le fujet principal ; comportions froides,
celles où les figures manquent de pallions & de mouvemens
; composions maigres, celles où le peintre n’a
pas fû tirer parti de fon fujet, ou dont le iiijet eft ingrat
; composions chargées, celles où le peintre a montré
trop d’objets, &c.
Une compoftion peut aifément être riche en figures
& pauvre d’idées, une autre compoftion excitera
beaucoup d’idées, ou en inculquera fortement une
feule, & n’aura qu’une figure. Combien la repréfen-
tation d’un anachorète ou d’un philofophe ablorbé
dans une méditation profonde, n’ajoûtera-t-elle pas
à la peinture d’une folitude ? il femble qu’une folitu-
de ne demande perfonne ; cependant elle fera bien
plus folitude fi vous y mettez un être penfant. Si
vous faites tomber un torrent des montagnes, & que
vous vouliez que j’en fois effrayé, imitez Homere,
placez à l ’écart un berger dans la montagne, qui en
écoute le bruit avec effroi.
Nous ne pouvons trop inviter les Peintres à la lecture
des grands poètes., & réciproquement les poètes
ne peuvent trop voir les ouvrages des grands peintres;
les premiers y gagneront du goût, des idées,
de l’élévation ; les féconds, de l’exaélitude & de la
vérité. Combien de tableaux poétiques qu’on admire
, & dont on fentiroit bien-tôt l’abfurdité. fi on les
exécutoit en peinture ? Il n’y a prefque pas un de ces
poèmes appeilés temples, qui n’ait un peu ce défaut.
Nous lifons ces temples avec plaifir ; mais l’architeûe
qui réalife dans fon imagination les objets à mefure
que le poëte les lui offre, n’y voit félon toute apparence
qu’un édifice bien confus & bien mauffade.
Un peintre qui aime le fimple, le vrai & le grand,
s’attachera particulièrement à Homere & à Platon.
Je ne dirai rien d’Homere, perfonne n’ignore juf-
qu’où ce poëte a porté l’imitation de la nature. Platon
eft un peu moins connu de ce côté, j’ofe pourtant
affûrer qu’il ne le cede guere à Homere..Prefque
toutes les entrées de fes dialogues font des chefs-d’oeuvre
de vérité pittorefque: on en rencontre même
dans le cours du dialogue ; je n’en apporterai qu’un
exemple tiré du banquet. Le banquet qu’on regarde
communément comme une chaîne d’hymnes à l’Amour,
chantés par une troupe de philofophes, eft
une des apologies les plus délicates de Socrate. On
fait trop le reproche injufte auquel fes liaifons étroites
avec Alcibiade l’avoient expofé. Le crime imputé
à Socrate étoit de nature que l’apologie direéle
devenoit une injure; aufli Platon n’a-t-il garde d’en
faire le fujet principal de fon dialogue. Il aflèmble
des philofophes dans un banquet : il leur fait chanter
l’Amour. Le repas ôt l’hymne étoient fur la fin,
lorfqu’on entend un grand bruit dans le veftibule ;
les portes s’ouvrent, 6c l’on voit Alcibiade couronné
de lierre & environné d’une troupe de joiieufes
d’inftrumens. Platon lui fuppofe cette pointe de vin
qui ajoute à la gaieté & qui difpofe à l’indiferétion.
Alcibiade entre ; il divife fa couronne en deux au-
très ; il en remet une fur fa tête, & de l’autre il ceint
le front de Socrate : il s’informe du fujet de la con-
verfàtion ; les philofophes ont tous chanté le triomphe
de l’Amour. Alcibiade chante fa défaite par la
SagelTe, ou les efforts inutiles qu’il a faits pour corrompre
Socrate. Ce récit eft conduit avec tant d’art,
qu’on n’y apperçoit par-tout qu’un jeune libertin que
l’ivreffe fait parler, & qui s’accufe fans ménagement
des deffeins les plus corrompus & de la débauche
la plus honteufe : mais l’impreflîon qui refte au
fond de l’ame, fans qu’on le foupçonne pour le moment
, c’eft que Socrate eft innocent , & qu’il eft très-
heureux de l’avoir été; car Alcibiade entêté de fes
propres charmes, n’eût pas manqué d’en relever encore
la puiffance, en dévoilant leur effet pernicieux
fur le plus fage des Athéniens. Quel tableau , que
l’entrée d’Alcibiade & de fon cortege au milieu des
philofophes ! n’en feroit-ce pas encore unbien inté-
reffant & bien digne du pinceau de Raphaël ou de
Vanloo, que la repréfentation de cette affemblée
d’hommes vénérables enchaînés par l’éloquence &
les charmes d’un jeune libertin, pendentes ab ore lo-
quentis? Quant aux parties de la peinture dont la
compofition fuppofe la connoiffance, voye^ C olor
is , D essein , D raperies, Pe r sp e c t iv e , G roup
e s , C o u l e u r s , Pein tu re, C la ir - o b scu r ,
O m br e, Lumière s, & c. Nous n’avons dû expofer
dans cet article que ce qui en concernoit l’objet particulier.^
C omposition, dans le Commerce, fe dit d’un contrat
palfé entre un débiteur infolvable & fes créanciers,
par lequel ceux-ci confentent à recevoir une
partie de la dette en compenfation du tout, & en
conféquence donnent une quittance générale.
Compoftion, fe dit aufti dans le Commerce, du bon
marché qu’on donne d’une chofe ; faire bonne compoftion
de fa marchandée , c’eft fe relâcher fur le prix.
C omposition, {Pharm.} voye{ C omposé. •
C omposition, en termes d'imprimerie, s’entend
de l’arrangement des lettres, qui, levées les unes
après les autres, forment un nombre de lignes, de
pages, & de feuilles. Un ouvrier compofiteur interrogé
pour fa voir où il en eft de fa compoftion, répond
: il me refte à faire 6 pages zo lignes de compofition
pour parfaire ma feuille.
COMPOSTELLE, ( Géogr. mod. ) ville fameufe
d’Efpagne à caufe du pèlerinage de S. Jacques, dont
on croit que les reliques y repofent, fur les rivières
de Tambra & d’Ulla. Long. g . z8 . lat. 4 2 .64.
C ompostelle, {la nouvelle} Géog.mod. ville
de l’Amérique feptentrionale, dans la nouvelle Ef-
pagne, dans la province de Xalifco. Long.zyo. 16.
lat. z i.
COMPOSTEUR, f. m. infrument d’Imprimerie,
& particulier à l’ouvrier compofiteur. C’eft un morceau
de fer ou de cuivre, plat, poli, de neuf à dix
pouces de long, fur cinq à fix lignes de large, &
portant un rebord de deux à trois lignes de haut dans
toute fa longueur; il eft terminé à l'on extrémité antérieure
en forme d’équerre ; l’autre extrémité en eft
arrondie : le corps eft une efpece de lame percée de
plufieurs trous de diftance en diftance, pour recevoir
par-deffous une v is , & par-deffus l’écrou de
cette vis ; cet écrou eft échancré par les deux côtés,
& deftiné à ferrer ou deflèrrer deux petites couliffes
de trois ou quatre pouces de long pofées l’une fur
l’autre, &c fur la lame, dont elles n’excedent pas la
largeur, maintenues entre la vis ôc l’écrou, &c ap-.
puyées contre le rebord, avec lequel leurs extrémités
intérieures forment une autre équerre: ces couliffes
, ou plus ou moins avancées fur la lame, déterminent
la longueur des lignes d’une page. C ’eft dans
l’efpace que laiffent entr’elles les deux équerres, que
le compofiteur tient de la main gauche, qu’il pofe le
pié de la lettre qu’il leve de la main droite, jufqu’à
ce qu’il ait rempli fa ligne* Voye{, dans nos Planches
dImprimerie, le compofeur entier & par pièces fépa-
rées. Il Y a une autre forte de compofeur qui fert à
compofér de la note, des vignettes, de l’algebre ; il
ne diffère du premier qu’en ce que celui-ci porte un
rebord de douze à quatorze lignes géométriques, ce
qui donne la faculté de pouvoir y faire entrer cinq
à fix lignes de compofition les unes fur les autres.
Il y a aufli un compofeur de bois de près de deux
piés de longueur, fait pour compofér les groflès lettrés
ou cara&eres des affiches. Voye^ P article Im p r i m
e r .
C O M P O S T E U R , (Fonderie en caractères d 'imp rim erie.)
il fert à donner aux lettres les dernieres façons ;
ce font des morceaux de bois de dix-huit à vingt pouces
de long, fur un de large. D ’un côté & dans toute
la longueur eft un petit rebord pour arrêter le pié
de la lettre, qui eft arrêtée aufli au commencement
par une petite languette de bois menu de deux pouces
de long, qui eft collée fur le compofeur qui fert
à le tenir. Depuis cette languette jufqu’à un pouce’
de l’autre extrémité, on arrange les lettres à côté les
unes des autres, pour pouvoir enfuite les faire tomber
toutes à-la-fois dans le juftifieur , les couper &
les reprendre de même à-la-fois. C’eft aufli fur des
£ompofieurs qu’on leur donne la derniere façon, &
qu’on les apprête. V o y e { Varticle C a r a c t è r e .
* COMPOSTEUR , Manufacture en foie , petite baguette
de bois, fur laquelle on paffe les portées de
la chaîne pour la plier. Le compofeur fe place dans
une cavité qu’on lui a pratiquée dans l’enfuple & où
il eft retenu. V^oy. les articles C h a n é e <S* V e l o u r s .
COMPOTE , f. f. en terme de Gonfifeur , eft une
forte de confiture de peu de garde, parce que les
fruits dont elle eft faite ne font pas cuits au degré
jiéceffaire pour être confervés long-tems. Compote
eft donc proprement une confiture dont les fruits ne
font pas affez confits.
C o m p o t e , en terme de Cuifine, eft une maniéré
d ’accommoder des pigeons & des canards, en les
paflant dans du lard, du beurre, ou même du fain-
doux , &.les empotant enfuite avec du jus ou du
bouillon affaifonné, un bouquet de perfil, de l’écorce
de citron, &c. ...
COMPRÉHENSION , f . f. terme de Théologie : ce
terme marque l’état de ceux qui joiiiffent de la vi-
fion béatifique, & qu’on appelle compréhenfeurs, par
oppofition à ceux qui vivent fur la terre, & qu’on
appelle voyageurs. Û oye^ V is ION.
C o m p r é h e n s i o n , en Rhétorique, trope par lequel
on donne au, tout le nom de la partie, ou à la
partie le nom du tout, ou à une chofe un nombre
déterminé pour un nombre indéterminé. Ainfi M. de
.Voltaire a dit de l’Angleterre, en parlant du régné
d’Elifabeth:
Sur ce fanglant théâtre ou cent héros périrent,
Sur ce throne glijfant, dont cent rois défendirent,
Une femme à fes piés enchaînant les défias ,
De L'éclat de fon régné étonnait les humains.
Henriad. ch. J.
Voyei MÉTONIMIE. ( G)
* COMPRENDRE, v . a£l. terme de Pkilofophie ;
c’eft appercevoir la liaifon des idées dans un jugement
, ou la liaifon des propofitions dans un raifon-
nement. Ainfi cet aâe de l’entendement doit précéder
l’affirmation ou la négation. Ce que Xon comprend
peut être vrai ou faux : s’il eft v rai, on en convient -9
s’il eft faux, on le nie. Voye^ Juger , Raisonner.
II a , en Théologie, une autre acception relative à l’étendue
de nos facultés ; ainfi comprendre D ieu, c’eft
connoître de cet être infini tout ce qui en peut être
connu par une créature finie dans ce monde & dans
l’autre.
COMPRESSE, f. f. terme de Chirurgie, eft un linge
plié en plufieurs doubles & pofé fous le bandage ,
pour empêcher la plaie de faigner, ou pour y tenir
les médicamens appliqués.
Ce mot vient du latin comprimert, qui lignifiepref-
fer avec force.
Scultet, dans fon Armam. chirug. obferve que les
anciens faifoient leurs comprejfes de lin cardé, ou de
duvet de plume, coufus entre deux linges, & les appelaient
couffins ou coujfihets. Chambers.
Lés comprejfes font deftinées à être placées fur une
partie offèrifee, foit pour y contenir les médicamens
, y remplir les vuides, fervir d’appui aux bandes
, foit pour comprimer quelque partie molle ou
dure.
Les compreffes doivent avoir les mêmes conditions
que les bandes, c’eft-à-dire qu’il faut qu’elles foient
de linge à demi-ufé, fans ourlet ni lifiere.
On divife les comprejfes en Amples ÔC en compo-
fées. Lès fimples ne font faites que d’un feul lai de
linge, telles que font les premières comprejfes dont
on fe fert pour les fraûures fimples de la jambe ou
du bras.
Les compofées font de deux fortes, unies ou irrégulières.
Les compofées unies font ployées également
; elles font de différente figure & de diverfe
grandeur. Les irrégulières ou graduées font égales
ou inégales.
Les égales font celles qui étant de différente grandeur
ôc par degrés, s’appliquent les unes fur les autres,
commençant par les plus étroites. Voy. ce que
nous en avons dit au fujet de l’anevrifme qui peut fe
guérir par compreflion.
Les comprejfes graduées inégales font faites d’une
feule piece de linge, qui étant ployée plufieurs fois
fur elle-même, fe trouve plus épaiffe d’un côté que
de l’autre. Ces fortes de comprejfes s’employent avec
les bandages expulfifs, & font fort utiles. L’applica-
j tion méthodique des comprejfes expulfives vuides des
finus, procure le récollement de la peau dilacérée ,
empêche de faire plufieurs incitions & contr’ouver-
tures, & évite par-là beaucoup de douleurs aux malades.
V'oye^ C ontre-ouverture & C ompres-
I SION.
On appelle aufli ies compreffes, contentives, unif-
fautes, dxvifves, &c. V o y e z , Planche II. figure i z •
de Chirurgie , cômprejfe qiiarrée; figure 13. & 14. comprejfes
ob longues ;figure i f . cômprejfe triangulaire pour
l’oe il, l’aine , &c. jig. 1f . cômprejfe en croix de malthc
pour les amputations des membres & les extrémités
des doigts.-On fe fert aufli d’une cômprejfe de cette
figure pour panfer l’extrémité de la verge ; on fait
alors un petit trou dans fon milieu, pour répondre à
l’orifice de l’urethre. Figure. 1 y. compreffes longuettes
pour les amputations. Figure 18. cômprejfe fendue ou
à deux chefs. Figure 1 g . cômprejfe à quatre chefs. Planche
X X X I . fig. n . cômprejfe graduée inégale. ('Y )
COMPRESSIBLE, adj. fe dit d’un corps capable
de compreflion. Voye^ C ompression. (O)
COMPRESSION, f. £. (Phyfique.} eft l’aâion de
preflèr ou de ferrer un corps, & de laquelle il réfulte
qu’il occupe moins d’efpace, & que fes parties fe
: trouvent plus près les unes des autres. La comprejfion
eft donc une preflion dont l’effet eft une diminution
de volume dans le corps prèffé ; & c’eft par - là que
la cOmpreJfon diffère de la preflion prilè en général.
F 6ye{ Pression & V olume.
La comprejfion > félon quelques auteurs, diffère de