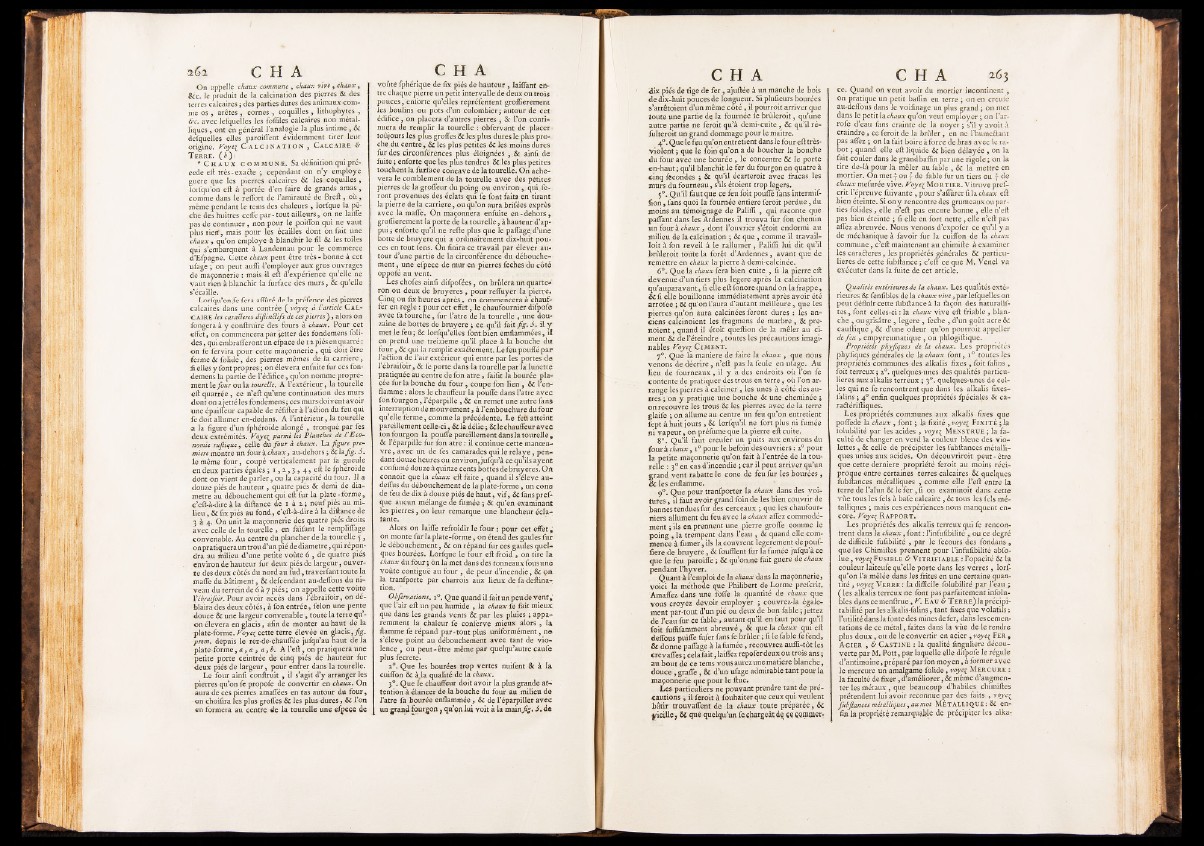
On appelle chaux commune , chaux vivt, èhdux,
& c . le .produit de la calcination des pierres & des
terres calcaires ; des parties dures des animauxcom-
me os , arêtes , cornes -, coquilles , lithophytes .,
&c. avec lefquelles les fofliles calcaires non métalliques.,
ont en général l’analogie la plus intime , &
desquelles elles paroiffent évidemment tirer leur
origine, y'oyez C a l c i n a t i o n , C a lc a ir e •&
T erre. (é.)\
* C h a u x c o m m u NE. Sa définition qui précédé
eft très- exacte ; cependant on n’y employé
guere que les pierres calcaires & les ^coquilles ,
lorfqu’on eft à portée d’en faire de .grands amas ,
comme dans le reffort de l’amirauté de Breft , où y
même pendant le tems des chaleurs , lorfque la péché
des huîtres ceffe par - tout -ailleurs , on ne laiffe
pas de continuer, non .pour le poifion qui ne vaut
plus rieif, mais .pour les écailles dont on fait une
chaux y qu’on employé à blanchir le fil &. les toiles
qui s’embarquent à Landernau pour le commerce
d’Efpagne* Cette chaux .peut être très - bonne à cet
ufage ; on peut aulïi l’employer aux gros ouvrages
de maçonnerie : mais il eft d’expérience qu’elle ne
vaut rien à blanchir la furface des murs, & qu’elle
s’écaille.
Lorfqu’on:fe fera affûré de la préfence des pierres
calcaires dans une contrée ( voyez à l'article C alc
a ir e les caractères difiinctifs de ces pierres )> alors on
fongera à y conftruire des fours à chaux. Pour cet
effet, on commencera par jetter des fondemens foli-
des, qui embrafferont un efpace de 12 piés en quarre :
on le fervira pour cette maçonnerie, qui doit être
ferme & folide, des pierres mêmes de la carrière,
fi elles y font propres ; on élevera enfuite fur ces fondemens
la partie de l’édifice, qu’on nomme, proprement
le four ou la tourelle. A l’ extérieur, la tourelle
eft quarrée, ce n’eft qu’une continuation des murs
dont on a jettéles fondemens; ces murs doivent avoir
une épaiffeur capable de réfifter à l’aûion du feu qui
fe doit allumer en-dedans. A l’intérieur, la tourelle
a la figure d’un fphéroïde alongé , tronqué par fes
deux extrémités. Voyez parmi les Planches de l'Economie
rujtiqüe, celle du four à chaux. La figure première
montre un four à chaux, au-dehors ; & la fig, 6,
le même four, coupé verticalement par fa gueule
en deux parties égales ; 1 , 2 , 3 , 4 » ^P^roic^e
dont on vient de parler, ou la capacité du tour. Il a
douze piés de hauteur, quatre pies & demi de diamètre
au débouchement qui eft fur la plate - forme,
c’eft-à-dire à la diftance de 1 à 2 ; neuf piés au milieu
, & fix piés au fond, c’ eft-à-dire à la diftance de
3 à 4. On unit la maçonnerie des quatre piés droits
avec celle de la tourelle , en faifant le rempliffage
convenable. Au centre du plancher de la tourelle 5 ,
on pratiquera un trou d’un pié de diamètre, qui répondra
au milieu d’une petite voûte 6 , de quatre piés
environ de hauteur fur deux piés de largeur, ouverte
des deux côtés du nord au fud,traverfant toute la
maffe du bâtiment, & defeendant au-deffous du niveau
du terrein de 6 à 7 piés ; on appelle cette voûte
Yébraifoir. Pour avoir accès dans l’ébraifoir, on déblaira
des deux côtés, à fon entrée, félon une pente
douce & une largeur convenable ', toute la terre qu’on
élevera en glacis, afin de monter au haut de la
plate-forme. Voyez cette terre élevée en glacis, ƒ#.
prem, depuis le rez-de-chauffée jufqu’au haut de la
plateforme , a , a , a , b. A l’eft, on pratiquera une
petite porte ceiritrée de cinq piés de hauteur fur
deux piés de largeur, pour enfrer dans la tourelle.
Le four ainfi conftruit , il s’agit d’y arranger les
pierres qu’on fe propofe de convertir en chaux. On
aura de ces pierres amaffées en tas autour du four,
on choifira les plus greffes & les plus dures, & l’on
en formera au centre de la tourelle une efpece de
voûte fphériqùe de fix piés de hauteur, laiffant eft*
tre chaque pierre un petit intervalle de deux ou trois
■ pouces, enlorte qu’elles repréfentent grofiierement
les boulins ou pots d’un colombier; autour de cet
édifice, on placera d’autres pierres , & l’on continuera
de remplir la tourelle : obfervant de placer-
toûjours les plus groffes & les plus dures le plus proche
du centre, & les plus petites & les moins dures
fur des circonférences plus éloignées , & ainfi de
fuite ; enforte que les plus tendres & les plus petites
touchent la furface concave de la tourelle. On achèvera
le comblement de la tourelle avec des petites
pierres de la groffeur du poing ou environ, qui feront
provenues des éclats qui fe font faits en tirant
la pierre de la carrière, ouqli’on aura brifées exprès
avec la maffe. On maçonnera enfuite en - dehors ,
grofiierement la porte de la tourelle, à hauteur d’appui
; enforte qu’il ne refte plus que le paffage. d’une
botte de bruyere qui a ordinairement dix-huit pouces
en toiit lens. On finira ce travail par élever autour
d’une partie de la circonférence du débouchement
, une efpece de mur en pierres feches du côté
oppofé au vent.
Les chofes ainfi difpofées, On brûlera un quarteron
ou deux de bruyères , pour reffuyer la pierre*
Cinq ou fix heures après, on commencera à chaufj
fer en réglé : pour cet effet, le chaufournier difpofe
avec fa fourche, fur l’ atre de la tourelle , une douzaine
de bottes de bruyere ; ce qu’il fait fig. 5. il y
met le feu ; & lorfqu’elles font bien emflammées, il
en prend une treizième qu’il place à la bouche du
fou r , &c qui la remplit exa&ement. Le feu pouffé par
l’aftion de l’air extérieur qui entre par les portes de
l’ébraifoir, & fe porte dans la tourelle par la limette
pratiquée aü centre de fon atre, faifit la bourée placée
fur la bouche du fou r, coupe fon lien , & l’enflamme
: alors le chauffeur la pouffe dans l’atre avec
fon fourgon, l’éparpille , & en remet une autre fans
interruption de mouvement, à l’embouchure du four
qu’elle ferme, comme la précédente. Le feti atteint
pareillement celle-ci, & la délie ; & le chauffeur avec
Ion fourgon la pouffe pareillement dans la tourelle,
& l’éparpille fur fon atre : il continue cette manoeuv
re , avec un de fes camarades qui le relaye, pendant
douze heures ou environ, jufqu’à ce qu’ils ayent
confumé douze à quinze cents bottes de bruyères. On
connoît que la chaux eft faite , quand il s’élève au-
deffus du débouchement de la plate-forme, un cône
de feu de dix à douze piés de haut, v i f * & fans pref-
que aucun mélange de fumée ; & qu’en examinant
les pierres, on leur remarque une blancheur éclatante.
Alors on laiffe refroidir le four : pour cet effet
on monte fur la plate-forme, on étend des gaules fur
le débouchement, & on répand fur ces gaules quelques
bourées. Lorfque le four eft froid , on tire la
chaux du four ; ôn la met dans des tonneaux fous une
voûte contiguë au four , de peur d’incendie, & çn
la tranfporte par charrois aux lieux de fa deftina-
tion. \
Obfervations. i°. Que quand il fait un peu de vent,'
que l’air eft un peu humide , la chaux fe fait mieux
que dans les grands vents & par les pluies ; apparemment
la chaleur fe conferve mieux alors , la
flamme fe répand par-tout plus uniformément, no
s’élève point au débouchement avec tant de violence
, ou peut-être même par quelqu’autre caufe
plus fecrete.
2°. Que les bourées trop vertes nuifent & à la
cuiffon &c à la qualité de la chaux.
30. Que le chauffeur doit avoir la plus grande attention
à élancer de la bouche du four au milieu de
l’atre fa bourée enflammée, & de l’éparpiller avec
un grand fourgon, qu’on lui voit à la main/g. S. de
dix piés de tige de fe r , ajuftée à un manche de bois
de dix-huit pouces de longueur. Si plufieurs bourées
s’arrêtoient d’un même cô té ,, il pourroit arriver que
toute une partie de la fournée fe brûleroit, qu’une
autre partie ne feroit qu’à demi-cuite , & qu’il ré-
fulteroit un grand dommage pour le maître.
40. Que le fçu qu’on entretient dans le four eft très-
violent ; que le loin qu’on a de boucher la bouche
du four avec une bourée , le concentre & le porté
en-haut ; qu’il blanchit le fer du fourgon en quatre à
cinq fécondés ; & qu’il écarteroit avec fracas les
murs du fourneau, s’ils étoient trop légers.
<°. Q u ’il faut que ce feu foit pouffé fans intermif-
fion, fans quoi la fournée entière feroit perdue, du
moins au témoignage de Palilfi , qui raconte que
paffant dans les Ardennes il trouva fur fon chemin
un four à chaux , dont l’ouvrier s’étoit endormi au
milieu de la calcination ; & que , comme il travail-
loit à fon reveil à le rallumer , Palifîi lui dit qu’il
brûleroit toute la forêt d’Ardennes , avant que de
remettre en chaux la pierre à demi-calcinée.
6°. Que la chaux fera bien cuite , fi la pierre eft
devenue d’un tiers plus legere après la calcination
qu’auparavant * fi elle eft fonore quand on la frappe,
& fi elle bouillonne immédiatement après avoir été
arrofée ; & qu’on l’aura d’autant meilleure, que les
pierres qu’on aura calcinées feront dures : les anciens
calcinoient les fragmens de marbre, & pre-
iioient, quand il étoit queftion de la mêler au ciment
& de l’éteindre , toutes les précautions imaginables
Voyez C im e n t .
70. Que la maniéré de faire la chaux , que nous
venons de décrire, n’eft pas la feule en ulage. Au
lieu de fourneaux, il y a des endroits; oü l’on fe
contente de pratiquer des trous en terre ,• où l’on arrange
les pierres à calciner , les unes à côté des autres
; on y pratique une bouche & une cheminée ;
on recouvre les. trous & les pierres avec de la terre
gîaife ; on allume au centre un feu qu’on entretient
l'ept à huit jours , & lorfqu’il ne fort plus ni fumée
ni vapeur, on préfume que la pierre eft cuite.
8°. Qu’il faut creufer un puits aux environs du
fôur à chaux, i° pour le befoin des ouvriers : 20 pour
la petite maçonnerie qu’on fait à l’entrée de la tourelle
: 30 en cas d’incendie ; car il peut arriver qu’un
grand vent rabatte le cône de feu fur les bourées ,
& les enflamme.
90. Que pour tranfporter la chaux dans des voitures
, il faut avoir grand foin de les bien couvrir de
bannes tendues fur des cerceaux ; que les chaufourniers
allument du feu avec la chaux affez commodément
; ils en prennent une pierre groffe comme le
poing , la trempent dans l’eau , & quand elle commence
à fumer, ils la couvrent legerement de poiif-
fiere de bruyere, & foufflent fur la fumee jufqu à ce
que le feu paroiffe ; & qu’onjqg fait guere de chaux
pendant l’hyver.
Quant à l’emploi de la chaux dans la maçonnerie*
voici la méthode que Philibert de Lorme prelcrit.
Amaffez dans une foffe la quantité de chaux que
vous croyez devoir employer ; couvrez-la également
par-tout d’un pié ou deux de bon fable ; jettez
de l’eau fur ce fable, autant qu’il en faut pour qu’il
foit fuffifamment abreuvé, & que la chaux qui eft
deffous puiffe fufer fans fe brûler ; fi le fable fefend,
& donne paffage à la fumée, recouvrez aufli-tôt les
crevaffes ; cela fait, laiffez repofer deux ou trois ans ;
au bout de ce tems vous aurez une matière blanche,
douce, graffe, & d’un ufage admirable tant pour la
maçonnerie que pour le ftuc.
Les particuliers ne pouvant prendre tant de précautions
, il feroit à fouhaiter que ceux qui veulent
bâtir: trouvaffent de la chaux toute préparée, &
vieille , ôc que quelqu’un fe chargeât de çeçQnuuerce.
Quand on veut avoir du mortier incontinent,
on pratique un petit baflin en terre ; on en creufe
au-deffous dans le voifinage un plus grand ; on met
dans le petit la chaux qu’on veut employer ; on l’ar-
rofe d: éau fans crainte dç la noyer ; s’il y avoit à
craindre, ce feroit de la brûler, en ne l’hume&ant
pas affez ; on la fait boire à force de bras avec le rabot
; quand elle eft liquide & bien délayée , on la
fait couler dans le grand baflin par une rigole ; on la
tire de-là pour là mêler au fable , & la mettre en
mortier. On met y ou y de fable fur un tiers ou f de
chaux mefurée vive. Voyez Mo rtier. Vitrüve pref-
crit l’épreuve fuivante , pour s’aflurer fi la chaux eft
bien éteinte. Si on y rencontre des grumeaux ou parties
folides, elle n’eft pas encore bonne , elle n’eft
pas bien éteinte ; fi elle en fort nette, elle n’eft pas
affez abreuvée. Nous venons d’expofer ce qu’il y. a
de méchanique à favoir fur la cuiffon de la chaux
commune, c’eft maintenant au chimifte à examiner
les caratteres, les propriétés générales & particulières
de cette fubftance ; c’eft ce que M. Venel va
exécuter dans la fuite de cet article.
Qualités extérieures de la chaux. Les qualités extérieures
& fenfibles de la chaux vive, par lefquelles on
peut définir cette fubftance à la façon des naturalif-
tes, font celles-ci : la chaux vive eft friable , blanche
, ou grisâtre , legere , feche , d’un goût acre
cauftique, & d’une odeur qu’on pourroit appeller
de feu t empyreumatique , ou phlogiftique.
Propriétés phyjiques de la chaux. Les propriétés
phyfiques générales de la chaux font, i° toutes les
propriétés communes des alkalis fixes , foit fàlins ,
loft terreux ; 20. quelques-unes des qualités particulières
aux alkalis terreux ; 30. quelques-unes de celles
qui ne fe rencontrent que dans les alkalis fixes-
l'alins ; 40 enfin quelques propriétés fpéciales & ca-
raélériftiques.
Les propriétés, communes aux alkalis fixes que
poffede la chaux, font ; la fixité , voye^ Fix it é ; la
îblubilité par les acides , voye^ Menstrue ; la faculté
de changer en verd la couleur bleue des violettes
y & celle de précipiter les fubftances métalliques
unies aux acides. On découvriroit peut - être
que cette derniere propriété feroit au moins réciproque
entre certaines terres calcaires & quelques
fubftances métalliques , comme elle l’eft entre la
terré de l’alun & le f e r , fi on examinoit dans cette
vûe tous les fels à bafe calcaire , & tous les fels métalliques
; mais ces expériences nous manquent encore.
Voyei Ra ppo r t .
Les propriétés des alkalis terreux qui fe rencontrent
dans la chaux, font : l’infufibilité , ou ce degré
de difficile fufibilité , par le l’ecours des fondans ,
que les Chimiftes prennent pour l’infxifibilité abfo-
lu e , voye^ Fusible & V itrif ia ble : l’opacité & la
couleur laiteufe qu’elle porte dans les verres , lorf-
qu’on l’a mêlée dans les frites en une certaine quantité
, voyez V erre : la difficile folubilité par l’eau ;
( les alkalis terreux ne font pas parfaitement infolu-
bles dans cemenftrue, V. Eau & T erre) la précipi-
tabilité par les alkalis-falins, tant fixes que volatils :
l’utilité dans la fonte des mines de fer, dans les cementations
de ce métal, faites dans la vûe de le rendre
plus doux, oit de le convertir en acier , voyez Fer ,
A cier , & C astin e : la qualité finguliere découverte
par M. P ott, par laquelle elle difpofe le régule
d’antimoine, préparé par fon moyen, à former avec
le mercure un amalgame folide, voyez Mercure :
la faculté de fixer, d’améliorer, & même d’augmenter
les métaux, que beaucoup d’habiles chimiftes
prétendent lui avoir reconnue par des faits , voyez
fubftances métalliques, au mot METALLIQU E: & enfin
la propriété remarquable de précipiter les alka