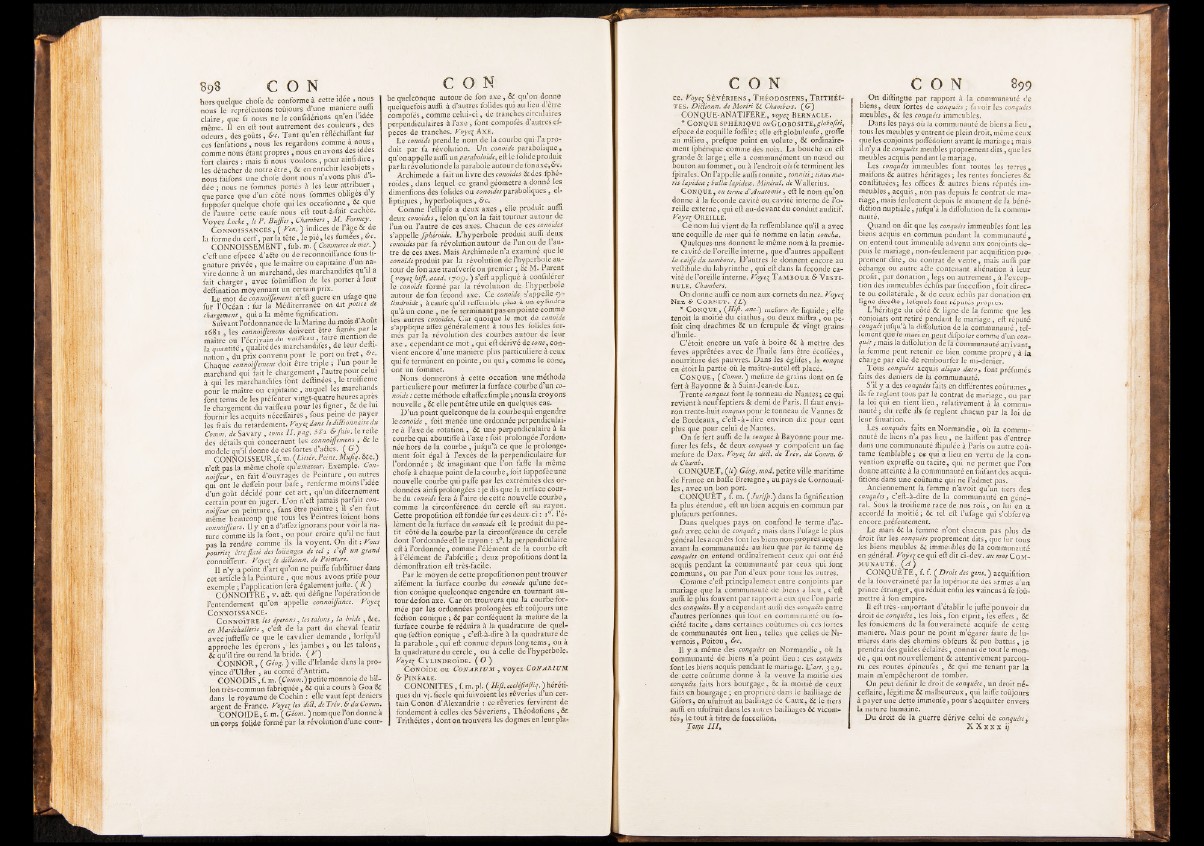
hors quelque chofe de conforme à cette idée , nous
nous le repréfentons toûjours d’une maniéré aufli
claire, que fi nous ne le confidérions qn’en l’idee
même. Il en eft tout autrement des couleurs , des
odeurs, des goûts, &c. Tant qu’en réfléchiffant fur
ces fenfations, nous les regardons comme à nous,
comme nous étant propres, nous en avons des idées
fort claires : mais fi nous voulons , pour amfi dire,
les détacher de notre être, 8c en enrichir les objets,
nous faifons une chofe dont nous n’avons plus d 1-
dée ; nous ne fommes portés à les leur attribuer,
que parce que d’un côté nous fommes obliges d y
l'uppofer quelque chofe qui les occafionne, 8c que
de l’autre cette caufe nous eft tout-à-fait cachee.
Voyez Locke, le P. Buffier, Ckambers , M. Formey.
Connoissances , ( Ven. ) indices de l’âpe & de
la forme du cerf, par la tête, le p ié, les fumées, &c.
CONNOISSEMENT, fub. m. ( Commerce de mer.)
c’eft une efpece d’afte ou de reconnoiffance fous fi-
gnature privée, que le maître ou capitaine d’un navire
donne à un marchand, des marchandifes qu il a
fait charger, avec fourmilion de les porter à leur
deftination moyennant un certain prix.
Le mot de connoijjement n’eft guere en ufage que
fur l’Océan : fur la Méditerranée on dit police de
chargement, qui a la même lignification. ^ A
Suivant l’ordonnance de la Marine du mois d Août
1681 , les connoiffemens doivent etre lignés par e
maître ou l’écrivain du v.üTeau faire mention de
la quantité', qualité des marchandifes, de leur delti-
nation , du prix convenu pour le port ou fre t, o*c.
Chaque connoijfement doit être triple ; l’un pour le
marchand qui fait le chargement , l’autre pour celui
à qui les marchandifes font deftinees , le troifieme
pour le maître ou capitaine , auquel les marchands
font tenus de les préfenter vingt-quatre heures apres
le chargement du vaiffeau pour les figner, & de lui
fournir les acquits néceffaires, fous peine de payer
les frais du retardement. Voyez dans le dictionnaire du.
Comm. de Savary , tome U.pag. 58 z Gfuiv. lerefte
des détails qui concernent les connoijjemens , 8c le j
modèle qu’il donne de ces fortes d aâes. ( G )
CONN OISSEUR, f. m. {Littér. Peint. Mufiq. 8cc.)
n’eft pas la même chofe qu 'amateur. Exemple. Con-
noifeur, en fait d’ouvrages de Peinture , ou autres
qui ont le deffein pour bafe, renferme moins l’idée
d’un goût décidé pour cet art, qu un difeernement
certain pour en juger. L’on n’eft jamais parfait con-
noifieur en peinture , fans être peintre ; il s’en faut
même beaucoup que tous les Peintres foient bons
connoifeurs. Il y en a d’affezignorans pour voir la nature
comme ils la font, ou pour croire qu’il ne faut
pas la rendre comme ils la voyent. On dit : Vous
pourriez êtrejlatè des louanges de tel ; c ejl un grand
connoiffeur. Voyez le diclionn. de Peinture.
Il n’y a point d’art qu’on ne puiffe fubftituer dans
cet article à la Peinture , que nous avons prife pour
exemple ; l’application fera egalement jufte. ( R )
CONNOITRE, v . a&. qui défigne l’opération de
l’entendement qu’on appelle connoifance. Voye.z
CONNOISSANCE.
CO N N O ÎTR E les éperons, les talons , la bride , &c.
en Maréchallerie, c’eft de la part du cheval fentir
avec jufteffe ce que le cavalier demande , lorfqu’il
approche les éperons ,' les jambes , ou les talons,
& qu’il tire ou rend la bride. ( V )
CONNOR, ( Géog. ) ville d’Irlande dans la province
d’Ulfter , au comté d’Antrim.
CONOD1S , f. m. {Comm.') petite monnoie de bil-
lon très-commun fabriquée, 8c qui a cours à Goa 8c
dans le royaume de Cochin : elle vaut fept deniers
argent de France. Voyez les dict. de Trév. & du Comm.
CONOIDE, f. m. ( Géom. ) nom que l’on donne à
un corps folide formé par la révolution d’une courbe
quelconque autour de fon a x e , 8c qu’on donne
quelquefois aufli à d’autres folides qui au lieu d’être
compofés, comme celui-ci, de tranches circulaires
perpendiculaires à l’a x e , font compofés d’autres ef-
peces de tranches. Voyez Ax e .
Le conoide prend le nom de la courbe qui l’a pn>
duit par fa révolution. Un conoide parabolique ,
qu’on appelle aufli unparaboloïde, eft le folide produit
par la révolution de la parabole autour de fonaxe,«^.
Archimede a fait un livre des conoïdes &des fphe-
roïdes, dans lequel ce grand géomètre a donne les
dimenfions des folides ou conoides paraboliques, elliptiques
, hyperboliques, &c.
Comme l’ellipfe a deux axes , elle produit aufli
deux conoïdes, félon qu’on la fait tourner autour de
l’un ou l’autre de ces axes. Chacun de ces conoïdes
s’appelle fphéroïde. L’hyperbole produit aufli deux
conoïdes par fa révolution autour de l’un qu de l’autre
de ces axes. Mais Archimede n’a examiné que le
conoide produit par la révolution de l’hyperbole autour
de fon axe tranfvèrfe ou premier ; 8f M. Parent
{ voye£ hijl. acad. iyoc). ) s’eft applique à confiderer
le conoide formé par la révolution de l’hyperbole
autour de fon fécond axe. Ce conoide, s’appelle cy-
lindroide , à caufe qu’il reffemble plus à un cylindre
qu’à un cône , ne le terminant pas en pointe comme
les autres conoides. Car quoique le mot de conoide
s’applique alfez généralement à tous les folides formés
par la révolution des courbes autour de leur
ax e, cependant ce m o t, qui eft dérivé de cône, convient
encore d’une maniéré plus particulière à ceux
qui fe terminent en pointe, ou qui, comme le cône,
ont un fommet.
Nous donnerons à cette occafion une méthode
particulière pour mefurer la furface courbe d’un co-
noïde : cette méthode eft affez fimple ; nous la croyons
nouvelle, 8c elle peut être utile en quelques cas.
D ’un point quelconque de la courbe qui engendre
le conoide , foit menée une ordonnée perpendiculaire
à l’axe de rotation , 8c une perpendiculaire à la
courbe qui aboutiffe à l’axe : foit prolongée l’ordonnée
hors de la courbe , jufqu’à ce que le prolongement
foit égal à l’excès de la perpendiculaire fur
l’ordonnée ; 8c imaginant que l’on faffe la même
chofe à chaque point de la courbe, foit fuppofée une
nouvelle courbe qui paffe par les extrémités des ordonnées
ainfi prolongées : je dis que la furface courbe
du conoide fera à l’aire de cette nouvelle courbe ,
comme la circonférence* du cercle eft au rayon.
Cette propofition eft fondée fur ces deux-ci : i° . l’e-
lément de la furface du conoide eft le produit du petit
côté de la courbe par la circonférence du cercle
dont l’ordonnée eft le rayon : z°. la perpendiculaire
eft à l’ordonnée, comme l’élément de la courbe eft
à l’élément de l’abfciffe ; deux propofitions dont la
démonftration eft très-facile.
Par le moyen de cette propofition on peut trouver
aifément la furface courbe du conoide qu’une fec-
tion conique quelconque engendre en tournant autour
de fon axe. Caron trouvera que la courbe formée
par les ordonnées prolongées eft toûjours une
fe&ion conique ; 8c par conféquent la melûre de la
furface courbe fe réduira à la quadrature de quelque
feétion conique , c’eft-à-dire à la quadrature de
la parabole , qui eft connue depuis long-teins, ou à
la quadrature du cercle, ou à celle de l’hyperbole.
Voyez C ylindroïde. ( O )
Conoïde ou Co n a r iu m , voyez Co n a r iu m
& P inéale.
CONONITES, f. m. pl. ( Hifi. eccléfiafliq, ) hérétiques
du vj. fiecle quifuivoient les rêveries d’un certain
Conon d’Alexandrie : ce rêveries fervirent de
fondement à celles des Séveriens, Théodofiens, 8c
Trithéites, dont on trouvera les dogmes en leur place.
Voyez Sévériens , T héodosiens, T rithéit
e s . Diaionn. de Moréri 8c Chambers. {G)
CONQUE-ANATIFERE, voyez Bernacle.
* C onque sphérique ouGLOBOsiTE,globofiti,
efpece de coquille foflile; elle eftglobuleufe, groffe
au milieu, prefque point en volute, 8c ordinairement
fphérique comme dés noix. La bouche en eft
grande 8c large ; elle a communément un noeud ou
boiiton au fommet, ou à l’endroit où fe terminent les
lpirales. On l’appelle aufli tonnite, tonniti; tinus maris
lapideoe ; bullce lapidées. Minéral, de Wallerius.
C onque , en terme d'Anatomie, eft le nom qu’on
donne à la fécondé cavité ou. cavité interne de l’oreille
externe, qui eft au-devant du conduit auditif.
Voyez Oreille.
Ce nom lui vient de la reffemblance qu’il a avec
une coquille de mer qui fe nomme en latin concka.
Quelques-uns donnent le même nom à la première
cavité de l’oreille interne, que d’autres appellent
la caijje du tambour. D ’autres le donnent encore au
veftibule du labyrinthe , qui eft dans la fécondé cavité
de l’oreille interne. Voyez T ambour & V est ibu
le. Chambers.
On donne aufli ce nom aux cornets du nez. Voyez
Nez & C o rn e t . (L )
* C o n q u e , {Hifi. anc.) mefure de liquide ; elle
tenoit la moitié du ciathus, ou deux miftra, ou pe-
foit cinq drachmes 8c un fcrupule 8c vingt grains
d’huile.
C ’étoit encore un vafe à boire 8c à mettre des
feves apprêtées avec de l’huile fans être écoffées,
nourriture des pauvres. Dans les églifes, la «onque
en étoit la partie où le maître-autel eft placé.
C o n qu e, {Comm.) mefure de grains dont on fe
fert à Bayonne 8c à Saint-Jean-de-Luz.
Trente conques font le tonneau de Nantes; ce qui
revient à neuf feptiers 8c demi de Paris. Il faut environ
trente-huit conques y>o\vc le tonneau de Vannes 8c
de Bordeaux, c’eft-à-dire environ dix pour cent
plus que pour celui de Nantes.
On fe fert aufli de la conque à Bayonne pour mefurer
les fels, 8c deux conques y compofent un fac
mefure de Dax. Voyez les dict. de Trév. du Comm. &
de Chamb.
CONQUET, {le) Géog. mod. petite ville maritime
de France en baffe Bretagne, au pays de Cornouailles
, avec un bon port.
CONQUÊT , f. m. {Jurifp.) dans la lignification
la plus étendue, eft un bien acquis en commun par
plufieurs perfonnes.
Dans quelques pays on confond le terme d’acquêt
avec celui de conquit ; mais dans l’ufage le plus
général lés acquêts font les biens non-propres acquis
avant la communauté : au lieu que par le terme de
conquêts on entend ordinairement ceux qui ont été
acquis pendant la communauté par ceux qui font
communs, ou par l’un d’eux pour tous les autres.
Comme c’eft principalement entre conjoints par
mariage que la communauté de biens a lieu , c’eft
aufli le plus fouvent par rapport à eux que l’on parle
des conquêts. Il y a cependant aufli des conquêts entre
d’autres perfonnes qui font en communauté ou fo-
ciété tacite , dans certaines coûtumes où ces fortes
de communautés ont lieu, telles que celles de Ni-
yernois, Poitou, &c.
Il y a même des conquêts en Normandie, où la
communauté de biens n’a point lieu : ces conquêts
font les biens acquis pendant le mariage. \Jart. 320.
de cette coûtume donne à la veuve la moitié des
conquêtS' faits hors bourgage, 8c la moitié ,de ceux
faits eh bourgage ; en propriété dans le bailliage de
Gifors, eh ufiifruit au bailliage de Caux, 8c le tiers
aufli en ufufruit dans les autres bailliages 8c vicomtés,
le tout à titre de fucceflion.
Tome III*
On diftingue par rapport à la communauté de
biens, deux fortes de conquêts; fa voir les conquêts
meubles, & les conquêts immeubles.
Dans les pays où la communauté de biens a lieu,
tous les meubles y entrent de plein droit, même ceux
que les conjoints pofledoient avant le mariage ; mais
il n’y a de conquêts meubles proprement dits, que les
meubles acquis pendant le mariage.
Les conquêts immeubles font toutes les terres,
maifons & autres héritages ; les rentes foncières 8c
conftituées; les offices 8c autres biens réputés immeubles,
acquis, non pas depuis le contrat de mariage
, mais feulement depuis le moment de la bénédiction
nuptiale, jufqu’à la diffolution de la communauté.
^ Quand on dit que les conquêts immeubles font les
biens acquis en commun pendant la communauté,
on entend tout immeuble advenu aux conjoints depuis
le mariage, non-feulement par acquifition proprement
dite, ou contrat de vente, mais aufli par
échange ou autre a£te contenant aliénation à leur
profit, par donation, legs ou autrement, à l’exception
des immeubles échûs par fucceflion, foit directe
ou collatérale, 8c de ceux échûs par donation en
ligne direCle, lefquels font réputés propres.
L ’héritage du côté & ligne de la femme que les
conjoints ont retiré pendant le mariage, eft réputé
conquit jufqu’à La diffolution de la. communauté, tellement
que le mari en pçut difpoler comme d’un con-
quet ; mais la diffolution de là communauté arrivant,
la femme peut retenir ce bien comme propre, i la
charge par elle de rembourfer le mi-denier.
Tous conquêts acquis aliquo dato, font préfumés
faits des deniers de la communauté.
S’il y a des conquêts faits en différentes coûtumes ,
ils fe règlent tous par le contrat de mariage, ou par
la loi qui en tient lieu, relativement à la communauté
; du refte ils fe règlent chacun par la loi de
leur fituation.
Les conquêts faits en Normandie, où la communauté
de biens n’a pas lieu , ne laiffent pas d’entrer
dans une communauté ftipulée à Paris ou autre coutume
femblable ; ce qui a lieu en vertu de la convention
expreffe ou tacite, qui ne permet que l’on
donne atteinte à la communauté en faifant des acqui-
fitions dans une coûtume qui ne l ’admet pas.
Anciennement la femme n’avoit qu’un tiers des
conquêts, c’eft-à-dire de la communauté en général.
Sous la troifieme race de nos rois, on lui en a
accordé la moitié ; 8c tel eft l’ufage qui s’obferve
encore préfentement.
Le mari 8c la femme n’ont chacun pas plus de
droit fur les conquêts proprement dits, que fur tous
les biens meubles 8c immeubles de la communauté
en général. Voyez ce dit ci-dev. au mot Communauté..
{A )
CONQUETE, f. f. {Droit des gens.) acquifition
de la fouveraineté par la lupériorité des armes d’un
prince étranger, qui réduit enfin les vaincus à fe foû-
mettre à fon empire.
Il eft très - important d’établir le juftépouvoir du
droit de conquête, lès lois, fon elprit, fes effets, &C
les fondemens de la fouveraineté acquife de cette
maniéré. Mais pour ne point m’égarer faute de lumières
dans des chemins obfcurs 8c peu battus , je
prendrai des guides éclairés, connus de tout le monde
, qui ont nouvellement & attentivement parcouru
ces routes épineufes , 8c qui me tenant par la
main m’empêcheront de tomber.
On peut définir le droit de conquête, un droit né-
ceffaire, légitime 8c malheureux, qui laiffe toûjours
à payer une dette immenfe, pour s’acquitter envers
la nature humaine.
Du droit de la guerre dérive celui de conquête,
X X x x x ij