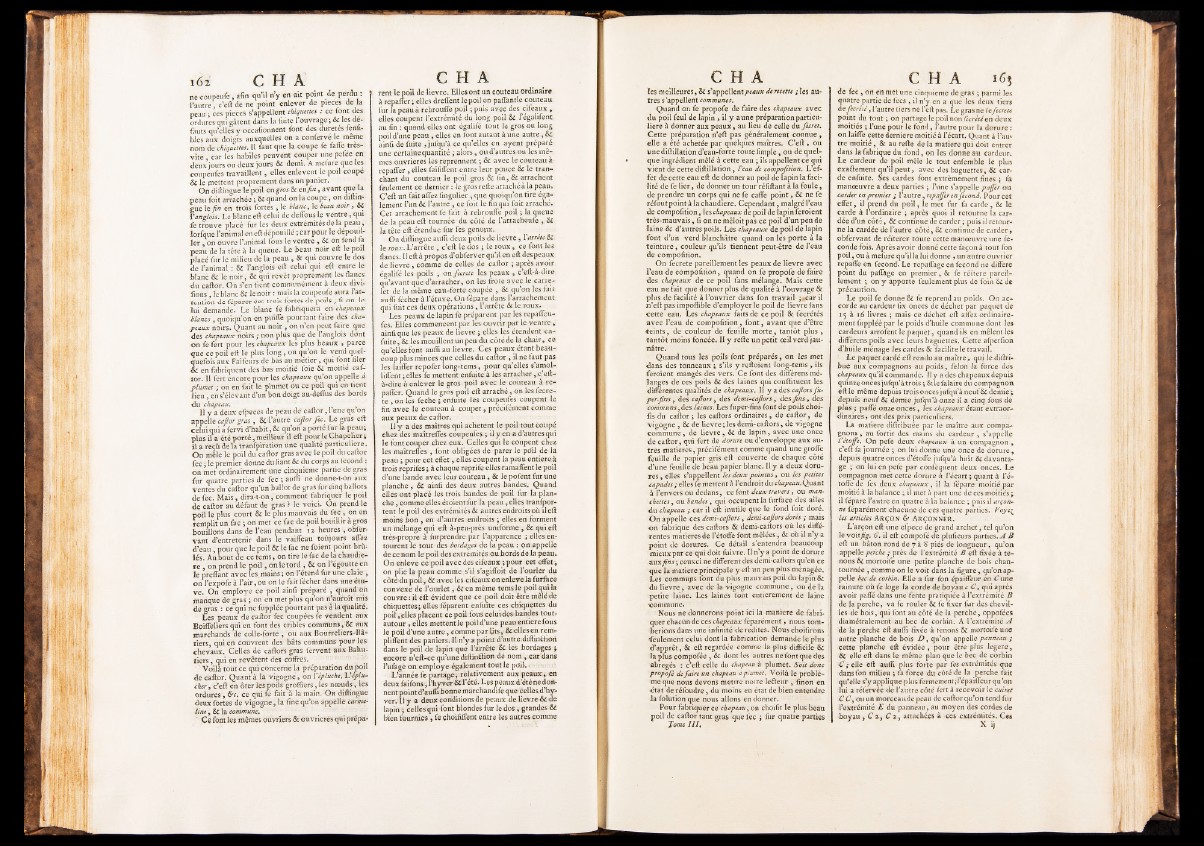
necoupcrfe, afin qu’il n’y en a it point fie perdu : 1
l’autre., e’eft de ne point enlever de pièces de là
peau ; ces pièces s’appellent chiqucttes »• ce font des
ordures qui gâtent dans la fuite l’ouvrage ; 8c les defauts
qu’elles yoccafionnent font des duretes fenfi-
bles aux doigts auxquelles on a conl'ervé le même
nom dé chiquettes. Il faut que la coupe fe faffe très-
v î t e , car les habiles peuvent couper une pefee en
deux jours ou deux jours 8c demi. A mefure que les
coupeufes travaillent, elles enlevent le poil coupe
Sc le piettent proprement dans un panier.
On diftingue le poil en gros & enfin, avant que la
çeau foit arrachée ; 8c quand on la coupe, on diflin-
■ gue le fin en trois fortes , le blanc, le beau noir, &
Vanglois. Le blanc eft celui de deffous le ventre, qui
fé trouve placé fur les deux extrémités de la peau,
iorfque l’animal en eft dépouillé ; car pour le dépouiller
, on ouvre l’animal forts le ventre , 8c on fend fa
peau de la tête à la queue. Le beau noir eft le poil
placé fur le milieu de la peau , & qui couvre le dos
de l’animal : 8c l’anglois eft celui qui eft entre le
blanc 8c le noir, 8c qui revet proprement les flancs
du caftor. On s’en tient communément à deux divisons
, le blanc 8c le noir : mais la coupeufe aura 1 at*-
tention de féparer ces trois fortes dè poils , fi on le
lui demande. Le blane fe fabriquera en chapeaux
■ blancs , quoiqu’on en puiffe pourtant faire des chapeaux
noirs. Quant au noir , on n en peut faire que
des chapeaux noirs j non plus que de 1 auglois (font
o n fe fert pour les chapeaux les plus beaux , parce
que ce poil eft le plus long, ou qu’on le vend quelquefois
aux Faifeurs de bas au métier, qui font filer
en fabriquent des bas moitié foie 8c moitié caftor.
Il fert encore pour les chapeaux qu’on appelle à
plumet ; on en fait le plumet ou ce poil qui en tient-
lie u , en s’élevant d’un bon doigt au-deffus des bords
élu chapeau. t
Il y a deux efpeces de peau dé caftor, l’uiie qu on
appelle cafior gras , Sc‘l’autre cafior fec. Le gras eft
celui qui a fervi d’habit, & qu’on a porte fur la peau;
plus il a été porté, meilleur il eft pour le Chapelier ;
i l a reçu delà tranfpiration une qualité particulière.
On mêle le poil du caftor gras avec le poil du caftor
fec ; le premier donne du liant 8c du corps au fécond :
on met ordinairement une cinquième partie de gras
fur quatre parties de fec ; auffi ne donne-t-on aux
ventes du caftor qu’un ballot de gras fur cinq ballots
de fec. Mais, dira-t-on ; comment fabriquer le poil
de caftor au défaut de gras ? le voici. On prend le
poil le plus court 8c le plus mauvais du fec j on en
remplit un faç ; on met ce fac de poil bouillir à gros
bouillons dans de l’eau pendant i z heures , obfèr-
vant d’entretenir dans le vaifféau toujours a fiez
d’eau , pour que le poil 8c le fac ne foient point brûlés.
Au bout de ce tems, on tire le fac de la chaiidie-
re , on prend le p o il, on le tord , & on 1 egoùtte en
le preffant avec les, maifis ; on l’étend fur une claie ,
on l’expofe à l’air,ou on le fàitfécher dans une étuv
e. On employé ce poil ainfi préparé , quand ôh
manque de gras ; on en met plus qu’on n*àüfoit mis
de gras : ce qui ne fupplée pourtant pas à la qualité.
Les peaux de caftor fec coupées fe vendent aux
Boiffeliers qui en font des cribles communs , & au*
marchands de colle-fortè , ou aux Boutrélîers-Bâ-
tiers, qui en couvrent des bâts communs poür les
chevaux. Celles dé caftors gras fervent aux Bahu-
tiers, qui en revêtent des coffres. f
Voilà tout ce qui concerné là préparation du poil
de caftor. Quant à là vigogne , on l’épluche. L ’éplucher
, c’eft en ôter les poils greffiers, les noeuds, les
ordures , &c. ce qui lé fait à la main. On diftingue
deux fortes de vigogne, la fine qu’on appelle carnte-
line , 8c la commune.
' Ce font les mêmes ouvriers & ouvrierés qui préparent
le poil de lievre. Elles ont un couteau ordinaire
à repaffer; elles dreffent le poil en paffantle couteau
fur la peau à rebrouffe poil ; puis avec des cifeaux,
elles coupent l’extrémité du long poil 8c l’égalifent.
au fin : quand elles ont égalifé tout le gros ou long
poil d’une peau , elles en font autant à une autre, 8c
ainfi de fuite ,jufqu’à ce qu’elles en ayent préparé
une certaine quantité ; alors, ou d’autres ou les mêmes
ouvrières les reprennent ; 8c avec le couteau à
repaffer , elles faififfent entre leur pouce 8c le tran-
chànt du couteau le poil gros & fin, & arrachent
feulement ce dernier ; le grosrefte attaché à la peau*
Ç’eft un fait affez lîngulier , que quoiqu’on tire également
l’un 5c l’autre , ce foit le fin qui foit arraché.
Cet arrachement fe fait à rebrouffe poil ; la queue
de la peau eft tournée du côté de l’arracheufe , 8c
la tête eft étendue fur fes genojix*
Ondiftingue auffi deux poils de lie v re , Yarrête 8c
le roux. L’arrête , c’eft le dos ; le roux, ce font les
flancs. Il eft à propos d’obferver qu’il en eft despeaux
de lie v re , comme de celles de caftor ; après avoir
égalifé les poils , on fecrete les peaux , c’eft-à-dire
qu’avant que d’arracher, ôn les frote avec le carrelet
de la même eau-forte coupée , 8c qu’on les fait
auffi fécher à l’étuve. On fépare dans l’arrachement,
qui fuit ces deux opérations, l’arrête & le roux.
Lès peaux de lapin fe préparent par les repaflou-
fes. Elles commencent par les ouvrir par le ventre,
ainfi que les peaux de lievre ; elles les étendent en-
fuite , 8c les mouillent un peu du côté de. la chair, ce
qu’élles font auffi au lievre. Ces peaux étant beau--
coup plus minces que celles du caftor , il ne faut pas
les laiffer repofer long-tems, pour qu’elles s’amol-
liffent ; elles fe mettent enfuite à les arracher, c ’eft-
à-dire à enlever le gros poil avec le couteau à repaffer.
Quand le gros poil eft arraché, on les fecre-,
te , on les feche ; enfuite les coupeufes coupent le
fin avec le couteau à couper, précifément comme
aux peaux de caftor. ,
Il y a des maîtres qui achètent le poil tout coupé
chez des maîtreffes coupeufes ; il y en a d’autres qui
le font couper chez eux. Celles qui le coupent chez
les maîtreffes , font obligées de parer le po'il de la
peau ; pour cet effet, ellesxoupent la peau entiereà
trois reprifes ; à chaque reprife elles ramaffent le poil
d’une bande avec leur couteau, & le pofent fur une
planche, 8c ainfi des deux autres bandes. Quand
ellésont placé les trois bandes de poil fur la planche
, comme elles étoientfiir la peati, elles tranfpor-
tent le poil des extrémités & autres endroits oit il eft
moins bon , en d’autres endroits ; elles _en forment
un mélange qui eft à-peu-près uniforme , 8c qui eft
très-propre à furprendre par l’ap paren cee lles entourent
le tout des bordages de la peau : on,appelle
de ce nom le poil des ex trémités ou bords de la peau.
On enleve ce poil avec dés eifeaux ; pour cet effet,
on plie la peau comme.s’il s’agiffoit de l’ourlér du
eôtédu poiL,8c avec les cifeaux on enlevie la furface
convexe de l’ourlet, 8c en même teins le poil qui la
couvre : il eft évident que ce .poil doit être mêle de
chiquettes; elles féparent enfuite ces chiquettes du
poil, plies placent ce poil fous celui des'bandes tout-
autour , elles mettent le poil d’une peau entière fous
le poil d’une autre, comme par 'lits, êcellesearetny
pliffent des paniers. IL n’y a point d’autre .diftinêlioii
dans le poil de lapin que l’arrête 8c les bordages ;
encore1 n’eft-ce qu’une diftinélion dé nom., car dans
l’ufagè on employé également tout le poil. ^ >
L ’année fe partage^ relativement aux peaux:, en
deux faifons d l’hyver ôc l ’été. Les peaux'd’été ne donnent
point d’aum bonne màrchandife quecellesd’hy-
ver. Il y a deux conditions de peaux de lievre 8c de
lapin ; celles qui font blondes fur le dosjgrandes-8c
bien fournies , fe choififfent entre les autres comme
les meilleures, & s’appellent peaux de recette ; les autres
s ’appellent communes.
Quand on fe propofe de faire des chapeaux avec
du poil feul de lapin, il y aune préparation particulière
à donner aux peaux, au lieu de celle du fecret.
Cette préparation n’eft pas généralement connue ,
elle a été achetée par quelques maîtres. C ’eft > ou
une diftillation d’eau-forte toute fimple, ou de quelque
ingrédient mêlé à cette eau ; ils appellent ce qui
vient de cette diftillation, Veau de compojîtion. L’effet
de cette eau eft de donner au poil de lapin la facilité
de fe lier, de donner un tour réfiftant à la foule,
de prendre un corps qui ne fe caffe point, 8c ne fe
réfout point à la chaudière. Cependant, malgré l’eau
de eompofition, les chapeaux de poil de lapin feroient
très-mauvais, fi on ne mêloit pas ce poil d’un peu de
laine 8c d’autres poils. Les chapeaux de poil de lapin
font d’un verd blanchâtre quand on les porte à la
teinture, couleur qu’ils tiennent peut-être de l’eau
de eompofition.
On fecrete pareillement les peaux de lievre avec
l ’eau de eompofition, quand on fe propofe de faire
des chapeaux de ce poil fans mélange. Mais cette
eau ne fait que donner plus de qualité à l’ouvrage 8c
plus de facilité à l’ouvrier dans fon travail ;«car il
n ’eft pas impoffible d’employer le poil de lievre fans
cette eau. Les chapeaux faits de ce poil 8c fecrétés
avec l’eau de eompofition, fon t, avant que d’être
teints, de couleur de fçuille morte, tantôt plus ,
tantôt moins foncée. Il y refte un petit oeil verd jaunâtre.
Quand tous les poils font préparés, on les met
dans des tonneaux ; s’ils y reftoient long-tems , ils
feroient mangés des vers. Ce font des différens mélanges
de ces poils 8c des laines qui conftituent les
différentes qualités de chapeaux. Il y a des çajlors fu-
per-fins, des cafiors, des demi-cajlors, des fins , des
communs ,dts laines. Les fuper-fins font de poils choi-
fis du caftor % les caftors ordinaires, de caftor, de
vigogne , 8c de lievre ;les demi-caftors, de vigogne
commune, de lievre , 8c de lapin, avec une once
de caftor, qui fert de dorure ou d’enveloppe aux autres
matières, précifément comme quand une groffe
feuille de papier gris eft couverte de chaque côté
d’une feuille de beau papier blanc. Il y a deux dorures
, elles s’appellent les deux pointus , ou les petites
capades ; ellès fe mettent à l’endroit du chapeau.Quant
à l’envers ou dedans, ce font deux travers, ou manchettes
, ou bandes, qui occupent la furface des ailes
du chapeau ; car il eft inutile que le fond foit doré.
On appelle ces demi-caflors, demi-cafiors dores ; mais
on fabrique des caftors 8c demi-eaitors où les différentes
matières de l’étoffe font mêlées , 8c où il n’y a
point de dorures. Ce détail s’entendra beaucoup
mieux par ce qui doit füivre. Il n’y a point de dprure
aux fins ; ceuxci ne different des demi-caftors qu’en ce
que la matière principale y eft un peu plus ménagée.
Les communs font du plus mauvais poildu lapin 8c
du lievre, avec de la vigogne commune, où dé la
petite laine. Les laines font entièrement de laine
^commune.
Nous ne donnerons point ici la maniéré de fabriquer
chacun de ees ckaptaUx féparément, nous tomberions
dans une infinité de redites. Nous ehôifirons
■ feulement celui dont la' fabrication demandé lo pins
d’apprêt, 8c eft regardée comme la plus difficile 8c
la plus compofée , 8c dont les autres ne fontqué des
abrégés : c’eft celle du chapeau à plumet. Soit donc
propofl de faire un chapeau à piumét. ‘Voilà le problème
que nous devons mettre notre le&eùr , finon en
état de réfoudre, du moins en état de bien entendre
la folution que nous allons en donner.
Pour fabriquer ce chapeau, on ehoifit le plus beau
poil de caftor tant gras que lec ; fur quatre parties
J orne I I I ,
de feé , on en ttiet une cinquième de gras ; parmi les
quatre partie de fecs , il n’y en a que les deux tiers
dejecrété, l ’autre tiers né l’eft pas. Le gras ne lefecrete
point du tout ; on partage le poil non fureté en deux
moitiés ; l’une pour le fond, l’autre pour la dorure :
on laiffe cette derniere moitié à l’écart. Quant à l’au*
tre moitié, 8c au refte de la matière qui doit entrer
dans la fabrique du fond, on les donne au cardeur.
Le cardeur de poil mêle le tout enfemble le plus
exaôement qu’il peut, avec des baguettes, 8c carde
enfuite. Ses cardes font extrêmement fines ; fa
manoeuvre a deux parties ; l’une s’appelle pajftr ou
carder en premier ; l’autre, repaffer en fécond. Pour cet
effet, il prend du p o il, le met fur fa carde, 8c lé
carde à l’ordinaire ; après quoi il retourne la cardée
d’un cô té, 8c continue de carder ; puis il retourne
la cardée de l’autre côté, 8c continue de carder,
obfervant de réitérer toute cette manoeuvre une fécondé
fois. Après avoir donné cette façon à tout fon
poil, ou à mefure qu’il la lui donne, un autre ouvrier
repaffe en fécond. Le repaffage en fécond ne différé
point du paffage en premier, 8c fe réitéré pareillement
; on y apporte feulement plus de foin 8c de
précaution.
Le poil fe donùe 8c fe reprend au poids. On accorde
au cardeur fix onces de déchet par paquet de
15 à 16 livres ; mais ce déchet eft allez ordinairement
fupplée par le poids d’huile commune dont les
cardeurs arrofent le paquet, quand ils en mêlent les
différens poils avec leurs baguettes. Cette afperfion
d’huile ménage les cardes & facilite le travail.
Le paquet cardé eft rendu au maître, qui le diftri-
bue aux compagnons au-poids, félon la force des
chapeaux qu’il commande. Il y a des chapeaux depuis
quinze onces jufqu’à trois ; 8c le falaire du compagnon
eft le même depuis trois onces jufqu’à neuf 8c demie;
depuis neuf 8c demie jufqu’à onze il a cinq fous de
plus paffé onze onces, les chapeaux étant extraordinaires,
ont des prix particuliers.
La matière diftribuee par le maître aux compagnons
, au fortir des mains du cardeur , s’appelle
Vétoffe. On pefe deux chapeaux à un compagnon ,
c’eft fa journée ; on lui donne une once de dorure,
depuis quatre onces d’étoffe jufqu’à huit 8c davantage
; on lui en pefe par conséquent deux onces. Le
compagnon mer cette dorure à l’écart ; quant à l’étoffe
de fes deux chapeaux, il la fépare moitié par
moitié à la balance ; il met à part une de ces moitiés ;
il fépare l’autre en quatre à la balance ; puis il arçon-
ne féparément chacune de ces quatre parties. Voye^
les articles Arço n 6* Arçonner.
L’arçon eft une efpece de grand archet, tel qu’on
le voit^g. <?. il eft compofé de plufieurs parties. A B
eft un bâton rond de 7 à 8 pies de longueur, qu’on
appelle perche ; près de l’extrémité B eft fixée à tenons
8c mottoife une petite planche de bois chantournée
., comme on Le voit dans la figure, qu’on appelle
bec dé corbin. Elle a fur fon épaiffeur en C une
rainure où fe logé la corde de boyau c C , qui après
avoir paffé dans une fente pratiquée à l’extrémité B
de la perche, va fe rouler 8c fe fixer fur des chevilles
de bois, qui font au côté de la perché, oppofées
diamétralement au bec de corbin. A l’extrémité A
de là perche eft auffi fixée à tenons 8c mortoife une
autre planche de bois Z) , qu’on appelle panneau ^
cette planche eft évidée , pour être plus legere,
8c elle eft dans le même plan que le bec de corbin
f j elle eft auffi plus forte par fes extrémités que
dans fon tniljeu ; fa force du côté de la perche fait
qit*èlle s’y applique plus fermement ;l’épaiffeur qu ’on
lui a réfervée de l’autre côté fert à recevoir le cuiret
C C , ou un morceau de peau de caftor qu’on tend fur
l’extrémité E du panneau, au moyen des cordes de
boyau f C î , C i , attachées à ces extrémités. Ces