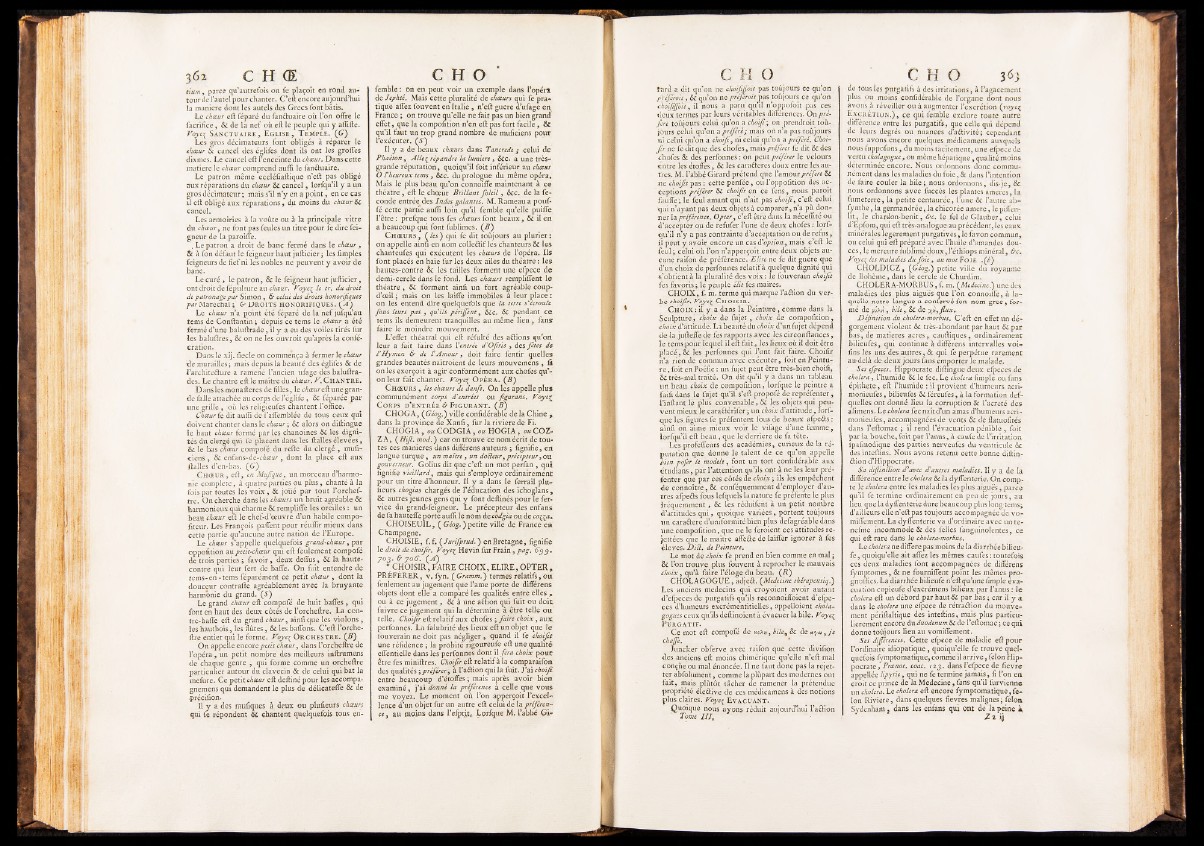
tium, parce qu’autrefois on fe plaçoit en rond autour
de l’autel pour chanter. C’ eft encore aujourd’hui
la maniéré dont les autels des Grecs font bâtis.
Le choeur eft féparé du fanûuaire oit l’on offre le
facrifice, & de la nef où eft le peuple qui y aflifte.
Voyei Sa n c t u a ir e , Eg l is e , T emple. (G)
Les gros décimateurs font obligés à réparer le
choeur & cancel des églifes dont ils ont les groffes
dixmes. Le cancel eft l’enceinte du choeur. Dans cette
matière le choeur comprend auffi le fanâuaire.
Le patron même eccléliaftique n’eft pas obligé
aux réparations du choeur & cancel, lorfqu’il y a un
gros décimateur ; mais s’il n’y en a point, en ce cas
il eft obligé aux réparations, du moins du choeur ôc
cancel.
Les armoiries à la voûte ou à la principale vitre
du choeur, ne font pas feules un titre pour fe dire fei-
gneur de la paroiffe.
, Le patron a droit de banc-fermé dans le choeur,
& à fon défaut le feigneur haut jufticier ; les fimples
feigneurs de fief ni les nobles ne peuvent y avoir de
banc.
Le curé , le patron, & le feigneur haut jufticier,
ont droit de fépulture au choeur. Voye[ le tr. du droit
de patronage par Simon, 6* celui des droits honorifiques
par Maréchal ; 6* D r o it s honorifiques. (A )
Le choeur n’a point été féparé de la nef jufqu’au
tems de Conftantin ; depuis ce tems le choeur a été
fermé d’une baluftrade, il y a eu des voiles tirés fur
les baluftres, & on ne les ouvroit qu’après la confé-
cration.
Dans le xij. fiecle on commença à fermer le choeur
de murailles; mais depuis la beauté des églifes & de
l ’architeôure a ramené l’ancien ufage des baluftra-
des. Le chantre eft le maître du choeur. V. C hantre.
Dans les monafteres de filles, le choeur eft une grande
falle attachée au corps de l’églife , & féparée par
une grille , où les religieufes chantent l’office.
Choeur fe dit auffi de l’affemblée de tous ceux qui
doivent chanter dans le choeur ; & alors on diftingue
le haut choeur formé par les chanoines & les dignités
du clergé qui fe placent dans les ftalles élevees,
& le bas choeur compofé du refte du clergé , mufi-
ciens , & enfans-de-cAoewr , dont la place eft aux
ftalles d’en-bas. (G)
C hoe u r, eft, en Mufique, un morceau d’harmonie
complété, à quatre parties ou plus, chanté à la
fois par toutes les voix , & joué par tout l’orchef-
tre. On cherche dans les choeurs un bruit agréable &
harmonieux qui charme & rempliffe les oreilles : un
beau choeur eft le chef-d’oeuvre d’un habile compo-
fiteur. Les François paffent pour réuffir mieux dans
cette partie qu’aucune autre nation de l’Europe.
Le choeur s’appelle quelquefois grand-choeur, par
oppofition au peùt-thoeur qui eft feulement compofé
de trois parties ; favoir, deux deffus, & la haute-
contre qui leur fert de baffe. On fait entendre de
tems-en-tems féparément ce petit choeur , dont la
douceur contrafte agréablement avec la bruyante
harmonie du grand. (S)
Le grand choeur eft compofé de huit baffes , qui
font en haut des deux côtés de l’orcheftre. La contre
baffe eft du grand choeur, ainfi que les violons,
les hautbois, les flûtes, & les baffons. C ’eft l’orcheftre
entier qui le forme. Voye^ O r ch e s tr e . (JT)
On appelle encore petit choeur, dans l’orcheftre de
l’opéra, un petit nombre des meilleurs inftrumens
de chaque genre , qui forme comme un orcheftre
particulier autour du clavecin & de celui qui bat la
mefure. Ce petit choeur eft deftiné pour les accompa-
gnemens qui demandent le plus de délicateffe & de
précifion.
Il y a des mufiques à deux ou plufieurs choeurs
qui fe répondent ôc chantent quelquefois tous enfemble
: oh en peut voir un exemple dans l’opéra
de Jephté. Mais cette pluralité de choeurs qui fe pratique
affez fouvent en Italie , n’eft guere a’ufage en.
France ; on trouve qu’elle ne fait pas un bien grand
effet, que la compofition n’en eft pas fort facile, &
qu’il faut un trop grand nombre de muficiens pour
l’exécuter. (G)
Il y a de beaux choeurs dans Tancrede ; celui de
Phaeton, Alle^ répandre la lumière , & c . a une très-
grande réputation, quoiqu’il foit inférieur au choeur
O l'heureux tems , & c . du prologue du même opéra*
Mais le plus beau qu’on connoiffe maintenant à ca
théâtre , eft le choeur Brillant fo leil, & c . de la fécondé
entrée des Indes galantes. M. Rameau a pouffé
cette partie auffi loin qu’il femble qu’elle puiffe
l’être : prefque tous fes choeurs font beaux, & il en
a beaucoup qui font fublimes. (B )
C hoeurs , ( les ) qui fe dit toûjours au plurier :
on appelle ainfi en nom colle&if lés chanteurs & les
chanteufes qui exécutent les choeurs de l’opéra. Ils
font placés en haie fur les deux ailes du théâtre : les
hautes-contre oc les tailles forment une efpece de
demi-cercle dans le fond. Les choeurs rempliffent le
théâtre , & forment ainfi un fort agréable coup-
d’oeil ; mais on les laiffe immobiles à leur place:
on les entend dire quelquefois que là terre s'écroule
fous leurs pas , qu'ils périjfent, & c . & pendant ce
tems ils demeurent tranquilles au même lieu , fans'
faire le moindre mouvement.
L’effet théâtral qui eft réfulté des aéfions qu’on
leur a fait faire dans Ventrée d'Ofiris > des fêtes de
l'Hymen & de l'Amour, doit faire fentir quelles
grandes beautés naîtroient de leurs mouvemens , fi
on les exerçoit à agir conformément aux chofes qu*-.
on leur fait chanter. Voye^ O péra. (B)
C hoeurs , les choeurs de danfe. On les appelle plus
communément corps d'entrées ou figurans. Voye£
C orps d’entrée & Fig u r an t . ( 2?)
CHOGA, ( Géog.) ville confidérable de la Chine 9
dans la province de Xanfi, fur la riviere de Fi.
CH OG IA, ou C O D G IA , ou H OGIA, ou COZ-
Z A , ( Hifi. mod. ) car on trouve ce nom écrit de toutes
ces maniérés dans différens auteurs ; lignifie, en
langue turque, un maître , un docteur, précepteur, ou
gouverneur. Golius dit que c’eft un mot perfan , qui
lignifie vieillard, mais qui s’employe ordinairement
pour un titre d’honneur. Il y a dans le ferrail plu-
lieurs chogias chargés de l’éducation des ichoglans,
& autres jeunes gens qui y font deftinés pour le fer-
vice du grand-feigneur. Le précepteur des enfans
de fa hauteffe porte aulfi le nom de codgia ou de co%?a*
CHOISEUIL, ( Géog. ) petite ville de France en
Champagne.
CHOISIE, f. f. ( Jurifprud. ) en Bretagne, lignifie
le droit de choifir. Voye^ Hevin fur Frain, pag. (><)$•
703. & 70 G. (A )
* CHOISIR, FAIRE CHOIX, ELIRE, O P TE R ,
PRÉFÉRER, v . fyn. ( Gramm. ) termes relatifs, ou
feulement au jugement que l’ame porte de différens
objets dont elle a comparé les qualités entre elles ,
ou à ce jugement, & à une aftion qui fuit ou doifc
fuivre ce jugement qui la détermine à être telle ou
telle. Choifir eft relatif aux chofes ; faire choix, aux
perfonnes. La falubrité des lieux eft un objet que le
louverain ne doit pas négliger , quand il fe choifit
une réfidence ; la probité rigoureufe eft une qualité
effentielle dans les perfonnes dont il fera choix pour
être fes miniftres. Choifir eft relatif à la comparaifon
des qualités ; préférer, à l’aôion qui la fuit. J’ai choifi
entre beaucoup d’étoffes; mais après avoir bien
examiné, j’ai donné la préférence à celle que vous
me voyez. Le moment où l’on apperçoit l’excellence
d’un objet fur un autre eft celui de la préférence
, au moins dans l’efprit, Lorfque M. l’abbé Gifard
a dit qu’on ne chofijjoit pas toûjours ce qu’on
j>) éféroit, &c qu’on ne préjeroit pas toûjours ce qu’on
choifijfoit, il nous a paru qu’il n’oppofoit pas ces
deux termes par leurs véritables différences. On préféré
toûjours celui qu’on a choifi ; on prendroit toû-
jôurs celui qu’on a préféré; mais on n’a pas toûjours
ni celui qu’on a choifi, ni celui qu’on a préféré. Choifir
ne fc dit que des chofes, mais préférer fe dit & des
chofes & dés perfonnes : ôn peut préférer le velours
entre les étoffes, & les carafteres doux entre les autres.
M. l’abbé Girard prétend que l’amour préféré &
ne choifit pas : cette penfée, ou l’oppofition des acceptions
préférer & choifir en ce fens, nous paroît
fiauffe; le feul amant qui n’ait pas choifi 9 c’eft celui
"qui n’ayant pas deux objets à comparer, n’a pû donner
la préférence. Opter, c’eft être dans la néceflité ou
d’accepter ou de refufer l’une de deux chofes : lorfqu’il
n’y a pas contrainte d’acceptation ou de refus,
jl peut y avoir encore un cas d'option, mais c’eft le
feul ; celui où l’on n’apperçoit entre deux objets aucune
faifon de préférence. Elire ne fe dit guere que
d’un choix de perfonnes relati f à quelque dignité qui
^’obtient à la pluralité des voix : le fouverain choifit
fes favoris ; le peuple élit fes maires.
CHOIX, f. m. terme qui marque l’aûion du verbe
choifir. Voyt{ C h o is ir .
C hoix : il. y. a dans, la Peinture, comme dans la
Sculpture* choix de fu je t, choix de compofition,
•choix d’ attitude. La beauté du choix d’un fujet dépend
de la .jufteffe de fes rapports .avec les circonftances,
le tem§;pôuf lequel il eft fait, les lieux où il doit être
placé, & les perfonnes qui l’ont fait faire. Choifir
h’a rien de commun avec exécuter, foit en Peinture
, foit en Ppëfie : un fujet peut être très-bien choifi,
& très-mal traité. On dit qu’il y a dans un tableau
un bea.u choix de compofition, lorfque le peintre a
faifi dans , le fujet qu’il s’eft propofé de repréfenter,
l’inftant lé plus convenable, & les objets qui peuvent
mieux le caraûérifef ; un choix d’attitude, lorfque
lçs. figures fe préfentent fous de beaux afpetts :
ainfi on aime mieux voir le vifage d’une femme ,
lorfqu’il eft beau, que le derrière de fa tête.
Les profeffeurs des académies, curieux de la réputation
que donne le talent de ce qu’on appelle
lien pofer le modèle, font un tort confidérable aux
étudians, par l ’attention qu’ils ont à ne les leur présenter
que par ces côtés de choisc ; ils les empêchent
de connoître, ôc conféquemment d’employer d’autres
afpeûs fous lefquels la nature fe préfente le plus
fréquemment , & les réduifent à un petit nombre
d’attitudes q ui, quoique variées, portent toûjours
un caraûere d’uniformité bien plus defagréable dans
une compofition, que ne le feroient ces attitudes re-
jettées que le maître affe&e de laiffer ignorer à fes
éleves. Dict. de Peinture.
Le mot de choix fe prend en bien comme en mal ;
& l’on trouve plus fouvent à reprocher le mauvais
choix, qu’à faire l’éloge du beau. (R)
CHOLAGOGUÉ, adje£h^(Medecine thérapeutiq.)
Les anciens médecins qui croyoient avoir autant
d’ efpeces de purgatifs qu’ils reconnoiffoient d ’efpe-
ces d’humeurs excrémentitielles, appelloient chola-
gogucs ceux qu’ils deftinoient à évacuer la bile. Voye{
P u r g at if .
Ce mot eft compofé de ko\m , bile9 & de ayu, je
cliajfe.
Juncker obferve avec .faifon que cette divifion
des ânçiens eft moins chimérique qu’elle n’eft mal
conçûe ou mal énoncée. Il ne faut donc pas la rejet-
ter abfolument, comme la plûpart des modernes ont
fait, mais plutôt tâcher de ramener la prétendue
propriété éleâive de ces médicamens à des notions
plus claires. Voye1 Ev a cu a n t .
Quoique nous ayons réduit aujourd’hui l’attion
Tome I I I ,
de tous les purgatifs à des irritations, à l’agacement
plus pu moins confidérable de l’organe dont nous
avons à réveiller ou à augmenter l’excrétion (voyeç
Excré t io n .) , ce qui femble exclure toute autre
différence entre les purgatifs, que celle qui dépend
de leurs degrés ou nuances d’aélivité; cependant
nous avons encore quelques médicamens auxquels
nous fuppofons, du moins tacitement, une efpece de
vertu cholagogue, ou même hépatique, qualité moins
déterminée encore. Nous ordonnons donc communément
dans les maladies du foie, & dans l’intention
de faire couler la bile ; nous ordonnons, dis-je, &
nous ordonnons avec fuccès les plantes ameres, la
fumeterre, la petite centaurée, l’une & l’autre ab-
fynthe, la germandrée, la chicorée amere, le piffen-
lit, le chardon-benit, Gc. le fel de Glauber, celui
d’Epfora, qui eft très-analogue au précédent, les eaux
minérales legerement purgatives, le favon commun,
ou celui qui eft préparé avec l’huile d’amandes douces
, le mercure fublimé doux, I’éthiops minéral, &c.
Voye£ les maladies du foie, au mot Foie .(fi)
CHOLDICZ, (Géog.) petite ville du royaume
de Bohème, dans le cercle de Churdim.
CHOLÊRA-MORBUS, f. m. (Medecine.) une des
maladies des plus aiguës que l’on connoiffe, à laquelle
notre langue a confervé fon nom grec, formé
de pt/A«', hile, & de %»,fiux.
Définition du cholera-morbus. C ’eft en effet un dégorgement
violent & très-abondant par haut & par
bas, de matières acres, cauftiques, ordinairement
bilieufes, qui continue à différens intervalles voi-
fins Ies uns des autres, & qui fe perpétue rarement
au-delà de deux jours fans emporter le malade.
Ses efpeces. Hippocrate diftingue deux elpeces de
choiera, l’humide & le fec. Le choiera fimple bu fans
épithete, eft l’humide : il provient d’humeurs acri-
monieufes, bilieufes & féreufes, à la formation def-
quelles ont donné lieu la corruption & l’acreté des
alimens. Le choiera fec naît d’un amas d’humeurs acri-
monieufes, accompagnées de vents & de flatuofités
dans l’eftomac ; il rend l’évacuation pénible , foit
par la bouche, foit par l ’anus, à caufe de l’ irritation
lpafmodique des parties nerveufes du ventricule Sc
des intefiins» Nous avons retenu cette bonne diftin-
âion d’Hippocrate.
Sa difiinction d/avec d'autres maladies. Il y a de la
différence entre le choiera & la dyffenterie. On compte
le choiera entre les maladies les plus aiguës, parce
qu’il fe termine ordinairement en peu de jours, au
lieu que la dyffenterie dure beaucoup plus long-tems;
d’ailleurs elle n’eft pas toujours accompagnée de vo-
miffement. La dyffenterie va d’ordinaire avec un te-
nefme incommode &.des felles fanguinolentes, ce
qui eft rare dans le cholera-morbus.
Le choiera ne différé pas moins de la diarrhée bilieu-
fe , quoiqu’elle ait affez les mêmes caufes : toutefois
ces deux maladies font accompagnées de différens
fymptomes, & ne fourniffent point les mêmes pro-
gnoftics. La diarrhée bilieufe n’eft qu’une fimple évacuation
copieufe d’excrémens bilieux par l’anus : le
choiera eft un débord par haut & par bas ; car il y a
dans le choiera une efpece de rétraûion du mouvement
përiftaltique des inteftins, mais plus particulièrement
encore du duodénum & de l’eftomac ; ce qui
donne toûjours lieu au vomiffement.
Ses dijférefUes. Cette efpece de maladie eft pour
l’ordinaire idiopatique, quoiqu’elle fe trouve quelquefois
fymptomatique, comme il arrive, félon Hip-
• p ocra te , Protnot. coac. 123. dans l’elpece de fievre
appellée lipyrie, qui ne fe termine jamais, fi l’on en
croit ce prince de la Medecine, fans qu’il furvienne
un choiera. Le choiera eft encore fymptomatique,félon
Riviere, dans quelques fievres malignes ; félon
Sydenham 2 dans les enfans qui ont de la peine à,