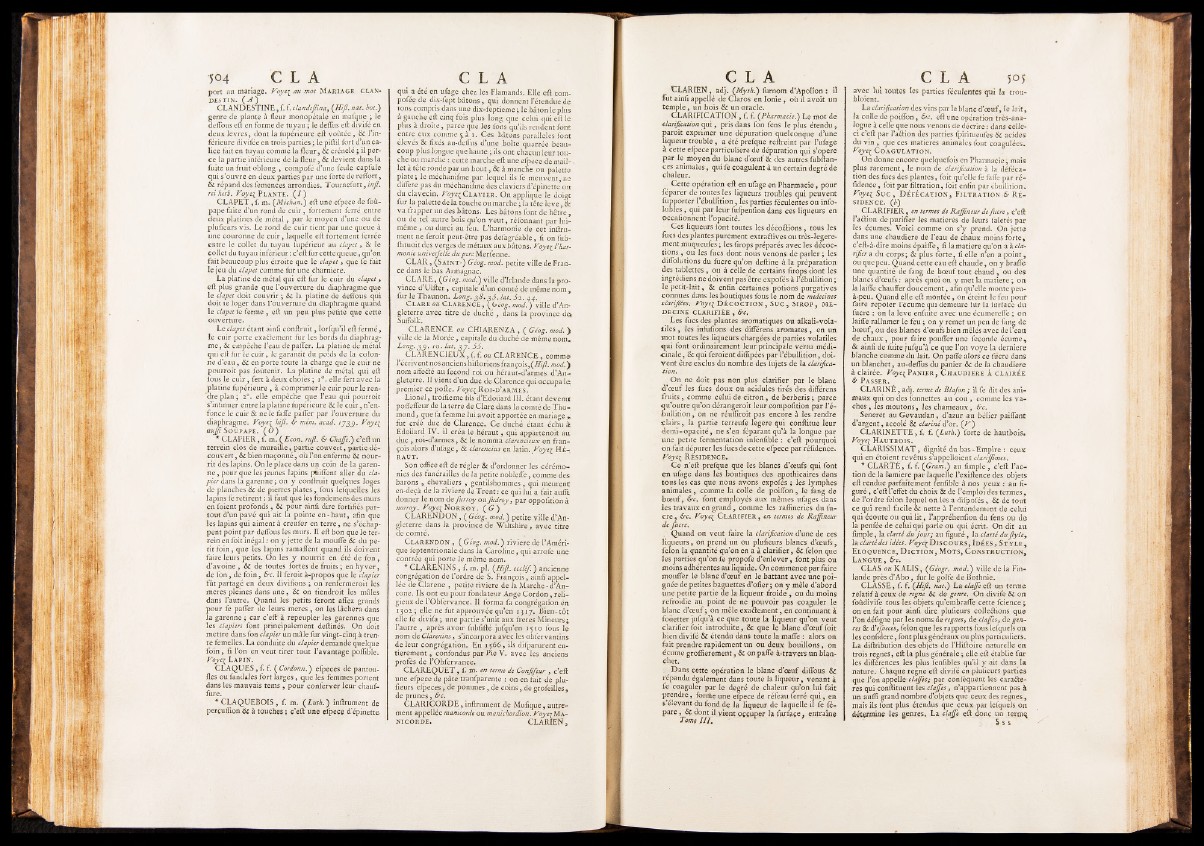
port au mariage. Voye^ au mot MARIAGE cland
e s t i n . { A )
CLANDESTINE, f. f. clandeßina, {Hiß-nat- bot.')
genre de plante à fleur monopétale en mafque ; le
deffous eft en forme de tuyau ; le deffus eft divifé en
deux levres, dont la fupérieure eft voûtée, & l’inférieure
divifée en trois parties ; le piftil fort d’un calice
fait en tuyau comme la fleur, & crénelé ; il perce
la partie inférieure de la fleur, &c devient dans la
fuite un fruit oblong , compofé d’une feule capfule
qui s’ouvre en deux parties par une forte de reffort,
& répand des femences arrondies. Tournefort, inß.
reiherb. Voyt{ Plante. ( / )
C LA PE T , f. m. {Méchan.) eft une efpece de fou-
pape faite d’un rond de cuir, fortement ferré entre
deux platines de métal, par le moyen d’une ou de
plufieurs vis. Le rond de cuir tient par une queue à
une couronne de cuir, laquelle eft fortement ferrée
entre le collet du tuyau füpérieur au clapet, & le
collet du tuyau inférieur : c’eft fur cette queue, qu’on
fait beaucoup plus étroite que le clapet, que fe fait
le jeu du clapet comme fur une charnière.
La platine de métal qui eft fur le cuir du clapet,
eft plus grande que l’ouverture du diaphragme que
le clapet doit couvrir ; & la platine de deffous qui
doit le loger dans l ’ouverture du diaphragmé quand
le clapet le ferme , eft un peu plus petite que cette
ouverture.
Le clapet étant ainfi conftruit, lorfqu’il eft fermé,
le cuir porte exa&ement fur les bords du diaphragme
, & empêche l’eau de paffer. La platine de métal
qui eft fur le cuir, le garantit du poids de la colonne
d’eau, & en porte toute la charge que le cuir ne
pourroit pas foûtenir. La platine de métal qui eft
fous le cuir, fert à deux choies ; i° . elle fert avec la
platine fupérieure , à comprimer le cuir pour le ren-
’dre plan ; 20. elle empêche que l’eau qui pourroit
s’infinuer entre la platine fupérieure & le cuir, n’enfonce
le cuir & ne le faffe paffer par l’ouverture du
diaphragme. Voye7 hiß. & mém. acad. iy$ q. Voye£
uujfiSoupape. (O )
* CLAPIER, f. m. {Ècon. ruß. & Chajfe.) c’eft un
terrein dos de muraille, partie couvert, partie découvert
, & bien maçonné, où l’on enferme & nourrit
des lapins. On le place dans un coin de-la garenne
, pour que les jeunes lapins jrtiiffent aller du clapier
dans la garenne ; on y conftruit quelques loges
de planches & de pierres plates, fous lefquelles les
lapins fe retirent : il faut que les fondemens des murs
en foient profonds , & pour ainli dire fortifiés partout
d’un pavé qui ait la pointe en - haut, afin que
les lapins qui aiment à creufer en terre, ne s’échappent
point par-deffous les murs. Il eft bon que le ter-
rein en foit inégal : on y jette de la moufle & du petit
foin, que les lapins ramaffent quand ils doivent
faire leurs petits. On les y nourrit en été de fon ,
d’avoine , & de toutes fortes de fruits ; en hy v e r ,
de fon, de foin, &c. II feroit à-propos que le clapier
fût partagé en deux divifions ; on renfermerait les
meres pleines dans une, & on tiendrait les mâles
dans l’autre. Quand les petits feront affez grands
pour fe paffer de leurs meres , on les lâchera dans
la garenne ; car c’eft' à repeupler les garennes que
les clapiers font principalement deftinés. On doit
mettre dans fon clapier un mâle fur vingt-cinq à trente
femelles. La conduite du clapier demande quelque
fo in , fi l’on en veut tirer tout l’avantage poflîble.
Voye{ Lapin.
C L A Q U E S ,f .f. ( Cordonn. ) efpeces de pantoufles
oitfandales fort larges, que les femmes portent
dans les mauvais tems , pour conferver leur chauf-
fure.
* CLAQUEBOIS , f. m. ( Luth. ) inftrument de
percuflion & à touches : c’eft une efpece d’épinette
qui a été en ufage chez les Flamands. Elle eft com-
pofée de dix-fept bâtons, qui donnent l’étendue de
tons compris dans une dix-feptieme ; le bâton le plus
à gauche eft cinq fois plus long que celui qui eft le
plus à droite, parce que les fons qu’ils rendent font
entre eux comme 5. à 1. Ces bâtons parallèles font
élevés & fixés au-deffus d’une boîte quarrée beaucoup
plus longue que haute ; ils ont chacun leur touche
ou marche : cette marche eft une efpece de mail- ;
let à tête ronde par un bout, & à manche ou palette
plate; le mechanifme par lequel ils fe meuvent, ne
différé pas du méchanifme des claviers d’épinette ou
du clavecin. Voye^ Clavier. On applique le doigt
fur la palette de la touche ou marche ; la tête lev e, &
va frapper un des bâtons. Les bâtons font de hêtre,
ou de tel autre bois qu’on veu t, réfonnant par lui-
meme , ou durci au feu. L’harmonie de cet infiniment
ne feroit peut-être pas defagréable, fi on fub-
ftituoit des verges de métaux aux bâtons. Voye^ l'harmonie
univerfelle du pare Merfenne.
C L A R , (Saint-) Géog. mod. petite ville de France
dans le bas Armagnac.
CLARE, {Géog. mod.) v ille d’Irlande dans la province
d’Ulfter, capitale d’un comté de même nom,
fur le Thaunon. Long. 38.36. Int. 5 z . 44.
Clare ou Clarence , {Géog. mod.) ville d’Angleterre
avec titre de duché , dans la province de*
Suffolk.
CLARENCE ou CHIARENZA , ( Géog. mod. )
ville de la Morée, capitale du duché de même nom« .
Long.3 $ . 10 . lat. 3 y . 5 6 . ,
j CLARENCIEUX, f. f. ou CLARENCE „comme
l’écrivent nos anciens hiftoriens fran çois, {Hïfi. mod.)
nom affeûe au fécond roi ou héraut-d’armes d’Angleterre.
Il vient d’un duc de Clarence qui occupa le
premier ce pofte. ^oyeçRoi-ü’ARMES.
Lionel, troifieme fils d’Edoiiard III. étant devenu
poffeffeur de la terre de Clare dans la comté de Tho-
mond, que fa femme lui avoit apportée en mariage „
fut créé duc de Clarence. Ce duché étant échu k
Edouard IV. il créa le héraut qui appartenoit au
duc , roi-d’armes, & le nomma clarencieux en fran-
çois alors d’ufage, & clarencius en latin, f^oye^ Héraut.
Son office eft de régler & d’ordonner les cérémonies
des funérailles de la petite nobleffe, comme des
barons , chevaliers , gentilshommes, qui meurent
en-deçà de la riviere de Trent: ce qui lui a fait aufli
donner le nom de Jurroy ou fudroy, par oppofition à
norroy. Voye^ Norr© Y. { G )
CLARENDON, ( Géog. mod.) petite ville d’Angleterre
dans la province de "Wiltshire, avec titre
de comté.
Clarendon , ( Géog. mod. ) riviere de l’Amérique
féptentrionale dans la Caroline, qui arrofe une
contrée qui porte le même nom.
* CLARENINS , f. m. pl. {Hifi. eccléf. ) ancienne
congrégation de l’ordre de S. François, ainfi appel-
lée de Clarene , petite riviere de la Marche-d’An-
cone. Ils ont eu pour fondateur Ange Cordon, religieux
de l’Obfervance. Il forma fa congrégation én
1302 ; elle ne fut approuvée qu’en 1317. Bien-tôt
elle fe divifa ; une partie s’unit aux freres Mineurs ;
l’autre , après avoir fubfifté jufqu’en 1510 fous le
nom de Clarenins , s’incorpora avec les obfervantins
de leur congrégation. En 1566, ils difparurent entièrement
, confondus par Pie V. avec les anciens
profès de l’Obfervance.
CLAREQUE T, f. m. en terme de Confifeur , c’eft
une efpece de pâte tranfparente : on en fait de plufieurs
efpeces, de pommes, de coins, de grofeilles ,
de prunes, &c.
CLARICORDE, inftrument de Mufique, autrement
appellée manicorde ou manichordion. Voye^Ak-
ni corde. CLARIEN,
CLARIEN, adj. (Myth.) furnom d’Apollon : iï
lut ainfi appellé de Claros en Ionie, où il avoit un
temple, un bois & un oracle.
CLARIFICATION, f. f. {Pharmacie.) Le mot de
clarification <jui, pris dans fon fens le plus étendu,
paraît exprimer une dépuration quelconque d’une
liqueur trouble , a été prefque reftreint par l’ufage
à cette efpece particulière de dépuration qui s’opère
par le moyen du blanc doeuf & des autres, fubftan-
çes animales, qui fe coagulent à un certain degré de
chaleur.
Cette opération eft en ufage en Pharmacie, pour
féparer de toutes les liqueurs troubles qui peuvent
fiipporter l’ébullition, les parties féculentes ou info-
lubles, qui par leur fulpenfion dans ces liqueurs en
occafionnent l’opacité.
• Ces liqueurs font toutes les décoftions , tous les
fucs des plantes purement extraûives ou très-legere-
ment muqueufes ; les firops préparés avec les décoctions
, ou les fucs dont nous venons de parler ; les
diffolutions du fucre qu’on deftine à la préparation
des tablettes , ou à celle de certains firops dont les
ingrédiens ne doivent pas être expofés à l’ébullition ;
le petit-lait, & enfin certaines potions purgatives
connues dans les boutiques fous le nom de médecines
clarifiées.. Voye^ DÉCOCTION , Suc, SlROP , M E DECINE
CLARIFIÉE , &C.
Les fucs des plantes aromatiques ou alkali-vola-
t ile s , les infufions des différens aromates, en un
mot toutes les liqueurs chargées de parties volatiles
qui font ordinairement leur principale vertu médicinale
, & qui feroient diffipées par l’ébullition, doivent
être exclus du nombre des fujets de la clarification.
. ■
On ne doit pas non plus clarifier par le blanc
d ’oeuf les fucs doux ou acidulés tirés des différens
fruits, comme celui de citron, de berberis ; parce
qu’outre qu’on dérangeroit leur compofition par l’ébullition
, on ne réulîîroit pas encore à les rendre
clairs, la partie terreufe legere qui conftitue leur
demi-opacité, ne s’en féparant qu’à la longue par
une petite fermentation infenfible : c’eft pourquoi
on fait dépurer les fucs de cette efpece par réfidence.
Voyei R ésidence,
Ce n’eft prelque que les blancs d’oeufs qui font
en ufage dans les boutiques des apothicaires dans
tous les cas que nous avons expofés ; les lymphes
animales, comme la colle de poiffon, le fang de
boeuf, &c, font employés aux mêmes ufages dans
les travaux en grand, comme les raffineries du luc
re , &c. Voye^ C l a r if ie r , en termes de Raffineur
de fucre.
. Quand on veut faire la clarification d’une de ces
liqueurs, on prend un ou plufieurs blancs d’oe ufs,
félon la quantité qu’on en a à clarifier, & . félon que
les parties qu’on fe propofe d’enlever, font plus ou
moins adhérentes au liquide. On commence par faire
mouffer le blanc d’oeuf en le battant avec une poignée
de petites baguettes d’ofier ; on y mêle d’abord
une petite partie de la liqueur froide , ou du moins
refroidie au point de ne pouvoir pas coaguler le
blanc d’oeuf ; on mêle exa&ement, en continuant à
fouetter jufqu’à ce que toute la liqueur qu’on veut
clarifier foit introduite, & que le blanc d’oeuf foit
bien divifé & étendu dans toute la malle : alors on
fait prendre rapidement un ou deux bouillons, on
écume groflierement, & on paffe à-travers un Manchet.
: Dans cette opération le blanc d’oe uf diffous &
répandu également dans toute la liqueur, venant à
fe coaguler par le degré de chaleur qu’on lui fait
prendre, forme une elpece de réfeau ferré q ui, en
s’élevant du fond de la liqueur de laquelle il fe fé-
pa re, Sf dont il vient occuper la furfaçe. entraîne
Tome ///.
aV6c lui toutes les parties féculentes qui la trou-
bloient.
La clarification des vins par le blanc d’oeuf, le lait,
la colle de poiffon, &c. eft une opération très-analogue
à celle que nous venons de décrire : dans celle-
ci c’eft par l’a&ion des parties fpiritueufes & acides
du vin , que ces matières animales font coagulées.
Foyei C o a g u l a t io n .
On donne encore quelquefois en Pharmacie ; mais
plus rarement, le nom de clarification à la défécation
des,fucs des plantes, foit qu’elle fe faffe par réfidence
, foit par filtration, foit enfin par ébullition.
Voyei S u c , D é f é c a t io n , Fil t r At i o n R ésid
en ce. (£)
CLARIFIER, en termes de Raffineur de fucre , c’eft
l’a&ion de purifier les matierés de leurs làletés par
les écumes. Voici comme on s’y prend. On-jette
dans une chaudière de l’eau de chaux moins forte,
c’eft-à-dire moins épaiffe, fi la matière qu’on a à clarifier
a du corps ; & plus forte, fi elle n’en a point,
ou que peu. Quand cette eau eft chaude, on y braffe
une quantité de fang de boeuf tout chaud, ou des
blancs d’oeufs : après quoi on y met la matière ; on
la laiffe chauffer doucement, afin qu’elle monte peu-
à-peu. Quand elle eft montée, on éteint le feu pouf
faire repofer l’écume qui demeure fur la furface du
fucre : on la leve enfuite avec une écumereffe ; on
laiffe rallumer le feu ; on y remet un peu de fang de
boeuf, ou des blancs d’oeufs bien mêlés avec de l’eau
de chaux, pour faire pouffer une féconde écume,
& ainfi de fuite jufqu’à ce que l’on voye la derniere
blanche comme du lait. On paffe alors ce fucre dans
un blanchet, au-deffus du panier & de la chaudière
à clairée. Voye^Pan ier , C haudière 1 clair ée
<5* Passer.
CLARINÊ, adj. terme de Blafon J il fe dit des animaux
qui on des fonnettes au cou , comme les vaches
, les moutons, les chameaux, &c.
Seneret au Gevaudan, d’azur au bélier paiffant
d’argent, accolé & clariné d’or. {V )
CLARINETTE, f, f. {Luth.) forte de hautbois»
Voye{ Hau t bo is .
CLARISSIMAT, dignité du bas •■ Empire i ceux
qui en étoient revêtus s’appelloient clariffimes.
* CLARTÉ, f. f. {Gram.) au fimple , c’eft l’action
de la lumière par laquelle l ’exiftence des objets
eft rendue parfaitement lenfible à nos yeux : au figuré
, c’eft l’effet du choix & de l’emploi des termes,
de l’ordre félon lequel on les a difpofés, & de tout
ce qui rend facile & nette à l’entendement de celui
qui écoute ou qui l i t , l’appréhenfion du fens ou de
la penfée de celui qui parle ou qui écrit. On dit au
fimple, la clarté du jour; au figuré, la clarté du fiyle9
l a clartédesidées. Voye^Dis c o u r s , I d ées, St y l e ,
Eloquence, D ic t io n , Mo t s , C o n stru ct ion ,
L an g u e , & c,
CLAS ou KA LIS, (Géogr. mod.) ville de la Finlande
près d’Ab o, fur le golfe dè Bothnie.
CLASSE, f. f. {Hijl. nat.) La clajfe eft un terme
relatif à ceux de régné & de genre. On divifé & on
foûdivife tous les objets qu’embraffe cette fcience ;
on en fait pour ainfi dire plufieurs colleâions que
l’on défigne par les noms de régnés, de clajfes, de genres
& d'efpeces, félon que les rapports fous lefquels on
les confidere, font plus généraux ou plus particuliers.
La diftribution des objets de l’Hiftoire naturelle en
trois régnés, eft la plus générale ; elle eft établie fur
les différences les plus fenfibles qu’il y ait dans la
nature. Chaque régné eft divifé en plufieurs parties
que l’on appellé clajfes; par conféquent les carafte-
res qui conftituent les clajfes, n’appartiennent pas à
un auflx grand nombre d’objets que ceux des régnés,
mais ils font plus étendus que ceux par lefquels on
détermine les genres. La clajfe eft donc un termq