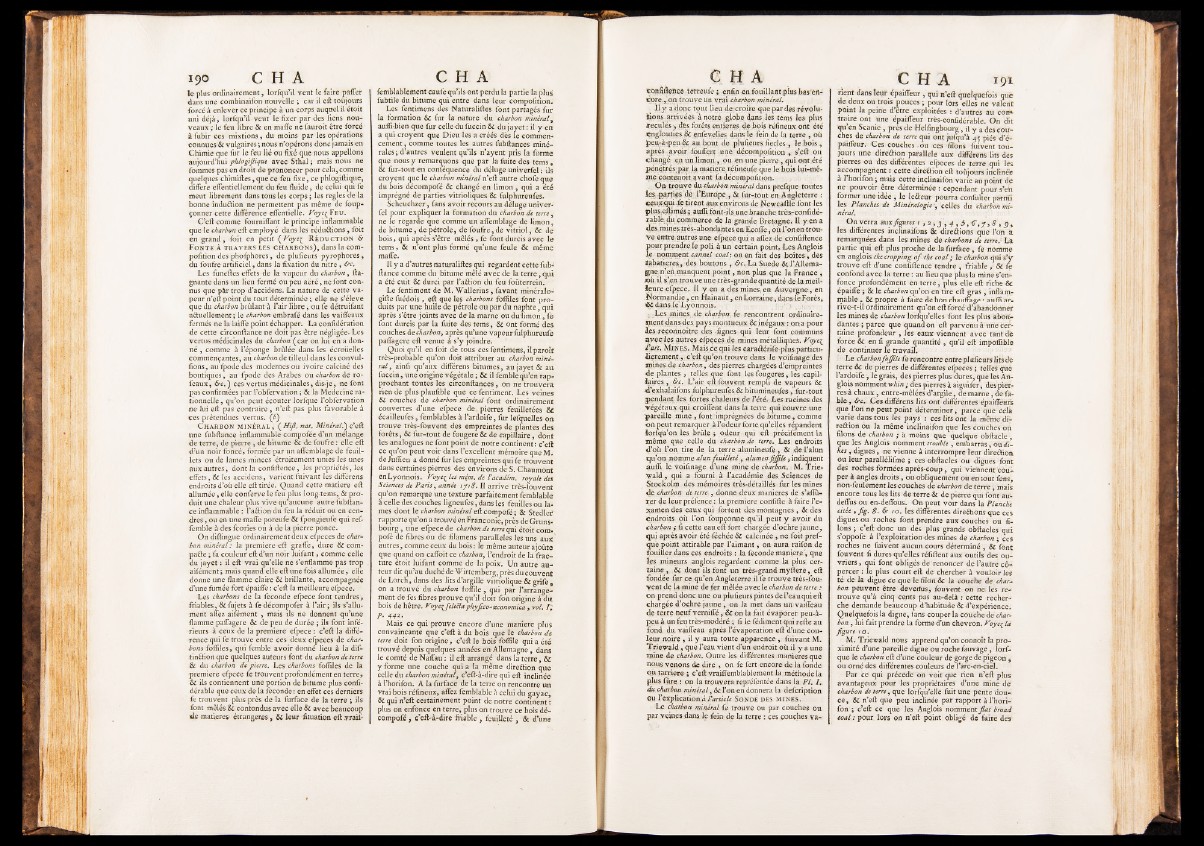
le plus ordinairement, lorfqu’il veut le faire pafler
dans une combinaifon nouvelle ; car il eft-toujours
forcé à enlever ce principe à un corps auquel il étoit
uni déjà, lorfqu’il veut le fixer par des liens nouveaux
, le feu libre & en maffe ne fauroit être forcé
à fubir ces mixtions, du moins par les opérations
connues & vulgaires ; nous n’opérons donc jamais en
Chimie que fur le feu lié ou fixé que nous appelions
aujourd’hui phlogifiique avec Sthal ; mais nous ne
fommes pas en droit de prononcer pour cela, comme
quelques chimiftes, que ce feu fixe, ce phlogiftique,
différé effentiellement du feu fluide, de celui qui fe
meut librement dans tous les corps ; les réglés de la
bonne induction ne permettent pas même de foup-
çonner cette différence effentielle. Voyt{ Feu .
C ’eft comme fburniffant le principe inflammable
que le charbon eft employé dans les réductions, foit
en grand, foit en petit {Voye^ R éd u c t io n &
F onte à travers les ch arbon s) , dans la com-
pofition des phofphores, de plufieurs pyrophores,
du foufre artificiel, dans la fixation du nitre , &c.
Les funéftes effets de la vapeur du charbon, fta-
gnante dans un lieu fermé ou peu aëré, ne font connus
que pàr trop d’accidens. La nature de cette vapeur
n’eft point du tout déterminée ; elle ne s’élève
que du charbon brûlant à l’air libre, ou fe détruifant
aâuellemènt ; le charbonembrafé dans les vaiffeaux
fermés ne la laiffe point échapper. La confidération
de cette circonftance ne doit pas être négligée. Les
vertus médicinales du charbon (car on lui en a donné
, comme à l’éponge brûlée dans les écroiielles
commençantes, au charbon de tilleul dans les convul-
fions, au fpode des modernes ou ivoire calciné des
boutiques, au fpode des Arabes ou charbon dé ro-
feaux, 6*c.) ces vertus médicinales, dis-je, ne font
pas confirmées par l’obfervation ; & la Medecine rationnelle
, qu’on peut écouter lorfque l’obfervation
ne lui eft pas contraire, n’eft pas plus favorable à
ces prétendues vertus, (b')
C harbon minéral , ( Hifi. nat. Minéral.') c’eft
une fubftance inflammable compofëe d’un mélange
de terre, de pierre , de bitume ëc de foufre : elle eft
d?un noir foncé, formée par un aflemblage de feuillets
ou de lamés minces étroitement unies les unes
aux autres, dont la confiftence, les propriétés, les
effets, 8c les accidens, varient fuivant les différens
endroits d’où elle eft tirée. Quand cette matière eft
allumée, elle conferve le feu plus long-tems, & produit
une chaleur plus vive qu’aucune autre fubftance
inflammable : l’a&ion du feu la réduit ou en cendres
, ou en une maffe poreufe 8c fpongieufe qui ref-
femble à des fcories ou à de la pierre ponce.
On diftingue ordinairement deux ef j)eces de charbon
minéral : la première eft grade, dure & comp
a re ; fa couleur eft d’un noir luifant, comme celle
du jayet : il eft vrai qu’elle ne s’enflamme pas trop
aifément; mais quand elle eft une fois allumée, elle
donne une flamme claire 6c brillante, accompagnée
d’une fumée fort épaiffe : c’eft la meilleure efpece.
Les charbons de la fécondé efpece font tendres,
friables, 8c fujets à fe décompofer à l’air; ils s’allument
affez aifément , mais ils ne donnent qu’une
flamme paffagere 8c de peu de durée ; ils font inférieurs
à ceux de la première efpece : c’eft la différence
qui fe trouve entre ces deux efpeces de charbons
fofliles, qui femble avoir donné lieu à la dif-
tinftion que quelques auteurs font du charbon de terre
& du charbon de pierre. Les charbons fofliles de la
première efpece fe trouvent profondément en terre,
& ils contiennent une portion de bitume plus confi-
dérable que ceux de la fécondé : en effet ces derniers
fe trouvent plus près de la furface de la terre ; ils
font mêlés 8c confondus avec elle 8c avec beaucoup
de matières- étrangères, 8c leur fituation eft vrailfemblablement
caufe qu’ils ont perdu la partie la plus
fubtile du bitume qui entre dans leur compofition.
Les fentimens des Naturaliftes font partagés fur
la formation 6c fur la nature du charbon minéral_
aufli-bien que fur celle du fuccin 8c du jayet : il y en
a qui croyent que Dieu les a créés dès le comment
cernent, comme toutes les autres fubftances minérales;
d’autres veulent qu’ils n’ayent pris la forme
que nous y remarquons que par la fuite des tems ,
8c fur-tout en conféquence du déluge univerfel : ils
croyent que le charbon minéral n’eft autre chofe que
du bois décompofé 6c changé en limon, qui a été
imprégné de parties vitrioliques 8c fulphureufes.
Scheuchzer, fans avoir recours au déluge univerfel
pour expliquer la formation du charbon de terre,
ne le regarde que comme un aflemblage de limon,
de bitume, de pétrole, de foufre,de vitriol, 6c de
bois, qui après s’être mêlés, fe font durcis avec le
tems, & n’ont plus formé qu’une feule 6c même
maffe.
Il y a d’autres naturaliftes qui regardent cette fubftance
comme du bitume mêlé avec de la terre, qui
a été cuit 6c durci par l’aftion du feu foûterrein.
Le fentiment de M. "Wallerius, favant minéralo-
gifte fuédois , eft que les charbons fofliles font produits
par une huile de pétrole ou par du naphte, qui
après s’être joints avec de la marne ou duîimon, fô
font durcis par la fuite des tems , 6c ont formé des
couches de charbon, après qu’une Vapeur fulphureufe
paffagere eft venue à s’y joindre.
Quoi qu’il en foit .de tous ces fefitirtietfs, il paroît
très-probable qu’on doit attribuer au charbon minéral,
ainfi qu’aux différens bitumes, au jayet 8c au
fuccin, une origine végétale ; 6c il femble qu’en rapprochant
toutes les circonftances, on ne trouvera
rien de plus plaufible que ce fentiment. Les veines
6c couches ae charbon minéral font ordinairement
couvertes d’une efpece de. pierres feuilletées èC
écailleufes, femblables à l’ardoife, fur lefquelles on
trouve très-fouvent des empreintes de plantes des
forêts, 6c fur-tout de fougere6c de capillaire, dont
les analogues ne font point de notre continent : c’eft:
ce qu’on peut voir dans l’excellent mémoire que M*
de Juflîeu a donné fur les empreintes qui fe trouvent
dans certaines pierres des environs de S. Chaumont
enLyonnois. Voye^ les mém. de Facadèm. royale des
Sciences de Paris, année i j i8 . Il arrive très-fouvent
qu’on remarque une texture parfaitement femblable
à celle des couches ligneufes, dans les feuilles ou lames
dont le charbon minéral eft compofé ; 8c Stedlef
rapporte qu’on a trouvé en Franconie, près de Gruns-
bourg, une efpece de charbon de terre qui étoit compofé
de fibres ou de filamens parallèles les uns aux
autres, comme ceux du bois : le même auteur ajoûte
que quand on caffoit ce charbon, l’endroit de la fracture
étoit luifant comme de la poix. Un autre auteur
dit qu’au duché de Virtemberg, près du couvent
de Lorch, dans des lits d’argille vitriolique 6c g rife,
on a trouvé du charbon fofîile, qui par l’arrangement
de fes fibres prouve qu’il doit fon origine à du
bois de hêtre. Voye^feleclaphyjico-ceconomica , vol. ƒ.
p. 442.
Mais ce qui prouve encore d’une maniéré plus
convaincante que c’eft à du bois que le charbon de
terre doit fon origine , c’eft le bois fofîile qui a été
trouvé depuis quelques années en Allemagne, dans
le comté de Naffau : il eft arrangé dans la terre 6c
y forme une couche qui a la même dire&ion que
celle du charbon minéral, c’eft-à-dire qui eft inclinée
à l’horifon. A la furface de la terre on rencontre un
vrai bois réfineux, affez femblable à celui du gayac,
6c qui n’eft certainement point de notre continent :
plus on enfonce en terre, plus on trouve ce bois décompofé
, ç’eft'à-dire friable , feuilleté , 6c d’une
tonfifteftce terreufe ; enfin en fouillait plus bas’én-
ilfore.^oiï trouve un vr.ai charbon minéral.
I l y a .donc tout lieu de[croire que par des révolutions
arrivées à notre globe 4ans les tems les plus
Reculés > dés forêts, entières 4? bois réfineux ont été
.englouties 6ç çnfeyeUes d,ans le fein de la terre , où
peu-àipeu ôc au bout 4e plufieurs fiecles, le bois ,
après ayoir fouffert i?dè déçompofition, s’eft ou
changé .en un limon,, pu en une pierre, qui ont été
pénçtrés^par la matière réfiuçufe que le bois lui-rfiê-
me contenoitavant fa décomposition. ;
. On trgpve du charbon minéral dans prefque toutes
les. parties de l’Europe , 8t fiir-tout en Angleterre :
ceu,x«pû.fe tirent aux environs de Newcaftle font les
pjus;eifomés; aufli font-ils une branche trèsrconfidé-
rablè. du ,commerce de la grande Bretagne; B y en a
des mine? très-abondantes enÉçofie, où Bon en trouv
e entre.autres une efpece qui a affez de confiftence
pour prendre le poli 4 un certain point. LesAnglois
le nomment c(innel coal: on en fait des boîtes, des
tabatière?, des boutons , (S’c. La Suede 8c l ’Allemagne
n’en manquent point, non plus que la France ,
>©ù il s’em trouve une très-grande quantité dè.la meilleure
efpece. Il y en a des mines en Auvergne, en
Normandie, en Hainaut, en Lorraine , dans leForés,
&i dans .le' Lyonnois.
Les mines de charbon, fe rencontrent ordinairement
dans des pays montiieux 6c inégaux : ona pour
Lesreçonrioître des :fignesqui leur font communs
a v e c ifs. autres efpece,? de mines métalliques. Voye{
Part. Mi^îe?. Mai?.ce qui les earaélérifo-plusiparticu-
lierement, c’eft qu’on trouve dans le voifinage des
mines de^ charbon, des pierres chargées d’empreintes
de plantes , telles que font les fougères , les capillaires,,
&c. L’air eft fouvent rempli de vapeurs 6c
d’exhaiaifonsfulphnreufes 8c bitumineufes fur-tout
pendant les. fortes chaleurs de l’été. Les racines des
végétaux qui croiffent dans la terre qui couvre une
pareille miné, font imprégnées de bitume, comme
on peut remarquer à l’odeur forte, qu’elles répandent
•iorfqu’on les brûle ; odeur qui eft précisément la
même que celle du charbon, de terre. Les endroits
d’où l’on tire de la terre alumineufe, & de l’alun
qu’on nomme alun feuilleté , alumen JiJJile , indiquent
aufli le voifinage d’une mine de charbon. M. Trie-
v a ld , qui a fourni à l’académie des. Sciences de
Stockolm des mémoires très-détaillés fur les mines
de charbon de terre- donne deux maniérés de s’affû-
irer de leur préfence : la première confifte à faire l’examen
des eaux qui fortent d.es montagnes , & des
•endroits où l’on foupçonne qu’il peut y avoir du
charbon ,• fi cette eau eft fort chargée d’ochre jaune,
qui apres avoir été féchée 6c calcinée:, ne. foit pref-
que point attirable par l’aimant, on aura raifon de
fouiller dans ces endroits : la fécondé maniéré/, que
les mineurs anglois regardent comme la plus certaine
, 6c dont ils font un très-grand myfterè, eft
fondée fur ce qu’en Angleterre il fe trouve très-fou-
Vent de la mine de fer mêlée avec le charbon de terre :
on prend donc une ou plufieurs pintes de Beau qui eft
chargée d’ochre jaune , on la met dans un vaiffeau
de terre neuf verniffé, 6c on la fait évaporer peu-à-
peu à un feu très-modéré ; fi le fédiment qui refte au
fond du. vaiffeau après l’évaporation eft d’une cou-
leur noire , il y aura toute ap p a ren c e fü ivan t M.
Triewa ld, que Beau vient d’un endroit où il y a une
mine de ç/iarbon. Outre les différentes maniérés que
nous vepons de dire , on fe fert encore de la fonde
outarriere ; c’eft vraiffemblablement la méthode la
plus fûre : on la trouvera repréfentée dans la PI. I.
du charbon minéral, 6c Ton en donnera la defcription
OU l’explicationàJ'artiele SONDÉ DES MINES.
Le charbon minéral fe trouve ou par couches ou
par vernis dans le fein de la terre : ces couche? va-?
rient dans leur epaiffeur , qui n’eft quelquefois que
de deux ou trois pouces ; pour lors elles ne valent
point la peine d’être exploitées : d’autres au con*-
traire ont une épaiffeur très-confidérable. On dit
qu’en Scanie , près de Helfingbourg -, il y a des couches
de charbon de terre qui ont julqu’à 45 piés d’é-
paiffeur. Ces couches - ou ce? fil’ons fuivent toujours
une direâion parallèle aux différens lits dés
pierres ou des differentes efpeces- de terre qui lés
accompagnent : cette dire&ion eft toûjours inclinée
à 1 horifon ; mais cette inçlinaifon varie au point de
ne pouvoir être déterminée : cependant pour s’eh
former une idée , le lerieur pourra confulter parmi
les Planches de Minéralogie ', celles du charbon mi*
néral.
On verra aux figures 1 , 2 , j , 4 , à , C , y , 8 - ,§ ,
les différentes inclinaifons & diredions que l’on a
remarquées dans les mines de charbons de terre.- La
partie qui eft plus proche de la furface , fe nomme
en anglois the cropping ô f the coal; le charbon qüi s?y
trouve eft d’une confiftence tendre , 'friable , & le
confond avec la terre: au lieu que plus la miné s’enfonce
profondément en terré, plus elle eft riche 6c
épaiffe ; & le charbon qu’on en tire eft gras , inflammable
, 6c propre à faire de bon chauffage : auflî arrive
t-il ordinairement qu’on eft fdrcé d’abandonner
les mines de charbon lorfqu’elles font les plus abondantes
; parce que quand on eft parvenu à une certaine
profondeur , les eaux-viennent avec tant de
force 6c en fi grande quantité , qu’il eft impoflîble
de continuer le travail.
Le charbonfofille fe rencontre entre plufieurs lits dé
terre 6c de pierres dé différentes efpeces ; telles que
l’ardoife, le grais, des pierres plus dures, que les Anglois
nomment whin ; des pierres à aiguil’e r , des pierres
à chaux, entre-mêlées d’argile, de marne, de fable
, &c. Ces différens lits ont différentes épaiffeurs
que l’on ne peut point déterminer, parce que célk
varie dans tous les pays : ces lits ont la même di-
re&ion ou la même inclinaifon que les couches ou
filons de charbon ; à moins que quelque obftacle ,
que les Anglois nomment trouble , embarras, Ôti di-
kes, digues, ne vienne à interrompre leur direcHon
ou leur parallélifme ; ces obftacles ou digues font
des roches formées après-coup, qui viennent coui
per à angles droits , ou obliquement ou en tout féns,
non-feulement les couches de charbon de terre | mais
encore tous les lits de terre 8c de pierre qui font au^-
deffus ou en-deffous. On peut voir dans la Planche
citée , fig. 8. & 10. les différentes directions que ces
digues ou roches font prendre aux couches ou filons
; c’eft donc un des plus grands obftacles qui
s’oppofe à l’exploitation des mines de charbon ; ces
roches ne fuivent aucun cours déterminé , 8c font
fouvent fi dures qu’elles réfiftent aux outils des ouvriers,
qui font obligés de'renoncer de l’autre cô-
percer : le plus court eft de chercher à vouloir les
té de la digue ce que le filon 8c la couche de charbon
peuvent être devenus, fouvent on ne les re-<
trouve qu’à cinq cèpts pas au-delà : cette recher-«
che demande beaucoup d’habitude 8c d’expérience.
Quelquefois la digue, fans couper la couche de charbon
, lui fait prendre la forme d’un chevron. Voye^ là
figure 10.
M. Triewald nous apprend qu’on connoît la proximité
d’une pareille digue ou roche fauvage, lorfque
le charbon eft d’une couleur de gorge de pigeon ,
ou orné des différentes couleurs de l’arc-en-ciel.
Par ce qui précédé ori voit que rien n’eft plus
avantageux pour les propriétaires d’une mine de
charbon de terre, que lorfqu’elle fuit une pente dou-,
c e , 6c n’eft que peu inclinée par rapport à l’hori-
fon ; c’eft ce que les Anglois nomment fiat broad
coal : pour lors on n’eft point obligé de faire des