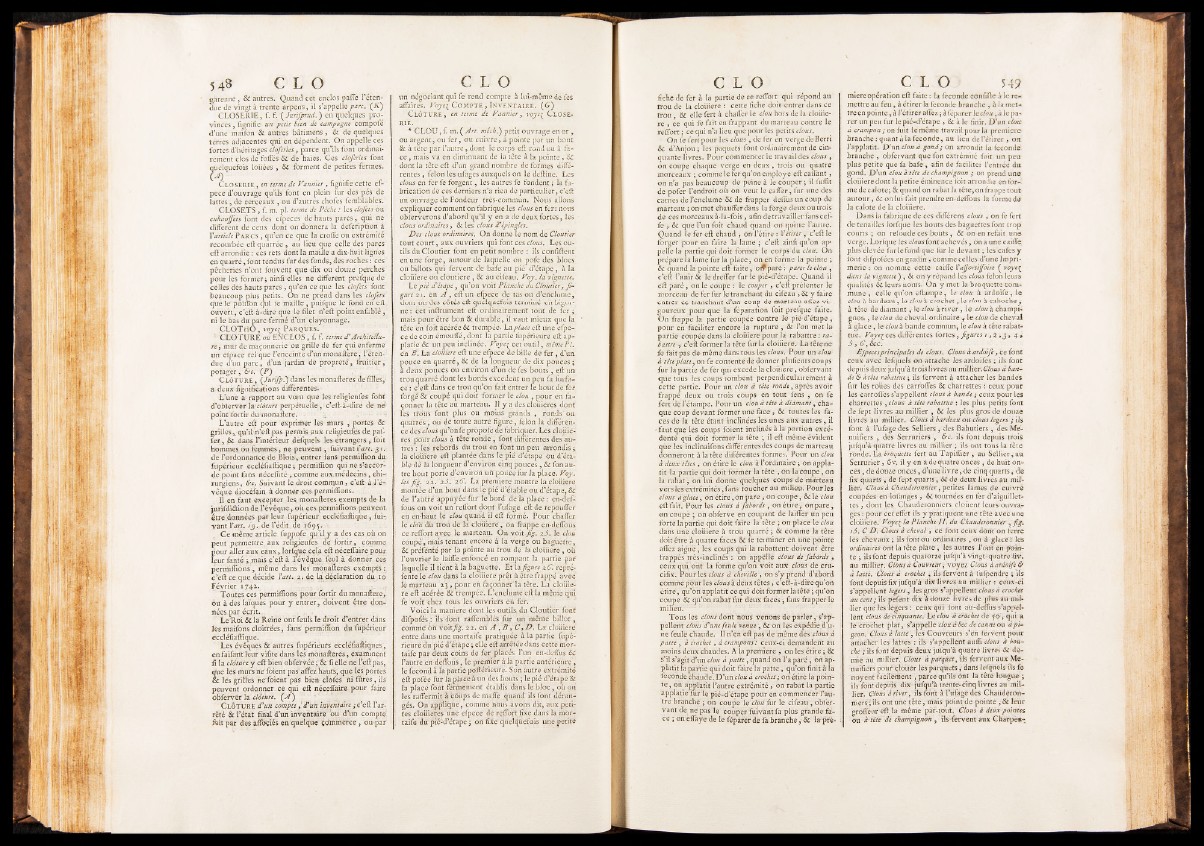
garenne, de autres. Quand cet enclos paffe l’étendue
de vingt à trente arpens, il s’appelle parc. {K)
CLOSER1E , f. f. ( Jurifprud. ) en quelques provinces
, lignifie un petit bien dt campagne cornpole
d’une mail'on & autres bârimens, & de quelques
terres adjacentes qui en dépendent. On appelle ces
fortes d’héritages cLoferies, parce qu’ils font ordinairement
clos de foffés de de haies. Ces cLoferies font
quelquefois loiiées , de forment de petites fermes.
( a ) I B i
C l o s e r ie ^ en terme de Vannier, lignifie cette efpece
d’ouvrage qu’ils font en plein fur des pés de
la tte s, de cerceaux , ou d’autres chofes femblables.
CLOSETS, f. m. pl. terme de Pêche : les clofets bu
cuhaujfets font des elpeces de hauts parcs, qui né
different de ceux dont on donnera la description à
l 'article Parcs , qcr’en ce que la croffe ou extrémité
recourbée eft quarrée , au lieu que celle des parcs
éft arrondie : ces rets dont la maille a dix-huit ligh'es
en quarré, font tendus fur des fonds, des roches : ces
pêcheries n’ont fou vent que dix ou douze perches
pour les former; ainli elles ne different prèfque de
celles des hauts parcs, qu’en ce que les clofets font
beaucoup plus petits. On ne prend dans les clofets
que le poiffon qui f è maille , puifque le' fond en eft.
ouvert, c’eft-à-dire que le filet n’eft point enfablé, ;
ni le bas du parc fermé d’un clayonnage.
C LO TH O , voyez ParqUÉS* '
r CLOTURE ou ENCLOS , f. f. terme d'Architecture)
mur de maçonnerie ou grille de fer qui enferme
un elpace ref que l’enceinte d’nn monaftefe,' l’étendu
e d’un parc, d’un jardin de propreté, fruitier,
potager, &c. (P)
C lôture, Çfurijp.') dansles monafteres de filles/
a deux fignifications différentes;
L ’une a rapport au voeu què lesreligieufes font
d’obferver la1 clôture perpétuelle, : c’eft-à-difé dé ne-'
point fortir du TOonallere. -
L’autre eft pour exprimer les murs , portes de
grilles % qu’i f n’eft pas permis .aux religieufes de paf-
l e f , .& dans l’intérieur défquels les étrangers , foit
hommes ou femmes, ne peuvent.fuivant l’art- 3 1 •
de l’ordonnancé de Blois ». entrer fans permiflion du
fupérieur eccléfiaftique ; permiflion qui né s'accorde
point fans nécefîlté;, comme aux. médecins, ehi--
rurgiens, &e. Suivant le droit commun, q’eft à^l’é-.
vêque diocéfajn à donner çe(s permiflions. ,
Il en faut excepter les; monafteres exempts de la
jurifdi&ion de l’évêque-,.où ces permiflions peuvent
être;;dpùnées par leur fupérieur eccléfiaftique, fuivant
Y art. ic). dé l’édit de 1695* V
Ce même article fuppofe au’il y a des cas où on
peut permettre . aux religieufes dç fortir, comme
pour aller aux eaux, IprCqiie.Cela eft néceffaire po.ur.
leur fanté ; mais p’e.ft à tevèque. feu! à donner ces
permiflions , même dans les1 monafteres exempts
c ’eft ce que.décide l’art.-.sLi f a Ig .déclaration dù^io
Février 1742.
Toutes ces permiflions pour fortir du monaftere,;
ou à des laïques pour y entrer, doivent être données
par écrit.,
Le'Roi & la Reine ont fetils le droit d’entrer dâns
les maifons cloîtfréës, fans" permiflion du fupérieur
eccléfiaftique.
Les évêques & autres fupérieufs eccléfiaftiques ,
enfaifanrleur vifite dans les mohafterés, examinent
il la clotûre y eft bien obfe'rvée ; t e fi elle ne l’eft pas,
que les murs rte'fbïent pas' affez hauts, que les'porteS
d e lés grilles néfbientrpàs bien- ctoféS ni" fures , ils
peuvent ordpnner. ee qui eft néceffaire pour faire
o b fe rv é rla .clotûre. (A }
CLÔTURE d’un compte j d'un inventaire ; c’eft l’af-
rêté & l’étàt final d’un inventaire ou d ’un compte!
feit par des âffbçiés enqueique çtroifreWé, ou-pâf
un négociant qui fe rend compte à lui-même de fes
affaires. Voyez C o m p t e , In v en t air e. (G)
CLÔTURE, en terme de Vanniervbye{ Cl OSE-
RIE.
* C LO U , f. m. ( Art. méch.') petit ouvrage en o r ,
ou argent, ou fer, ou cuivre, à pointe par un bout
& à lête par l’autre, dont le corps eft rond ou à face
, mais va en diminuant de la tête à la pointe , &
dont la tête eft d’un grand nombre de formes différentes
, félon les ufages auxquels on le deftine. Les
clous’ en fer fe forgent, les autres fe fondent ; la fabrication
de ces derniers n’a rien de particulier, c’eft
un ouvrage de Fondeur très-commun. Nous allons
expliquer comment on fabrique les clous én fer: nous
oblcrverons d’abord qu’il y en a de deux fortes, les
clous ordinaires , & les clous a épingles.
Dès clous ordirtaires. On donne le nom de Cloutier
tout court, aux ouvriers qui font ces clous. Lés oii-
tils du Cloutier font en petit nombre : ils confiftent
en une forge, autour de laquelle on pofe des blocs
ou billots qui fervent de bâfe au pié d’étape, à la
cloüiere bu cîoutiere , & au cifeau. Voy, là vignette.
Lépié d’étape y q u ’ o n voit Planche du Cloutier} figure
21. en A , eft un efpece de tas ou d’enclume,
dont un des côtés eft quelquefois terminé en bigorne:
cet inftrument eft ordinairement touf.de fer ;
mais pour être bon & durable, il vaut mieux que la
têt e en foit acérée de trempée. L a place e ft une efpece
de coin émouffé, dont la partie luperieure eft ap-
plafie Se u n peu inclinée. Voyez cet outil, même PL
e'n Ê. La cloüiere eft une efpece de bille de fe r , d’un
pouce en quarré, & de la lpngueur de dix p o u c e s ;
à déiix pouces ou environ d’un dé fes bouts, eft un
t ro u q u a r r é dont les bords excédent un peu fa furfa-
ce : c’eft dans ce trou qu’on fait entrer le bout de fer
forge te coupé qui doit former le clou , pour en façonner
la tête au martéau. Il y a des cloiiiêres dont
fes trÔüS font plus , ou moins grands , ronds"ou
quarrés, ou de toute autre figure, félon la différence
dés'c/owi qu’on fe prôpofe de fabriquer. Les çlôiiiè-
r es pour clous à tête ro ïïd è ', font différentes des autres":
les rebotds du trou en font iiri peu arrondis ;
la clouieré eft plantée dans lé pié d’étape ou d’étable
de lâ longueur d’environ c in q pouces, & fon autre
bout porte .d’envirO'n un pouce fur la place. Voy.
Les f g . 22. 2.5'. 2C. La pfemieré montre la cloüiere
montée d’üri bout dans le pié d’étable ou d’étape, de
dé Taùtrë appuyée'ftifT'ébord de là place: en-def-
fous on voit un reffortdont l’üfâgè eft de repduffer
en en-fiaut lé clou quand il eft formé. Pour chaflcr
le cloii àh trou dê là cldüiérë, on frappe en-deflous
ce reffort avec le marteau. On voit fig. 26. le clou
coupé',! maïs 'tenant encôré à la verge ou baguette,
de préfénté par là pointe au trou d e fa c lo ü ie r e ', où
l’ouvrier le laiffe, enfoncé en rompant la partié par
laquelle il" tient à là baguette. Et'là figure 2 6. représente
le clou dans la cloüi'éfe prêt à être frappé avec
lé martéaii 23 , pour eh fâçônner'Ia tête. La cloiiie-
re etl àceréè de trempée. L’enciume eft la même qui
fe voit chez tous lë^ ouvriers en fer.
Voici la maniéré dont les outils, du Cloutier font"
difpofés :.iis font raffemblés fur un même billot,
commé ôh vôïifig. 22. én A , B , C , D . La cloüiere
entre.dans une mortaife pratiquée à la partie füpé-
rieüré du pié d’étape ; elle eft arrêtée dans cetfë mortaife
par deux coins dé fer placés l’un ën-deflïis de
l’autfë ëmdèffoüs, le prenViér à'iâ partie antérieure,
le fécond â là partié poftëriéufè. Son autre extrémité
eft poféé fur là placé à un dès bouts ; le pié d’étape &
la place fbnt fermement établis dans le bloc, où 911
lés raffermit à'coups de maffe quand ils font dérangés.
On appliquè, comme nous avons dit, aux petites
cloüierës üne efpece de réffdrt fixe dans la mortaife
du pi'ë-d’étape ; on fiie quélqüëfois une petite
fiche de fer à la partie de ce reffort qui répond au
trou de la cloüiere : cette fiche doit entrer dans ce
trou, de elle fert à chaffer le clou hors de la cloüiere
, ce qui fe fait en frappant du marteau contre le
reffort ; ce qui n’a lieu que pour lés petits clous.
On fe fert pour les clous , de fer en verge deBerri
de d’Anjou; les paquets-font ordinairement de cinquante
livres. Pour commencer le travail des clous ,
on coupe chaque verge en deux, trois ou quatre
morceaux ; comme le fer q u ’o n employé efteaffant,
on n’a pas beaucoup de peine à le couper ; il fuffit
de peffer l’endroit Où on vèut le cafler, fur une des
carnes de l’enclume de dé frapper déffus un coup de
marteau ; on met chauffer dans la forge deux ou trois
de ces morceaux à-la-fois, afin de travailler fans cef-
fe , de que l’un foit chaud quand oh* quitte l’autre.
Quànd le fer-eft ch a u d > on l’étire : Y étirer -,; c’eft le
forger pour en faire la lamé ; c’eft airifi qu’on appelle
la- partie qui doit former le cofp'S-du clou. On
prépare la lame fur la place -, on en forme la pointe ;
de quand la pointe eft faite, oi^pare': pdrer le clou ,
c’eft l’unir & le dréffer fur le pié-d’étape. Quand il
eft paré, onle coupe : le couper , c’êft-prélenter le
morceau de ferfiir le tranchant du cifeau, & y faire
entrer ce tranchant d?un coup de marteau aflèz vigoureux
pour que la féparation foit prefque faite.
On frappe la partie coupée contre le pié^d’étape,
pour en faciliter encore la rüpture, & l’on met la
partie coupée dans la cloüiére pour lâ rabattré : rabattre
j- c’ëft former la tête fur la cloüiere. La tête ne
fe fait pas de-même dans tous lés clous. P o u r tin clou
à tête plate, on fe contentë de donner plufieürs coups
fur la partie de fer qui excede la cloüiere ; obfervant
que tous les Coups tombent perpendiculairement à
cette partie. Pour un clou à tête ronde, après avoir
frappé deux ou trois éôups en tout fens , on fe
fert dé l’étampe. Pour un clou à tête à diamant, chaque
coup devant former une face , de toutes les faces
de la tête étant inclinées les unes aux autres, il
- faut que lés coups fbient inclinés à la portion excé-
denté qui doit former la tête ; il eft même évident
que les inclinàifons différentes dès coups de marteau
donneront à la tête différentes formes. Pouf" un clou
à deux têtes, on étire le chu à l’ordinaire ; on appla-
tit la partie qui dôitformér la tête-, on la coupe1,.on
la rabat ; ôri lui donne quelques coups de mafrteati
vers le^extrémités, fans loucher au milieu. Pour les
clous à glace, on étiré, on pàre, on coupe, de lé clou
eft fait. Pour les clous à f abords, on étire, onpare,
on coupé ; ôn obferve en coupant de laiffef Un peu
forte la partie qui doit faire la tête ; on placé le clou
dans une cloüiere à trOu quarré ; & comme la tête
doit être à quatre faces & le terminer en une pointe
affez aiguë, les coups qui lâ rabattent doivent être
frappés très-inclinés':- on app’éîlë clous de fabords ,
ceux qui oiit la forme qu’on voit aux clous de crucifix.
Pour leè clous a cheville , on s’y pf end d’abord
comme pour les cldus à deux têtes, c’eft-à-dîre qu’on
étiré, qu’brt applatit ce-qui doit former la tête ; qu’on
coupe & qù’on rabat1 fur deux faces ; fans frapper lé
milieu.
Tous les clous dont hOUs venbns de parler, s’appellent
doits d'une feule venue\ de ôn; lés é ipé’diè d’une
feulé chaude. Il n’en eft pas de même dés clous à
patte , à èrdàhet, à cràtnpotis : cèux-ci demandeiït aù
moins deux chaudes. À la première , on les étire de
s’il s’agit d’ un clou à patte, qaand Ôn l’a paré -, ôrTàp1-
platit la partie, qui doit faire la patte , qu’oh finit à là
fécondé chaude. D ’un clou a crockti; oriétifè la pointe
, on appiatît l’autre extrémité, on rabat là partie
aPP^a.tTe fur le pié-d’étape pour en commencer l’àü-
tre branché ; on coupe \é'clou fwx le cifeau , obféf-
vant dé ne pas le çoupçr fuivant fa plus grande face
; on eflaye de le fépâref de fa branche, de la prémîere
opération eft faite : la fécondé eonfifte à le remettre
au feu , à étirer la fécondé branche , à la mettre
en pointe, à l’étirer affez ; à féparer le clou, à le parer
un peu fur le pié-d’étape , de à le finir. D ’un clou
à crampon ; on fuit le même travail pour la première'
branche: quant à la fécondé, au lieu de l’étirer , on
l’applatit. D ’un clou à.gond; on arrondit la fécondé,
branche , obfervant que fon extrémité foit un peu
plus petite que fa bafe , afin de faciliter l’entréè du
gônd. D ’un clouà tête dt champignon ; on prend une
cloüiere dont la petite éminence foit arrondie en forme
de caiote; & quand on rabat la tête, on frappe tout
autour, de on lui fait prendre en-deffous la forme de
la calote de là cloüiere.
Dans la fabrique de ces différens clous on fe fert
de tenailles lorfque les bouts des baguettes font trop
courts ; on refonde ces bouts, & on en refait une
verge. Lorfque les clous font achevés, cm a une caiffe
plus élevée fur le fond-que fur le devant ; les cafés y
ibnt difpofées en gradin , comme celles d’une Imprimerie:'
on nomme nette ■ caille Yaffortijfoire (f voye^
dans la vignette ) , & on ÿ'fépand les clous félon leurs
qualités de leurs noms. Oh y met la broquette commune,
celle qu’on eftampe, le clou à ardoife, le
clou à bardeau, le clou à crochet, le clou à caboche ,
à tête de diamant, lé clou à river-, le clou à champignon
, 1 d clou de cheval.ordinaire Xq cIou Aq cheval
à glace, \e'clôu à bande commun, le clou à tête rabattue.
Voye% ces différentes fortes, figures 1 , 2 53, 4 »
5<g S , S e c .
Ejpecesprincipales de clous. Clous â ardoife, ce font
ceux avec lefquels on -attache les ardoifes ; ils font
depuis deux jufqu’à trois livres au millier. Clous à bande
& à tête rabattue \ ils fervent à attacher les bandés
fur les roues des carfoffes de charrettes^ ceux pour
les carroffës s’appellent clous à bande ; ceux pour les
charrettes y clous- à tête rabattue : les plus petits font
de fept livres au millier , de les plus gros de douze
livrés au millier. Clous à bardeau ou clous légers ; ils
font à l’ufage des Selliers , des Bahutiers , des Mé-
nuifiers , dés Serruriers , &c. ils font depuis trois
jufqifà quatre livres au-millier ; ils ont tous la tête
ronde. La brbquette fert au Tapiflier , au Sellier,au
Serruriet, &c. il y en a de quatre onces , de huit once
s , de douze onces, d’une livré jde cinq quarts, de
fix quarts y dé fept quarts, '& de deux livres au millier;
Clous à Chauderonnier, petites lames de cuivré
coupées- en-lofanges , & tournées en fer d’aiguillettes
, dont les Chauderonniers cloiient leurs ouvra,-
ges : pour c-et effet ils y pratiquent une tête avec une
cXoYûétè. Voyez la Plarickc 11. Chauderonnier , fig.
i5. C D . Chus à cheval 3 ce font ceux dont on ferre
les chevaux ;• ils font ou ordinaires , ôù à glace : les
ordinairés-àritla tête pfârë , les autres l’ont en pointe
; ils font depuis quatorze jufqu’à vingt-quatre Jiv.
au millier. Clôùsà Couvreur, yoyëz Clous àatdàife &
d latte. Chies à crochet j ils-fervent à fnfjberidre ; ils
font depuisfiX jufqu’à dix lïvres;àu milliér-:: ceux-ci
s’appèlîenf légers, les grôS Rappellent t/oaj à crochpt
au cent; ils pèfént dix à douze livres de plus du'millier
que les légers : cèUx qiii' font àü-defllis s’appellent
clous de cinquante. Le clou à crochet dé ^ô’; qui: a
lé crochet plat, s’appelle cloüabec de canne ou à pigeon.
Clotis d làitè'y îes Gôùvretirs-s’ën fervent polir
attacher lés lattés : ils s’appellent àufli c/0«5 à bouche
/ils font depuis deux jiifqù’à quatrè livrés-& dë-
mié au millier.. Clous à parquée, ils fervent auX Mè-
nuifiérS poùi1 clôiiér lès parquets , dans lefquelsîls fe
noyent Fàcilëifiènt, parce qit’ils ont la tête longue ;
ils1 fbnt clëpuis dix jufqu’à trente-cinq livres àu millier.
Clous 'à river, ils font à l’iifage des Chauderort-
niers ; ils ont une tête, mais point de pointé , & leur
groffèùr eft. la même pàf-totii.; Clous à deux pointes
Ou à-tête- de champignon , ils-fervent aux C harpes-,
!