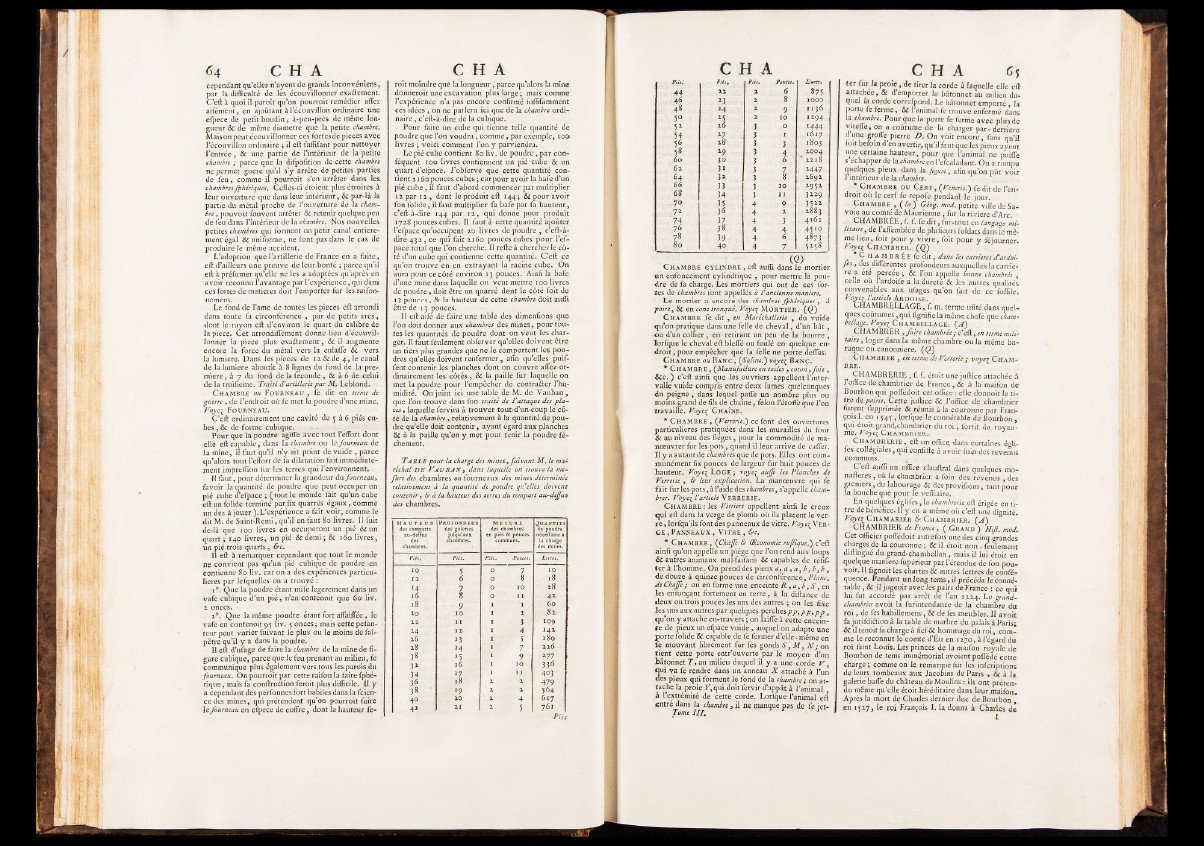
/ ;
cependant qu’elles n’ayent de grands inconvéniens,
par la difficulté de les écouvillonner exa&ement.
C ’eft à quoi il paroît qu’on pourroit remédier affez
aifément, en ajoutant à l’écouvillon ordinaire une
efpece de petit boudin, à-peu-près de même longueur
& de même diamètre que la petite chambre.
Mais on peut écouvillonner ces fortesde pièces avec
l ’écouvillon ordinaire ; il eft fuffifant pour nettoyer
l’entrée , & une partie de l’intérieur de la petite
chambre ; parce que la difpofition de cette chambre
ne permet guere qu’il s’y arrête de petites parties
de feu , comme il pourroit s’en arrêter dans les
chambres fphériqùes. Celles-ci étaient plus étroites à
leur ouverture que dans leur intérieur, & par-là la
partie du métal proche de l’ouverture de la chambre
y pouvoit fouvent arrêter & retenir quelque peu
de feu dans l’intérieur de la chambre. Nos nouvelles
petites chambres qui forment un petir canal entièrement
égal & uniforme, ne font pas dans le cas de
produire le même accident.
L’adoption que l’artillerie de France en a faite,
eft d’ailleurs une preuve de leur bonté ; parce qu’il
eft à préfumer qu’elle ne les a adoptées qu’après en
avoir reconnu l’avantage par l ’expérience, qui dans
ces fortes de matières doit l’emporter fur les raifon-
nemens.
Le fond de l’ame de toutes les pièces eft arrondi
dans toute fa circonférence , par de petits arcs,
dont le rayon eft d’environ le quart du calibre de
la piece. Cet arrondiffement donne lieu d’écouvil-
-lonner la piece plus exaûement, & il augmente
encore la force du métal vers la culalfe & vers
la lumière. Dans les pièces de 12 & de 4 , le canal
de la lumière aboutit à 8 lignes du fond de la première
, à 7 du fond de la fécondé , & à 6 de. celui
de la troifieme. Traité £ artillerie par M . Leblond. ;
C hambre ou Fourneau , le dit en terme de
guerre, de l’endroit où fe met la poudre d’une mine.
Voye^ Fourneau.
C ’eft ordinairement une cavité de 5 à 6 piés cubes
, & de forme cubique. . . .
Pour que la poudre agiffe avec tout l’effort dont
elle eft capable, dans la chambre ou le fourneau de
lamine, il faut qu’il n’y ait point de vuid e, parce
qu’alors tout l’effort de la dilatation fait immédiatement
impreffion fur les terres qui l ’environnent; .
Il faut, pour déterminer la grandeur dxx fourneau,
favoir la quantité de poudre que peut occuper un
pié cube d’efpace ; (tout le monde fait qu’un cube
eft un folide terminé par fix quarrés égaux, comme
un dez à jouer ) . L’expérience a fait voir, comme.le
dit M. de Saint-Remi, qu’il en faut 80 livres. Il fuit
de-là que 100 livres en occuperont un pié & u n
quart • 140 livres, un pié & d em i; & 160 livres,
un pié trois quarts, &c.
Il eft à remarquer cependant que tout le monde
ne convient pas qu’un pié cubique de poudre en
contienne 80 liv. car on a des expériences particulières
par lefquelles on a trouvé :
i°. Que la poudre étant mife legerement dans un
vafe cubique d’un p ié , n’en contenoit que 60 liv.
2 onces.
z ° . Que la même poudre étant fort affaiffée, le
vafe en contenoit 95 liv. 5 onces ; mais cette pefan-
teur peut varier fuivant le plus ou le moins de fal-
pêtre qu’il y a dans la poudre.
Il eft d’ufage de faire la chambre de la mine de figure
cubique, parce que le feu prenant au milieu, fe
communique plus également vers tous les parois du
fourneau. On pourroit par cette raifon la faire fphé-
rique, mais fa conftru&ion feroit plus difficile. Il y
a cependant des perfonnes fort habiles dans la feien-
cedes mines, qui prétendent qu’on pourroit faire
le fourneau en efpece de coffre, dont îa hauteur feroit
moindre que la longueur, parce qu’alors la mine
donneroit une excavation plus large ; mais comme
l’expérience n’a pas encore confirmé fuffifamment
ces idées , on ne parlera ici que de la chambre ordinaire
, c’eft-à-dire de la cubique.
Pour faire un cube qui tienne telle quantité de
poudre que l’on voudra, comme, par exemple, 100
livres ; voici comment l’on y parviendra.
Le pié cube contient 80 liv. de poudre, par con-
féquent 100 livres contiennent un pié cube & un
quart d’efpace. J’obferve que cette quantité contient
2160 pouces cubes ; car pour avoir labafe d’un
pié cube, il faut d’abord commencer par multiplier
12 par 1 2 , dont le produit eft 144 ; & pour avoir
fon folide, il faut multiplier fa bafe par fa hauteur,
c’eft-à-dire 144 par 12 , qui donne pour produit
1728 pouces cubes. Il faut à cette quantité ajouter
l’efpace qu’occupent 20 livres de poudre , c’eft-à-
dire 432, ce qui fait 2160 pouces cubes pour l’efpace
total que l’on cherche. Il refte à chercher le côté
d’un cube qui contienne cette quantité. C ’eft ce
qu’on trouve en en extrayant la racine cube. On
aura pour ce côté environ 13 pouces. Ainfi la bafe
d’une mine dans laquelle on veut mettre 100 livres
de poudre, doit être un quarré dont le côté foit de
13 pouces, & la hauteur de cette chambre doit auffi
être de 13 pouces.
Il eft aifé de faire une table des dimenfions que
l’on doit donner aux chambres des mines, pour toutes
les quantités de poudre dont on veut les charger.
Il faut feulement obferver qu’elles doivent être
un tiers plus grandes que ne le comportent les poudres
qu’elles doivent renfermer, afin qu’elles p u it
fent contenir les planches dont on couvre affez ordinairement
les côtés , & la paille fur laquelle on
met la poudre pour l’empêcher de eontrafter l’humidité.
On joint ici une table de M. de Vauban ,
que l’on trouve dans fon traité de l'attaque des places,
laquelle fervira à trouver tout-d’un-coup le côté
de la chambre, relativement à la quantité de poudre
qu’elle doit contenir, ayant égard aux planches
& à la paille qu’on y met pour tenir fa poudre fé-
chement.
T a b l e pour la charge des mines, fuivant M . le maréchal
DE VAU B AN , dans laquelle on trouve la me-
fure des chambres ou fourneaux des mines déterminée
relativement à la quantité de poudre qu'elles doivent
contenir , & à la hauteur des terres du rempart au-dejfus
des chambres.
Ha u t eu r
^u-de&us *
des
chambres.
Profondeur
des galeries
julqu’aux
chambres.
des chambres
en piés & pouces
communs.
de poudre
des mines.
PiésY ' Piés. Piés. . Pouces. Livres.
IO 5 O 7 JO
12 6 0 8 18
H 7 O IO 28
l6 8 O II 42
l8 9 I I 60
20 10 I 2 82
22 i i I 3 IO9
24 12 I 4 I42
2Ó 13 i 5 l8o
18 14 i 7 22Ó
38 *5 1 9 277
32 16 1 10 336
34 8 17 1 11 403
36 18 2 2 479
38 • B 2 2 564
401 20 2 4 ■ 617
42 21 2 5 761
Piés
î Piés: ■ Piés. y Piés. Pouces. Livres.
4 4 22 2 6 875
46 23 2 8 IOOO
48 24 2 9 II36 1
5° 2 5 2 10 I294
5Z 26 3 0 1444
54 2 7 3 1 1617
1 56 *8 3 3 . 1803
58 29 3 4 2OO4 1
6 0 30 3 6 ; 22i 8
6 2 31 3 7 , 2447 I
6 4 31 3 8 2692
6 6 33 3 IO . 29 5 2 :
68 34 3 II 3229
• ,-7 ° 35 4 0 3511
1 7 2 36 4 2 2883
74 37 1 4 3 4 l 6 l
.76 38 4 4 45IO;
. ; 78 . 3 9 . 4 6 4873 '
80 .4 0 . 4 7 5m 8
C hambre cy lin d re , eft auffi dans le mortier
un enfoncement cylindrique , pour mëttre la poudre
de fa charge. Les mortiers qui ont de ces fortes
de chambres font appellés à l'ancienne maniéré.
Le mortier a encore dés chambres fphériqùes, à
poire y & en cône tronqué. Voye^ Mo r t ie r . (Q)
C hambre le d i t , en Maréchallerie ,. du vuide
qu’on pratique dans une felle de cheval-, d’un b â t ,
ou d’un collier, en retirant un peu de la bourre ,
lorfque le cheval eft bleffé ou foulé en quelque endroit
, pour empêcher que la felle ne porte deffus.
C hambre ou Banc , (Saline.) voye^ Ba n c .
* C h am b r e , (Manufacture en toiles , coton, foie ,
& c . ) c’eft ainfi que les ouvriers appellent l’intervalle
vuide compris entre deux lames quelconques
du peigne, dans lequel paffe un nombre plus ou
moins grand de fils de chaîne, félon l’étoffe que Fon
travaille. Voyeç C haîne.
* C h am b r e , (Verreriece font des ouvertures
particulières pratiquées dans les murailles du four
& au niveau des fiéges, pour la commodité de manoeuvrer
fur les pots, quand il leur arrive de cafi'er.
Il y a autant de chambres que de pots. Elles ont communément
fix pouces de largeur fur huit pouces de
hauteur. Voyeç L oge ; voye^ aufji les Planches de
Verrerie , & leur explication. La manoeuvre qui fe
fait fur les pots, à l’aide des chambres, s’appelle chambrer.
Voyei l'article VERRERIE.
C hambre : les Vitriers appellent ainfi le creux
qui eft dans la verge de plomb où ils placent le verre
, lorfqu’ils font des panneaux de vitre. Voye£ V erg
e , Panneaux , V itre , &c.
* C hambre , ( Chajfe & (Economie ruflique.) c’eft
ainfi qu’on appelle un piège que l’on tend aux loups
& autres animaux mal-faifans & capables de rélifter
à l’homme. On prend des pieux a ,a ,a yb y b ,b y
de douze à quinze pouces de circonférence, Plane,
de Chajfe ; on en forme une enceinte R ,a ,b y S en
les enfonçant fortement en terre, à la diftance de
deux ou trois pouces les uns des autres ; on les fixe
les uns aux autres par quelques perches p p ,p p ,p p ,
qu’on y attache en-travers ; on laiffe à cette enceinte
de pieux un efpace vuide, auquel on adapte une
porte folide & capable dp fe fermer d’elle- même en
îe mouvant librement fur fes gonds S , M , N ; on
tient cette porte entr’ouverte par le moyen d’un
bâtonnet T , au milieu duquel il y a une corde V
qui va fe rendre dans un anneau X attaché à l’un
des pieux qui forment, le fond de la chambre ; on attache
la proie Y, qui doit l'ervir d’appât à l’animal
à l’extrémité de cette corde. Lorfque l’animal eft
entré dans la chambre 3 il ne manque pas de fe jet-
Tàmt ITT J
ter fur la p roie, de tirer la corde à laquelle elle eft
attachée, & d’emporter le bâtonnet au milieu duquel
la corde correfpond. Le bâtonnet emporté , la
porte fe ferme, & 1 animal fe trouve enfermé dans
la.chambre. Pour que la porte fe ferme avec plus de
viteffe, on a coutume de la charger par-derrière
d’une groffe pierre D . On voit encore, fans qu’il
foit befoin d’en a vertir, qu’il faut que les pieux ayent
une certaine hauteur, pour que l’animal, ne puiffe
s échapper de la chambre en l’efcaladant. On a rompu
quelques pieux dans la figure, afin qu’on pût voir
1 intérieur de la chambre.
* C h ambre du C erf , ( Venerie.) fe dit de I’en-
droit où le cerf fe repofe pendant le. jour. :
C hambre , ( la j Géog. mod. petite ville de Savoie
au comté de Maurienne, fur la riviere d’Arc.
CHAMBRÉE, f. f. fe .dit, fur-.tput en langage militaire,
de l ’affemblée de plusieurs foldats dans le mê-
me lieu, foit pour y v iv re , foit pour y féjourner.
^°y% C h ambrer. (Q)
* C HAMBREE fe.-dit, dans les carrières cTardoi-
fes,, des différentes profondeurs auxquelles la carrière
a été percée:; & d’on appelle bonne chambrée ,
celles où l’ardoife a la:dureté & les autres qualités
convenables aux ufages qu’on fait de ce. foffile.
V?ye^ l'article Ard o ise.
CHAMBRELLAGE, f. m. terme ufité dans quelques
coutumes , qui lignifie la même chofe que cham-
bcllagc, Voyer^ CHAMBELLAGE. (A ) . ,•
CHAMBRER , faire chambrée ; c’eft, en terme militaire
, loger dans la même chambre .ou la même baraque
ou canonnière, (Q )
- C hambrer , en terme de Verrerie j voyez C h AMBRE.
CHAMBRERIE , f . f. étoit une juftice attachée à
l’office de chambrier de France, & à la maifon de
Bourbon qui poffédoit cet office : elle donnoit le titre
dç pairie. Cette juftice & . l’office de chambrier
furent fiipprimés & réunis à la couronne par François
I. en 1545, forfque te connétable de Bourbon ,
qui étoit grand,chambrier du r o i, fortit du royaume.
Voyt[ C h am br ier ,'
C h am b r e r ie , eft un office dans certaines égli-
f o collégiales, .qui ,co.nfifte à avoir foin des revenus
communs.
C ’eft: auffi un office clauftral dans quelques mo-
nafteres, ou le chambrier a foin- des revenus des
greniers, du labourage & des provifions, tant pour
la bouche que pour le veftiaire.
En quelques églifes, la chambrerie eft érigée en titre
de bénéfice. Il y en a même où c’eft une dignité.
Ybyei C hamarier & C hambrier. (A )
CHAMBRIER de France, ( G rand ) Hijl. mod.
Cet officier poffédoit autrefois une des cinq grandes
charges de la couronne ; & il étoit non - feulement
diftingué du grand-chambellan, mais il lui étoit en
quelque maniéré fupérieur par l’étendue de fon pouvoir.
Il fignoit les chartes & autres lettres de confé-
quence. Pendant un long tems, il précéda le connétable
, & il jugeoit avec les pairs de France : ce qui
lui fut accordé par arrêt de l’an 1224. Le grand-
chambrier avoit la furintendance de la chambre du
ro i, de fes habiilemens, & de fes meubles. Il avoit
fa jurifdi&ion à la table de marbre du palais à Paris;
& il tenoit fa charge à fief & hommage du roi,, comme
1e reconnut 1e comte d’Eu en 1270 , à l’égard du
roi faint Louis. Les princes de la maifon royale de
Bourbpn de tems immémorial avoient poffédé cette
charge ; comme on le remarque fur les inferiptions
de leurs, tombeaux aux Jacobins de Paris , & à la
galerie baffe du château de Moulins : ils ont prétendu
même qu’elle étoit héréditaire dans lepr maifon.
Après la mort de Charles dernier duc de Bourbon
en 1527, le roi François I. la donna à Charles de
I