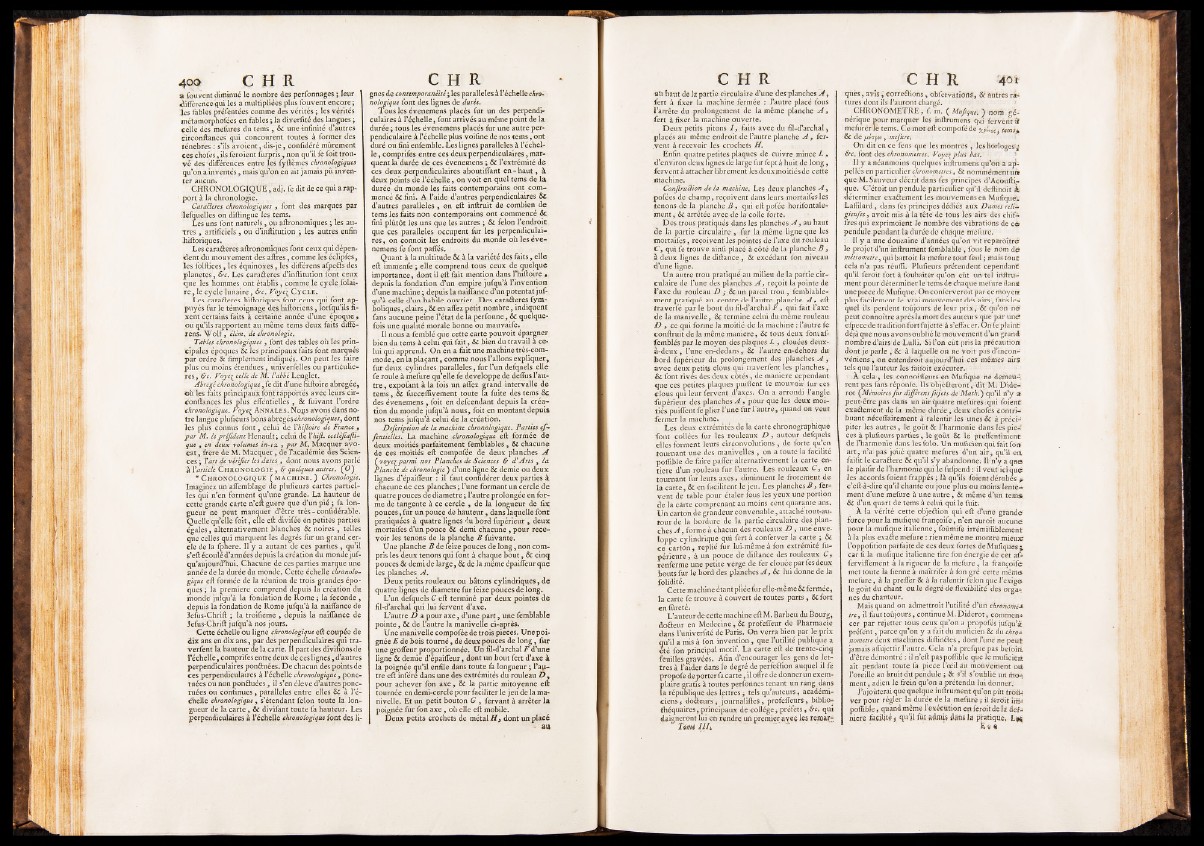
a Couvent diminué le nombre des perfonnages ; leur
différence qui les a multipliées plus Couvent encore;
les fables préCentées comme des vérités ; les vérités
métamorphofées en fables ; la diverfité des langues ;
celle des mëfures du tems , 6c une infinité d’autres
circonftances qui concourent toutes à former des
ténèbres : s’ils avoient, dis-je, confidéré mûrement
ces chofes, ils feroient furpris, non qu’il fe foit trouvé
des • différences entre les fyftèmes chronologiques
qu’on a.inventés, mais qu'on en ait jamais pu inventer
aucun.
CHRONOLOGIQUE, adj. fe dit de ce qui a rapport
à la chronologie.
Caractères chronologiques , font des marques par
•lesquelles on diftingue les tems.
Les uns font naturels, ou aftronomiques ; les au- !
t r è s , artificiels , ou d’inftitution ; les autres enfin ;
liiftoriques.
Les caraûeres aftronomiques font ceux qui dépendent
du mouvement des aftres, comme les éclipfes,
les folftices, les équinoxes, les différens afpeûs des
ylanetes, &c. Les caraCteres d’inftitution font ceux
que les hommes ont établis, comme le cycle Solaire
., le cycle lunaire, &c. Vqye\ CyCLE.
Lés cara&eres hiftoriques font ceux qui font appuyés
fur le témoignage des. hiftoriens, lorfqu’ils fixent
certains faits à certaine année d’une époque »
ou qu’ils rapportent au même tems deux faits différens.
W o lf , élém. de chronologie.
Tables chronologiques , font des tables oit les prin-
. cipàles époques &: les, principaux faits font marqués
par ordre & Amplement indiqués. On peut les faire
plus ou moins étendues, univerfelles ou particulières
, v'c. Voyeç celle de M. l ’abbé Lenglet.
Abrégé chronologique, fe dit d’une hiftoire abrégée,
•Ou les faits principaux îont rapportés a vec leurs circonftances
les plus eflëntielles , & fuivant l’ordre
chronologique. Voye^ Annales. Nojis avons dans notre
langue plufieurs bons abrégés chronologiques, dont
les plus connus fon t, celui de l’hiftoire de France ,
ja r M. le préjident Henaulf ; celui de Vhijl. eccléfiafii-
que y en deux volumes in-iz , par M. Macquer avocat
, frère de M. M acquer, de l’académie des Sciences
; P art de vérifier les dates , dont nous ayons parlé
à l’article CHRONOLOGIE, & quelques autres. (O )
* C hro nologique ( m a ch in e . ) Chronologie.
Imaginez un affemblage de plufieurs cartes partielles
qui n’en forment qu’une grande. La hauteur de
cette grande carte n’eft guere que d’un pié ; fa longueur
ne peut manquer d’être très - confidérable.
Quelle qu’elle foit, elle eft divifée en petites parties
égales, alternativement blanches 6c noires , telles
que celles qui marquent les degrés fur un grand cercle
de la fphere. Il y a autant de ces parties , qu’il
s’eft écoulé d’années depuis la création du monde juf-
qu’aujourd’hui. Chacune de ces parties marque une
année de la durée du monde. Cefte échelle chronologique
eft formée de la réunion de trois grandes époques
; la première comprend depuis la création du
monde' jufqu’à la fondation de Rome ; la fécondé ,
depuis la fondation de Rome jufqu’à la naiffance de
Ïefus-Chrift ; la troifieme , depuis la naiffance de
Jefus-Chrift jufqu’à nos jours.
Cette échelle ou ligne chronologique eft coupée de
dix ans en dix ans, par des perpendiculaires qui tra-
verfent la hauteur de la carte. Il part des divifions de
l’échelle, comprifes entre deux de ces lignes, d’autres
perpendiculaires ponftuées. D e chacun des points de
ces perpendiculaires à l’échelle chronologique, ponctuées
ou non ponâuées, il s’en éleve d’autres ponctuées
ou continues, parallèles entre elles 6ç à l'échelle
chronologique, s’étendant félon toute la longueur
de la carte, & divifant toute fa hauteur. Les
perpendiculaires à l’échelle chronologique font des lignes
de contemporanéité ; les parallèles à l’échelle chronologique
font des lignes de durée.
Tous les évenemens placés fur un des perpendiculaires
à l’échelle, font arrivés au même point de la
durée; tous les évenemens placés fur une autre perpendiculaire
à l’échelle plus voifine de nos tems, ont
duré ou fini enfemble. Les lignes parallèles à l’échelle
, comprifes entre ces deux perpendiculaires, marquent
la durée de ces évenemens ; 6c l’extrémité de
c es deux perpendiculaires aboutiffant en - haut, à
deux points de l’échelle, on voit en quel tems de la
durée du monde les faits contemporains ont commencé
& fini. A l’ aide d’autres perpendiculaires 6c
d’autres parallèles , on eft inftruit de combien de
tems les faits non contemporains ont commencé &
fini plutôt les uns que les autres ; 6c félon l’endroit
que ces parallèles occupent fur les perpendiculaires
, on connoît les endroits du monde où les évenemens
fe font paffés.
Quant à la multitude 6c à la variété des faits, elle
eft immenfe ; elle comprend tous ceux de quelque
importance, dont il eft fait mention dans l’hiftoire %
depuis la fondation d’un empire jufqu’à l’invention
d’une machine ; depuis la naiffance d’un potentat jufqu’à
celle d’un habile ouvrier. Des carafteres fym-
boliques, clairs, 6c en affez petit nombre, indiquent
fans aucune peine l’état de la perfonne, 6c quelquefois
une qualité morale bonne ou mauvaife.
Il nous a femblé que cette carte pouvoit épargner
bien du tems à celui qui fait, 6c bien du travail à celui
qui apprend. On en a fait une machine très-commode
, en la plaçant, comme nous l’allons expliquer,
fur deux cylindres parallèles, fur l’un defquels elle
fe roule à mefure qu’elle fe développe de deffus l’autre
, expofant à la fois un affez grand intervalle de
tems, 6c fucceflivement toute la fuite des tems 6c
des évenemens, foit en defeendant depuis la création
du monde jufqu’à nous, foit en montant depuis
nos tems jufqu’à celui de la création.
Defcription de la machine chronologique. Parties efi-
Jentielles. La machine chronologique eft formée de
deux moitiés parfaitement femblables , 6c chacune
de ces moitiés eft compofée de deux planches A
( voye^parmi nos Planches de Sciences & d'Arts , la
Planche de chronologie ) d’une ligne 6c demie ou deux
lignes d’épaiffeur : il faut confidérer deux parties à
chacune de c es planches ; l’une formant un cercle de
quatre pouces de diamètre ; l’autre prolongée en forme
de tangente à ce cercle , de la longueur de fix
pouces, fur un pouce de hauteur, dans laquelle font
pratiquées à quatre lignes du bord fupérieur , deux
mortaifes d’un pouce 6c demi chacune, pour recevoir
les tenons de la planche B fuivante.
Une planche B de feize pouces de long, non compris
les deux tenons qui font à chaque b out, 6c cinq
pouces & demi de large, 6c de la même épaiffeur que
les planches A .
Deux petits rouleaux ou bâtons cylindriques, de
quatre lignes de diamètre fur feize pouces de long.
L’un defquels C eft terminé par deux pointes de
fil-d’archal qui lui fervent d’axe.
L’autre D a pour ax e, d’une part, une femblable
pointe, 6c de l’autre la manivelle ci-après.
Une manivelle compofée de trois pièces. Une poignée
E de bois tourné, de deux pouces de long, fur
une groffeur proportionnée. Un fil-d’archal F d’une
ligne & demie d’épaiffeur, dont un bout fert d’axe à
la poignée qu’il enfile dans toute fa longueur ; l’autre
eft inféré dans une des extrémités du rouleau D ,
pour achever fon a x e , 6c la partie mitoyenne eft
tournée en demi-cercle pour faciliter le jeu de la manivelle.
Et un petit bouton G , fervant à arrêter la
poignée fur fon a x e , où elle eft mobile.
I Deux petits crochets de métal H, dont un placé
- au
ali haut de la partie circulaire d’une des planches A ,
fert à fixer la machine fermée : l’autre placé fous
l ’arrête du prolongement de la même planche A ,
fert à fixer la machine ouverte.
Deux petits pitons ƒ , faits avec du fil-d’archal *
placés au même endroit, de l’autre planche A , ferment
à recevoir les crochets H.
Enfin quatre petites plaques de cuivre mince L ,
d’environ deux lignes de large fur fept à huit de long,
■ fervent à attacher librement les deux moitiés de cette
machine.
Confiruclion de la machine. Les deux planches A ,
jpofées de champ , reçoivent dans leurs mortaifes les
tenons de la planche B , qui eft pofée horifontale-
anent, & arrêtée avec de la colle forte*
Des trous pratiqués dans les planches A , au haut
de la partie circulaire , fur la même ligne que les
mortaifes, reçoivent les pointes de Taxe du rouleau
C y qui fe trouve ainfi placé à côté de la planche B ,
à deux lignes de diftance , & excédant fon niveau
d’une ligne*
Un autre trou pratiqué au milieu de la partie circulaire
de l’une des planches A , reçoit la pointe de
l ’axe du rouleau D ; & un pareil trou, femblable-
ment pratiqué au centre de l’autre planche A , eft
traverfé par le bout du fil-d’arehal F , qui fait, l’axe
de la manivelle, 6c termine celui du même rouleau
I ) 9 ce qui forme la moitié de la machine : l’autre fe
conftruit de la même maniéré, 6c tous deux fontaf-
femblés par le moyen des plaques L , clouées deux-
à-deux, l’une en -d e d an s6c l’autre en-dehors du
bord fupérieur du prolongement des planches A ,
avec deux petits clous qui traverfent les planches*
6c font rives des deux côtés, de maniéré cependant
que ces petites plaques puiffent fe mouvoir fur ces
clous qui leur fervent d’axes. On a arrondi l’angle,
fupérieur des planches A , pour que les deux moitiés
puiffent fe p)ier l’une fur l’autre, quand on veut
fermer la machine.
Les deux extrémités de là Carte chronogrâphiquè
font collées fur les rouleaux D , auto.ur defquels
elles forment leurs circonvolutions , de forte qu’en
tournant une des manivelles , on a toute la facilité
poflible de faire paffer alternativement la carte en*
tiere d’un rouleau fur l’autre. Les rouleaux C , en
tournant fur ieufs axes > diminuent le frotenient de
la carte, 6c en facilitent le jeu. Les planches B , fervent
de table pour étaler fous les yeux une portion
de la cârte comprenant au moins cent quarante ans*
Un carton de grandeur convenable, attaché tout-autour
de la bordure de la partie circulaire des planches
A , forme à chacun des rouleaux D , une enveloppé
cylindrique qui fert à conferver la carjte ; 6c
ce carton, replié fur lui-même à fon extrémité fu-
périeure , à un pouce de diftance des rouleaux C f
renferme une petite verge de fer clouée par fes deux
bouts fur le bord des planches A y 6c lui donne de la
folidité. - -, . ' , .. . 1
Cette machine étant pliée fur elle-même & fermée*
la carte fe trouve à couvert de toutes parts, ôcfort
enfûrete* ...............................
L’auteur de cëtte machine eft M. Barbeü du Bourg*
do&eur en Médecine, 6c profeffeur de Pharmacie
dans l’univerfité de Paris. On verra bien par le prix
qu’il a mis à fon invention, que l’utilité publique a
été fon principal motif. La carte eft de trente-cinq
feuilles gravées. Afin d’encourager fes gens de lettres
à i’aider dans le degré de perfection auquel il fe
propofe de porter fa carte, il offre de donner un exemplaire
gratis à toutes petfdnnes tenant un rang dans
la république des lettres * tels qu’auteurs, académiciens
* dofteurs * journaliftès , profeffeurs, biblio-j
théqitaire9, principaux de collège* préfets * &ci qui
daigneront lui en rendre un premier ayeç les reraar^
Tomé I I h
quès, avis ; corrections-, obfervatiôns', & autres ri*
turcs dont ils l’auront chargé.
CHRONOMETRE, f. m. ( Mufiquè■. ) -nom générique
pour marquer les inftruméns q\ft fervent àf
mefurér le tems* Ce mot eft compofé de xp^oc ; tems±
6c de fj.î'rpov , mejure-.
On dit en ce fens que les montres , les horloges^1
&c. font des chronométrés. Voyei plus bas.
Il y a néanmoins quelques inftrümens qu’on a ajl-
pellés en particulier chronométrés, 6c nommément ur*
que M. Sauveur décrit dans fes principes d’Acoufti-
«ue. C ’étoit un pendule particulier qu’ il deftinôit i
déterminer exactement les mouvemens en Mufiquei
Laffilard, dans fes principes dédiés aux Damés reli-
gieufes, avoit mis à la tête de tous lés airs des chiffres
qui exprimoient le nombre des vibrations de cà>
pendule pendant la durée de chaque méfiire.
. Il y a une douzaine d’artnées qù’on vit reparbîtré1
le projet d’un inftrument femblable, fous le no’m dé
fnetrometre, qü\ battoit la mefure tout feul ; ifiais-tout
cela n’a pas réuffi. Plufieurs prétendent cependant!
qu’il feroit fort à fouhaiter qu’on eût un tel inftrument
pour déterminer le téms de chaque mefüre dani
pnepiece de Mufique. On conferveroit par ce moyen
plus facilement le vrai mouvement des airs , fans lequel
ils perdent toûjours de leur prix, & qu’on ne?
peut connoître après la mort des auteurs que par une?
efpece dé tradition fort füjette à s’effacer. On le plaint
déjà que nous avons oublié le mouvement d’un grand
nombre.d’airs de Lulli. Si l’on eût pris la précaution
dont je parle , 6c à laquelle On ne voit pas d’ineon-
véniens ; On entendroit aujOurd’hUi ces mêmes airs
tels que l’auteur les fâifoit exécuter.? -
À cela * les cormoiffeurs-en ‘Mufique né deméü-j
rentpas fans répônfe. I ls ’objèôéront, dit M: Diderot
(Mémoires fur dijferéns fùjets de Math:) qu’il n’y *
peutrêtre pas dans un air quatre niefiires iqui foient
exactement de la même durée * deux chofes Contribuant
néceffairement à ralentir les u nes& àpréci-'
piter les autres, le goût & l’harmonie dans les pièces
à plufieurs parties, le goût 6c le preffentiniené
de l’harmonie dans les folo. Un muficien qui fait fon
art, n’ai pas joué quatre mefures d’un ait; qu’il eii
faifit le cara&ere & qu’il s’y abandonne; Il n’y a que
le pfeifir de l’harmonie qui le fufpend : il veut ici qu©
les accords foient frappés ; là qii’ils foient dérobes *
c’eft-à*dire qu’il chante ou joue plus ou moins lenté~
ment d’une mefure à une autre, & même d’un teins*
6c d’un quart de tems à celui qui le fuit;
À la vérité cette objeôioh qui eft d’une gfànde^
force pour la mufique françoife, n’en auroit aucune
pour la mufique italienne * foûmife irrémifliblement
à la plus exaCïe mefure : rien même ne montre miëux?
l’oppofition parfaite de ces deux fortes deMufiqüesj.
car fi la mufiquë italienne tire fon énergie de cet afi*
ferviffement à la rigueur de la mefure, la françoife?
met toute la fienne à màîtrifer à fon gré cette mêüie»
mefure, à la preffer & à la ralentir félon que l’exigô
le goût du chant ou le degré de flexibilité des orga*
nés du chanteur;
Mais quand on àdmettroit l’utilité d’iui chrohômèA
tre, il faut toûjours, continue M. D iderot, commencer
par rejetter tous ceux qu’on a propofés jufqu’à
I préfënt, parce qu’on y a fait du muficièn & du chronométré
deux machines diftinCtes * dont l’iinè ne peut
jamais affujettir l’autre. Gela n’a prefque pas befoiü
d’être démontré : il n’eft pas poflible que le muficiëii
ait pendant toute fa piece l'oeil âii moûvement Oii
l’oreille au bruit dû pendule ; & s’il s ’oublié un fho^
ment * adieu le frein qu’on a prétendu lui donner*
j ’ajoûterai que quelque inftrument qu’on pût tfbtt-'
ver pour régler la durée de la meftire j il ferdif iiifa
poflible * quand même l’exéciition en feroit de là defr
nicre facilité, qu’il fût admis dans la pïatiqüë, LM
È e ê