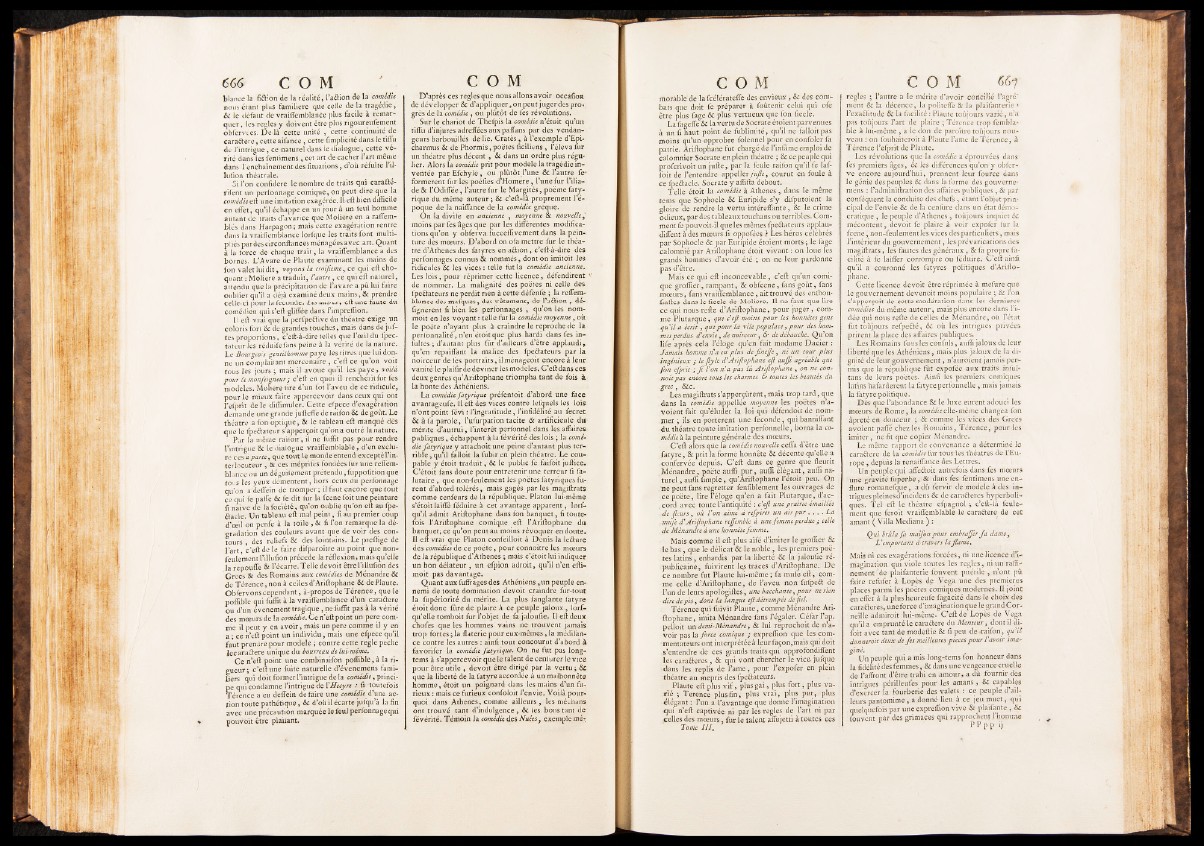
6 6 6 C O M
blance la fi&lon de la réalité, l’aftion de la comédie
nous étant plus familière que celle de là tragédie,
& le défaut de vraiffemblance plus facile à remarquer
, les réglés y doivent être plus rigoureufement
obfervces. De-là cette unité , cette continuité^ de
caraêtere, cette aifance, cette fimplicité dans le tiffu
de l’intrigue, cè naturel dans le dialogue, cette vérité
dans les fentimens , cet art de cacher l’art meme
dans l'enchaînement des fituations, d’ou refulte 1 il-
lufion théâtrale. . . ,
Si l’on confidere le nombre de traits- qui carafle-
rilent un perfonnage comique, on peut dire que la
comédie elt une imitation exagérée. Il-eft ^>ien difficile
en effet, qu’il échappe en un jour à un (eul homme
autant de traits d’avarice que Molière, en a raffem-
blés dans Harpagon ; mais cette exagération rentre
dans la vraiffemblance lorfque les traits font multipliés
par des circonftances ménagées avec art. Quant
à la force de chaque tra it, la vraiffemblance a des
bornes. L’Avare de Plaute examinant les mains de
fon valet lui d it, voyons la troijicme, ce qui eft choquant
: Moliere a traduit, l'autre, ce qui eft naturel,
attendu que la précipitation de l’avare a pû lui faire
oublier qu’il a déjà examiné deux mains, & prendre
celle-ci pour la fécondé. Les autres, eft une faute du
comédien qui s’eft gliffée dans l’impreffion. .
Il eft vrai que la perfpeûive du théâtre exige un
coloris fort & de grandes touches, mais dans de juf-
tes proportions, c’eft-à-dire telles que l’oeil du fpec-
tateur les réduifefans peine à la vérité de la nature.
L e Bourgeois gentilhomme paye les titres que lui donne
un complailànt mercenaire , c'eft ce qu’on voit
tous les jours ; mais il avoue qu’il les p ay e , voilà
pour le monfeigneur ; c’eft en quoi il renchérit fur les
modèles. Moliere tire d’un fot l’aveu de ce ridicule,
pour le mieux faire appercevoir dans ceux tp i ont
l’efprit de le diffimuler. Cette efpece d’exageration
demande une grande jufteffe de raifon & de goût. L e
théâtre a fon optique, & le tableau eft manqué dès
que le fpeftateur s’apperçoit qu’on a outré la nature.
Par la même ra ifon , il ne fuffit pas pour rendre
l’intrigue & le dialogue vraiffemblable, d’en exclure
ces à parte, que tout le monde entend excepté Pin-
terlocuteur , & ces méprifes fondées fur une reffem-
blance ou un déguilement prétendu, fuppolition que
tous les yeux démentent, hors ceux du perfonnage
qu’on a'deffein de tromper ; il faut encore que tout
ce qui fe paffe & fe dit tur la fcene foit une peinture
fi naïve de la fociété, qu’on oublie qu’on eft au fpe-
â a c le . Un tableau eft mal peint, fi au premier coup
d’oeil on penfe à la toile , & fi l’on remarque la dégradation
des couleurs avant que de voir des contours
, des reliefs & des lointains. Le preftige de
l ’art c ’eft de le faire difparoître au point que non-
feulement l’illufion précédé la réflexion, mais qu’elle
la repouffe & l’écarte. Telle devoit êtrel’Ulufion des
Grecs & des Romains aux comédies de Ménandre &
de T éren ce, non à celles d’Ariftophane & de Plaute.
Obfervonscependant, à-propos de T é ren ce, que le
poffible qui fuffit à la vraiffemblance d’un caraâere
ou d’un événement tragique, ne fuffit pas à la vérité
des moeurs de la comédie. Ce n’eft point un pere comme
il peut y en av o ir, mais un pere comme il y en
a • ce n’eft point un individu, mais une efpece qu’il
faut prendre pour modèle ; contre cette réglé peche
lecara&ere unique du bourreau de lui-même.
Ce n’eft point une combinaifon poffible, à la rigu
eur; c ’eft une fuite naturelle d’évenemens familiers
qui doit former l’intrigue de la comédie, principe
qui condamne l’intrigue de l'Hecyre : fi toutefois
Térence a eu deffein de faire une comédie d’une action
toute pathétique, & d’où il écarte jufqu’à la fin
avec une précaution marquée le feul perfonnage qui
pouvoit être plailant.
C O M
D ’après ces réglés que nous allons avoir occâfiott
de développer & d’appliquer, on peut juger des pro-
grès de la comédie , ou plutôt de fes révolutions.
Sur le chariot de Thefpis la comédie n’étoit qu’un
tiffu d’injures adreffées aux paffans par des vendangeurs
barbouillés délié. C ra tè s, à Pexemple d’Epi-
charmus & de Phormis, poètes ficiliens, l’éleva fur
un théâtre plus décen t, & dans un ordre plus régulier.
Alors la comédie prit pour modèle la tragédie inventée
par. E fchyle, ou plûtôt l’une & l’autre fe*
formèrent fur les poéfies d’Homere, l’une fur l’ilia—
de & l’Odiffée, l’autre fur le Margitès, poëme faty-
rique du même auteur ; & c’eft-là proprement l ’époque
de la naiffance de la comédie greque.
On la divife en ancienne , moyenne & nouvelle
moins par fes âges que par les différentes modifications
qu’on y obfervaaucceffivement dans la peinture
des moeurs. D ’abord on ofa mettre fur le théa-
tre d’Athènes des fatyres en aftion, c’eft-à-dire des
perfonnages connus & nommés, dont on imitoit les
ridicules & les vices : telle fut la comédie ancienne.
Les lo is , pour réprimer cette licence, défendirent
de nommer. La malignité des poètes ni celle des
fpe&ateurs ne perdit rien à cette défenfe ; la reffem-
blance des mafques, des vêtemens, de l’aâ ion , dé-
fignerent fi bien lés perfonnages , qu’on les nom-
moit en les voyant : telle fut la comédie moyenne, où
le poète n’ayant plus à craindre le reproche de la
perfonnalité, n’en étoit que plus hardi dans fes in-
fultes ; d’autant plus fur d’ailleurs d’être applaudi,
qu’en repaiffant la malice des fpeâateurs par la
noirceur de fes portraits, ilménageoit encore à leur
vanité le plaifir de deviner les modèles. C ’eft dans ces
deux genres qu’Ariftophane triompha tant de fois à
la honte des Athéniens.
L a comédie fatyrique préfentoit d’abord une face
avantageufe. Il eft des vices contré lefquels les lois
n’ont point févi i l’ingratitude, l’infidélité au fecret
&C à fà parole, l’ufurpation tacite & artificieufe du
mérite d’autrui, l’intérêt perfonnel dans les affaire»
publiques, échappent à la févérité des lois ; la comédie
fatyrique y attachoit une peine d’autant plus terrib
le , qu’il falloit la fubir en plein théâtre. Le coupable
y étoit traduit, & le public fe faifoit juftice.
C’étoit fans doute pour entretenir une terreur fi fa-
lutaire , que non-feulement les poètes fatyriques furent
d’abord tolérés, mais gages par les magiftrats
comme cenfeurs de la république. Platon lui-même
s ’étoit laiffè féduire à cet avantage apparent, lorfi-
qu’il admit Ariftophane dans fon banquet, fi toutefois
l’Ariftophane comique eft l’Ariftophane du
banquet; ce qu’on peut au moins révoquer en doute.
Il eft vrai que Platon confeilloit à Denis la ledure
des comédies de ce p o è te , pour connoître les moeurs
de la république d’Athenes ; mais c’étoit lui indiquer
un bon délateur , un efpion adroit, qu’il n’en etti-
moit pas davantage.
Quant aux fuffrages des Athéniens ,un peuple ennemi
de toute domination devoit craindre fur-tout
la fupériorité du mérite. La plus langlante fatyre
étoit donc fùre de plaire à ce peuple jaloux , lo r s qu'elle
tomboit fur l’objet de fa jaloufie. Il eft deux
chofes que les hommes vains ne trouvent jamais
trop fortes ; la flaterie pour eux-mêmes, la médifan-
ce contre les autres : ainfi tout concourut d’abord à
favorifer la comédie fatyrique. On ne fut pas long-
tems à s’appercevoir que le talent de cenlurer le vice
pour être utile , devoit être dirigé par la vertu ; &
que la liberté de la fatyre accordée à un malhonnête
homme, étoit un poignard dans les mains d’un fit-:
rieux : mais ce furieux confoloit l’envie. Voilà pourquoi
dans Athènes, comme ailleurs , les médians
ont trouvé tant d’indulgence, & les bons tant de
févérité. Témoin la comédie des Nuées 9 exemple mé?
C O M
morâble de la fcélérateffe des envieux, & des combats
que doit fe préparer à foûtenir celui qui ofe
être plus fage & plus vertueux que fon fiecle.
La fageffe & la vertu de Socrate étoient parvenues
à un fi haut point de fublimité, qu’il ne falloit pas
moins qu’un opprobre folennel pour en confoler fa
patrie. Ariftophane fut chargé de l’infâme emploi de
calomnier Socrate en plein théâtre ; & ce peuple qui
proferivoit un jufte, par là feule raifon qu’il fe laf-
foit de l’entendre appeller jufte, courut en foule à
ce fpeûacle. Socrate y affifta debout.
Telle étoit l a .comédie à Athènes , dans le même
tems que Sophocle & Euripide s’y difputoient la
gloire de rendre la vertu intéreffante, & le crime
odieux, par des tableauxtouchansou terribles. Comment
fe pouvoit-il que les mêmes fpe&ateurs applau-
diffent à des moeurs fi oppofées ? Les héros célébrés
par Sophocle & par Euripide étoient morts ; le fage
calomnié par Ariftophane étoit vivant : on loue les
grands hommes d’avoir été ; on ne leur pardonne
pas d’être-.
Mais ce qui eft inconcevable, c’eft qu’un comique
groffier, rampant, & obfcene, fans goû t, fans
moeurs, fans vraiffemblance, ait trouvé des enthou-
iiaftes dans le fiecle de Moliere. Il ne faut que lire
ce qui nous refte d’Ariftophane, pour ju g e r, comme
Plutarque, que c'eft moins pour les honnêtes gens
qu'il a écrit , que pour la vile populace , pour des hommes
perdus d'envie, de noirceur , & de débauche. Qu’on
life après cela l’éloge qu’en fait madame Dacier :
Jamais homme ri a eu plus de fineffe, ni un tour plus
ingénieux ; le ftyle d'Ariftophane eft aujji agréable que
fon eflprit ; f i l'on n'a pas lu Ariftophane -, on ne côn-
nott pas encore tous les charmes & toutes les beautés du
grec , &c .
Les magiftrats s’apperçûrent, mais trop tard, que
dans la comédie appellée moyenne les poètes n’a-
voient fait qu’éluder la loi qui défendoit de nommer
; ils en portèrent une fécondé, qui banniffant
• du théâtre toute imitation perfonnelle, borna la comédie
à la peinture générale des moeurs.
C ’eft alors qiie la comédie nouvelle ceffa d’être une
faty re , & prit la formé honnête & décente qu’elle a
confervée depuis. C ’eft dans ce genre que fleurit
Ménandre, poète auffi p u r, auffi élégant, auffi naturel
, auffi fimple, qu’Ariftophane l’étoit peu. On
/ne peut fans regretter fenfiblement les ouvrages de
ce poète, lire l’éloge qu’en a fait Plutarque, d’accord
avec toute l’antiquité : c'eft une prairie émaillée
de fleurs, où l'on aime à refpirer un air pur . . . . La
.mufe d'Ariftophane rcjflemble à une femme perdue ; celle
. de Ménandre à une honnête flemme.
Mais comme il eft plus aifé d’imiter le groffier &
•le b a s , que le délicat & le n ob le, les premiers poètes
latin s, enhardis par la liberté & la jaloufie républicaine,
fuivirent les traces d’Ariftophane. D e
ce nombre fut Plaute lui-même ; fa mufe eft, comme
celle d’Ariftophane, de l’aveu non fufpeét de
l’un de leurs apologiftes, une bacchante, pour ne rien
dire de pis, dont la langue eft détrempée de fiel.
Térence qui fuivit Plaute, comme Ménandre Ariftophane
, imita Ménandre fans l’égaler. Céfar l’ap.
pelloit un demi-Ménandre, & lui reprochoit de n’avoir
pas la force comique ; expreffion que les commentateurs
ont interprétée à leur façon,mais qui doit
s ’entendre de ces grands traits qui approfondiffent
les cara&eres , & qui vont chercher le v ice jufque
dans les replis de l’am e , pour l’expofer en plein
théâtre au mépris des fpeûateurs.
Plaute eft plus v i f , plus g a i , plus fo rt, plus v arié
; Terence plus fin, plus v ra i, plus pur, plus
élégant : l’un a l’avantage que donne l’imagination
qui n’eft captivée ni par les réglés de l’art ni par
.celles des moeurs, fur le talent affujetti à toutes ces
Tonie III,
C O M .
règles ; l'autre a le mérite d’avoir concilié l’agré"
ment & la décence, la politeffe & la plaifanterie »
l’exa&itude & la facilité : Plaute toûjours varié, n’a
pas toûjours l’art de plaire ; Térence trop fembla-»
ble à lui-même , a le don de paroître toûjours non*
veau : on fouhaiteroit à Plaute l’ame de T érence, à
Térence l’efprit de Plaute.
Les révolutions que la comédie a éprouvées dans
fes premiers âges, & les différences qu’on y obfer*
ve encore aujourd’hui, prennent leur fource dans
le génie des peuples & dans la forme des gouverne^
mens : l’adminiftration des affaires publiques, & pat
conféquent la conduite des chefs, étant l'objet principal
de l’envie & de la cenfuré dans un état démocratique
, le peuple d’Athenes , toûjours inquiet Ô£
mécontent, devoit fe plaire à voir expofer fur la
fcene, non-feulement les vices des particuliers, mais
l’intérieur du gouvernement, les prévarications des
magiftrats > les fautes des généraux, & fa propre facilité
à fe laiffer corrompre ou féduire. C ’eft ainfi
qu’il a couronné les fatyres politiques d’Ariftophane.
Cette licence devoit être réprimée à mefure que
le gouvernement devenoit moins populaire ; & l’on
s’apperçoit de cette modération dans les dernieres
comédies du même auteur, mais plus encore dans l’idée
qui nous refte de celles de Ménandre, où l’état
fut tôûjours refpe&é, & où les intrigues privées
prirent la place des affaires publiques.
Les Romains fous les confuls, auffi jaloux de leur
liberté que les Athéniens, mais plus jaloux de la dignité
de leur gouvernement, n’auroient jamais permis
que la république fût expofée aux traits inful*
tans de leurs poètes. Ainfi les premiers comiques
latins hafarderent la fatyre perfonnelle ,.mais jamais
la fatyre politique.
Dès que l’abondance & le luxe eurent adouci les
moeurs de Rome, la comédie elle- même changea fon
âpreté en douceur ; & comme les vices des Grecs
avoient paffé chez les Romains, Térence, pour les
imiter, ne fit que copier Ménandre.
Le même rapport de convenance a déterminé le
caraûere de la comédie fur tousdes théâtres de l’Europe
, depuis la renaiffance des Lettres.
Un peuple qui affeûoit autrefois dans fes moeurs
une gravité fuperbe, & dans fes fentimens une enflure
romanefque, a dû fervir de modèle à des intrigues
pleinesd’incidens & de carafteres hyperboliques.
Te l eft le théâtre efpagnol ; c’eft-là feulement
que feroit vraiffemblable le cara&ere de cet
amant ( Villa Mediana ) :
Qui brûla fa maiflon poür embrajfer fa dame,
L'emportant à-travers laflame.
Mais ni ces exagérations forcées, ni une licence d'imagination
qui viole toutes les ré g lé s, ni un raffi-
nement,de plaifanterie fouvent puérile , n’ont pû
faire refufer à Lopès de Vega une des premières
places parmi les poètes comiques modernes. Il joint
en effet à la plus heureufe fagacité dans le choix des
caratteres, uneforce d’imagination que le grand C orneille
admiroit lui-même. C’eft de Lopès de Vega
qu’il a emprunté le cara&ere du Menteur, dont il di-
foit avec tant de modeftie & fi peu de-raifon , qu'il
donneroit deux de fes meillêures pièces pour l'avoir ima-
giné.
Un peuple qui a mis long-tems fon honneur dans
la fidélité des femmes, & dans une vengeance cruelle
de l’affront d’être trahi en amour, a dû fournir des
intrigues périlleufes pour les amans, & capables
d’exercer la fourberie des valets : ce peuple d’ailleurs
pantomime, a donné lieu à ce jeu muet, qui
quelquefois par une expreffion v ive & plaifante , 6c
fouvent par des grimaces qui rapprochent l'homme