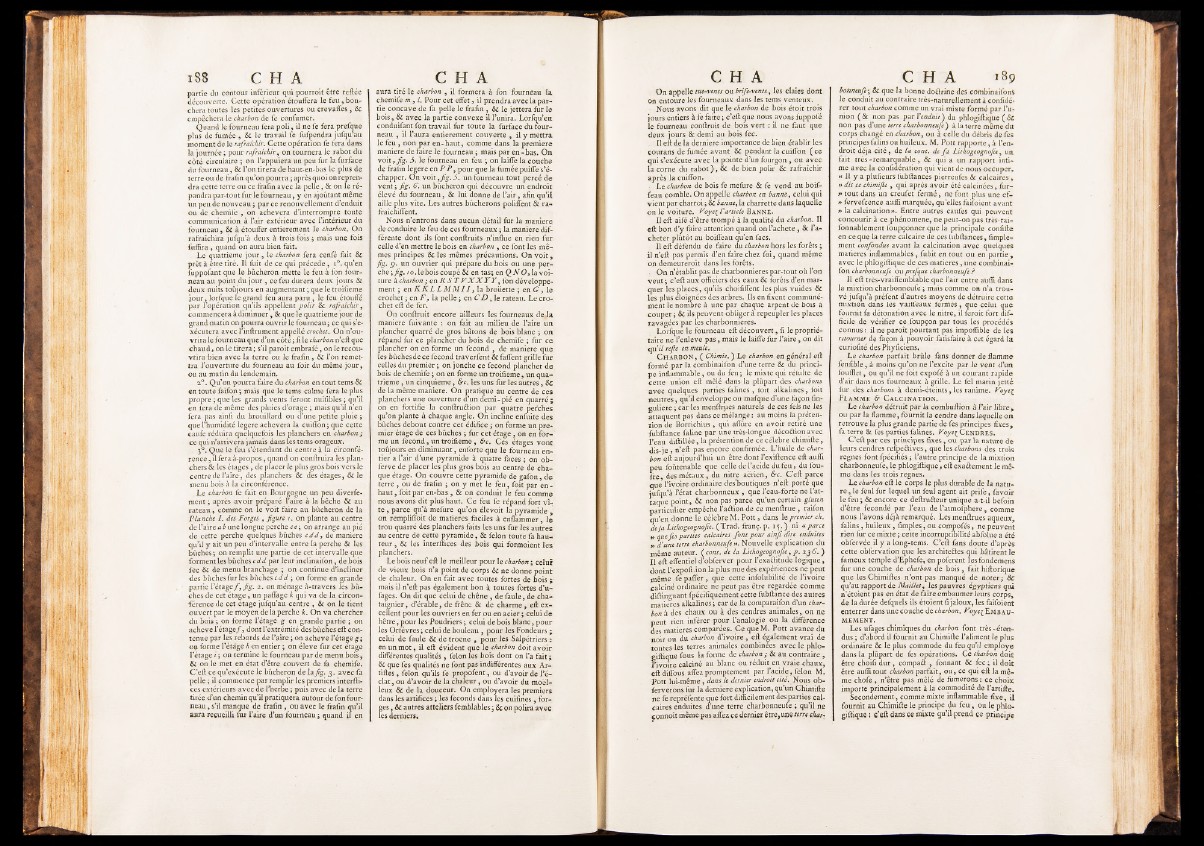
188 C H A
partie du contour inférieur qui pourroit être reftée
découverte. Cette opération étouffera le f e u b o u chera
toutes les petites ouvertures ou crevaffes, &c
empêchera le charbon de fe confumer.
Quand le fourneau fera p oli, il ne fe fera prefque
plus de fumée , & le travail fe fufpendra jufqu’au
moment de le rafraîchir. Cette opération fe fera dans
la journée ; pour rafraîchir, on tournera le rabot du
côté circulaire ; on l’appuiera un peu fur la furface
du fourneau, & l’on tirera de haut-en-bas le plus de
terre ou de frafin qu’on pourra ; après quoi on reprendra
cette terre ou ce frafin avec la pelle, & on le répandra
par-tout fur le fourneau, y en ajoutant même
un peu de nouveau ; par ce renouvellement d’enduit
ou de chemife , on achèvera d’interrompre toute
communication à l’air extérieur avec l’intérieur du
fourneau, & à étouffer entièrement le charbon. On
rafraîchira jufqu’à deux à trois fois ; mais une fois
fuffira, quand on aura bien fait.
Le quatrième jou r, le charbon fera cenfé fait &
prêt à être tiré. Il fuit de ce qui précédé, i°. qu’en
fuppofant que le bûcheron mette le feu à fon fourneau
au point du jour , ce feu durera deux jours &
deux nuits toujours en augmentant ; que le troifieme
jou r , lorfque le grand feu aura paru, le feu étouffe
par l’opération qu’ils appellent polir &c rafraîchir,
commencera à diminuer, & que le quatrième jour de
grand matin on pourra ouvrir le fourneau ; ce qui s’exécutera
avec l’infirument appellé crochet. On n’ouvrira
le fourneau que d’un côté ; fi le charbon n’eft que
chaud, on le tirera ; s’il paroît embrafé, on le recouvrira
'bien avec la terre ou le frafin, & l’on remettra
l’ouverture du fourneau au foir du même jour,
ou au matin du lendemain.
i ° . Qu’on pourra faire du charbon en tout tems &
en toute faifon ; mais que le tems calme fera le plus
propre ; que les grands vents feront nuifibles ; qu’il
en lera de même des pluies d’orage ; mais qu’il n’en
fera pas ainfi du brouillard ou d’une petite pluie ;
que l’humidité legere achèvera la cuiffon ; que cette
caufe réduira quelquefois les planchers en charbon;
ce qui n’arrivera jamais dans les tems orageux.
. 3°. Que le feu s’étendant du centre à la circonférence
, il fera à-propos, quand on conftruira les planchers
& les étages, de placer le plus gros bois vers le
centre de l’aire, des planchers & des étages, ÔC le
menu bois à la circonférence.
Le charbon fe fait en Bourgogne un peu diverfe-
ment ; après avoir préparé l’aire à la bêche & au
rateau, comme on le voit faire au bûcheron de la
Planche 1. des Forges , figure /. on plante au centre
de l’aire a b une longue'perche ce ; on arrange au pié
de cette perche quelques bûches cd d , de maniéré
qu’il y ait un peu d’intervalle entre la perche & les
bûches ; on remplit une partie de cet intervalle que
forment les bûches cdd par leur indinaifon, de bois
fec & de menu branchage ; on continue d’incliner
des bûches fur les bûches ; on forme en grande
partie l’é t a g e / ,^ , a. on ménage à-travers les bûches
de cet é tage, un paffage k qui va de la circonférence
de cet étage jufqu’au centre , & on le tient
ouvert par le moyen de la perche k. On va chercher
du bois ; on forme l’étage g en grande partie ; on
achevé l’étage/, dont l’extrémité des bûches eft contenue
par les rebords de l’aire ; on achevé l’étape g';
ou forme l’étage h en entier ; on éleve fur cet etage
l’étage i ; on termine le fourneau par de menu bois,
& on le met en état d’être couvert de fa chemife.
C ’eft ce qu’exécute le bûcheron delà fig. 3. avec fa
pelle ; il commence par remplir les premiers interfti-
ces extérieurs avec de l’herbe ; puis avec de la terre
tirée d’un chemin qu’il pratiquera autour de fon fourneau
, s’il manque de frafin, ou avec le frafin qu’il
aura recueilli fur l’aire d’un fourneau ; quand il en
C H A
aura tiré le charbon , il formera à fon fourneau la
chemife m, /. Pour cet effet, il prendra avec la partie
concave de fa pelle le frafin, & le jettera fur le
bois, & avec la partie convexe il l’unira. Lorfqu’en
conduifant fon travail fur toute la furface du fourneau
, il l’aura entièrement couverte , il y mettra
le feu , non par en-haut, comme dans la première
maniéré de faire le fourneau ; mais par en - bas. On
v o it, fig. à. le fourneau en feu ; on laiffe la couche
de frafin legere en P P , pour que la fumée puiffe s’échapper.
On v o it , fig. 5. un fourneau tout percé de
vent ; fig. 6~. un bûcheron qui découvre un endroit
élevé du fourneau, & lui donne de l’air, afin qu’il
aille plus vite. Les autres bûcherons poliffent & ra-
fraîchiffent.
Nous n’entrons dans aucun détail fur la manière
de conduire le feu de ces fourneaux ; la maniéré différente
dont ils font conftruits n’influe en rien fur
celle d’en mettre le bois en charbon , ce font les memes
principes & les mêmes précautions. On v o it ,
fig. c>. un ouvrier qui prépare du bois ou une perche
; fig. 1 o. le bois coupé & en tas ; en Q N O, la voiture
à charbon; en R S T V X X Y Y , fon développement
; en K K L L M M I J , la broiictte ; en G , le
crochet ; en F , la pelle ; en C D , le rateau. Le crochet
eft de fer.
On conflruit encore ailleurs les fourneaux detla
maniéré fuivante : on fait au milieu de l’aire un
plancher quarré de gros bâtons de bois blanc ; on
répand fur ce plancher du bois de chemife ; fur ce
plancher on en forme un fécond , de maniéré que
les bûches de ce fécond traverfent & faflënt grille fur
celles du premier ; on jonche ce fécond plancher de
bois de chemife ; on en forme un troifieme, un quatrième
, un cinquième, &c. les uns fur les autres, Sc
de la même maniéré. On pratique au centre de ces
planchers une ouverture d’un demi-pié en quarré;
on en fortifie la conftruâion par quatre perches
qu’on plante à chaque angle. On incline enfuite des
bûches debout contre cet édifice ; on forme un premier
étage de ces bûches ; fur cet é tage, on en forme
un fécond, un troifieme, &c. Ces étages vont
toûjours en diminuant, enforte que le fourneau entier
a l’air d ’une pyramide à quatre faces ; on ob-
ferve de placer les plus gros bois au centre de chaque
étage. On couvre cette pyramide de gafon, de
terre , ou de frafin ; on y met le feu, foit par en -
haut, foit par en-bas , & on conduit le feu comme
nous avons dit plus haut. Ce feu fe répand fort vite
, parce qu’à mefure qu’on élevoit la pyramide ,
on remplifl'oit de matières faciles à enflammer, le
trou quarré des planchers faits les uns fur les autres
au centre de cette pyramide, & félon toute fa hauteur
, & les interftices des bois qui formoient les
planchers.
Le bois neuf eft le meilleur pour le charbon ; celui
de vieux bois n’a point de corps & ne donne point
de chaleur. On en fait avec toutes fortes de bois ;
mais il n’eft pas également bon à toutes fortes d’u-
fages. On dit que celui de chêne , de faule, de châtaignier
, d’érable, de frêne & de charme, eft excellent
pour les ouvriers en fer ou en acier ; celui de
hêtre, pour les Poudriers ; celui de bois blanc, pour
les Orfèvres ; celui de bouleau , pour les Fondeurs ;
celui de faule & de troene 9 pour les Salpétriers :
en un mot, il eft évident que le charbon doit avoir
differentes qualités , félon les bois dont on l’a fait ;
& que fes qualités ne font pas indifférentes aux Ar-
tiftes, félon qu’ils fe propofent, ou d’avoir de l’éclat
, ou d’avoir de la chaleur, ou d’avoir du moelleux
& de la douceur. On employera les premiers
dans les artifices ; les féconds dans les cuifines , forges
, & autres atteüers femblables ; & on polira avec
les derniers.
C H A
On appelle tue-vents ou brife-vents, les claies dont
on entoure les fourneaux dans les tems venteux.
• Nous avons dit que le charbon de bois étoit trois
jours entiers à fe faire ; c’eft que nous avons fuppofé
le fourneau conftruit de bois vert : il ne faut que
deux jours & demi au bois fec.
Il eft de la derniere importance de bien établir les
courans de fumée avant & pendant la cuiffon ( ce
qiii s’exécute avec la pointe d’un fourgon, ou avec
la corne du rabot ) , & de bien polir & rafraîchir
après la cuiffon.
: Le charbon de bois fe mefure & fe vend au boif-
feau comble. On appelle charbon en banne, celui qui
vient par charroi ; & banne, la charrette dans laquelle
on le voiture. Voye[ Varticle Banne.
Il eft aifé d’être trompé à la qualité du charbon. Il
eft bon d’y faire attention quand on l’achete, & l’acheter
plûtôt au boiffeau qu’en facs.
Il eft défendu de faire du charbon hors les forêts ;
il n’eft pas permis d’en faire chez foi, quand même
on demeureroit dans les forêts.
, On n’établit pas de charbonnières par-tout où l’on
veut ; c ’eft aux officiers des eaux & forêts d’en marquer
les places, qu’ils choififfent les plus vuides &
les plus éloignées des arbres. Ils en fixent communément
le nombre à une par chaque arpent de bois à
couper ; & ils peuvent obliger à repeupler les places
ravagées par les charbonnières.
Lorfque le fourneau eft découvert, fi le propriétaire
ne l’enleve pas, mais le laiffe fur l’aire, on dit
qu’i/ refie en meule.
C h a r bo n , ( Chimie. ) Le charbon en général eft
formé par la combinaifon d’une terre & du principe
inflammable, ou du feu ; le mixte qui réliilte de
cette union eft mêlé dans-la plûpart des charbons
avec quelques parties falines , foit alkalines, foit
neutres, qu’il enveloppe ou mafque d’une façon fin-
guliere ; car les menftrues naturels de ces fels ne les
attaquent pas dans ce mélange : au moins la prétention
de Borrichius , qui affûre en avoir retiré une
fubftance faline par une très-longue décoâion avec
l’eau diftillée, la prétention de ce célébré chimifte,
dis-je , n’eft pas encore confirmée. L’huile de charbon
eft aujourd’hui un être dont l’exiftence eft aufli
peu foûtenable que celle de l’acide du feu, du fou-
f re , des métaux, du nitre aerien, &c. C ’eft parce
que l’ivoire ordinaire des*boutiques n’eft porté que
jufqu’à l’état charbonneux , que l’eau-forte ne l’attaque
point, & non pas parce qu’un certain gluten
particulier empêche l’aftion de ce menftrue, raifon
qu’en donne le célébré M. Pott, dans le premier ch.
déjà Lithogeognofie. (Trad. franç. p. 15. ) ni « parce
» que fes parties calcaires font pour ainfi dire enduites
» d'une terre charbonneufe ». Nouvelle explication du
même auteur, (cont. de la Lithogeognofie, p . 23 <f. )
Il eft effentiel d’obferver pour l’exaûitude logique,
dont Pexpofi.ion la plus nue des expériences ne peut
même fe paffer, que cette infolubilité de l’ivoire
calciné ordinaire ne peut pas être regardée comme
diftin^uant fpécifiquement cette fubftance des autres
matières alkalines ; car de la comparaifon d’un charbon
à des chaux ou à des cendres animales, on ne
peut rien inférer pour l’analogie ou la différence
des matières comparées. Ce que M. Pott avance du
noir ou du charbon d’ivo ire, eft également vrai de
toutes les terres animales combinées avec le phlogiftique
fous la forme de charbon ; & au contraire ,
l’ivoire calciné au blanc ou réduit en vraie chaux,
eft diffous affez promptement par l’acide, félon M.
Pott lui-même, dans le dernier endroit cité. Nous ob-
ferverons fur la derniere explication, qu’un Chimifte
ne fe repréfente que fort difficilement des parties calcaires
enduites d’une terre charbonneufe ; qu’il ne
connaît même pas affez ce dernier être,une terre char-
C H A 189
bûtineufe ; & que la bonne doélrine deS combinaifons
le conduit au contraire très-naturellement à confidé-
rer tout charbon comme un vrai mixte formé par l’union
( & non pas par l’enduit ) du phlogiftique ( &c
non pas d’une terre charbonneufe ) à la terre même du
corps changé en charbon, ou à celle du débris de fes
principes falins ou huileux. M. Pott rapporte, à l’endroit
déjà cité , de la cont. de fa Lithogeognofie, un
fait très-remarquable, & qui a un rapport intime
avec la confiaeration qui vient de nous occuper.
« Il y a plufieurs fubftances pierreufes & calcaires ,
» dit çe chimifie , qui après avoir été calcinées, fur-
» tout dans un creufet fermé, ne font plus une ef-
» fervefcence aaffi marquée, qu’elles faifoient avant
» la calcination». Entre autres caufes qui peuvent
concourir à ce^phénomene, ne peut-on pas très-rai-
fonnablement foupçonner que la principale confifte
en ce que la terre calcaire de ces fubftances, Amplement
confondue avant la calcination avec quelques
matières inflammables, fubit en tout ou en partie,
avec le phlogiftique de ces matières, une combinai-
fon charbonneuj'e ou prefque charbonntufe ?
Il eft très-vraiffemblable que l’air entre atifli dans
la mixtion charbonneufe ; mais comme on n’a trouvé
jufqu’à préfent d’autres moyens de détruire cette
mixtion dans les vaiffeaux fermés, que celui que
fournit fa détonation avec le nitre, il feroit fort difficile
de vérifier ce.foupçon par tous les procédés?
connus: il ne paroît pourtant pas impoffible de les
retourner de façon à pouvoir fatisfaire à cet égard la
curiofité des Phyfieiens.
Le charbon parfait brûle fans donner de flamme
fenfible, à moins qu’on ne l’excite par le vent d’un
foufflet, ou qu’il ne foit expofé à un courant rapide
d’air dans nos fourneaux à grille. Le fel marin jette
fur des charbons à demi-éteints, les ranime. Voye£
Flamme & C a l c in a t io n .
Le charbon détruit par la combuftion à l’air libre,
ou par la flamme, fournit la cendre dans laquelle on
retrouve la plus grande partie de fes principes fixes,
fa terre & fes parties falines. Voyeç C endres.
C ’eft par ces principes fixes, ou par la nature de
leurs cendres refpe&ives, que les charbons des trois
régnés font fpécifiés ; l’autre principe de la mixtion
charbonneufe, le phlogiftique, eft exactement le même
dans les trois régnés.
Le charbon eft le corps le plus durable de la nature
, le feul fur lequel un feul agent ait prife, favoir
le feu ; & encore ce deftrufteur unique a-t-il befoin
d’être fécondé par l’eau de l’atmofphere, comme
nous l’avons déjà remarqué. Les menftrues aqueux,
falins, huileux, fimples, ou coropofés, ne peuvent
rien fur ce mixte ; cette incorruptibilité abfolue a été
obfervée il y a long-tems. C ’eft fans doute d’après
cette obfervation que les architectes qui bâtirent le
fameux temple d’Ephefe, en poferent les fondemens
fur une couche de charbon de bois , fait hiftorique
que les Chimiftes n’ont pas manqué de noter; &
qu’au rapport de Maillet, les pauvres égyptiens qui
n’étoieht pas en état de faire embaumer leurs corps,
de la durée defquels ils étoient fi jaloux, les faifoient
enterrer dans une couche de charbon. Voye? Embaumem
ent.
Les ufages chimiques du charbon font très-étendus
; d’abord il fournit au Chimifte l’aliment le plus
ordinaire & le plus commode du feu qu’il employé
dans la plûpart de fes .opérations. Ce charbon doit
être choifi dur, compaCt, fonnant & fec ; il doit
être aufli tout charbon parfait, ou, ce qui eft la même
chofe , n’être pas mêlé de fumerons : ce choix
importe principalement à la commodité de l’artifte.
Secondement-, comme mixte inflammable fixe, il
fournit au Chimifte le principe du feu , ou le phlogiftique
; c’ eft dans ce mixte qu’il prend ce principe