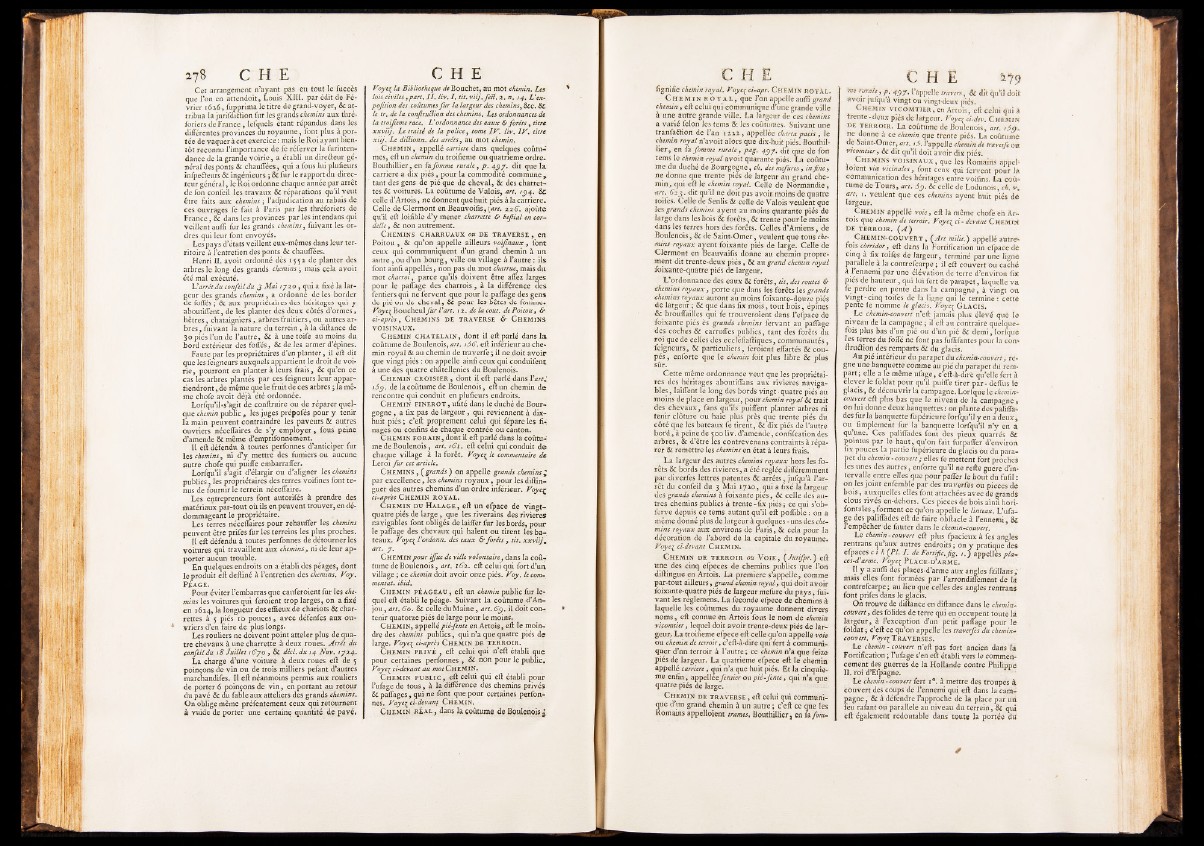
Cet arrangement n’ayant pas eu tout le fuccès
que l’on en attendoit, Louis XIII. par édit de Février
1626, fupprima le titre de grand-voyer, & attribua
la jurifdittion fur les grands chemins aux thré-
foriers de France, lefquels étant répandus dans les
différentes provinces du royaume, font plus à portée
de vaquer à cet exercice : mais le Roi ayant bientôt
reconnu l’importance de fe réferver la furinten-
dance de la grande voirie, a établi un directeur général
des ponts & chauffées, qui a fous lui plufieurs
infpefteurs & ingénieurs ; & fur le rapport du directeur
général, le Roi ordonne chaque année par arrêt
de fon confeil les travaux & réparations qu’il veut
être faits aux chemins ; l’adjudication au rabais de
ces ouvrages fe fait à Paris par les thréforiers de
France, & dans les provinces par les intendans qui
veillent auffi fur les grands chemins, fuivant les ordres
qui leur font envoyés.
Les pays d’états veillent eux-mêmes dans leur territoire
à l’entretien des ponts & chauffées.
Henri II. avoit ordonné dès 1552 de planter des
arbres le long des grands chemins ; mais cela avoit
été mal exécuté.
L’arrêt du confeil du 3 Mai 1720, qui a fixé la largeur
des grands chemins, a ordonné de les border
de foffés ; & aux propriétaires des héritages qui y
aboutiffent, de les planter des deux côtés d’ormes,
hêtres, châtaigniers ^.arbres fruitiers, ou autres arbres
, fuivant la nature du terrein , à la diftance de
30 piés l’un de l’autre, & à une toife au moins du
bord extérieur des foffés, & de les armer d’épines.
Faute par les propriétaires d’en planter, il eff dit
que les feigneurs auxquels appartient le droit de voirie
, pourront en planter à leurs frais, & qu’en ce
cas les arbres plantés par ces feigneurs leur appartiendront
, de même que le fruit de ces arbres ; la même
chofe avoit déjà été ordonnée.
Lorfqu’il»s’agit de conftruire ou de réparer quelque
chemin public 0 les juges prépofés pour y tenir
la main peuvent contraindre les paveurs & autres
ouvriers néceffaires de s’y employer, fous peine
d’amende & même d’emprifonnement.
Il eft défendu à toutes perfonnes d’anticiper fur
les chemins, ni d’y mettre des fumiers ou aucune
autre chofe qui puiffe embarraffer.
Lorfqu’il s’agit d’élargir ou d’aligner les chemins
publics, les propriétaires des terres voifines font tenus
de fournir le terrein néceffaire.
Les entrepreneurs font autorifés à prendre des
matériaux par-tout où ils en peuvent trouver, en dédommageant
le propriétaire.
Les terres néceffaires pour rehauffer les chemins
peuvent être prifes fur les terreins les plus proches.
Il eft défendu à toutes perfonnes de détourner les
voitures qui travaillent aux chemins, ni de leur apporter
aucun trouble.
En quelques endroits on a établi des péages, dont
le produit eft deftiné à l’entretien des chemins. Voy.
PEAGE.
Pour éviter l’embarras que cauferoient fur les chemins
les voitures qui feroient trop larges, on a fixé
en 1624, la longueur des eflieux de chariots & charrettes
à 5 piés 10 pouqes, avec défenfes aux ouvriers
d’en faire de plus longs.
Les rouliers ne doivent point atteler plus de quatre
chevaux à une charrette à deux roues. Arrêt du
confeil du 18 Juillet 1G70 , & dicl. du 14 Nov. 17x4.
La charge d’une voiture à deux roues eft de 5
poinçons de vin ou de trois milliers pefant d’autres
marchandifes. Il eft néanmoins permis aux rouliers
de porter 6 poinçons de v in , en portant au retour
du pavé & du fable aux atteliers des grands chemins.
On oblige même préfentement ceux qui retournent
à vuide de porter une certaine quantité de pavéi
Voye{ la Bibliothèque de Bouchet, au mot chemin. L u
lois civiles , part. I I . liv. I. tit. viij .fecl. 2. n. 14. L'ex-
pofition des coutumes fur la largeur des chemins, & c . &
le tr. de la confiruclion des chemins. Les ordonnances de
la troifieme race. L'ordonnance des eaux & forêts, titre
xxviij. Le traité de la police, tome IV . liv, IV. titre
xiij. Le diclionn. des arrêts, au mot chemin.
C hemin , appellé carrière dans quelques coûtu-
mes, eft un chemin du troifieme ou quatrième ordre.
Bouthillier, en fa fomme rurale, p. 497. dit que la
carrière a dix pié s, pour la commodité commune ,
tant des gens de pié que de cheval, & des charrettes
& voitures. La coutume de Valois, art. 194. &
celle d’Artois, ne donnent que huit piés à la carrière.
Celle de Clermont en Beauvoifis, [art. 226". ajoûte
qu’il eft loifible d’y mener charrette & bejlial en cor-
delle, & non autrement.
C hemins ch arruaux ou de tr av erse , en
Poitou , & qu’on appelle ailleurs voijinaux , font
ceux qui communiquent d’un grand chemin à un
autre, ou d’un bourg, ville ou village à l’autre : ils
font ainfi appelles , non pas du mot charrue^ mais du
mot charroi y parce qu’ils doivent être allez larges
pour le paffage des charrois, à la différence des
fentiers qui ne fervent que pour le paffage des gens
de pié ou de cheval, & pour les bêtes de fomme.
Voye{ Boucheul fur l'art. 12. de la coût, de Poitou, &
ci-après, C hemins DE TRAVERSE & CHEMINS
VOISINAUX.
C hemin ch â t e l a in , dont il eft parlé dans la
coutume de Boulenois, art. 16G. eft inférieur au che»
min royal & au chemin de traverfe ; il ne doit avoir
que vingt piés : on appelle ainfi ceux qui conduifent
à une des quatre châtellenies du Boulenois.
C hemin cr ois ie r , dont il eft parlé dans l’art*
16c,. de la coutume de Boulenois, eft un chemin de
rencontre qui conduit en plufieurs endroits.
C hemin finerot , ufité dans le duché de Bourgogne
, a fix pas de largeur, qui reviennent à dix-
huit piés ; c’eft proprement celui qui fépare les finages
ou confins de chaque contrée ou canton.
C hemin f o r a in , dont il eft parlé dans la coutume
de Boulenois, art. 161. eft celui qui conduit de
chaque village à la forêt. Voye^ le commentaire de
Leroi fur cet article.
C hemins , ( grands ) on appelle grands chemins ^
par excellence, les chemins royaux, pour les diftin-
guer des autres chemins d’un ordre inférieur. Voyeç
ci-après CHEMIN ROYAL.
C hemin du Ha l a g e , eft un efpace de vingt-
quatre piés de large, que les riverains des rivières
navigables font obligés de laiffer fur les bords, pour
le paffage des chevaux qui halent ou tirent les ba-,
teaux. Voyt^ l'ordonn. des eaux & forêts , tit. xxviij•
art. 7 .
C hemin pour iffue de ville volontaire, dans la coû-
tume de Boulenois, art. 162. eft celui qui fort d’un
village ; ce chemin doit avoir onze piés. Voy, le commentât.
ibid.
C hemin péageau , eft un chemin public fur lequel
eft établi le péage. Suivant la coûtume d’Anjou
, art. Go. & celle du Maine, art. Gg. il doit con-,
tenir quatorze piés de large pour le moins.
C hemin, appellé pie-fente en Artois, eft le moindre
des chemins publics, qui n’a que quatre piés de
large. Voye{ ci-après C hemin de terro ir.
C hemin pr iv é , eft celui qui n’eft établi que
pour certaines perfonnes , & non pour le public.
Voye[ ci-devant au mot CHEMIN.
C hemin p u b l ic , eft celui qui eft établi pour
l’ufage de tous, à la différence des chemins privés
& paffages, qui ne font que pour certaines perfonnes.
Voye£ ci-devanf CHEMIN.
C hemin réal , dans la coûtume de Boulenois £
lignifie chemin royal. Voye£ ci-apr. CHEMlto ROYAL.
C h eMin r o y a l , que l’on appelle auffi grand
chemin , eft celui qui communique d’une grande ville
à une autre grande ville. La largeur de ces chemins
a varié félon les tems & les coutumes. Suivant une
tranfa&ion de l’an 1222, appellée char ta pacis , le
chemin royal n’avoit alors que dix-huit piés. Bouthillier,
en h fomme rurale, pag. 4^7. dit qüe de fon
tems le chemin royal avoit quarante piés. La coutume
du duché de Bourgogne, ch. des mefures -, in fine >
ne donne que trente piés de largeur au grand chemin,
qui eft le chemin royal. Celle de Normandie -,
'art. G23. dit qu’il ne doit pas avoir, moins de quatre
toifes. Celle de Senlis & celle de Valois veulent que
les grands chemins ayent au moins quarante piés de
large dans les bois & forêts, & trente pour le moins
dans les terres hors des forêts. Celles d’Amiens, de
Boulenois, & de Saint-Omer, veillent que tous chemins
royaux ayent foixante piés de large. Celle de
Clermont en Beauvaifis donne au chemin proprement
dit trente-deux p iés, & au grand chemin royal
foixante-quatre piés de largeur.
L’ordonnance des eaux & forêts, tit. des routes &
themins royaux, porte que dans les forêts les grands
chemins royaux auront au moins foixante-douze piés
de largeur ; & que dans fix mois, tout b ois, épines
& brouffailles qui fe trouveroient dans l’efpace de
foixante piés ès grands chemins fervant au paffage
des coches & carroffes publics, tant des forêts du
roi que de celles des eccléfiaftiques, communautés,
feigneurs, & particuliers, feroient effartés & coupés
, enforte que le chemin foit plus libre & plus
sûr.
Cette même ordonnance veut que les propriétaires
des héritages aboutiffans aux rivières navigables,
laiffent le long des bords vingt-quatre piés au
moins de place en largeur, pour chemin royal & trait
des chevaux, fans qu’ils' puiffent planter arbres ni
tenir clôture ou haie plus près que trente piés du
côté que les bateaux fe tirent, & dix piés de l’autre
bord, à peine de 500 liv. d’amende, confifcation des
arbres, & d’être les contrevenans contraints à réparer
& remettre les chemins en état à leurs frais.
La largeur des autres chemins royaux hors les forêts
& bords des rivières, a été réglée différemment
par diverfes lettres patentes & arrêts, jufqu’à l’arrêt
du confeil du 3 Mai 1720, qui a fixé la largeur
des grands chemins à foixante pies, & celle des autres
chemins publics à trente-fix piés; ce qui s’ob-
ferve depuis ce tems autant qu’il eft poflible : on a
même donné plus de largeur à quelques-uns des chemins
royaux aux environs de Paris, & cela pour la
décoration de l’abord de la capitale du royaume.
Voye^ ci-devant CHEMIN.
C hemin de te rro ir ou V o ie , (Jurifpr.) eft
une des cinq efpeces de chemins publics que l’on
diftingue en Artois. La première s’appelle, comme
par-tout ailleurs, grand chemin royal, qui doit avoir
foixante-quatre piés de largeur meftire du pays , fuivant
les reglemens. La fécondé efpece de chemins à
laquelle les coutumes du royaume donnent divers
noms, eft connue en Artois fous le nom de chemin
vicomtier, lequel doit avoir trente-deux piés de largeur,
La troifieme efpece eft celle qu’on appelle voie
ou chemin de terroir, c’eft-à>dire qui fert à communiquer
d’nn terroir à l ’autre ; ce chemin n’a que feizé
piés de largeur. La quatrième efpece eft le chemin
appellé carrière, qui n’a que huit piés. Et la cinquième
enfin, appelleeJenner ou pié-fente, qui n’a que
quatre piés de large.
C hemin de tr a v er se , eft celui qui communique
d’un grand chemin à un autre ; c’eft ce que les
Romains appelaient trames. Bouthillier} en la fouir-
We Ÿurale, p. 4^7. l’appelle travers, & dit qu’il doit
avoir jufqu’à vingt ou vingt-deux piés.
C hemin v ic om t ie r , en Artois, eft celui qui â
trente - deux piés de largeur. V)yeç ci-dev. C hemin
de terro ir. La coûtume de Boulenois, art. 16g.
ne donne à ce chemin que tfente piés. La coûtumô
de Saint-Omer, art. 16. l’appelle chemin de traverfe oit
vicomtier, & dit qu’il doit avoir dix piés.
C hemins v o is in a u x , que les Romains appel-
loient via vicinales , font ceux qui fervent pour là
communication des héritages entre voifins. La coutume
de Tours, art. 6c,. & celle de Lodunois, ch. v-.
art-, 1. veulent que ces chemins ayent huit piés dé
largeur.
C hemin appellé voie, eft là même chofe eh Artois
que chemin de terroir. Voye£ ci-devant C hemin
DE TERROIR. (A )
C hemin-co u v er t , (Art mïlit.) appellé autrefois
corridor, eft dans la Fortification un efpace dé
cinq à fix toifes de largeur, terminé par une ligné
parallèle à la contrefcarpe ; il eft couvert ou caché
à l’ennemi par une élévation de terre d’environ fix
pies de hauteur, qui lui fert de parapet, laquelle v a
fe perdre en pente dans la campagne, à vingt ou
vingt - cinq toifes de la ligne qui le termine : cetté
pente fe nomme le glacis. Voye^ G l à c îs .
Le chemirt-couvert n’eft jamais plus élevé que ié
niveau de la campagne ; il eft au contrairè quelquefois
plus bas d’un pié ou d’un pié & demi, lorlqué
les terres du foffé ne font pas fuffifantes pour la corn
ftritélion des remparts & du glacis.
Au pié intérieur du parapet du chemin-couV èrl, régne
une banquette comme au pié du parapet dû rempart;
elle a le même ufage, c’eft-à-dirê qu’elle fert à
elever le foldat pour qu’il puiffe tirer par - deffus le
glacis, & découvrir la campagne. Lorfque le chemin-
couvert eft plus bas que le niveau de la campagne ,
on lui donne deux banquettes: on plante des palifla-
des fur la banquette fupérieure lorfqu’il y en a deux,
Ou fimplement fur la banquette lorfqu’il n’y en a
qu une. Ces paliffades font des pieux quarrés Ô£
pointus par le haut, qu’on fait furpaffer d’environ
fix pouces la partie fupérieure du glacis ou du parapet
du chemin - couvert ; elles fe mettent fort proches
les unes des autres, enforte qu’il ne refte guere d’intervalle
entre elles que pour pafler le bout du fufil :
on les joint enfemble par des traverfes ou pièces de
bois, auxquelles elles font attachées avec de grands
clous rivés en-dehors. Ces pièces de bois ainfi hori-
fontales, forment ce qu’on appelle le linteau. L’ufage
des paliffades eft de faire obftacle à l’ennemi, &
l’empêcher de fauter dans le chemin-couvert.
Le chemin-couvert eft plus fpacieux à fes angles
rentrans qu aux autres endroits ; on y pratique des
efpaces c i h (PI. I. de Fortifie, fig. 1. ) appellés pla-
tcs-d'arme. Voye{ Pl a c e -d’a rm e. "
Il y a auffi des places-d’arme aux angles faillans
mais elles font formées par l’arrondiffement de la
contrefcarpe ; au lieu que celles des angles rentrans
font prifes dans le glacis.
On trouve de diftance en diftance dans le chemin-
couvert, des folides de terre qui en occupent toute là
largeur, à l’exception d’un petit paffage pour le
foldat ; c’eft ce qu’on appelle les traverfes dit chemin-
couvert. Vcye{ T raverses.
Le chemin - couvert n’eft pas fort ancien dans la
Fortification ; l’ufage s’en eft établi vers le commencement
des guerres de la Hollande contre Philippe
II. toi d’Efpaghe.
Le chemirt-couvert fert t°. à mettre des troupes à
couvert des coups de l’ennemi qui eft dans la campagne
, & à défendre l’approche de la place par un
feu rafant où parallèle au niveau du terrein, & qui
eft également redoutable dans toute la portée du
✓