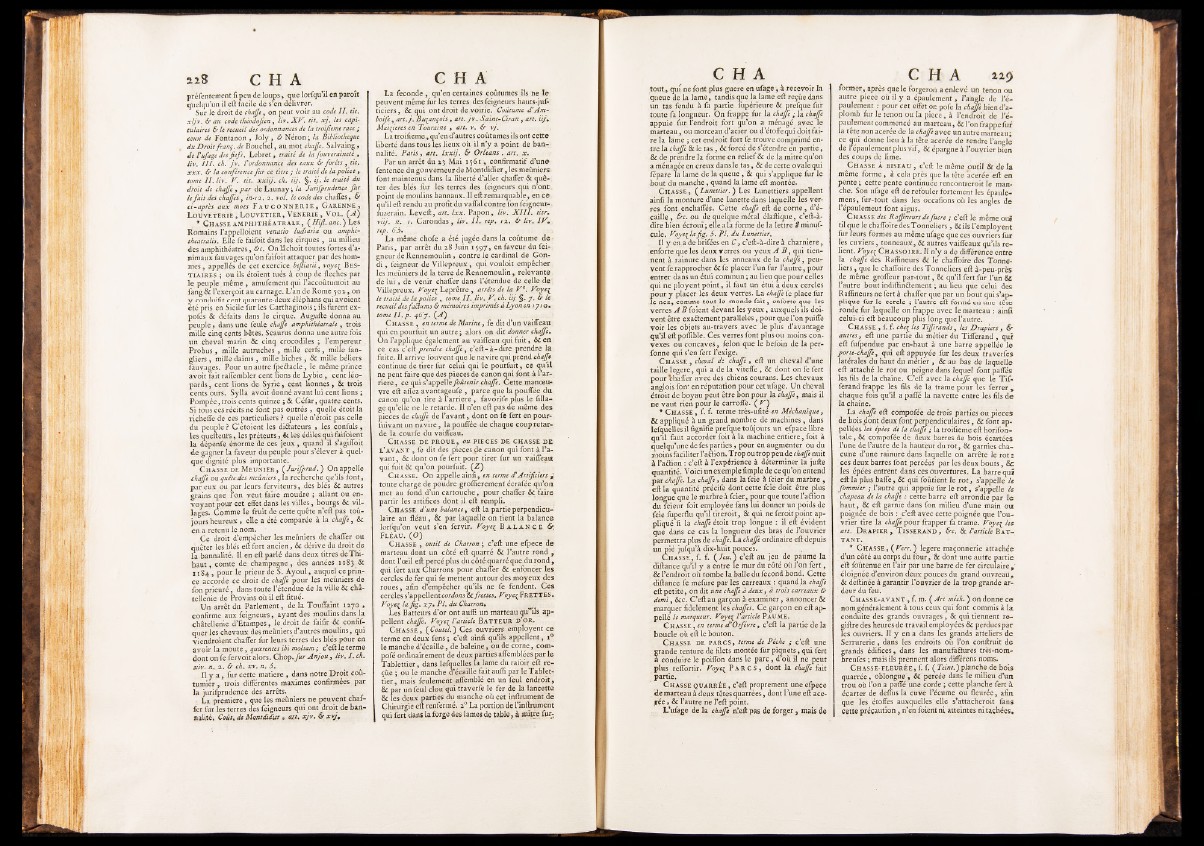
préfentement fi peu de loups, aue lorfqu’il en paroît
quelqu’un il eft facile de s’cn délivrer.
Sur le droit de chaJJe, on peut voir au code I I. tic.
xljv. & au code thèodojien, liv. X V . tit. x j. les capitulaires
& le recueil des ordonnances de la troifieme race ;
ceux de Fontanon , Joly, & Néron ; la Bibliothèque
du Droit frang. de Bouchel, au mot chaffe. Salvaing >
de Vufage des fiefs. Lebret, traité de la fouverainetè ,
liv. III- ch. jv . l'ordonnance des eaux & forêts , tit.
xxx. & la conférence fur ce titre ; le traité de la police ,
tome I I . liv. V. tit. xxiij. ch. iij. §. ij. le traité du
droit de chaffe , par de Launay ; la Jurifprudence fur
U fait des chajfes, in-tu. 2. vol. le code des chaffes, 6*
ci-après aux mots F a u c o n n e r i e , Garenn e,
L oUVETERIÈ , LoUVÈTIER, VENERIE , VOL. (A )
* C hASSE AMPHITHÉATRALE, ( Hift. anc. ) Les
Romains l’appelloient venatio ludiaria ou amphi-
theatralis. Elle fe faifoit dans les cirques , au milieu
des amphithéâtres, &c. On lâchoit toutes fortes d’animaux
fauvages qu’on faifoit attaquer par des hommes
, appellés de cet exercice befliarii, voye{ Best
iair e s ; ou ils étoient tués à coup de fléchés par
le peuple même , amufement qui l’accoûtumoit au
fang 8c l’exerçoit au carnage. L’an de Rome 501, on
y conduifit cent quarante-deux éléphans qui avoient
été pris en Sicile fur les Carthaginois ; ils furent ex-
pofés & défaits dans le cirque. Augufte donna au
peuple , dans une feule chaffe amplùthéatrale , trois
mille cinq cents bêtes. Scaurus donna une autre fois
un cheval marin 8c cinq crocodiles ; l’empereur ,
Probus , mille autruches , mille cerfs, mille fan-
gliers , mille daims , mille biches, & mille béliers
fauvages. Pour un autre fpeétacle, le même prince
ayoit fait raffembler cent lions de Lybie , cent léopards,
cent lions de Syrie, cent lionnes, & trois
cents ours. Sylla avoit donné avant lui cent lions ;
Pompée,trois cents quinze ; & Céfar, quatre cents.
Si tous ces récits ne font pas outrés , quelle étoit la
richeffe de ces particuliers ? quelle n’étoit pas celle
du peuple ? C ’étoient les dittateurs , les confuls ,
les quefteurs, les préteurs , & les édiles qui faifoient
la dépenfe énorme de ces jeux, quand il s’agifToit
de gagner la faveur du peuple pour s’élever à quelque
dignité plus importante.
C hasse de Meunier , ( Jurifprud. ) On appelle
chaffe ou quête des meuniers, la recherche qu’ils font,
par eux ou par leurs ferviteurs, des blés 8c autres
grains que l’on veut faire moudre ; allant ou envoyant
pour cet effet dans les v illes, bourgs 8c villages.
Comme le fruit de cette quête n’eft pas toujours
heureux , elle a été comparée à la chaffe, 8c
en a retenu le nom.
Ce droit d’empêcher les meuniers de chaffer ou
quêter les blés eft fort ancien, 8c dérive du droit de
la bannalité. Il en eft parlé dans deux titres de Thib
au t, comte de champagne, des années 1183.8c
1 18 4 , pour le prieur de S. Ayou l, auquel ce prince
accorde ce droit de chaffe pour les meûniers de
fon prieuré, dans toute l’étendue de la ville 8c châtellenie
de Provins oii il eft fitué.
Un arrêt du Parlement, de la Touffaint 1170 ,
confirme aux feigneurs, ayant des moulins dans la
châtellenie d’Etampes, le droit de faifir & confif-
quer les chevaux des meûniers d’autres moulins, qui
viendraient chaffer fur leurs terres des blés pour en
avoir la moute, quoerentes ibi moltam; c’eft le terme
dont on fe fier voit, alors. Chop.y«r Anjou, liv. I . ch.
xiv. n. 2. & ch. xv. m -
Il y a , fur cette matière , dans notre D roit coutumier
, trois differentes maximes confirmées par
la jurifprudence des arrêts.
La première, que les meûniers ne peuvent chaffer
fur les terres des feigneurs qui ont droit de bannalité,
Coût, de Montdidier » Qtt, xjv. & xvj9
La fécondé , qu’en certaines coûtumes ils ne le
peuvent même fur les terres des feigneurs hauts-juf*
ticiers, 8c qui ont droit de voirie. Coutume d'Am-
boife, art.j. Bu^ançois, art. jv . Saint- Ciran 9art. iij.
Maifieres en Touraine , art. v. & vj.
La troifieme, qu’en d’autres coûtumes ils ont cette
liberté dans tous les lieux où il n’y a point de bannalité.
Paris, art. Ixxij. & Orléans . art. x.
Par un arrêt du 13 Mai 15 6 1 , confirmatif d’une
fentence du gouverneur de Montdidier, les meûniers
font maintenus dans la liberté d’aller chaffer 8c quêter
des blés fur les terres des feigneurs qui n’on t.
point de moulins bannaux. Il eft remarquable, en ce
qu’il eft rendu au profit du vaffal contre fon feigneur-.
luzerain. Leveft, art. Ixx. Papon, liv. X I I I . titr.
viij. n. t. Carondas , liv. I I . rep. 12. & liv. IV*
rep. 65-
La même chofe a été jugée dans la coûtume de
Paris, par arrêt du 28 Juin 1597, en faveur du fei-;
gneur de Rennemoulin, contre le cardinal de Gon-
d i , feigneur de Villepreux, qui vouloit empêcher.
les meûniers de la terre de Rennemoulin, relevante
de lu i, de venir chafler dans l’étendue de celle de
Villepreux. Voye^ Leprêtre , arrêts de la V*. Voye{
le traité de la police , tome I I . liv. V. ch. iij § .7 . & le
recueil des fa&ums & mémoires imprimés à Lyon en iy io .
tome II. p. 467. (A )
C hasse , en terme de Marine, fe dit d’un vaifleau
qui en pourfuit un autre ; alors on dit donner chaffe.
On l’applique également au vaifleau qui fuit, & en
ce cas c’eft prendre chaffe, c’eft-à-dire prendre la
fuite. Il arrive fouvent que le navire qui prend chaffe
continue de tirer fur celui qui le pourfuit, ce qu’il
ne peut faire que des pièces de canon qui font à l’ar-
riere, ce qui s’appelle fouunir chaffe. Cette manoeuvre
eft affez avantageufe , parce que la pouflee du
canon qu’on tire à l ’arriere , favorife plus le fillà-
ge qu’elle ne le retarde. Il n’en eft pas de même des
pièces de chaffe de l’avant, dont on fe fert en pour-
fuivant un navire, la pouflee de chaque coupretar-,
de la courfe du vaifleau.
C hasse de p r o u e , ou pièces de chasse de
l’avant , fe dit des pièces ^e canon qui font à l’avant
, 8c dont on fe fert pour tirer fur un vaifleau
qui fuit 8c qu’on pourfuit. (Z )
C h asse. On appelle ainfi, en terme eT Artificiers i
toute charge de poudre groflieremenf écrafée qu’on
met au fond d’un cartouche, pour chaffer & faire
partir les artifices dont il eft rempli.
C hasse d'une balance, eft la partie perpendiculaire
au fléau, 8c par laquelle on tient la balance
Iorfqu’on veut s’en fervir. Vjye^ B a l a n c e
Flé au . (O)
C hasse , outil de Charron ; c’eft une efpece de
marteau dont un côté eft quarré 8c l ’autre rond ,
dont l’oeil eft percé plus du côté quarré que du rond ,
qui fert aux Charrons pour chaffer 8c enfoncer les
cercles de fer qui fe mettent autour des moyeux des
roues, afin d’empêcher qu’ils ne fe fendent. Ces
cercles s’appellent cordons 8c frettes, Vyye^ Fre t te s .
Voyei la fig. 27. PI. du Charron.
Les Batteurs d’or ont aufli un marteau qu’’ils appellent
chaffe. Voye[ l'article Ba t t eu r p’pR.
C h a s s e , ( Côutel.) Ces ouvriers employent ce
j terme en deux fens ; c’eft ainfi qu’ils appellent, i°
le manche d’écaille, de baleine, ou de corne, com-
pofé ordinairement de deux parties affemblees par le
Tablettier, dans lefquelles la lame du rafoir eft reçue
; ou le manche d’écaille fait aufli par le Tablettier
, mais feulement affemblé en un feul endroit,
& par un feul clou qui traverfe le fer de la lancette
& les deux parties du manche où cet inftrument de
Chirurgie eft renfermé. i ° La portion de l’inftrument
qui fert dans la forge des lames de table, à mitre furtout,
qui ne font plus guere en ufage, à recevoir la
queue de la lame, tandis que la lame eft reçûe dans
un tas fendu à fa partie lupérieure & prefque fur
toute fa longueur. On frappe fur la chaffe ; la chaffe
appuie fur- l’endroit fort qu’on a ménagé avec le
marteau, ou morceau d’acier ou d ’étoffe qui doit faire
la lâme ; cet endroit fort fe trouve comprimé entre
la chaffe & le tas , & forcé de s’étendre en partie,
& de prendre la forme en relief & de la mitre qu’on
a ménagée en creux dans le tas, & de cette ovale qui
fépafe la lame de la queue , & qui s’applique fur le
bout du manche, quand la lame eft montée.
C h a s se , ( Lunettier. ) Les Lunettiers appellent
ainfi la monture d’une lunette dans laquelle les verres,
font enchaffés. Cette chaffe eft de corne, d’écaille
, &c. ou de quelque métal élaftique, c’eft-à-
dire bien écroui ; elle a la forme de la lettre 2 minuf-
cule. Voye^ la fig. 5. PI. du Lunettier.
Il y en a de brifées en C , c’eft-à-dire à charnière,
enforte que les deux verres ou yeux A B , qui tiennent
à- rainure dans les anneaux de la chaffe, peuvent
fe rapprocher & fe placer l’un fur l’autre, pour
entrer dans un étüi commun ; au lieu que pour celles
qui ne ployent point, il faut un étui à deux cercles
pour y placer les deux verres. La chaffe fe place fur
le nez, comme tout le monde fait, enforte que les
verres A B foient devant les y eu x, auxquels ils doivent
être exactement parallèles, pour que l’on puiffe
voir les objets au-travers avec le plus d’avantage
qu’il eft poflible. Ces verres font plus ou moins convexes
ou concaves, félon que le befoin de la per-
fonne qui s’en fert l’exige.
C hasse , cheval de chaffe , eft un cheval d’une
taille legere, qui a de la vîteffe , 8c dont on fe fert
pour thafler avec des chiens courans. Les chevaux
anglois fon. en réputation pour cet ufage. Un cheval
étroit de boyau peut être bon pour la chaffe, mais il
ne vaut rien pour le carroffe. ( V )
* CHASSE, f. f. terme très-ufité en Mèchanique,
& appliqué à un grand nombre de machines , dans
lefquelles il fignifie prefque toujours un efpace libre
qu’il faut accorder foit à la machine entière, foit à
quelqu’une de fes parties, pour en augmenter ou du
moins faciliter l’aftion, Tropoutroppeu de chaffe nuit
à l’a&ion : c’eft à l’expérience à déterminer la jufte
quantité. Voici un exemple fimple de ce qu’on entend
par chaffe. La chaffe , dans la feie à feier du marbre ,
eft la quantité précife dont cette fcié doit être plus
longue que le marbre à feier, pour que toute l’a&ion
du feieur foit employée fans lui donner un poids de
feie fuperflu qu’il tireroit, 8c qui ne feroitppint appliqué
fi la chaffe étoit trop longue : il eft évident
que dans ce cas la longueur des bras de l’ouvrier
permettra plus de ckajfc.Lz chaffe ordinaire eft depuis
un pié jufqu’à dix-huit pouces.
C h asse, f. f. (/« * .; c’eft au jeu de paume la
diftance qu’il y a entre le mur du côté où l’on fe r t,
& l’endroit où tombe la balle du fécond bond. Cette
diftance fe mefure par les carreaux : quand la chaffe
eft petite, on dit une chaffe à deux, à trois carreaux &
demi, &c. C ’eft au garçon à examiner, annoncer &
marquer fidelèment les chaffes. Ce. garçon en eft ap-
pellé le marqueur. Voye1 l'article PAUME.
C hasse , en terme d'Orfèvre, c’eft la partie de la
boucle où eft le bouton.
CHASSE de p a r c s , terme de Pêche ; c’eft une
grande tenture de filets montée fur piquets, qui fert
a conduire le poiffon dans le pa rc, d’où il ne peut
plus reffortir. Voye{ P a r c s , dont la chaffe fait
partie.
C hasse q uarrée, c’eft proprement une efpece
de marteau à deux têtes quarrées, dont l ’une eft ace-
jrée, & l’autre ne l’eft point.
L ’ufage de la chaffe m’eft pas de forger, mais de
former , après que le forgeron a enlevé un tenon ou
autre pie ce où il y a épaulement, l’angle de l’é-
paulement : pour cet effet or. pofe la chaffe bien d’aplomb
fur le tenon ou la piece, à l’endroit de l’é-
paulement commencé au marteau, & l’on frappe fur
la tête non acerée de la chaffe avec un autre marteau;
ce <jui donne lieu à la tête acerée de rendre l’angle
de 1 épaulement plus v if, & épargne à l’ouvrier bien
des coups de lime.
C hasse a biseau , c’eft le même (outil 8c de la
même forme, à cela près que la tête aCerée eft en
pente ; cette pente continuée rencontreroit le manche.
Son ufage eft de refouler fortement les épaule-
mens, fur-tout dans les occafions où les angles de
l’épaulemeut font aigus,
CHASSE des Raffineurs defucré ; c’eft le même ou*
til que le chaffoire des Tonneliers, & ils l’employent
fur leurs formes au même ufage que ces ouvriers fur
les cuviers, tonneaux, & aurres vaifleaux qu’ils relient.
Viye£ C hassôire. Il n’y a de différence entre
la chaffe dès Raffineurs & le chaffoire des Tonneliers
, que le chaffoire des Tonneliers eft à-peu-près
de même groffeur par-tout, 8c qu’il fert fur l’un &
l’autre bout indiftinfrement ; au lieu que celui des
Raffineurs ne fert à chaffer.que par un bout qui s’applique
fur le cercle ; l’autre eft formé en une tête
ronde fur laquelle on frappe avec le marteau : ainfi
celui-ci eft beaucoup plus long que l’autre.
C hasse , f. f. che^ les Tifferands, les Drapiers, 6*
autres y eft une partie du métier du Tiflerand , qui
eft fufpendue par en-haut à une barre appellée le
porte-chaffe, qui eft appuyée fur les deux traverfes
latérales du haut du métier , 8c au bas de laquelle
eft attaché le rot ou peigne dans lequel font paffés
les fils de la chaîne. C ’eft avec la chaffe que le Tif-
ferand frappe les fils de la trame pour les ferrer y
chaque fois qu’il a paffé la navette entre les fils de
la chaîne.
La chaffe eft compofee de trois parties ou pièces
de boi$tdont deux font perpendiculaires, 8c font app
e lle s les épées de la chaffe ; la troifieme eft horifon-
ta le, 8c compofée dè deux barres de bois écartées
l’une de l’autre de la hauteur du rot, 8c garnies chacune
d’une rainure dans laquelle on arrête le rot t
ces deux barres font percées par les deux bouts, 8c
les épées entrent dans ces ouvertures. La barre qui
eft la plus baffe, 8c qui foûtient le ro t, s’appelle le
fommier.; l’autre qui appuie fur le ro t , S’appelle le
chapeau de la chaffe : cette barre eft arrondie par le
haut, 8c eft garnie dans fon milieu d’une main ou
poignée de bois : c’eft avec cette poignée que l’ouvrier
tire la chaffe pour frapper fa trame. Voye[ les
art. D rapier , T isserand , &c. 8c l'article Ba t t
a n t .
* C h asse, ( Verr.) legere maçonnerie attachée
d’un côté au corps du fùur, 8c dont une autre partie
eft foûtenué en Pair par une barre de fer circulaire ,
éloignée d’environ deux pouces du grand ouvreau,
& deftinée à garantir l’ouvrier de la trop grande ardeur
du feu.
C hasse- a v an t , f. m. ( Art méch- ) on donne ce
nom généralement à tous ceux qui font commis à la
conduite des grands ouvrages, 8c qui tiennent re-
giftre des heures de travail employées 8c perdues par
les ouvriers. Il y en a dans les grands atteliers de
Serrurerie, dans les endroits où l’on conftruit de
grands édifices, dans les manufactures très-nom-
breufes ; mais ils prennent alors différens noms.
C hasse-fleurée, f. f. ( Teint.') planche de bois
quarrée, oblongue , 8c percée dans le milieu d’un
trou où l’on a paffé une corde ; Cette planche fert à
écarter de deffus la cuve l’écume ou fleurée, afin
que les étoffes auxquelles elle s’attâcheroit fans
cette précaution, n’en foient ni atteintes ni tachées.