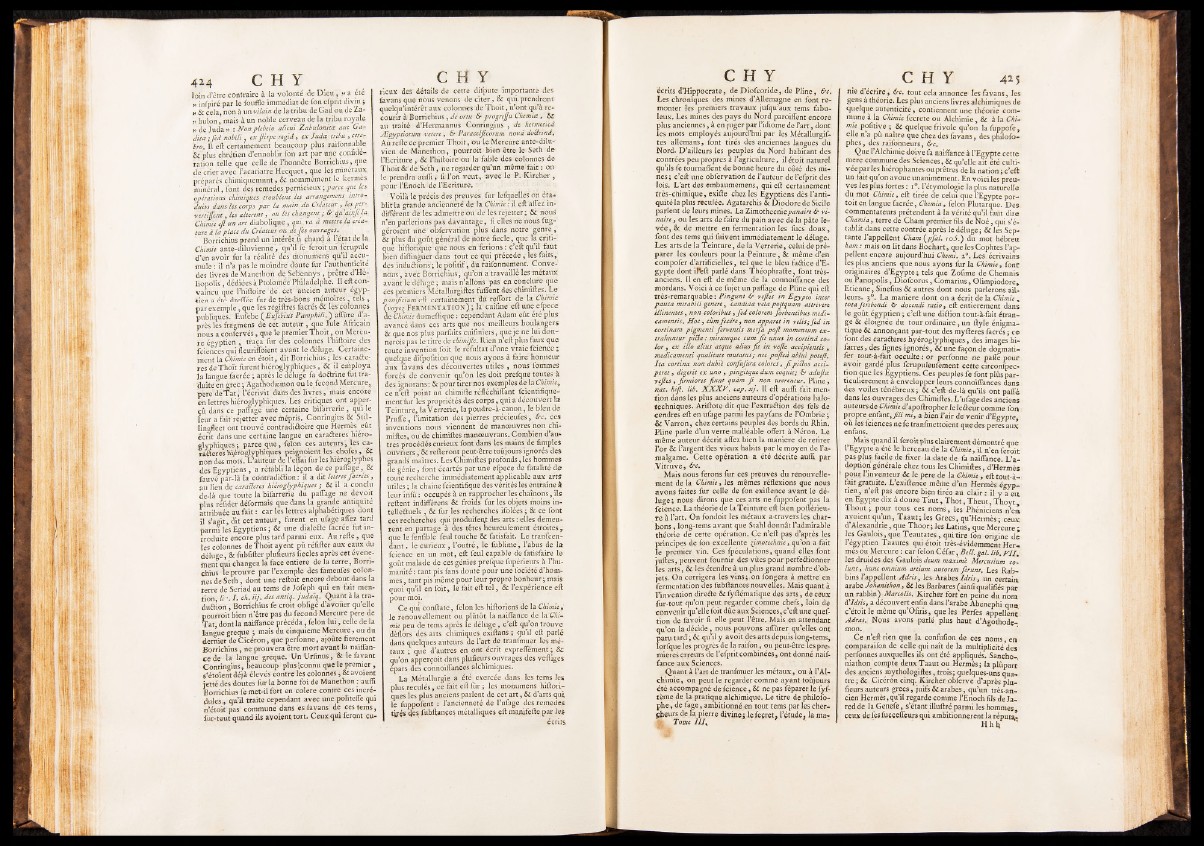
I I
nj:
loin d’être contraire à .la volonté de D ie u , » a ete
»> infpiré par le fouffle immédiat de Ton efprit divin ;
„ & cela, non à un vilain de latribu'de Gad ou de Za-
» bulon, mais à un noble cerveau de la tribu royale
» de Juda » : Non plebeio aticui Zabulonim aut Gar
duoe ;Jed nobili, ex fikpe regid , ex Juda tribu , cere-
bro. Il eft certainement beaucoup plus raifonnable
plus chrétien d’ennoblir ion art par une confidér
ration telle que celle de l’honnête Borrichius, que
de" crier avec l’acariatre Hecquet., que les minéraux,
préparés chimiquemnnt, êc nommément le kermes
minéral, font. des remedes pernicieux ; pake que f*s
opérations chimiques troublent les arrangement introduits
dans les corps par la main du Créateur ,fies per- .
vertijfent, les altèrent, ou lés changent > quAinfifa
Chimie, ejl un art diabolique , qui . va à mettre.la. créa- \
ture à la place du Créateur'ou,defes ouvrages. ^
Borrichius prend un interèÿfi çhapj à l’état de la.
Chimie ante-diluvienne,. qu’ il le feroit un fcrupule :
d’en avoir fur la réalité dés niOnuinéhà qü’il accumulé
: il n’a pas le moindre' d'oute fur l’authenticite
des livres de Manethon dé Sébennys , prêtre d’Hé-
liopolis, dédiées à Ptoïôriiéè'Philadelphe. Il éft convaincu
que l’hiftoire dé. éét' alicien autélir égyptien
a été drelfée fur de très-bons mémoires ,' tels ,
par exemple, que les regiftres facrés & lès colonnes
publiques. Eufebe ( EuJebiWS Pamphili. ) allure d’après
les fragmens de cet auteur , que Iule Africain
nous a conlervés, que le premier T h o ït , ou Mercure
égyptien , traça fur des colonnes l’hiftoire des
fciences qui fleurifloient avant le déluge. Certainement
la Chimie en étoit, dit Borrichius ; les ^àja&e-
res de Thoït furent hiéroglyphiques, il employa
la langue facrée ; après le déluge fa do&rine fut traduite
en grec ; Agathotlæmon ou le fécond Mèrair^e^
père' deTat J l’écrivit dans dés livres, mais' encore
en lettres hiéroglyphiques. Les critiques ont apper-
çû dans ce paffage uné certaine bifàrrerie, qui le
leur a fait rejetter avec mépris. Conringius & Stil-
linofleet ont trouvé contradiftoire que Hermès eut
écrit dans une certaine langue en carafteres, hiéroglyphiques
; parce que, félon ces auteursI lès ca-
rafteres hiéroglyphiques peignoient les chofes, 5f
non des mots. L’auteur de M a i fur les.hiéroglyphes
des Egyptiens, a rétabli la leçon de ce paflage, &
fauvé pàr-là la contradiélion : il a dit lettres facrées,
au lieu de caractères hiéroglyphiques ; & il a conclu
de-là que toute la bifarrerie du paflage ne devoit
plus refider déformais que dans la grande antiquité
attribuée au fait : car les lettres alphabétiques dont
il s’agit, dit cet auteur, furent en ufage allez tard
parmi les Egyptiens ; & une diale&e facrée fut introduite
encore plus tard parmi eux. Au refte, que
les colonnes de Thoït ayent pu réfifter aux eaux du
déluge, & fubfifter plufieurs fiecles après cet événement
qui changea la face entière de la terre, Borrichius
le prouve par l’exemple des fameufes colonnes
de Seth, dont une reftoit encore debout dans la
terre de Seriad au tems de Jofeph qui en fait mention
l i \ !• ch.iij. des antiq. judaiq. Quant à la traduction,
Borrichius fe croit obligé d’avoiier qu’elle
pourroit bien n’être pas du fécond- Mercure pere de
Tat, dont la naiflance précéda, félon lu i, Celle de la
langue greque ; mais du cinquième Mercure, ou du
dernier de Cicéron , que perfonne, ajoute fierement
Borrichius, ne prouvera être mort avant la naiffan-
ce de • la langue greque. Un Urfinus, & le favant
Conringius, beaucoup plus ^connu que le premier ,
s’étoient déjà élevés contre les colonnes ; & avoient
jetté des doutes fur la bonne foi de Manethon : aufli
Borrichius fe met-il fort en colere contre ces incrédules,,
qu’il traite cependant avec une politeffe qui
n’étoit pas commune dans es favans de ces tems,
fur-tout quand ils avoient tort. Ceux qui feront eurieux
des détails de cette difpute importante des
lavans que nous venons de citer, & qui- prendront
quelqu’intérêt aux colonnes-de Thoït, n’ont qu’à recourir
à Borrichius, dé ortu & progrçjfti Chemia , &
au traité d’Hermannus Conringius , de hermetied
Ægyptiorilm vetere, & Paracelficortim novâdoctrinâ.
Au refte ce premier Thoït , ou le Mercure ante-diluvien
d é Manethon, pourroit bien être ta Seth de
l’Ecriture ,• 5é Fhiftoire ou la fable des colonnes de
Thoxt& de Seth, ne regarder qii’un même'fait : on
le prendra aiifli, flüiToh .veut,, a v e c le P. Kircher ,
pour l’Enoch;!de l’Ecriture.
Voilà;lé précis des preuves fur lefquelles oii établit'là
grande ancienneté dç la Chimie : il eft aflez indifférent1
déliés admettre Ou de lès rejetter ; ,ôc nous
n’en parlerions pas davahtage, fi elles né nous fitg-
géroierit une obfervation plus dans notre genre ,
& plus du goût général de notre fiecle, que la critiqué
hiftoriqûe que nous en ferions : c’eft qu’il faut
bien diftingüer dans tout ce qui précédé, les faits,
des .inductions1; le pofitif, du raifonnement. Convenons
, àve'c Borrichius, qti’ort a travaille les tnèfaux
avant lé déluge ; mais n’alloris pas en conclure que
ces premiers Métallurgiftes fuffent des chimiftes. Le
panificiuni eft certainement du refîbrt de la Chirhie
(yoye^ F e r m e n t a t io n ), ; la cuifine eft une efpece
de Chimie domeftique : cependant Adam eût été plus
avancé dans ces arts que nos meilleurs boulangers
& que nos plus parfaits cuifinïers, que je ne lui don-
nerois pas le titre de chïmifle. Rien n’eft plus faux que
toute invention ,foit le réfiiîtat d’une vraie fcience ;
quelque difpofition que nous ayons à faire honneur
aux favans des découvertes utiles , nous fommes
forcés' de convenir qu’on les doit prefque toutes à
des ignbraris : & pour tirer nos exemples de là Chimie,
ce n’eft point un chimifte réfléchiflant feientifique-
mertt fur les propriétés des corps, qui a décoiivert la
Teinture, la Verrerie, la poudre-à-canon, le bleu de
Pniffë, l’imitation dés pierres précieufes, ces
inventions bous viennent de manoeiivres non chi-
mifltes, ou de chimiftes manoeuvrans. Combien d’autres
procédés curieux font dans les mains de fimples
ouvriers, & relieront peut-être toujours ignorés des
<*randî> maîtres^ Les Chimiftes profonds , Ies hommes
de génie, font écartés par une efpece de fatalité de
toute recherche immédiatement applicable aux arts
utiles ; la chaîne feientifique des vérités les entraîne à
leur infû : occupés à en rapprocher les chaînons, ils
relient indifférens & froids fur les objets moins intellectuels
, & fur les recherches ifolées ; & ce font
ces recherches qui produifeat des arts : elles demeurent
en partage à des têtes heureufement étroites ,
que le fenfible feul touche & fatisfait. Le tranfeen-
dant, le curieux, l’outré, le fublime, l’abus de la
fcience en un mot, eft feul capable defatisfaire le
goût malade de ces génies prefque fupérieurs à l’humanité
: tant pis fans doute pour une fociété d’hom-
më$, tant pis même pour leur propre bonheur ; mais
auoi qù’il en foit, le fait eft t e l, & l’expérience eft
pour moi.
Ce qui conftate, félon les hiftoriens de la Chimie,
le renouvellement ou plûtôt la naiflance de la C7w-
mie peu de tems après le déluge, c ’eft qu’on trouve
dèflors des arts chimiques, exiftans ; qu’il eft parlé
dans quelques auteurs de l’art de tranfmuer les métaux
; que d’autres en ont écrit expreflement ; &
qu’on apperçoit dans plufieurs ouvrages des veftiges
epars des connoiflances alchimiques.
La Métallurgie a été exercée dans les tems les
plus reculés, ce fait eft fur ; les moiiumens hiftori-
ques les plus anciens parlent de cet art, & d’arts qui
le fu p p o f e n t l’ancienneté de l’ufage des remedes
tirés des fubftançes métalliques eft manifefte par le$
écrits
écrits d’Hippocrate, de Diofcoride, de Pline, &c.
Les chroniques des mines d’Allemagne en font remonter
les premiers travaux jufqu’aux tems fabuleux.
Les mines des pays du Nord paroiflent encore
plus anciennes, à en juger par l’idiome de l’art, dont
les mots employés aujourd’hui par les Métallurgiftes
allemans, font tirés des anciennes langues du
Nord. D ’ailleurs les peuples du Nord habitant des
contrées peu propres à l’agriculture, il étoit naturel
qu’ils fe tournaflent de bonne heure du côté des mines;
c’eft une obfervation de l’auteur del’efprit des
lois. L ’art des embaumemens, qui eft certainement
très-chimique, exifte chez les Egyptiens dès l’antiquité
la plus reculée. Agatarchis & Diodore de Sicile
parlent de leurs mines. La Zimothecniepanaire & vi-
naire , ou les arts de faire du pain avec de la pâte lev
é e , & de mettre en fermentation les fucs doux,
font des tems qui fuivent immédiatement le déluge.
Les arts de la Teinture, de la Verrerie, celui de préparer
les couleurs pour la Peinture, & même d’en
compofer d’artificielles, tel que le. bleu faélice d’Egypte
dont iflfeft parlé dans Théophrafte, font très-
anciens. Il en eft de même de la connoiflance des
mordans. Voici à ce fujet un paflage de Pline qui eft
très-remarquable: Pingunt & vefies in Egypto inter
pauca mirabili genere, candida vêla pojlquam attrivere
illinentts, non coloribus, fed colorem forbentibus medi-
camentis. Hoc, cùrnfecêre , non apparet in velis; fed in
cordnam pigmenti ferventis merfa poil momentum ex-
trahuntur picta: mirumque cum f it unus in cortinâ co-
lor y ex illo alius atque alius fit in vefie accipitntis ,
medicamenti qualitate mutatus; nec pojieà ablui potefi.
Ipa cortina non dubih confufura colores, f i pictos acci-
peret, digerit ex uno , pingitque dum coquit; & adujlcc
vefies y firmiores fiunt quant f i non urerentur. Pline,
1tat. hifi. lib. X X X V . cap. x j. Il eft aufli fait mention
dans les plus anciens auteurs d’opérations halo-
techniques. Ariftote dit que l’extraélion des fels de
cendres eft en ufage parmi les payfans de l’Ombrie ;
& Varron, chez certains peuples des bords du Rhin.
Pline parle d’un verre malléable offert à Néron. Le
même auteur décrit aflez bien la maniéré de retirer
l’or 5c l’argent des vieux habits par le moyen de l’ amalgame.
Cette opération a été décrite aufli par
.Vitruve, &c.
Mais nous ferons fur ces preuves du renouvellement
de la Chimie, les mêmes réflexions que nous
avons faites fur celle de fon exiftence avant le déluge
; nous dirons que ces arts ne fuppofent pas la
fcience. La théorie de la Teinture eft bien poftérieu-
re à l’art. On fondoit les métaux a-travers les charbons
, long-tems avant que Stahl donnât l’admirable
théorie de cette opération. Ce n’eft pas d’après les
principes de fon excellente ÿmotechnie, qu’on a fait
le premier vin. Ces fpéculations, quand elles font
juftes, peuvent fournir des vûes pour perfeéfionner
les arts, & les étendre à un plus grand nombre d’objets.
On corrigera les v ins;.on fongera à mettre en
fermentation des fubftançes nouvelles. Mais quant, à
l ’invention direéle & fyftématique des arts, de ceux
fur-tout qu’on peut regarder comme chefs, loin de
convenir qu’elle foit dûe aux .Sciences, c’ eft une quef-
tion de favoir fi elle peut l’être. Mais en attendant
qu’on la décide, nous pouvons aflïirer qu’elles ont
paru tard ; & qu’il y avoit des arts depuis long-tems,
lorfque les progrès de la raifon, ou peut-être les premières
erreurs de l’efpritcombinées, ont donné naiffance
aux Sciences.
Quant à l’art de tranfmuer les métaux, ou à l’Alchimie
, on peut le regarder comme ayant toujours
été accompagné de fcience, & ne pas féparer le fyf-
ième de la pratique alchimique. Le titre de philosophe
, de fage, ambitionné en tout tems par les chercheurs
de la pierre divine; lefeçret, l’étude, la ma- IL Tome III. ’
nie d’ecrire, &c. tout cela annonce les favans, les
gens à théorie. Les plus anciens livres alchimiques de
quelque aütenticité, contiennent une théorie commune
à la Chimie fecrete ou Alchimie, & à la Chimie
pofitive -y fie quelque frivole qu’on la fuppofe,
elle n’a pû naître que chez des favans, des philofo-
phes, des raifonneurs, &c.
Que 1 Alchimie doive fa naiflance à l’Egypte cette
mere commune des Sciences, & qu’elle ait été cultivée
par les hiérophantes ou prêtres de la nation ; c’eft
un fait qu’on avoue unanimement. En voici les preuves
les plus fortes : i° . l ’étymologie la plus naturelle
du mot Chimie, eft tirée de celui que l’Egypte por-
toit en langue facrée, Chemia, félon Plutarque. Des
commentateurs prétendent à la vérité qu’il faut dire
Chamia, terre de Cham premier fils de Noé, qui s’établit
dans cette contrée après le déluge ; & les Septante
l’appellent Cham (pfal. io5é) du mot hébreu
ham : mais on lit dans Bochart, que les Cophtes l’appellent
encore aujourd’hui Chemi. z°. Les écrivains
les plus anciens que nous ayons fur la Chimie, font
originaires d’Egypte ; tels que Zofime de Chemnis
ou Panopolis, Diofcorus, Comarius, Olimpiodore,
Etienne, Sinefius & autres dont nous parlerons ailleurs.
30. La maniéré dont on a écrit de la Chimie ,
tota feribendi & docendi ratio, eft entièrement dans
le goût égyptien ; c’eft une diftion tout-à-fait étrange
& éloignée du tour ordinaire, un ftyle énigmatique
& annonçant par-tout des myfteres facrés ; c©
• font des caraéteres hyéroglyphiques, des images bi-
farres, des lignes ignorés, & u n e façon de dogmati-
fer tout-à-fait occulte : or perfonne ne pafle pour
a.voir gardé plus fcrupuleufement cette circonfpec-
tion que les Egyptiens. Ces peuples fe font plûs particulièrement
à envelopper leurs connoiflances dans
des voiles ténébreux; & c’eft-de-là qu’ils ont paffé
d?ns les ouvrages des Chimiftes. L ’ufage des anciens
auteursde Chimie d’apoftropher le leéleur comme fon
propre enfant,./?// mi, a bien l ’air de venir d’Egypte,
oit les fciences ne fe tranfmettoient que des peres aux
enfans.
1 Mais quand il feroit plus clairement démontré que
l’Egypte a été le berceau de la Chimie, il n’en feroit
pas plus.' facile de fixer la .date de fa naiflance. L’a-
doption générale chez tous les Chimiftes, d’Hermès
pour, l’inventeur & le pere de la Chimie , eft tout-à-
fait gratuite. L’exiftence même d’un Hermès égyptien
, n’eft pas encore bien tirée au clair : il y a eut
en Egypte dix à douze T âu t , Thot, Theut, T h o y t ,
Thout ;. pour tous ces noms, les Phéniciens n’en
avoient qu’un, Taaut; les Grecs, qu’Hermès; ceux
d’Alexandrie, que Thoor; les Latins, que Mercure ;
les Gaulois , que Teautates, qui tire fon origine de
l’égyptien Taautes qui étoit très-évidemment Hermès
ou Mercure : car félon Céfar, Bell. gai. lib. V IZ.
les druides des Gaulois deum maximï Mercurium colune
, hune omnium artium autorem ferunt. Les Rabbins
l’appellent Adrisy les Arabes Idris, un certain.
arabe Johanithon, & les. Barbares (ainfi qualifiés par
un rabbin) Marcolis. Kircher fort en peine du nom
dé Idris, a découvert enfin dans l’arabe Abenephi que:
c’étôit le même qu’Ofiris, que les Perfes appellent
Adras. Nous avons parlé plus haut d’Agothodç-
mon.
. Ce .n’eft rien que la confufion de ces noms, en
comparaifon de celle qui naît de la multiplicité des
perfonnes auxquelles ils ont été appliqués. Sancho-,
niathon compte deux Taaut ou Hermès; la plûpart
des anciens mythologiftes, trois; quelques-uns quatre
; & Cicéron cinq. Kircher obferve d’après plufieurs
auteurs grecs, juifs & arabes, qu’un très-ancien
Hermès, qu’il regarde comme l’Enoch fils de Ja-
red de là Genefe, s’étant illuftré parmi les hommes
ceux de fes fucceffeurs qui ambitionnèrent la réputa-
H h fi *