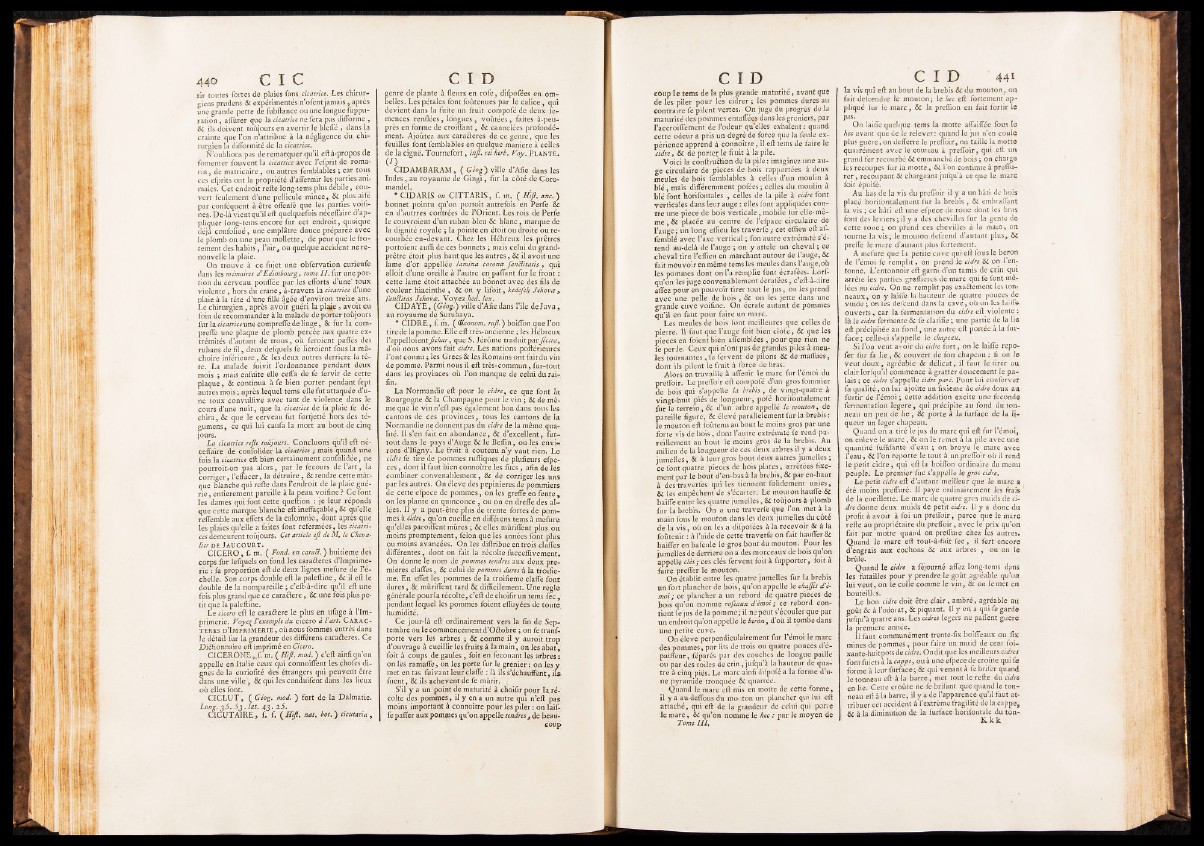
h
f
II
440 C I C
r-ir toutes fortes de plaies fans, cicatrice. Les chirurgiens
prudens & expérimentés n’ofent jamais, après
une grande perte de fubftance ou une longue fuppu-
ration, affûter que la cicatrice ne fera pas difforme ,
& ils doivent toujours en avertir le bleffé , dans la
crainte que l’on n’attribue à la négligence du chirurgien
la difformité de la cicatrice.
N’oublions pas de-remarquer qu’il eft à-propos de
fomenter -fouvent la cicatrice avec l’efprit de romarin
, de matricaire, ou autres femblables ; car tous
ces efprits ont la propriété d’affermir les parties animales.
Cet endroit refte long-tems plus débile, couvert
feulement d’une pellicule mince, & plus aife
par conféquent à être offenfé que les^ parties voifi-
ne$.De-là vient qu’il eft quelquefois néceffaire d’appliquer
long-tems encore fur cet endroit, quoique
déjà confolidé, une emplâtre douce préparée avec
le plomb ou une peau mollette, de peur que le frôlement
des habits, l’air , ou quelque accident ne renouvelle
la plaie.
On trouve à ce fujet une obfervation curieufe
dans les mémoires d'Edimbourg, tome I I . fur une portion
du cerveau pouffée.par les efforts d’une' toux
violente , hors du crâne, à-travers la cicatrice d’une
plaie à la tête d’une fille âgée d’environ treize ans.
Le chirurgien, après avoir guéri la pl^je, avoit eu
ioin de recommander à la malade de porter toujours
fur la cicatrice une compreffe de linge, & fur la com-
preffe une plaque de plomb percée aax quatre extrémités
d’autant de trous, où feroient paffés des
rubans de fil, deux defquels fe lieroient fous la mâchoire
inférieure, & les deux autres derrière la tête.
La malade fuivit l’ordonnance pendant deux
mois ; mais enfuite elle ceffa de fe fervir de cette
plaque, & continua à fe bien porter pendant fept
autres mois ; après lequel tems elle fut attaquée d’une
toux convulfive avec tant de violence dans le
cours d’une nuit, que la cicatrice de fa plaie fe déchira,
& que le cerveau fut fortjetté hors des té-
gumens, ce qui lui caufa la mort au bout de cinq
jours.
La cicatrice reße toujours. Concluons qu’il eft néceffaire
de confolider la cicatrice ; mais quand une
fois la cicatrice eft bien certainement confolidée, ne
pourroit-on pas alors, par le fecours de l’art, la
corriger, l’effacer, la détruire, & rendre cette marque
blanche qui refte dans l’endroit de la plaie guérie
, entièrement pareille à la peau voifine ? Ce font
les dames qui font cette queftion : je leur réponds
que cette marque blanche eft ineffaçable, & qu’elle
reffemble aux effets de la calomnie, dont après que
les plaies qu’elle a faites font refermées, les cicatrices
demeurent toûjours. Cet article efi de M. le Chevalier
DE JAUCOURT.
C IC E RO , f. m. ( Fond, en caracl. ) huitième des
corps fur lefquels on fond les carafteres d’imprimerie
: fa proportion eft de deux lignes mefure de l’échelle.
Son corps double eft la paleftine, & il eft le
double de la nompareille ; c’eft-à-dire qu’il eft une
fois plus grand que ce caraftere, & une fois plus petit
que la paleftine.
Le cicero eft le cara&ere le plus en ufage à l’Imprimerie.
Voye%_ Vexemple du cicero a l'art. C a r a c tères
d ’Im p r i m e r i e , où nous fommes entrés dans
le détail fur la grandeur des différens caraûeres. Ce
Diûionnaire eft imprimé en Cicero.
CICERONE „ f . m. ( Hiß. mod. ) c’eft ainfi qu’on
appelle en Italie ceux qui connoiffent les chofes dignes
de la curiofité des étrangers qui peuvent être
dans une ville \ & qui les conduifent dans les lieux
où elles font.
C IC LU T , ( G log. moi. ) fort de la Dalmatie.
Long. 36. 63. lat. 43. z 5.
ClCUTAIREj f. f. ( Hiß. nat, bot. ) cicutaria ,
C I D
genre de plante à fleurs en rofe, difpofées en ombelles.
Les pétales font foûtenués par le calice, qui
devient dans la fuite un fruit compofé de deux ie-
mences renflées, longues , voûtées, faites à-peu-
près en forme de croiffant, & cannelées profondément.
Ajoutez aux cara&eres de ce genre, que les
feuilles font femblables en quelque maniéré à celles
de la ciguë. Tournefort, infi. rei herb. Voy. Plante.
■ ■ ■ ■
CIDAMBARAM, ( Geog) ville d’Afie dans les
Indes, au royaume de Gingi, fur la coté de Coromandel.
* CIDARIS ou CITTARIS, f. m. ( Hiß. anc. )
bonnet pointu qu’on portoit autrefois en Perfe &
en d’autrres contrées de l’Orient. Les rois de Perfe
le couvroient d’un ruban bleu & blanc, marque de
la dignité royale ; la pointe en étoit ou droite ou recourbée
en-aevant. Chez les Hébreux les prêtres
portoienr aufîi de ces bonnets ; mais celui du grand-
prêtre étoit plus haut que les autres, & il avoit une
lame d’or appellée lamina coronce faticlitatis, qui
alloit d’une oreille à l’autre en paffant fur le front :
cette lame étoit attachée au bonnet avec des fils de
couleur hiacinthe , & on y lifoit, kedefcli Jehova ,
fanclitas Jehova. Voyez hèd. lex.
C ID A Y E , (G log.) ville d’Afie dans l’île de Java,
au royaume de Surubaya.
* CIDRE, f. m. ( OEconom. ruß.') boiffon que l’on
tire de la pomme. Elle eft très-ancienne ; les Hébreux
l’appelloient fichar, que S. Jérôme traduit par ficera9
d’où nous avons fait cidre. Les nations poftérieures
l ’ont connu ; les Grecs & les Romains ont fait du vin
de pomme. Parmi nous il eft très^commun, fur-tout
dans les provinces- où l’on manque de celui du rai-,
fin.
La Normandie eft pour le cidre, ce que font la
Bourgogne & la Champagne pour le vin ; & de même
que le vinn’ejt pas également bon dans tous les
cantons de ces provinces, tous les cantons de la
Normandie ne donnent pas du cidre de la même qualité.
Il s’en fait en abondance, & d’excellent, fur-
tout dans le pays d’Auge & le Beflin, ou les environs
d’Ifigny. Le fruit à couteau n’y vaut rien. Le
cidre fe tire de pommes ruftiques de plufieurs efpe-
ce s , dont il faut bien connoître les fuçs , afin de les
combiner convenablement, & de corriger les uns
par les autres. On éleve des pepinieres de pommiers
de cette efpece de pommes, on les greffe en fente ,
on les plante en quinconce , ou on en dreffe des allées.
Il y a peut-être plus de trente fortes de pommes
à cidre, qu’on cueille en différens tems à mefure
qu’elles paroiffent mûres ; & elles mûriffent plus ou
moins promptement, félon que les années font plus
ou moins avancées. On les diftribue en trois claffes
différentes, dont on fait la récolte fuccelîivement.
On donne le nom de pommes tendres aux deux premières
claffes, & celui de pommes dures -à la troifie-
mc. En effet les pommes de la troifieme claffe font
dures, & mûriffent tard & difficilement. Une regle
générale pour la récolte, c’eft de choifir un tems fec ,
pendant lequel les pommes foient effuyées de toute,
humidité.
Ce jour-là eft ordinairement vers la fin de Septembre
ou le commencement d’Oftobre ; on fe tranf-
porte vers les arbres ; & comme il y auroit trop
d’ouvrage à cueillir les fruits à la main, on les abat,
foit à coups de gaules, foit en fecouant les arbres :
on lès ramaffe, on les porte fur le grenier : on les y
met en tas fuivant leur claffe : là ils s’échauffent, ils
fuent, & ils achèvent de fe mûrir. (
S’il y a un point de maturité à choifir pour la. récolte
des pommes > il y en a un autre qui n’eft pas
moins important à connoître pour les piler : on laif-
fe paffer aux pommes qu’on appelle tendres 9 de beaucoup
C I D
côup le tems de la plus grande maturité, avant que
de les piler pour les cidrer ; les pommes dures au
contraire fe pilent vertes. On juge du progrès de la
maturité des pommes entaffé^ dans les greniers, par
l’accroiffement de l’odeur qu’elles exhalent : quand
cette odeur a pris un degré de force que la feule expérience
apprend à connoître, il eft tems de faire le
cidre, & de porter le fruit à la pile.
Voici la conftruftion de la pile : imaginez une auge
circulaire de pièces de bois rapportées à deux
meules de bois femblables à celles d’un moulin à
b lé , mais différemment pofées ; celles du moulin à
blé font horifontales , celles de la pile à cidre font
verticales dans leur auge : elles font appliquées contre
une piece de bois verticale, mobile fur elle-même
, & placée au centre de l’efpace circulaire de
l’auge ; un long eflièu les traverfe ; cet èflieu eft af-
femblé avec l’axe vertical ; fon autre extrémité s’étend
au-delà de l’auge ; on y attelé un cheval ; ce
cheval tire l’effieu en marchant autour de l’auge, &
fait mouvoir en même tems les meules dans l’auge,où
les pommes dont on l’a remplie font écrafées. Lorf-
qu’on les juge convenablement écralées, c’eft-à-dire
affez pour en pouvoir tirer tout le jus, on les prend
avec une pelle de bois , & on les jette dans une
grande cuve voifine. On écrafe autant de pommes
qu’il en faut pour faire un marc.
Les meules de bois font meilleures que celles de
pierre. U faut que l’auge foit bien clofe, & que les
pièces en foient bien affemblées , pour que rien ne
fe perde. Ceux qui n’ont pas de grandes piles à meules
tournantes , fe fervent de pilons & de maffues,
dont ils pilent le fruit à force de bras.
Alors on travaille à affeoir le marc fur l’émoi du
preffoir. Le preffoir eft compofé d’un gros fommier
de bois qui s’appelle la brebis,. de vingt-quatre à
vingt-huit piés de longueur, pofé horilôntalement
fur le terrein, & d’un arbre appellé le mouton, de
pareille figure, & élevé parallèlement fur la brebis:
le mouton eft foûtertu au bout le moins gros par une
forte vis de bois, dont l’autre extrémité fe rend pareillement
au bout le moins gros de la brebis. Au
milieu de la longueur de ces deux arbres il y a deux
jumelles, & à leur gros bout deux autres jumelles ;
ce font quatre pièces de bois plates, arrêtées fixement
par le bout d’en-basà la brebis, & par en-haut
à des traverfes qui les tiennent folidement unies,
& les empêchent de s’écarter. Le mouton hauffe &i
baiffe entre les quatre jumelles, & toûjours à-plomb
fur la brebis. On a une traverfe que l’on met à la
main fous le mouton dans les deux jumelles du côté
de la v is , où on les a difpofées à la recevoir & à la
foûtenir : à l’aide de cette traverfe on fait hauffer &
baiffer en bafcule le gros bout du mouton. Pour les
jumelles de derrière on a des morceaux de bois qu’on
appelle cils; ces clés fervent foit à fupporter, loit à
faire preffer le mouton.
On établit entre les quatre jumelles fur la brebis
un fort plancher de bois, qu’on appelle le chajjis d'émoi;
ce plancher a un rebord de quatre pièces de
bois qu’on nomme rofeaux d’émoi ; ce rebord contient
le jus de la pomme ; il ne peut s’écouler que par
un endroit qu’on appelle le beron9 d’où il tombe dans
une petitè cuve. ^ ^ .
On éleve perpendiculairement fur l’émoi le marc
des pommes, par lits de trois ou quatre pouces d’é-
paiffeur, féparés par des couches de longue paille
ou par des toiles de crin, jufqu’à la hauteur de quatre
à cinq piés. Le marc ainfi difpofé a la forme d’une
pyramide tronquée & quarrée.
Quand le marc eft mis en motte de cette forme,
il y a au-deffous du mouton un plancher qui lui eft
attaché, qui eft de la grandeur de celui qui porte
le marc, &c qu’on nomme le hec : par le moyen de
Tome III,
C I D 4 4 *
la vis qui eft au bout de la brebis & du mouton, on
fait delcendre le mouton; le hec eft fortement appliqué
fur le marc, ôi la prefiion en fait fortir le
jus.
On laiffe quelque tems la motte affaiffée fous le
hec avant que de le relever: quand le jus n’en coule
plus guere, on defferre le preffoir, on taille la motte
quarrément avec le couteau à preffoir, qui eft un
grand fer recourbé & emmanché de bois ; on charge
les recoupes fur la motte, & l’on continue à preffu-
re r , recoupant & chargeant jufqu’à ce que le marc
foit épuifé.
Au bas de la vis du preffoir il y a un bâti de bois
placé horifontalement fur la brebis , & embraffant
la vis ; ce bâti eft une efpece de roue dont les bras
font des leviers ; il y a des chevilles fur la gente de
cette roue; on prend ces chevilles à la main-, on
tourne la vis; le mouton defeend d’autant plus,
preffe le marc d’autant plus fortement.
A mefure que la petite cuve qui eft fous le beron
de l’émoi fe remplit, on prend le cidre & on l’entonne.
L’entonnoir eft garni d’un tamis de crin qui
arrête les parties groflieres de marc qui fe font mêlées
au cidre. On ne remplit pas exa&ement les tonneaux,
on y laiffe la hauteur de quatre pouces de
vuide ; on les defeend dans la cave, où on les laiffe
ouverts, car la fermentation du cidre eft violente :
là le cidre fermente & fe clarifie ; une partie de la lie
eft précipitée au fond, une autre eft portée à, la fur-
face ; celle-ci s’appelle le chapeau.
Si l’on veut avoir du cidre fort, on le laiffe repo-
fer fur fa l ie , & couvert de fon chapeau : fi on le
veut doux, agréable & délicat, il faut le tirer au
clair lorfqu’il commence à gratter doucement le palais
; ce cidre s’appelle cidre pâté. Pour lui conferver
fa qualité, on lui ajoûte un fixieme de cidre doux au-
fortir de l’émoi ; cette addition excite une fécondé
fermentation legere, qui précipite au fond du tonneau
un peu de l ie , & porte à la furface de la liqueur
un leger chapeau.
Quand on a tiré le jus du marc qui eft fur l’émoi,
on enleve le marc, & on le remet à la pile avec une
quantité fuffifante d’eau ; on broyé le marc avec
l’eau, & l’on reporte le tout à un preffoir où il rend
le petit cidre, qui eft la boiffon ordinaire du menu
peuple. Le premier fuc s’appelle le gros cidre.
Le petit cidre eft d’autant meilleur que le marc a
été moins preffuré. Il paye ordinairement les frais
de la cueillette. Le marc de quatre gros muids de cidre
donne deux muids de petit cidre. Il y a donc du
profit à avoir à foi un preffoir, parce que le marc
refte au propriétaire du preffoir, avec le prix qu’on
fait par motte quand on preflure chez les autres.
Quand le marc eft tout-à-fait fe c , il fert encore
d’engrais aux cochons &c aux arbres , ou on le
brûle.
Quand le cidre a féjourné affez long-tems dans
les futailles pour y prendre le goût agréable qu’on
lui veut, on le colle comme le vin, & on le met en
bouteilles.
Le bon cidre doit être clair, ambré, agréable au
goût & à l’odorat, & piquant. Il y en a qui fe garde
jufqu’à quatre ans. Les cidres légers ne paffent guere
la première année.
Il faut communément trente-fix boiffeaux ou fix
mines de pommes, pour faire un muid de cent foi-
xante-huit pots de cidre. On dit que les meilleurs cidres
font fujets à la cappe, ou à une efpece de croûte qui fe
forme à leur furface; & qui venant à fe brifer quand
le tonneau eft à la barre, met tout le refte du cidre
en lie. Cette croûte ne fe brifant que quand le tonneau
eft à la barre, il y a de l’apparence qu’il faut attribuer
cet accident à l’extrême fragilité de la cappe,
& à la diminution de la furface horifontale du ton