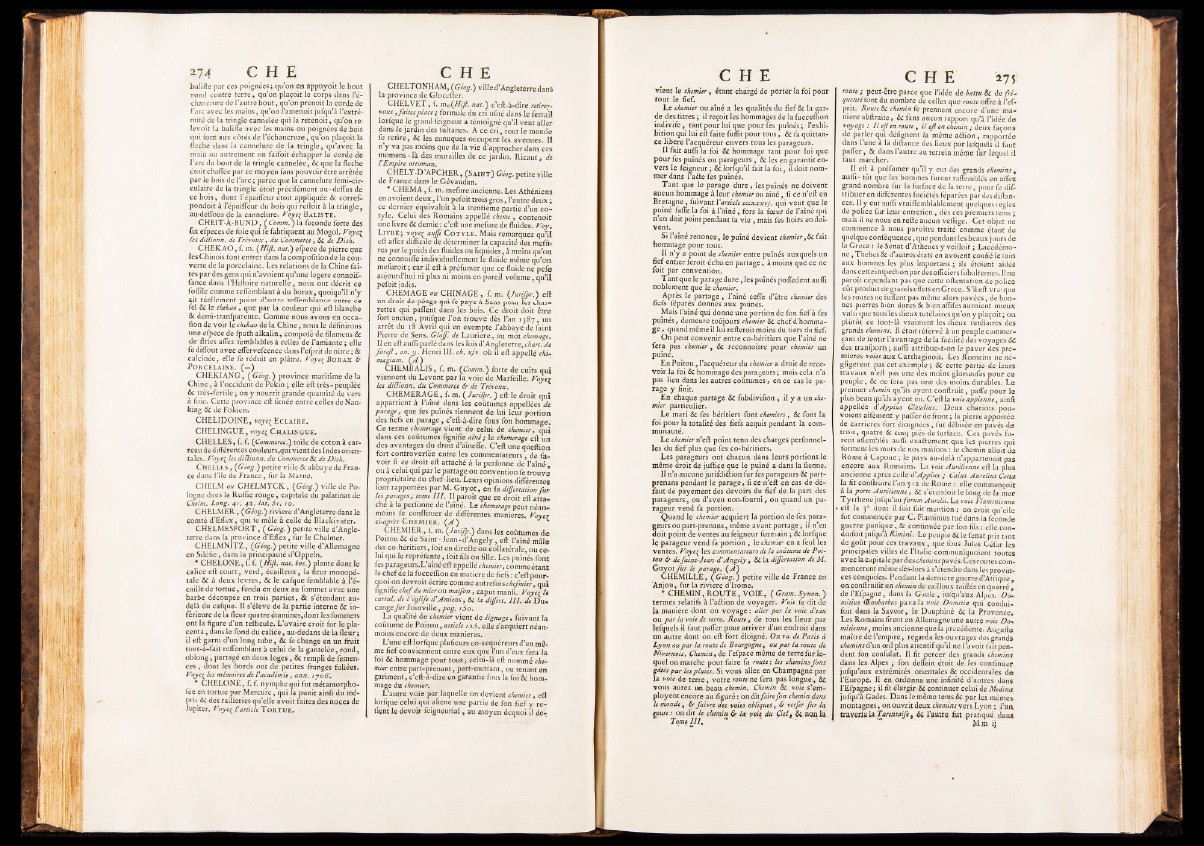
balifte par ces poignées ; qu’on en appuyoit le bout
rond contre terre, qu’on plaçoit le corps dans l’échancrure
de l’autre bout, qu’on prenoit la corde de
Tarc avec les mains, qu’on l’amenoit jufqu’à l’extrémité
de la tringle cannelée qui la retenoit, qu’on re-
levoit la balifte avec les mains ou poignées de bois
•qui font aux côtés de l’échancrure, qu’on plaçoit la
fléché dans la Cannelure de la tringle, qu’avec la
main ou autrement on faifoit échapper la corde de
l ’arc du bout de la tringle cannelée, & que la fléché
étoit chaffée par ce moyen fans pouvoir être arrêtée
par le bois de l’arc ; parce que la cannelure femi-cir-
culaire de la tringle étoit précifément au - deHiis de
ce bois, dont l’épaiffeur etoit appliquée & corref-
pondoit à l’épaiffeur du bois qui reftoit à la tringle,
au-deftous de la cannelure. Foye^ Ba list e»
CHEIT-À-BUND, ( Comm. ) la fécondé forte des
flx efpeces de foie qui fe fabriquent au Mogol. Foyei
les diclionn. de Trévoux, du Commerce , &C de Dish.
CHEKAO, f. m. (Hift. nat.) efpece de pierre que
les Chinois font entrer dans la compolition de la couverte
de la porcelaine. Les relations de la Chine faites
par des gens qui n’avoient qu’une legere connoif-
fance dans l ’Hiftoire naturelle, nous ont décrit ce
foffile comme refl'emblant à du borax, quoiqu’il n’y
ait réellement point d’autre reffemblance entre ce
fel & le chekao, que par la couleur qui eft blanche
& demi-tranfparente. Comme nous avons eu occa-
fion de voir le chekao de la Chine, nous le définirons
une efpece de fpath alkalin, compofé de fîlamens &
de ftries aflez femblablesà celles de l’amiante; elle
fe diffout avec effervefcence dans l’elprit de nitre ; &
calcinée, elle fe réduit en plâtre. Voyet^ Bo rax &
Po r ce l ain e . (—)
CHEK1AN G, ( Géog.) province maritime de la
Chine, à l’occident de Pékin ; elle eft très-peuplée
& très-fertile ; on y nourrit grande quantité de vers
à foie. Cette province eft fituée entre celles de Nan-
king & de Fokien.
CHELIDOINE, voye^ E cl air e.
CHELINGUE, voye{ C ha lin gue.
CHELLES, f. f. ( Commerce.) toile de coton à carreau
de différentes couleurs,qui vient des Indes orientales.
Voye{ les diclionn. du Commerce & de Dish.
C helles , (Géog.) petite ville & abbaye de France
dans l’île de France, fur la Marne.
CHELM ou CHELMYCK, ( Géog.) ville de Pologne
dans la Ruflie rouge, capitale du palatinat de
Chelm. Long. 4/. 4a. lat. S i. 10.
CHELMER, (Géog.') riviere d’Angleterre dans le
comté d’Effex, qui fe mêle à celle de Blackivater.
CHELMESFORT, (Géog.) petite ville d’Angleterre
dans la province d’Effex, l'ur le Chelmer.
GHELMNITZ, (Géog.) petite ville d’Allemagne
en Siléfie, dans la principauté d’Oppeln.
* CHELONE, f. f. (Hijl. nat. bot.) plante dont le
calice eft court, verd, écailleux, la fleur monopétale
& à deux levres, & le cafque femblable à l’écaille
de tortue, fendu en deux au fommet avec une
barbe découpée en trois parties, & s’étendant au-
delà du cafque. Il s’élève de la partie interne & inférieure
de la fleur quatre étamines,dont les fommets
ont la figure d’un tefticule. L’ovaire croît fur le placenta
, dans le fond du calice, au-dedans de la fleur ;
il eft garni d’un long tube, & fe change en un fruit
tout-à-fait refl'emblant à celui de la gantelée, rond,
oblong, partagé en deux loges, & rempli de femen-
c e s , dont les bords ont de petites franges foliées.
Voye£ les mémoires de C académie , ann. lyoG.
* CHELONÉ, f. f. nymphe qui fut métamorpho-
fée en tortue par Mercure, qui la punit ainfi du mépris
& des railleries qu’elle a voit faites des noces de
Jupiter, Foyeç l'article TORTUE.
CHELTONHAM, (Géog.) ville d’Angleterre dans
la province de Glocefter.
CHELVET, 1. m+(Hift. nat.) c’eft-à-dire retireç*
vous , faites place; formule du cri ufité dans le ferrai!
lorfque le grand-feigneur a témoigné qu’il veut aller
dans le jardin des fultanes. A ce cri, tout le monde
fe retire, & les eunuques occupent les avenues. Il
n’y va pas moins que de la vie d’approcher dans ces
momens-là des murailles de ce jardin. Ricaut, de
I Empire ottoman.
. CHELY-D’APCHER, (Sa in t ) Géog. petite ville
de France dans le Gévaudan.
* CHEMA, f. m. mefure ancienne. Les Athéniens
en a voient deux, 1 un pefoit trois gros, l’autre deux ;
ce dernier équivaloit à la trentième partie d’un co-
tyle. Celui des Romains appellé cheme, contenoit
une livre & demie : c’eft une mefure de fluides. Voy,
Livr e ; voye{ auffi C o t y l e . Mais remarquez qu’il
eft aflez difficile de déterminer la capacité des rnefù-
res par le poids des fluides ou liquides, à moins qu’on
ne connoiffe individuellement le fluide même qu’on
mefuroit ; car il eft à préfumer que ce fluide ne pefe
aujourd’hui ni plus ni moins en pareil volume, qu’il
pefoit jadis.
CHEMAGE ou CHINAGE, f. m. (Jurifpr.) eft
un droit de péage qui fe paye à Sens pour les charrettes
qui paflent dans les bois. Ce droit doit être
fort ancien, puifque l’on trouve dès l’an 1387, un
arrêt du 18 Avril qui en exempte l’abbaye de faint
Pierre de Sens. Glojf. de Lauriere, au mot chemage.
II en eft auffi parlé dans les lois d’Angleterre, chart. de
forejl, an. C). Henri III. ch. xjv. où il eft appelle chi»
magiurn. (A )
CHEMBALIS, f. m. (Comm.) forte de cuirs qui
viennent du Levant par la voie de Marfeille. Foyer
les diclionn. du Commerce & de Trévoux.
CHEMERAGE, f. m. ( Jurifpr. ) eft le droit qui
appartient à l’aîné dans les coûtumes appellées do
parage, que fes puînés tiennent de lui leur portion
des fiefs en parage, c’eft-à-dire fous fon hommage.'
Ce terme chemerage vient de celui de chemier, qui
dans ces coûtumes fignifie aîné ; le chemerage eft un
des avantages du droit d’aîneffe. C ’eft une queftion
fort controverfée entre les commentateurs, de fa-
voir fi ce droit eft attaché à la perfonne de l’aîné
ou à celui qui par le partage ou convention fe trouve
propriétaire du chef-lieu. Leurs opinions différentes
font rapportées par M. G u yo t, en fa differtationfur
les paragesx tome I I I . Il paroît que ce droit eft attaché
à la perfonne de l’aîné. Le chemerage peut néanmoins
fe conftituer de différentes maniérés. Foyer
ci-après C h em ier. (A )
CHEMIER, f. m. (Jurifp.) dans les coûtumes de
Poitou & de Saint-Jean-d’Angely, eft l’aîné mâle
des co-héritiers, foit en direfre ou collatérale, ou celui
qui le repréfente, foit fils ou fille. Les puînés font
fes parageurs.L’aîné eft appellé chemiercomme étant
le chef de la fucceffion en matière de fiefs : c’eft pourquoi
on devroit écrire comme autrefois chefmier, qui
fignifie chef du mier ou maifon, caput manfi. Foye^ U
cartul. de Téglijè d'Amiens, & la differt. I II. de D u ,
cange fur Joinville, pag. iào. :
La qualité de chemier vient de lignage, fuivant la
coutume de Poitou, article 12S. elle s’acquiert néan-
moins encore de deux maniérés.
L’une eft lorfque plulieurs co acquéreurs d’un même
fief conviennent entre eux que l’un d’eux fera la
foi & hommage pour tous ; celui-là eft nommé che-
mier entre part-prenant, part-mettant, ou tenant en
gariment, c’eft-à-dire en garantie fous la foi & hommage
du chemier.
L’autre voie par laquelle on devient chemier, eft
lorfque celui qui aliéné une partie de fon fief y retient
le devoir feigneurial, au moyen dequpi il derient
le chemier, étant chargé de porter la foi pour
tout le fief.
Le chemier ou aîné a les qualités du fief & la garde
des titres ; il reçoit les hommages de la fucceffion
indivife, tant pour lui que pour les puînés ; l’exhibition
qui lui eft faite fuffit pour tous, & fa quittance
libéré l’acquéreur envers tous les parageurs.
Il fait auffi la foi & hommage tant pour lui que
pour fes puînés ou parageurs , & les en garantit envers
le feigneur ; & lorlqu’il fait la fo i, il doit nommer
dans Pafre fes puînés.
Tant que le parage dure, les puînés ne doivent
aucun hommage à leur chemier ou aîné, fi ce n’eft en
Bretagne, fuivant l 'article cccxxxvj. qui veut que le
puîné faffe la foi à l’aîné, fors la foeur de l’ aîné qui
n’en doit point pendant fa v ie , mais fes hoirs en doivent.
Si l’ainé renonce, le puîné devient chemier, ôc fait
hommage pour tous;
Il n’y a point de chemier entre puînés auxquels un
fief entier feroit échu en partage, à moins que ce ne
foit par convention.
Tant que le parage dure, les puînés pofledent auffi
noblement que le chemier.
Après le partage , l’aîné ceffe d’être chemier des
fiefs féparés donnés aux puînés.
Mais l’aîné qui donne une portion de fon fief à fes
puînés, demeure toujours chemier & chef d’hommage
, quand même il lui refteroit moins du tiers du fief.
On peut convenir entre co-héritiers que l’aîné ne
fera pas chemier, ÔC reconnoître pour chemier un
puîné.
En Poitou, l’acquéreur du chemier a droit de recevoir
la foi 6c hommage des parageurs ; mais cela n’a
pas lieu dans les autres coûtumes, en ce cas le parage
y finit.
En chaque partage 6c fubdivifion , il y a un chemier
particulier.
Le mari 6c fes héritiers font chemiers, ÔC font la
foi pour la totalité des fiefs acquis pendant la communauté.
Le chemier n’eft point tenu des charges perfonnel-
les du fief plus que fes co-héritiers.
Les parageurs ont chacun dans.leurs portions le
même droit de juftice que le puîné a dans la tienne.
Il n’a aucune jurifdiétion fur fes parageurs ôc part-
prenans pendant le parage, fi ce n’eft en cas de défaut
de payement des devoirs du fief de la part des
parageurs, ou d’aveu non-fourni, ou quand un pa-
rageur vend fa portion.
Quand le chemier acquiert la portion de fes parageurs
ou part-prenans, même avant partage, il n’en
doit point de ventes au feigneur fuzerain ; & lorfque
le parageur vend fa portion , le chemier en a feul les
ventes. Foyc^ les commentateurs de la coutume de Poitou
& de faint-Jean-d'Angely, ÔC la differtation de M.
Guyot fur le parage. (A )
CHEMILLÉ, ( Géog. ) petite ville de France en
Anjou, fur la riviere d’Irome.
* CHEMIN, RO UTE , VOIE, ( Gram. Synon. )
termes relatifs à l’afrion de voyager. Foie fe dit de
la maniéré dont on voyage : aller par la voie d'eau
ou par la voie de terre. Route , de tous les lieux par
lefquels il faut paffer pour arriver d’un endroit dans
un autre dont on eft fort éloigné. On va de Paris à
Lyon ou par la route de Bourgogne, ou par la route de
Nivernoisi Chemin, de l’efpace même de terre fur lequel
on marche pour faire fa route : les chemins font
gâtés par les pluies. Si vous allez en Champagne par
la voie de terre, votre route ne fera pas longue, ôc
vous aurez un beau chemin. Chemin ÔC voie s’emp
lo y e r encore au figuré : on dit faire fon chemin dans
le monde, 6* fuivre des voies obliques, & verfer fur la
Mute : on dit le chemin & la voie du Ciel » & non la
Tome ///, ~
route ; peut-être parce que l’idée de battu & de fré-*
quenté f ont du nombre de celles que route offre à l’efprit.
Route & chemin fe prennent encore d’une maniéré
abftraite, & fans aucun rapport qu’à l’idée de
voyage : I l ejl en route , i l eft en chemin ; deux façons
de parler qui défignent la même aftion, rapportée
dans l’une à la diftance des lieux par lefquels il faut
paffer, & dans l’autre au terrein même fur lequel il
faut marcher.
Il eft à préfumer qu’il y eut des grands chemins ;
auffi-tôt que les hommes furent raflemblés en aflez
grand nombre fur la furface de la terre, pour fe dif-
tribuer en différentes fociétés féparées par des diflan-
ces. II y eut auffi vraiffemblablement quelques réglés
de police fur leur entretien, dès ces premiers tems ;
mais il ne nous en refte aucun veftige. Cet objet ne
commence à nous paroître traité comme étant de
quelque conféquence, que pendant les beaux jours de
la Grece : le Sénat d’Athenes y veilloit ; Lacédémone,
Thebes&d! ’autres états en avoient confié le loin
aux hommes les plus importans ; ils étoient aidés
dans cette inlpefrion par des officiers fubaiternes. Il ne
paroît cependant pas que cette oftentation de police
eût produit de grands effets en Grece. S ’il eft vrai que
les routes ne fuffent pas même alors pavées, de bonnes
pierres bien dures & bien affifesauroient mieux
valu que tous*les dieux tutélaires qu’on y plaçoit; ou
plutôt ce font-là vraiment les dieux tutélaires des
grands chemins. Il étoit réfervé à un peuple commerçant
de fentir l’avantage de la facilité des voyages &c
des tranfports; auffi attribue-t-on le paver des premières
voies aux Carthaginois. Les Romains ne négligèrent
pas cet exemple ; & cette partie de leurs
travaux n’eft pas une des moins glorieufes pour ce
peuple, 6c ne fera pas une des moins durables. Le
premier chemin qu’ils ayent conftruit, paffe pour le
plus beau qu’ils ayent eu. C ’eftla voieappienne, ainfi
appellée d'Appius Claudius. Deux chariots pou-
voient aifément y paffer de front ; la pierre apportée
de carrières fort éloignées, fut débitée en pavés de
trois, quatre & cinq piés de lurface. Ces pavés furent
affemblés auffi exactement que. les pierres qui
forment les murs de nos maifons : le chemin alloit de
Rome à Capoue ; le pays au-delà n’appartenoit pas
encore aux Romains. La voie Aurélienne eft la plus
ancienne après celle d'Appius ; Caius Aurelius Cotta
la fit conftruire 1 an ç 11 de Rome : elle commeriçoit
à la porte Aurélienne, & s’étendoit le long de la mer
Tyrrhene jufqu’au forum Aurelii. La voie Flaminitnne
eft la 3e dont il foit fait mention : on croit qu’elle
fut commencée par C . Flaminius tué dans la fécondé
guerre punique, 8t continuée par fon fils : elle con-
duifoit jufqu’à Rimini. Le peuple & le fenat prit tant
de goût pour ces travaux, que fous Jules Céfar les
principales villes de l’Italie communiquoient toutes
avec la capitale par des chemins pavés.Ces routes commencèrent
même dès-lors à s’étendre dans les provinces
conquifes. Pendant la derniere guerre d’Afrique,
onconftruifit un chemin de cailloux taillés en quarré ,
de l’Efpagne, dans la Gaule , jufqu’aùx Alpes. Do-,
mitius (Enobarbus pava la voie Domitia qui condui-
foit dans la Savoie, le Dauphiné & la Provence*
Les Romains firent en Allemagne une autre voie Do-
mitienne, moins ancienne que la précédente. Augufte
maître de l’empire, regarda les ouvrages des grands
chemins d’un oeil plus attentif qu’il ne 1 avoir fait pendant
fon confulat. Il fit percer des grands chemins
dans les Alpes ; fon deffein étoit de.les continuer
jufqu’aux extrémités orientales & occidentales dô
L’Europe. Il en ordonna une infinité d’autres dans
l’Efpagne ; il fit élargir & continuer celui de Médina
jufqu’à Gades. Dans le même tems & par les mêmes
montagnes, on ouvrit deux chemins vers Lyon ; l ’un,
trayeria la Tarentaife, 6c l’autre fut pratiqué dan*
Mm ij