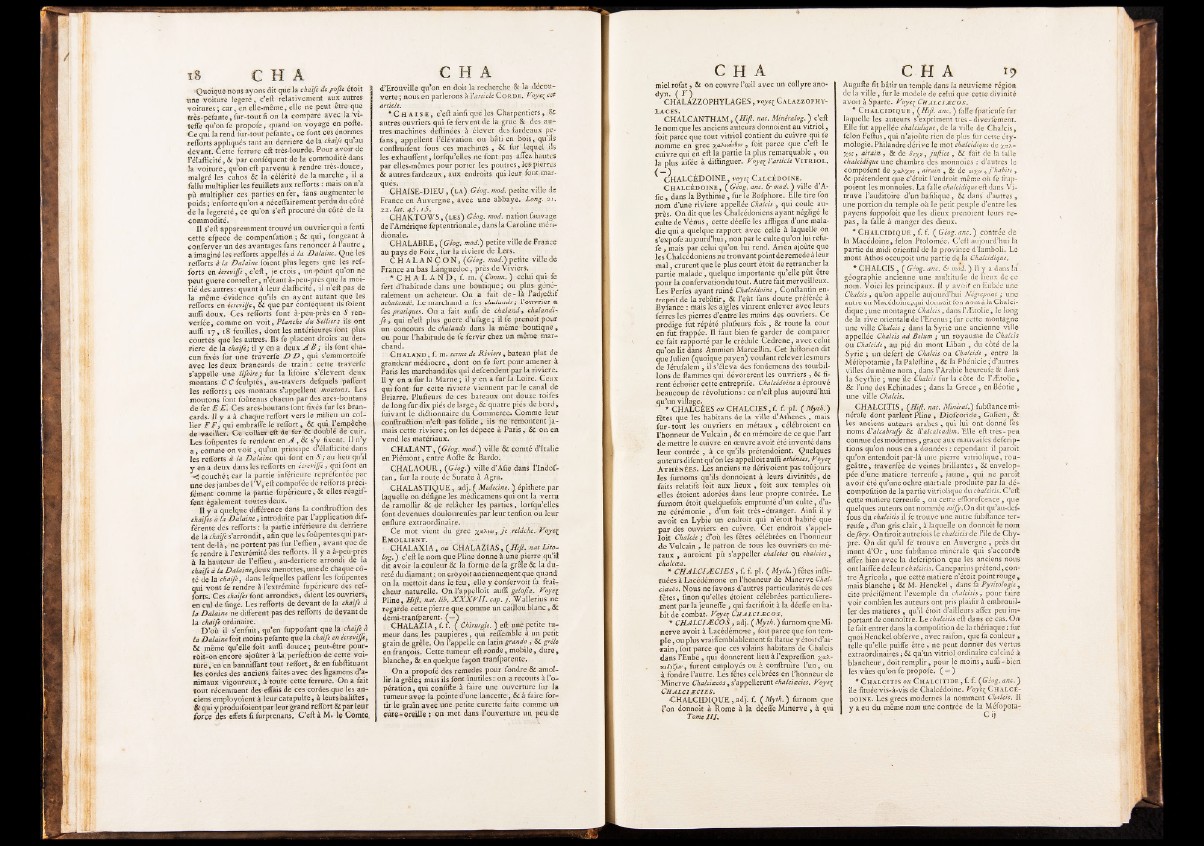
■ Quoique nous ayons dit qtié la chaife depojle étoit
une voiture legerô, c’eft relativement aux autres
voitures ; car, en elle-même, elle ne peut etre que
très-pefante, fur-tout fi on la compare avec la ‘vi-
teffe qu’on fe propofe, quand on voyage en pofte.
Ce qui la rend fur-tout pefante, ce font ces énormes
refforts appliqués tant au derrière de la chaife qu au
devant. Cette ferrure eft très-lourde.'Pour avoir de
Télafticité, & jpar conféquent de la commodité dans
la voiture, qu’on cil parvenu à rendre très-douce,
malgré les cahos & la célérité de la marche, il a
fallu multiplier les feuillets aux refforts : mais on n a
pu multiplier ces parties en fer, fans augmenter le
poids ; enforte qu’on a néeeffairement perdu du côte
de la legereté, ce qu’on s’eft procuré du côté de la
commodité. . . .
Il s’ell apparemment trouvé un ouvrier qui a fenti
cette efpece de compenfation ; & qui, fongeant à
conlèrver un des avantages fans renoncer à l’autre,
a imaginé les refforts appellés à la Dalaine. Que les
refforts à la Dalaine foient plus légers que les refforts
en écrevijfe, c’eft, je crois , un-point qu’on ne
peut guere contefter, n’étant à-peu-près que la moitié
des autres : quant à leur élafticité, il n’eft pas de
la même évidence qu’ils en ayent autant que les
refforts en écrevijfe, & que par conféquent ils foient
aufli doux. Ces refforts font à-peu-près en S ren-
verfée, comme on v o it , Planche du Sellier: ils ont
aufli 1 7 , 18 feuilles , dont les antérieures font plus
courtes que les autres. Ils fe placent droits au derrière
de la chaife; il y en a deux A B ; ils font chacun
fixés fur une traverfe D D , qui s’eramortôife
avec les deux brancards de train : cette traverfe
s’appelle une lifoire; fur la lifoire s’élèvent deux
montans C C fculptés,' au-travers defquels paffent
les refforts ; ces montans s’appellent moutons. Les
moutons font foûtenus chacun par des arcs-boutans
de fer SE E\ Ces arcS-boufans font fixés fur les brancards.
Il y a à chaque 'reffort vers le milieu un collier
F F , qui embraffe le reffort, & qui. l’empêche
de vaciller. Ce collier eft de fer 6c doublé de cuir.
Les foûpentes fe rerident en A , & s ^ fixent. Il n y
a , comme on v o it , qu’un principe d elafticite dans
les refforts à la Dalaine qui font en S ; au lieu qu’il
y en a deux dans lés refforts en écrevijfe, qui font en
-< couché ; car la partie inférieure repréfentée par
une des jambes de TV, eft compofée de refforts préci-
fement comme la partie fupérieure, & elles réagif-
fent également toutes deux.
Il y ’a quelque différence dans la conflruflion des
chaifes à la Dalaine, introduite par l’application différente
des refforts : la partie inférieure du derrière
de la chaijc s’arrondit, afin que les foûpentes qui partent
de-là, ne portent pas fur l’eflieu, avant que de
fe rendre à l’extrémité des refforts. Il y a à-peu-pres
à la hauteur de l’eflieu,. au-derriere arrondi de la
chaife à la Dalaine,âeux menottes, une de chaque côté
de la chaife, dans lefquelles paffent les foûpentes
qui vont fe rendre à l’extrémite fupérieure des refforts.
Cês chaifes font arrondies, dilent les ouvriers,
en cul de finge. Les refforts de devant de la chaife à
la Dalaine different pas des refforts de devant de
la chaife ordinaire.
î d’Erouville qu’on en doit la recherche & la décou-
: verte ; nous en parlerons à 1’article C orde. Voye{ cet
D ’où il s’enfuit, qu’en fuppofant que la chaife a
la Dalaine foit moins pefante que la chaife en écrevijfe,
& même qu’elle foit aufli douce; peut-être pour-
rôit-on encore ajouter à'Ià.perfeâion de cette voiture
,' en en banniffant tout reffort, & en fubftituant
les cordes des anciens faites avec des ligamens d’animaux
vigoureux, à toute cette ferrure. On a fait
tout récemment des- effais de ces cordes que les anciens
employoienf à leur catapulte, à leurs baliftes,
& qui y produifoient par leur grand reffort & par leur
force des effets fi furprenans. C ’eft à M* lé Comte.
article.
* C H A i S E, c’eft ainfi que les Charpentiers, &
autres ouvriers qui fe fervent de la grue & des autres
machines deftinées à élever des.fardeaux pe-
fans, appellent l’élévation ou bâti en :bois, -qu’ils
conftruifent fous ces machines , & fur 'lequel-.ils
les exhauffent, lorfqu’elles .ne font pas affez hautes
par elles-mêmes pour porter les poutres,les-pierres
& autres fardeaux, aux endroits qui leu'r font 1 marqués.
CHAISE-DIEU, ( l a ) Géog. mod. petite ville de
France en Auvergne, avec une abbaye. Long. z i .
ZZ.lat.46. 16. • ' ?
CH AK TOWS, ( les) Giog. mod. nation fauvage
de l’Amérique feptentrionale, dans la Caroline méridionale.
CHALABRE, (Géog. mod.) petite ville de France
au pays de Foix, lur la riviere de Lers.
C H A L A N Ç O N , (Géog. mod.) petite ville de
France au bas Languedoc, près de Viviers.
♦ C H A L A N D , f. m. fComm. ) celui qui fe
fert d’habitude dans une boutique; ou plus généralement
un acheteur. On a fait de - là l’adjeétif
achalandé. Le marchand a fes chalands ; l’ouvrier a
fes pratiques. On a fait aufli de chaland, chalandU
fe , qui n’eft plus guere d’ufage ; il fe prenoit pour
un concours de chalands dans la même*' boutique ,
ou pour l’habitude de fe fervir chez un même marchand.
C h a l a n d , f. m. terme de Riviere, bateau plat de
grandeur médiocre, dont on fe fert pour amener à
Paris les marchandi fes qui defeendent par la riviere.
Il y en a fur la Marne ; il y en a fur la Loire. Ceux
qui font fur cette riviere viennent par le canal de
Briarre. Plufieurs de ces bateaux ont douze toifes
de long fur dix piés de large, & quatre piés dé bord,
fuivant le diûionnaire du Commerce. Comme leur
conftru&ion n’eft pas lblide, ils ne remontent jamais
cette riviere ; on les dépece à Paris, & on en
vend les matériaux.
CH ALANT, {Géog. mod.) ville & comté d’Italie
en Piémont, entre Aofte & Bardo.
CHALAOUR, (Géog.) ville d’Afie dans l’Indof-
tan, fur la route de Surate à Agfa.
CHALASTIQUE, ad j.( Medecine.') épithete par
laquelle on défigne les médicamens qui ont la vertu
de ramollir & de relâcher les parties, lorfqu’elles
font devenues douloureufes par leur tenfion ou leur
enflure extraordinaire.
Ce mot vient du grec %<***<», je relâche. Voye^
Em o l l ien t.
■ CHALAXIA, ou CH ALAZIAS, (H iß . nat Lito-
log. ) c’eft le nom que Pline donne à une pierre qu’il
dit avoir la couleur & la forme de la grêle & la dureté
du diamant :, on crôyoit anciennement que quand
on la mettoit dans le feu , elle y confervoit fa fraîcheur
naturelle. On l’appelloit aufli gelofia. Voyci
P lin e ,Hiß. nat. lib. X X X V 11. cap. /. Wallerius ne
regarde cette pierre que comme un caillou blanc, &
demirtfaijfparent. (—)
: CHALAZIA, f. f. ( Chirurgie. ) eft unè petite tumeur
dans les paupières, qui reffemble à un petit
grain de, grêle. On l’appelle en latin grando, & grêle
en françois. Cette tumeur eft ronde, mobile, dure,
blanche, & en quelque façon tranfparente.
On a propofé des remedes pour fondre & amollir
la grêle; mais ils font inutiles: on a recours à l’opération,
qui confifte à faire une ouverture fur la
tumeur avec la pointe d’une lancette', ôc à faire for-
tir le grain avec une petite curette faite comme un
cure- oreille : on met dans l'ouverture un peu de
miel rofat, & on couvre l’oeil avec un collyre ano-
dyn. ( Y )
CHALAZZOPHYLAGES, voye^ C a la zzoph y -
3LACES.
CHALCANTHAM, (Hf . nat. Minéralog. ) c’eft
le nom que les anciens auteurs donnoient au v itriol,
foit parce que tout vitriol contient du cuivre qui fe
nomme en grec xaxwtv^ov, foit parce que c eft le
cuivre qui en eft la partie la plus remarquable , ou
la plus aifée à diftinguer. Voye{ Varticle V it r io l .
( “ )
CHALCÉDOINE, voyc{ C a lcéd oin e .
C h a l cÉd o in e , ( Géog. anc. & mod-. ) ville d’Afie
, dans la Bythinie, fur le Bofphore. Elle tire fon
nom d’une riviere appellée Chalcis , qui coule auprès.
On dit que les Chalcédoniens ayant négligé le
culte de Vénus, cette déefle les affligea d’une maladie
qui a quelque rapport avec celle à laquelle on
s?expofe aujourd’hui, non par le culte qu’on lui refu-
f e , mais par celui •qu’on lui rend. Arien ajoûte que
les Chalcedoniens ne trouvant point de remede à leur
m a l, crurent que le plus court étoit de retrancher la
partie malade, quelque importante qu’elle pût être
pour la confervationdutout. Autre fait merveilleux.
Les Perfes ayant ruiné Chalcèdoine, Conftantin entreprit
de la rebâtir, & l’eût fans doute préférée à
ByfanCe : mais les aigles vinrent enlever avec leurs
ferres les pierres d’entre'les mains des ouvriers. Ce
prodige fut répété plufieurs fois , & toute la cour
en fut frappée. Il faut bien fe garder de comparer
c e fait rapporté par le crédule Cedrene, avec celui
qu’on lit dans Ammien Marcellin. Cet hiftorien dit
que Julien (quoique payen) voulant relever les murs
de Jérufalem , il s’éleva des fondemens des tourbillons
de flammes qui dévorèrent les ouvriers , & firent
échouer cette entreprife. Chalcèdoine a éprouvé
beaucoup de révolutions : ce n’eft plus aujourd’hui
qu’un village.
‘ * CHALCÉES ou CHALCIES, f. f. pli ( Myth. )
fêtes que les habitans de la ville d’Athènes., mais
fur-tout les ouvriers en métaux , célébroient en
l ’honneur de Vuîcain, & en mémoire de ce que l’art
de mettre le cuivre en oeuvre a voit été inventé dans
leur contrée , à ce qu’ils préteridoient. Quelques
auteurs difent qu’on les appelloit aufli athénées. Vùye^
A th éné es. Les anciens ne dérivoient pas toujours
les furnoms qu’ils donnoient à leurs divinités, de
faits relatifs foit aux lieux , foit aux temples où
elles étoient adorées dans leur propre contrée. Le
furnom étoit quelquefois emprunté d’un culte, d’une
cérémonie , d’un fait très-étranger. Ainfi il y
avoit en Lybie un endroit qui n’étoit habité que
par des ouvriers en cuivre. Cet endroit s’appel-
loit Chalcée ƒ d’où les fêtes célébrées en l’honneur
de Vulcain , le patron de tous les ouvriers en métaux
, auroient pû s’appeller chalcies ou chalcies,
chalcoea.
* CHALCIÆCIES, f. f. pl. ( Myth.) fêtes infti-
tuées à Lacédémone en l’honneur de Minerve Chah
cia ces. Nous nefavons d’autres particularités de ces
fêtes, finon qu’elles étoient célébrées particulièrement
par la jeuneffe, qui facrifîoit à la déefle en habit
de combat. Vqye^CHALCiÆCOs.
* CHALCIÆCOS, adj. (Myth. ) furnom que Minerve
avoit à Lacédémone, foit parce que fon temple
, ou plus vraiffemblablement fa ftatue y étoit'd’ai-
xain, foit parce que ces vilains habitans de Chalcis
dans l’Eubé , qui donnèrent lieu à l’expreflion
mS'iÇuv, furent employés ou à conftruire l’un, ou
à fondre l’autre. Les fêtes célébrées en l’honneur de
'Minerve Chalcicecos, s'appelèrent chalcicecies. Voye1
C h a l c i æ c i e s .
•CHALCIDIQUE, adj. f. ( Myth. ) furnom que
l’on donnoit à Rome à la deeffe Minerve, à qui
Tome IIJ.
Arigufte fit bâtir un temple dans la neuvième région
de la v ille , fur le modèle de celui que cette divinité
avoit à Sparte. Voye{ Ch a lc iæ c o s .
* C ha lc id iq u e , (ffift- anc, ) falle fpatieufe fur
laquelle les auteurs s’expriment très - diyerfemenr.
Elle fut appellée chalcidique, de la ville de Chalcis,
félon Feftus, qui n’ajoûte rien de plus fur cette é tymologie.
Philandre dérive le mot chalcidique de
Xoç, airain , & de S'ixu, jn f ice , & fait de la iàlle
chalcidique une chambre des monnoies : d’autres le
compofent de xaVxfic , airain , & de 0/%« , f habite ,
& ■ •prétendent que c’étoit l’endroit même où fe frap-
poient les monnoies. La falle chalcidique eft dans Vi-
truve l’auditoire d’un bafilique, & dans d’autres ,
une portion du temple où le petit peuple d’entre les
payens fuppofoit que les dieux prenoient leurs repas
, la falle à manger des dieux.
* C h a lc id iq u e , f. f. ( Géog. anc. ) contrée de
la Macédoine, félon Ptolomée. C ’eft aujourd’hui la
partie du midi oriental de la province d’Iamboli. Le
mont Athos occupoit une partie de la Chalcidique.
* CH A L d S , ( Géog. anc. & moh. ) Il y a dans la .
géographie ancienne une multitude de lieux de ce
nom. Voici lés principaux. Il y avoif en Eivbée une
Chalcis, qu’on appelle aujourd’hui Négrepont ; une
autre en Macédoine,qui donnoit fon nom à la Chalcidique
; une montagne Chalcis, dansl’Æ tolie, le long
de la rive orientale dé l’Erenus ; fur cette montagne
une ville Chalcis ; dans la Syrie une ancienne ville
appellée Chalcis ad Belum ; un royaume de Chalcis
ou Chalcide, au pié du mont Liban , du coté de la
Syrie ; un defert de Chalcis ou Chalcide , entre la
Méfopotamie, la Paleftine, & la Phénicie ; d’autres
villes du même nom, dans l’Arabie heureufe & danâ
la Scythie ; une île Chalcis fur la côte de l’Ætolie,
& l’une des Echinades ; dans la Grece , en Béotie,
une ville Chalcis.
CHALCITIS, (Hifi. nat. Minéral.) fubftânce minérale
dont parlent Pline , Diofcoride, Galien, &
les anciens auteurs -arabes , qui lui ont donné les
noms d'alcabrufy & d'alcalcadïm. Elle eft très-peu
connue des modernes, grâce aux mauvaifes descriptions
qu’on nous en a données : cependant il paroît
qu’on entendoit par-là une pierre vitriolique, rougeâtre
, traverfée de veines brillantes, & enveloppée
d’une matière terreufe , jaune, qui ne paroît
avoif été qu’une ochre martiale produite par la dé-
compofition de la partie vitriolique du chalcitis. C ?eft
cette matière terreufe , ou cette efflorefcence, que
quelques auteurs ont nommée mify.On dit qu’au-defi
fous du chalcitis il fe trouve une autre fubftânce terreufe
, d’un gris clair, à laquelle on donnoit le nom
de fory . On tiroit autrefois le chalcitis de l’île de Chypre.
On dit qu’il fe' trouve en Auvergne , près du
mont d’O r , une fubftânce minérale qui s’accorda
affez bien avec la description que les anciens nous
ontlaiflee de leur chalcitis. Caneparius prétend, contre
Agrïcola, que cette matière n’étoit point rouge ,
mais blanche ; & M. Henckel, dans fa Pyritologie ,
cite précifément l’exemple du chalcitis, pour faire
voir combien les auteurs ont pris plaifir à embrouiller
des matières , qu’il étoit d’ailleurs affez peu important
de connoîtrè. Le chalcitis eft dans ce cas. On
le fait entrer dans la compofition de la thériaque : fuf
quoi Henckel obferve, avec raifon, que fa couleur >
telle qu’elle puiflë être, ne peut donner des vertus
extraordinaires ; & qu’un vitriôf ordinaire calciné à
blancheur, doit remplir, pour le moins, aufli-bien
les vûes qu’on fe propofe. ( — )
* C h a lc it is ou C halc îtid e , f. f. (Géog. anc.)
île fituée vis-à-vis de Chalcèdoine. /'byc^CHALGÉ-
doine. Les grecs modernes la nomment Chalcis. Il
y a eu du meme nom une contrée de la Méfopota-
C i j