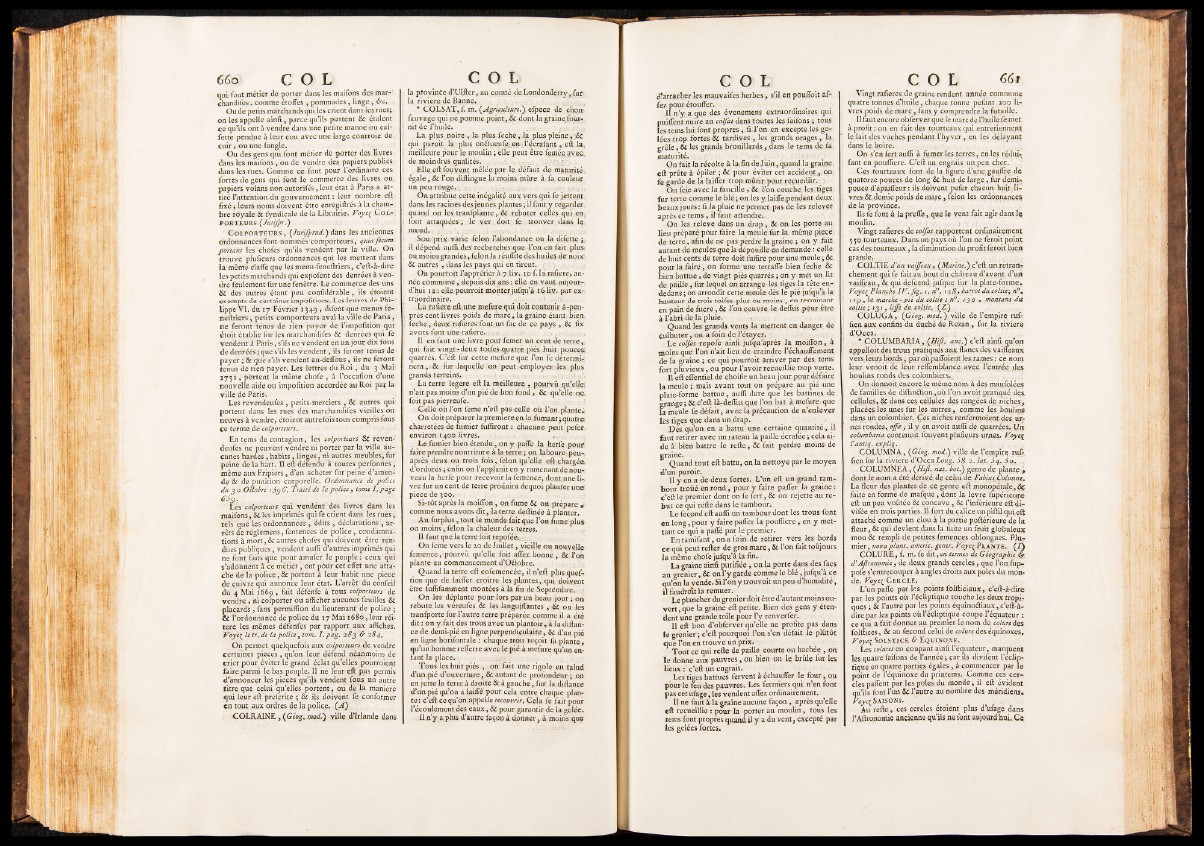
660 C O L
qui font .métier de porter dans les maifons des mar-
chandifes, icomme étoffes , pommades, linge., &c.
Ou de petits marchands qui les crient dans les'rues; >
on les appelle ainfi, parce qu’ils portent 8c étalent
ce qu’ils ont à vendre dans une petite manne oucaf-
fette pendue à leur cou avec une large courroie de
cuir, ;du une fangle.
Ou des gens qui font métier de porter des livres
dans les maifons you de vendre des papiers; publics
dans les rues. Comme ce font pour l’ordinaire ces
fortes de gens qui font le commerce des livrés, ou.
■ papiers, volans non autorifés., leur état à Paris a attiré
l’attention du gouvernement : leur nombre eft
fixé ; leurs noms doivent être enregiftrés à la chamr.
bre rdyale & fyndicale de la Librairie. Foye^Oot-.
PORTEURS(lurifpr.)
G ô i.£’0 R t É üi£ s , (Jutifprùdé)• dans les anciennes
ordonnances font- nommés: comporteurs, quia fecum
portant les chofes qu’ils vendent par la ville. On
trouvé plufiéurs ordonnances qui les mettent dans
la'mêm'é claffe que les menu-feneftriers-, c’eft-à-dire
les petits marchands qui expofent des denrées à vendre
feulement fur Une fenêtre. Le commerce des uns
8c des-autres étant peu cônfidérable, ils étoient
exempts de certaines impofitions. Les lettres de Phi-‘
lippe VI. du 17 Février 1349, difent que menus fe-
neftriérs, petits comporteurs aval la ville de Paris,
ne feront :fenus de rièn-payer de l’impofition qui
étoit établie fur les marchandifes & denrées qui fe
vendénf à! Pâtis, S’ils ne Vendent en un jour dix fous
de denrées; que s’ils les vendent-, ils feront ténus de
payer ; 8t dtie s’ils vendent au-deffous, ils ne feront
tenus dé riert j5àyër. Les lettres du Roi , du 3 Mai-
*751 > partent la même chofe , à l’occafion d?une
nouvelle aide ou impofition accordée au Roi par la
.ville de Paris.
Les revendeufes , petits-merciers , 8c autres qui-'
portent dans les rues des marchandifes vieilles ou
neuves à vendre, étoient autrefois tous compris fous
ce terme.de colporteurs.
En tems de contagion, lés colporteurs 8c reven-'
deufes ne peuvent vendre ni porter par la ville aucunes
hardes , habits, linges, ni autres meubles^ fur
peiné de la hart. 11 eft défendu à toutes perfonries,
même aux Fripiers, d’en acheter fur peine d’amende
& de punition corporelle. Ordonnance de police
du 3 à Octobre Traité de la police , tome I.page
WÉjm •
Lès colporteurs qui vendent des livres dans les
maifons, & les imprimés quife crient dans les rués1,
tels que les ordonnancés 3 édits , déclarations , arrêts
dé réglemens, fenténees dé police, condamnations
à mort, & autres chofes qui doivent être rendues
publiques, vendent' auffi d’autres imprimés qui
ne.font faits que pourâmufer le peuple: ceux qui
s’adonnent à Ce métier , oht pour cet effet une attache
de la policé, 8c portent à leur habit une piece
de cuivre qui annonce leur état. L’arrêt - du confeil
du 4 Mai 1669 , fait défenfe à tous colporteurs ' de
vendre, ni colporter ou afficher aucunes feuilles 8c
placards, fans permiffion du lieutenant de police ;
& Tordonnâftce de police du 17 Mai 1680, leur réitéré
les mêmes défenfes par rapport aux affiches.
Foye^ le lr. de la police, tom. I. pag. 2.8g & 2.84,
On permet quelquefois aux colporteurs. de vendre
certaines pièces , qu’on leur défend néanmoins de
crier pour éviter le grand éclat qu'elles pourroient
faire parmi le bas peuple. Il ne leur eft pas permis
d’annoncer les pièces qu’ils vendent fous un autre
titre que celui qu’elles portent, ou de la maniéré
qui leur eft preferire ; & ils doivent fe conformer
en tout aux ordres de la police. (A )
COLRA1NE , (Géog. mod.) ville d’Irlande dans
C O L
la province d’Ulfter, au comté deLondonderry },fur
la riviere de Banne.
* CO L S A T, f. m. (Agrifulture.) efpece dé cho,u;
fauvage qui ne^pomme p o in t,8c dont la grainefout;,
nit de l’ huile.
La plus .noirc , la- plusfeçhe;, l^.plus plqinex)&
qui paroît la plus onéfueuCenenvj’éc ra fan t, eft la,
meilleure pour le moulin ; elle peut être femé.e avec\
de- moindres, qualités.,'
Elle, eft,fo^yent mêlée; par le» défaut de .maturité;
é g a le , 8c l’on difhngue^a mpins p w e .à. fa.- çpüieur
un peu rouge.; y - : -,. ridEvl'i>iiri'■ ■
On attribue cette inégalité aux vers qui. fe jettent,
dans les racines des jeunes plan tes; il faut y regarder,
quand .on les: tranfplante , & rebuter celles. qtiien ,
font attaquées'; le ver ; doit; fe trouver dans le,
noeud, !
Sou prix^varie félon l’abondance ou la difette
il dépend auffi.desl reeberehes'que - l’on en fait- ; plus;
ou moios grandes,-félon la réuiîitedeshuiles,de noix
8c autres , dans les pays qui en tirent. / \
On potuf.oft l’apprétièr .à-7 jiv-., ip f. la ra fie re , année
commune » depuis -dix -ans :; elle en v au t, aujourd’hui
13.;: ejle •po.urroit monter jufqu’à par extraordinaire.
La.fâfiére. eft.uhe mefure qui, doit Contenir à-peu-
près cent livres poids de m a rc , la graine.étant bien,
feche» deux r^fiërésfontiùn fac de ce pays y 8c fix
avots font Une rafiere.üMSü
Il en faut une livre pptUrfemer un cent de teri-e,,,
qui fait' vingt y deux toiXeSjquatre pies huit pouces»
quarrés. C ’eft fur cette mefure que l’on Ye d é t e n d
ner a., i & t fur» - laquelle QU ; peu t employer > les plus
grands terreins» -,
La terre legere eft la meilleure , pourvu qu’ellei
n’ait pas moins d’un pié de,bon fond, & qu’elle ne,
foit pas pierreufe. ^.r. ;;
; Celle où l’on feme n’eft p a s celle oiv L’on, plante.'.
On doit préparer la première en la fumant ; quatre-
charretées de fumier fuffiront : chacune peut pefer
environ 1406; livres.
Le fumier bien étendu, on y paffe la herfe pour
faire prendre nourriture à la terre ; on laboure-peu-,
àprès deux ou trois foîs yfelon qu’elle eft chargée»
d’ordurës ; enfin on l’applanit en y ramenant de nouveau
la-herfe pour .recevoir la femenc,e, doi)ti.une lin
Vre fur un cent de terre produira dequoi planter une'
piece de 300.- --
Si-tôt après la moiffon, on fume 8c on prépare y
comme nousravons d ityla terre deftinée à planter.
Au furplus , tout le monde fait que l’on fume'plu»
ou moins,félon la chaleur des terres.
Il faut que la terre foit repoféé.o;;
On feme vers le 20 de Juillet y vieille ou nouvelle
femence ,.pourvu, qu’ellei.foit affe? bonne, & l’on
plante au commencement d’Oflohre.
Quand l a terre eft enfemencée , -il n’eft pjus .quef-
tion que dè laiffer croître les plantes, qui doivent
être fuffifamment montées à la fin, de Septembre. ' j
On les déplante pourlorspap.un b e a u ,jou r ; on
rebute les véreufes 8c les langujffantes , & on les
tranfporte fur, l’autre terre préparée, comme i l a été
dit : on y fait des trous avec un plantoir, à la diftan-
ce de.demi-pié en ligne perpendiculaire, 8c d-un pié
en ligne, horifontale : chaque trou reçoit fa p lan te ,
qu’un homme refterre av e c le pié à mefure qu’un enfant
la place,
. Tous les huit p ie s., on fait une rigole en talud
d’un pié d’ouverture, 8c autant de profondeur ; on
en jette la terre à droite & à gauche, fur la,.diftance
d’un pié qu’on a laiffé pour cela entre chaque plant
e : c’eft,ce qu’on appelle recouvrir. Cela fe fait pour
l’écoulement des e aux, & pour garantir de la gelée.
■ Il n’y_aplus d ’autre façon à donner, à moins que
C O L
d’arracher les mauvaifes herbes , s?il en poufloit af->
fez pour étouffer. , . v ;
Il n ’y a que des évenemens extraordinaires qui.
piufïent nuire au. colfat dansjtoutes les faifons ; tous
les tems,lui;fpnt p ro p r e s, fi, l’on, en excepte.lçs ger
lées, trop fortes 8ç ta rdiv e s,,Je s grands o rag e s, la.
g rê le , 8c les grands brouillards., .dans le tems de fa
maturité.... ■; -v,. ^ *. • /
On fait la récolte à Iaifin de Juin».quand la graine
eft prête à épiler ; 8c pour éviter cet accident,, on
fe, garde d e la laiffer trop mufit;-pôtu reçueilUt- )
On feie avec la faucille,' 8c rOn couche,- le§i tjges,
fur terre comme 'le blé ; on les ylaiffependant deux,
beaux-; jours : fi la pluie ne permet, pas de lés relever
après, ce tem s , itfa u t attendre;
Oh les r,eleve dans un dmp. , & on les porte:
ljeu préparé pour faire la m éulejfurja même piecé;
de terre , afin de ne pas, perdre la graine » on^y .fait
autant.de meulos.que ladépoifille en demande •* belle,
de huit cents de terre doit fuffiTe .pour une meule ; 8c
pour la.faireyOn forme, une terraffe bien feche 8c
bien b a t tu e d e vingt pies quarrés,; on y met un.lit
de paille., fur lequel on-arrange les, tiges la tête, en-
dedans ; on arrondit cette meule» dès le pié jufqu’à la;
hauteur de trois toifes . plus Ou moins -, en terminant
en pain de. fuçre , 8c l’on couvre, le. deffus p our être
à lfabri.deila pluie. . ,-f. .
Quand les grands vents la mettent en danger de
culbuter, on- a foin, d e j ?éîajyer2 . _.. • ...
L e colfat xepofe ainfi ju ^ u ’après la moifTon,; à
moins que l’on n’ait lieu de craindre réchauffement
de la graine ; ce qui pourroit. arriver par dest tems
fort p luvieux, ou pour l’avoir recueillie trop yerte.
Il eft effentiel de choifir un beau jour pour,défaire
la meule ; mais avant tout on prépare au pié une
plate-forme ba ttu e , auffi dure que les battines de
grange c’eft là-deflus que l’on bat à mefure que
la meule fe défa it, avec.la précaution de n’enlever
lé s tiges que dans un.drap. .
Dès qu’on en a battu une certaine quantité., il
faut retirer avec un rateau la paille écrafee ; cela.ai-
de à brén battre le re fte , 8c fait perdre moins.de
graine.
Quand tout eft battu, on la nettoye par le moyen
d’un puroir.
Il y en a de deux fortes. L ’un eft un grand tambour
troüé en ro n d , pour y faire paffer la graine:
c’eft le premier dont on fe fe rt, & on rejette au'rebu
t ce qui refte dans le tambour.
L e fecpnd eft auffi un tambour dont les trous font
en lon g , pour y faire paffer l a ppuffiere., en y mettant
ce .qui a paffé par le premier,
Én tamifant, orna foin.de retirer vers les bords
c e qui peut refter de gros marc , & l’on fait toujours
l a même chofe jufqu’a la fin.
L a graine ainfi purifiée, on la porte dans des facs
au grenier, 8c on l’y garde comme le b lé , jufqu’à ce
qu’on la vende. Si l’on y trouvoit un peu d’humidité,
il faudro\t la remuer.
Le plancher du grenier doit être d’autant moins ouv
e rt, que la graine eft petite. Bien des gens y étendent
une grande toi|e pour l’y renverfer.
Il eft bon d’obferver qu’elle ne profite pas. dans
le grenier ; c’eft pourquoi.Fan s’en défait le plutôt
que l’on en trouve un prix.
Tout ce qui refte de paille courte ou hachée , on
le donne aux pau vres, ou bien on le. brûle fur les
lieux c ’eft un engrais.
Les tiges battues fervent à échauffer le fo u r , ou
pour le feu des pauvres. Les fermiers qui n’en font
pas cet ufage, les vendent affez ordinairement.
Il ne faut à la graine aucune façon , après qu’elle
eft recueillie : pour la porter au moulin, tous les
tems font propres quand il y a du vent, excepté par
les gelées fortes*
C O L 4 B *
Vingt rafieres de grainç rendent année commune
quatre tonnes-d’huile,.cfiaque tonne pefant 200 livres
poids de m arç , fans y comprendre la futaille.
Il faut encore obfer ver que le marc de l’huile fe met
à profit : on en fait dgs tpurteaux qui entretiennent
le lait des vaçhes pendant l’hy v e r , en les1 délayant
dans, fe boire.
On s’en fert auffi à fumer,Ies,tqrres, e^leç réduL.
fant en pouffiere. C’ëft un engfais un peu cher.
Ces-tourteaux font{de; la figure d’une;gaqffire de
quatorze pouces de long 8c huit de large,,,fur demin
pQuee d’épaiffeur : ils doivent pefer chacun h u jt ji-
vresi&idemie poids de m a r c , félon les ordonnances
de la prpvinpe.
Ils te font ,à: la p.reffe , qup le vent fait agir dans le
moulip.
Vingt rafieres de coljat, rapportent ordinaire,ipent
5 50 tourteaux. Dans.un pays,oii l’on ne feroit point
cas des tp.urte.aux , la diminution du profit fproit,bien
grande.;,,
CO LT ÎE d'un vaijfeau ,. (Marine.) c ’eft, un,retranchement
qui fe fait au bout du,cfiâteau d’avant d’un
vaiflèau , & qui dçfçend jufqitq;fiir la plate-forme.
Foye^ Planche J F. du. £<>/#?; n?.
r2jC) » le mqrçhç- pii dp, coltïe ; n°. 13 0 » montftps du
coïtée 113,1, lijjê du confie. (Z)
C O LU G A , (Géog. mod,') ville de l’empire ruf-
fien sux. confins du duphé de R e zan , fur la riviere
d’Q çç a;. ,
, * CQLÜMBARIA, yjjjmÈ qpc.') c’eft ainfi qu’ofi
appellqit dps trous pratiqués aux flancs des vaiffeaux
vers, leurs bords , par oùpaffoient les rames : ce nom
leur verioit,de leur reffemblance avec l’çntrée des
boulins ronds des colombiers,, j
On donnoit encore.le même.nom. à des maufidées
de familles,de diftinâipn , où l’qn avoit pratiqué des.
cellules, & dans ces, qeljules des rangées.dJe.niches:>
placées les unes fur les au tr e s, comme les.boulins
dans un colombier. Ç,es niches renfermoient des un*
nés rondes, ojfoe ; ily , qn ayoit auffi de quarrées. Üij
columbafia. contenoit fouyent plufiéurs urnes. Foye^
f antiq. expliq.
COLUM NA, ( Géog. moi.') ville de l’empire ruff.
fien fur la riviere d’Ocça Long. 58. 2. lat. 54., 5o. .
COLUM NEA, (tiïfi.nat. bot.) genre de plante >
dont le, nom a été, dérive de celui, de fabius. Cofpnne,
La fleur des plantes de,cei genre eft monopethle,
faite en forme de mafque, dont la levre fupérieufç
eft un peu voûtée 8c con c ave, 8c l’inférieure éft dî-
vifée en trois parties, il fort du calice unpiftil qni çfl;
attaché comme un clou à la partie poftérieurç de la
fleur, & qui devient dans la fixité un fruit globuleux
mou 8c rempli de petites femences oblongues, Plur
mier, nova plant, americ. gener. Foyeç Pl a n t e . ( A
C O LU R E , f. m. fe d it, en termes de Géographie 6*
d'Astronomie, de deux grands cercles, que l’on fup-
pofe s’entrecouper à angles droits aux pôles du monde.
Foye^ C e r c l e .
L ’un paffe par les points folfticiaux, c’eft-à-dire
par les points oii l’écliptique touche les deux tropiques
; & l’autre par les points équinoftiaux, c’eft-à-
dire par les points oii l’écliptique coupe l’équateur :
ce qui a fait dpnner au premier le nom de colurt des
folftices, & au fécond celui de colure des équinoxes.
Foye[ Solstice & Equinoxe.
Les colur.es en coupant ainfi l’équateur, marquent
les quatre faifons de l’année ; car ils diyifent l’écliptique,
en quatre parties é g a le s, à commencer par le
point de l’équinoxe du priotems. Comme ces cercles
paffent par les pôles du monde, il eft évident
qu’ils font l’un 8c l’autre au nombre des méridiens*
Foye{Faisons.
Au refte , ces cercles étoient plus d’ufage dans
l’Aftronomie ancienne qu’ils ne font aujourd'hui, C ê