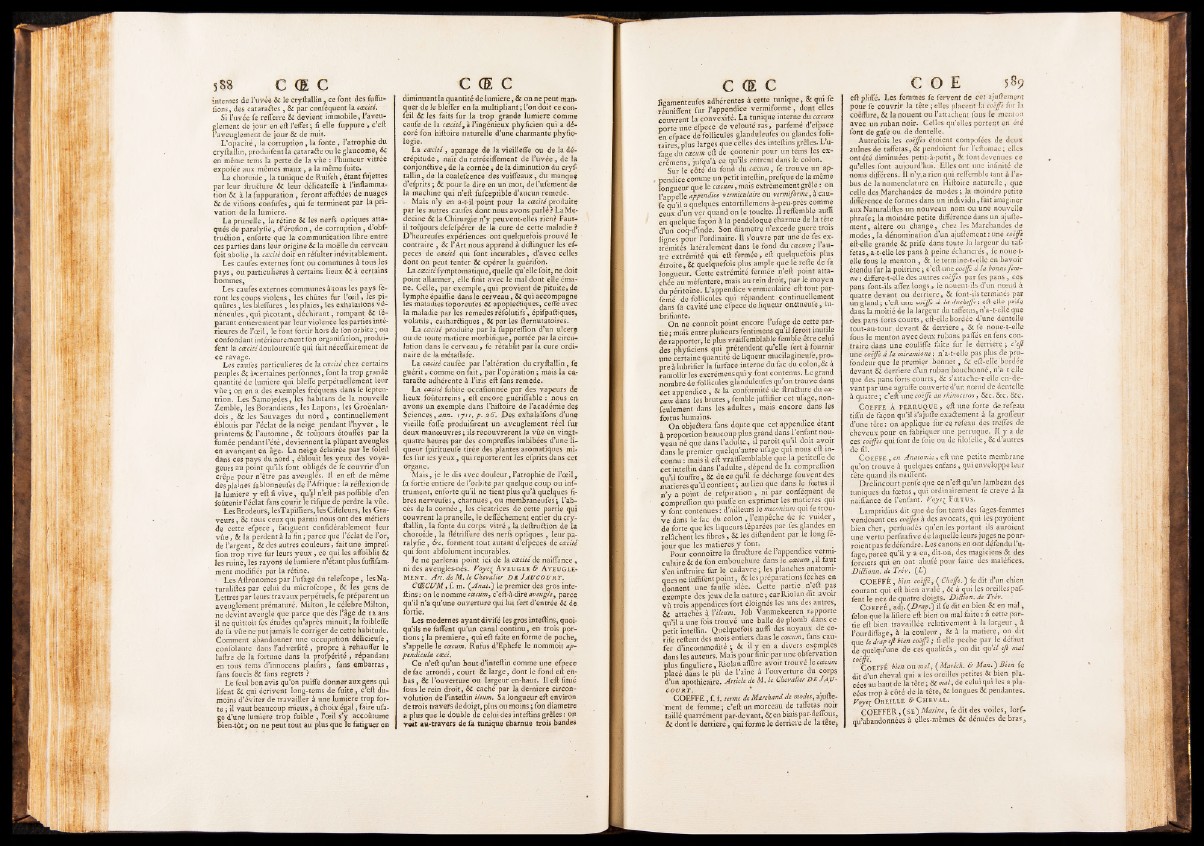
vfflHP’i l
5 SS C OE C
IHiJIfliPi
y m
internes de l’nvée & le cryftallin, ce font des fuffu-
fions, des cataraftes , & par conléquent la coecité.
Si l’uvée fe refferre & devient immobile, l’aveuglement
de jour en eft l’effet ; fi elle fuppure , e’eft
l'aveuglement de jour & de huit.
L ’opacité, la corruption, la fonte, l’atrophie du
cryftallin, produifent la cataraôe ou le glaucome, &C
en même tems la perte de la vue : l’humeur vitree
expofée aux mèmès maux, a la même fuite.
La choroïde, la tunique de Ruifch, étant fujettes
par leur ftruâipe & leur délicateffe à l’inflammation
& à la fuppuration, feront affeftées de nuages
& de vifions eonfufes, qui fe terminent par la privation
de la lumière.
La prunelle, la rétine & les nerfs optiques attaqués
de paralyfie, d’érofion, de corruption, d’obf-
t ru âion , enforte que la communication libre entre
ces parties dans leur origine & la moelle du cerveau
foit abolie, la coecité doit en réfulter inévitablement.
Les caufes externes font ou comntunes à tous les
pa ys, ou particulières à certains lieux & à certains
hommes,
Les caufes externes communes àttous les pays feront
les coups violens, les chûtes fiir l’oeil , les pi-
quûres, les bleffures, les plaies, les exhalaifons v é-
néneufes , qui picotant, déchirant ? rompant & réparant
entièrement par leur violence les parties intérieures
de l’oeil, le font fortir hors de fon orbite ; ou
confondant intérieurement fop organifation, produifent
la coecité douloureufe qui fuit néceflairement de
ce ravage.
Les caufes particulières de la coecité chez certains
peuples &Ç à*certaines perfonnes, font la trop grande
quantité de lumière qui bleffe perpétuellement leur
vue ; on en a des exemples fréquens dans le fepten-
trion. Les Samojedes, les habitans de la nouvelle
Zemble, les Borandiens, les Lapons, les Groënlan-
dois , & les Sauvages du nord, continuellement
éblouis par l’éclat de la neige pendant l’h y v e r , le
printems & l’automne, & toujours étouffés par la
fumée pendant l’été, deviennent la plûpart aveugles
en avançant en âge. La neige éclairée par le foleil
dans ces pays dii nord , éblouit les yeux des voyageurs
au point qu’ils font obligés de fe couvrir d’un
crêpe pour n’être pas aveugles. Il en eft de même
des plaines fablonneufes de l’Afrique : la réflexion de
la lumière y eft fi v iv e , qu’jl n’eft pas poflible d’en
foûtenir l’éclat fans courir le'rifque de perdre la vûe.
Les Brodeurs, lesTapifliers, les Cifeleurs, les Graveurs
, & tous ceux qui parmi nous ont des métiers
de cette efpecç , fatiguent confidérablement leur
v u e , & la perdent à la fin ; parce que l’éclat de l’or,
de l’argent, & des autres couleurs, fait une impref-
fion trop vive fur leurs y e u x , ce qui les affoiblit &
les ruine, les rayons de lumière n’etant plus fuffifam-
ment modifiés par la rétine.
Les Aftronomes par l’ufage dû telefcope, les Na-
turaliftes par celui du microfcope, & les gens, de
Lettres par leurs travaux perpétuels, fe préparent un
aveuglement prématuré. Milton, le célèbre Milton,
ne devint aveugle que parce que dès l’âge de i z ans
il ne quittoit fes études qu’après minuit ; la foibleffe
de fa vûe ne put jamais le Corriger de cette habitude.
Comment abandonner une occupation délicieufe ,
confolante dans l’adverfité , propre à rehauffer le
luftre de la fortune dans la profpérité, répandant
en tous tems d’innoçens plaifirs , fans embarras,
fans foucis & fans regrets ?
Le feul bon avis qu’on puiffe donner aux gens qui
lifent & qui écrivent long-tems de fuite, c’qft du-
pioins d’éviter de travailler à une lumière trop forte
; il vaut beaucoup mieux, à choix éga l, faire ufage
d’une lumière trop foible , l’oeil s’y accoutume
bien-tôt; on ne peut tout au plus que le fatiguer en
C CE C
diminuant la quantité de lumière, & on ne peut manquer
de le bleffer en la multipliant ; l’on doit ce con-
feii & les faits fur la trop grande lumière comme
caufe de la coecité, à l’ingénieux phyficien qui a décoré
fon hiftoire naturelle d’une charmante phyfip-
logie.
La coecité, apanage de la vieilleffe ou de la décrépitude
, naît du retréciffement de l’uvée , de la
eonjon&ive, de la cornée; de la diminution du cryftallin
, de la coalefcence des vaiffeaux, du manque
d’efprits ; & pour le dire en un mot, de i’ufement de
la machine qui n’eft fufceptible d’aucun remede.
. Mais n’y en a-t-il point pour la coecité produite
par les autres caufes dont nous avons parlé? La Médecine
& la Chirurgie n’y peuvent-elles rien? Faut-
il toujours defefpérer de la cure de cette maladie ?
D ’heureufes expériences ont quelquefois prouvé le
contraire , & l’Art nous apprend à diftinguer les ef-
peces de coecité qui font incurables, d’avec celles
dont on peut tenter & opérer la guérifon.
La coecitéfymptomatique, quelle qu’elle foit, ne doit
point allarmer, elle finit avec le mal dont elle émane.
Celle, par exemple,qui provient de pituite,de
lymphe épaiflie dans le cerveau, & qui accompagne
les maladies foporeufes & apoplectiques, ceffe avec
la maladie par les remedes réfolutifs, épifpaftiques,
volatils, catharéfciques , & par les fternutatoires.
La coecité produite par la fuppreflion d’un ulcéra
ou de toute matière morbifique, portée par la circulation
dans le cerveau, fe rétablit par la cure ordinaire
de la métaftafe.
La coecité caufée par l’altçration du cryftallin, fe
guérit, comme on fait, par l’opération ; mais la car
tarage adhérente à l’iris eft fans remede.
La coecité fubite çccafionnée par des vapeurs de
lieux foûterreins , eft encore guériflable : nous en
avons un exemple dans l’hiftoire de l’académie des
Sciences, ann. ty n .p . 2.6. Des exhalaifons d’une
vieille foffç produifirent un aveuglement réel fur
deux manoeuvres ; ils recouvrèrent la vue en vingt-
quatre heures par des çompreffes imbibées d’une liqueur
fpiritueufe tirée des plantes aromatiques mi-
fes fur les y e u x , qui reportèrent les efprits dans cet
organe.
Mais, je le dis avec douleur, l’atrophie de l’oe il,
fa fortie entière de l’orbite par quelque coup ou infi-
trument, enforte qu’il ne tient plus qu’à quelques fibres
nerveufes, charnues, ou membraneufes ; l’abcès
de la cornée, les cicatrices de cette partie qui
couvrent la prunelle, le defféchement entier du cryftallin
, la fonte du corps vitré , la deftruâion de la
choroïde, la flétriffure des nerfs optiques , leur paralyfie
, &c. forment tout autant d’efpeces de coecité
qui font abfolument incurables.
Je ne parlerai point ici de la coecité de naiffance,
ni des aveugles-nés. Voye^ Aveugle & A veuglem
en t. Art. de M. le Chevalier DK Ja v c o v k t .
C(ECUM, f. m. (Anat.) le premier des gros inte-
ftins : on le nomme cæcum, c’eft-à-dire aveugle, parce
qu’il n’a qu’une ouverture qui lui fert d’entrée & de
fortie.
Les modernes ayant divifé les gros inteftins, quoiqu’ils
ne faffent qu’un canal continu, en trois portions
; la première, qui eft faite en forme de poche,
s’appelle le cæcum. Rufus d’Ephefe le nommoit ap-
pendicula coeci.
Ce n’eft qu’un bout d’inteftin comme une efpece
de fac arrondi, court & large, dont le fond eft en-
bas , & l’ouverture ou largeur en-haut. Il eft fitué
fous le rein droit, & caché par la derniere circonvolution
de l’inteftin ileum. Sa longueur eft environ
de trois travers de doigt, plus ou moins ; fon diamètre
a plus que le double de celui des inteftins grêles : on
voit au-travers de fa tunique charnue trois bandes
M B f ia f e M m
C (K C
lieamenteufes adhérentes à cette tunique, & qui fe
■ réunifient fur l’appendice verraiforme, dont elles
couvrent la convexité. La tunique interne du cæcum
porte une efpece de velouté ras, parfemé d’efpace
en efpace de follicules glanduleufes ou glandes foli-
taires, plus larges que celles des inteftins grêles. L’ufage
du cæcum eft de contenir pour un tepis les ex-
crémens-,'jüfqu’à ce qu’ils entrent dans le colon.
Sur le côté dit fond du cæcum, fe trouve un ap-
. pendice comme un petit inteftin, prefque de la même
longueur que le cæcum, mais extrêmement grêle : on
l’appelle appendice vermicuiaire ou vermiforme, à caufe
qu’il a quelques entortiliemens à-peu-près comme
ceux d’un vér quand °U Ie touche. Il reffemble suffi
en quelque façon à la pendeloque charnue de la tête
d’un coq-d’inde. Son diamètre n’excede guere trois
lignes pour l’ordinaire. Il s’ouvre par une de fes extrémités
latéralement dans le fond du cæcum^ l’autre
extrémité qui eft fermée, eft quelquefois plus
étroite, & quelquefois plus ample que le refte de fa
longueur. Cette extrémité fermée n’eft point attachée
au méfenterë, mais7“tu rein droit, par le moyen
du péritoine. L’appendice vermicuiaire eft tout parfemé
de follicules qui répandent continuellement
dans fa cavité une efpece de liqueur onftueufe, lubrifiante.
I , .
On ne connoît point encore 1 ufage de cette partie
; mais entre plufienrs fentimens qu’il feroit inutile
de rapporter, le plus vraiffemblable femble être celui
dès phyficiens qui prétendent qu’elle fert à fournir
une certaine quantité de liqueur niucilagineufe,propre
à lubrifier la furface interne du fac du colon, & à
ramollir les excrémensquiy font contenus. Le grand
nombre de follicules glanduleufes qu’on trouve dans
cet appendice , & la conformité de ftruaure du cæcum
dans les brutes, femble juftifier cet ufage, non-
feulement dans les adultes, mais encore dans les
foetus humains.
Onobjeâera fans donte que cet appendice étant
à proportion beaucoup plus grand dans 1 enfant nouveau
né que dans l’adulte, il paroît qu’il doit avoir
dans le premier quelqu’autre ufage qui nous eft inconnu
: mais il eft vraiffemblable que la. penteffe de
cet inteftin dans l’adulte, dépend de la compreflion
qu’il fouffre, 8c de çe qu’il fe décharge fouvent des
matières qu’il contient; au lieu que dans le foetus il
n’y a point de refpiration , ni par conféquent de
compreflion qui puiffe en exprimer les matières qui
y font contenues : d’ailleurs le mecamum qui fe trouv
e’dans le fac du colon , l’empêçhe de le vuider,
de forte que les liqueurs féparees par fes glandes en
relâchent les fibres, & les diftendent par le long fe.
tour que les matières y font.
Pour connoître la ftruaure de l’appendice vernu-
culaire & de fon embouchure dans le cæcum, il faut
s’en inftruire fur le cadavre ; les planches anatomiques
ne fuffifent point, Scies préparations feches en
donnent une fauffe idée. Cette partie fieft pas
exempte des jeux de la nature; earRiolan dit avoir
vû trois appendices fort éloignés les uns des autres,
& attachés à Yilcum. Job Vanmekeeren rapporte
qu’il a une fois trouvé une balle de plomb dans ce
petit inteftin. Quelquefois aufli des n'ayauy de ce-
rife relient des mois entiers dans le cæcum, fans cau-
fer d’incommodité ; St il y en a divers exemples
dans les auteurs. Mais pour finir par une obfervation
plus finguliere, Riolan aflïire avoir trouvé le cæcum
placé dans le pii de l’aine à l’ouverture du corps
d’un apothicaire. Article deM.le Chevalier d e J n u -
COURT . * .
COEFFE, f. f . terme de Marchand de modest ajufte-
ment de femme; c’eft un morceau de taffetas noir
taillé quarrément par-devant, ôçen biais par-deflous,
& dont lé derrière, qui forme le derrière de la tête}
C O E 589
eft plifle. Les femmes fe fervent de cet ajuftemçnt
pour fe couvrir la tête ; elles placent la coiffe fur la
coëffure, & la nouent ou l’attachent fous le menton
avec un ruban noir. Celles qu’elles portent en été
font de gafe ou de dentelle.
Autrefois les coiffes étoient compofées de deux
aulnes de taffetas, df pendoient fur l’eftomac; elles
ont été diminuées petit-à-petit, & font devenues ce
qu’elles font aujourd’hui. Elles ont une infinité de
noms différens. Il n’y,a rien qui reffemble tant à l’abus
de la nomenclature en Hiftoire naturelle , que
celle des Marchandes de modes ; la moindre petite
différence de formes dans un individu, fait imaginer
aux Naturaliftes un nouveau nom ou une nouvelle
phrafe ; la moindre petite différence dans un ajuftey
ment, altéré ou change, chez les Marchandes de
modes, Ja dénomination d’un ajuftement : une coiffe
eft-elle grande & prife dans toute la largeur du taffetas,
a-t-elle les pans à peine échancrés, fe noue-t-
elle fous le menton , & fe termine-t-elle en bavoir
étendu fur la poitrine ; c’eft une coiffe à la bonne femme
: differe-t-elle des autres coiffes par fes pans , ces
pans fontrils affez longs , fe nouent-ils d’un noeud à
quatre devant ou derrière» & font-ils termines par
un giand ; c’eff une coiffe à la duçheffe : eft-elle prife
dans la moitié de la largeur du taffetas, n’a-t-elle que
des pan? forts courts, eft-elle bordée d’une dentelle
tout-au-tour, devant & derrière , & fe noue-t-elle
fous le menton avec deux rubans paffés en fens contraire
dans, une çouliffe faite fur le derrière ; e’efi
une coiffe à la miramione : n’a-t-elle pas plus de profondeur
que le premier bonnet, & eft-elle bordée
devant & derrière d’un ruban bouchonné, n’a t elle
que des pans forts courts, & s’attache-t-elle en-devant
par une agraffe couverte d’ur. noeud de dentelle
à quatre ; c’eft une coiffe au rhinocéros, & c . &c. & c .
C oeffe à perruque , eft une forte de refeau
tiffu de façon qu’il s’ajnfte exa&ement à la groffeu.r
d’une tête : on applique fur ce refeau des trèfles de
cheveux pour en fabriquer une perruque. Il y a de
ces coiffes qui font de foie ou de fiiofelle, ôc d’autres
de fil.
C oeffe , en Anatomie, eft une petite membrane
qu’on trouve à quelques enfans, qui enveloppe leur
tête quand Us naiffent.
Drelinçourt penfe que ce n’eft qu’un lambeau des
tuniques du foetus, qui ordinairement fe creve à la
naiffanee de l’enfant. Voye^_ F oe t u s .
Lampridius dit que de fon tems des fages-femmes
vendoient ces coiffes à des avocats, qui les payoient
bien cher, perfuadés qu’en les portant ils auroient
une vertu perfuafive de laquelle leurs juges ne pour-
roientpas fe défendre. Les canons en ont défendu l’ufage,
parce qu’il y a eu, dit-ori, des magiciens & des
forciers qui en ont abufe pour faire des maléfices*
Diçlionn. de Tréy. (L)
ÇOEFFÉ, bien coiffé, ( Chaffe. ) fe dit d’un chien
courant qui eft bien avale ; & à qui- les oreilles paf-
fent le nez de quatre doigts. Diction.de Trév.
C oeffe, adj. (Drapé) il fe dit en bien & en mal,
félon que la lifiere eft bien ou mal faite : fi cette partie
eft bien travaillée relativement à la largeur, à
l’ourdiflàge, à la couleur, & à la matière, on dit
que le drap eft bien coiffé; fi elle peche par J e défaut
de quelqu’une de ces qualités, ôn dit qu’i/ eji mal
Co EFFÉ bien ou mal y (Maréch. & Man.) Bien fe
dit d’un cheval qui a les oreilles petites & bien placées
au haut de la tête ; & mal y de celui qui les a placées
trop à côté de la tête, &: longues & pendantes.
Foye^ Oreille & C h e v a l .
CQEFFER ( se) Marine y fe dit des voiles, lorf-
qu’abandorinées à elles-mêmes & dénuées de bras,