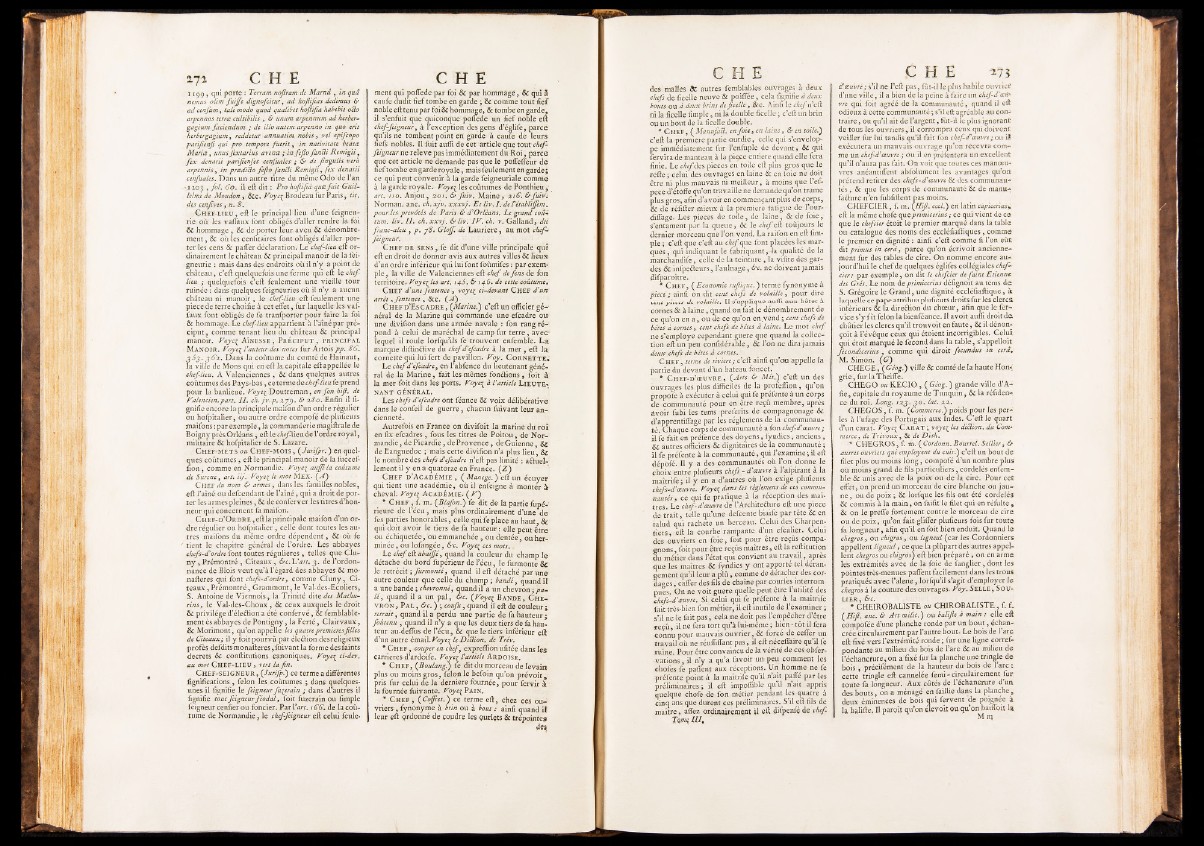
a7i C H E
1 *99 > qui Por^e : Terram noftramde Marné , in quâ
nemus olim fuiffe dignofcitur, ad hojlijias .dedimus &
ad cenfum, tait modo quod qualibet hofiijîa habtbit oclo
arpennos terra cultibi/is , & unum arpennum ad herber-
gagium faciendum ; de illo autan arpenno in quo erit
herbergagium, reddetur annuatim, nobis, vel epifcopo
parifitnfi qui pro tempore fuerit, in nativitate beat a
Maria, unusfextarius avence f in fefto fancti Remigii
fe x dinarii parifienfes cenfuales■ ; & de fingulis ver6
arpennis, in prtzdiBo fejlo fancti Remigii, fex denarii
cenfuales. Dans un autre titre du mêmeOdo de l’an
'I203 , fol. Go. il eft dit : Pro hofiijîa. quoe fuit Guil-
lelmi de Moudon ôCc. Voye^ Brodeau fur Paris, tit.
des cenjîves , n. 8.
C hef-l ie u , eft le principal lieu d’une feigneu-
rie où' les vaffaux font obligée d’aller rendre la 1 foi
& hommage , 6c.de porter leur, aveu 6c dénombrement,
6c oii les cenfitaires font obligés d’aller porter
les cens & palier déclaration.- Le chef-lieu eft ordinairement
le château 6c principal manoir de la fei-
gneurie : mais dans des endroits où il n’y a point de
château, c’eft quelquefois une ferme qui eft le chef-
lieu ; quelquefois c’eft feulement une vieille tour
ruinée : dans quelques feigneiiries oh il n’y a aucun
château ni manoir , le chef-lieu eft feulement, une
pièce de terre choifie à cét effet, fur laquelle les vaffaux
font obligés de fe tranfporter pour taire la foi
& hommage. Le chef-lieu appartient à l’âînépar pré-
ciput, comme tenant lieu du château 6c principal
manoir. Voye^ Aînesse , Préc iput , principal
Man o ir . Voye{ C auteur desnotes fur Artois pp. 8G.
3S3. 3G2. Dans la coutume du comté de Hainaut,
la ville de Mons qui en eft la capitale eft appellée le
chef-lieu. A Valenciennes , ôc dans quelques autres
coutumes des Pays-bas, ce terme de chef-lieu fe prend
pour la banlieue. Voye^ Doutreman, en fon hifi. de
Valencien.part. II. ch. jv .p .zy'ÿ. & 280. Enfin il lignifie
encore la principale maifon d’un ordre régulier
ou hofpitalier, ou autre ordre compofé de plulieurs
maifons : par exemple, la commanderie magiftrale de
Boigny prèsOrléans, eft le chef lien de l’ordre royal,
militaire ÔC hofpitalier de S. Lazare.
C hef-m e t s ou C hef-m o is ; ( Jurifpr. ) en quelques
coutumes, eft le principal manoir de la fuccef-
fion, comme en Normandie.. Voye£ aujjila coutume
de Surent, art. iij. Voye^ le mot Mex. (A )
C hef du nom & armes, dans les famillesnobles,
eft l’aîné ou defcendant de l’aîné, qui a droit de porter
les armes pleines, 6c de conferver les titres d’honneur
qui concernent fa maifon.
C hef-d’O rd r e , eft la principale maifon d’un ordre
régulier ou hofpitalier , celle dont toutes les autres
maifons du même ordre dépendent, 6c où fe
tient le chapitre général de l’ordre. Les abbayes
chefs-d'ordre font toutes régulières , telles que Clu-
n y , Prémontré , Cîteaux, &c. h'art, 3. de l’ordonnance
de Blois veut qu’à l’égard des abbayes 6c mo-
nafteres qui font cliefs-d.'ordre, comme Cluny , Cîteaux
, Prémontré, Grammont, le Val-des-Ecoliers,
S. Antoine de Viennois, la Trinité dite des Mathu-
rins, le Val-des-Choux, 6c ceux auxquels le droit
6c privilège d’élettion a été confervé, 6c femblable-
ment ès abbayes de Pontigny, la Ferté, Clairvaux,
6c Morimont, qu’on appelle les quatre premières filles
de Cîteaux; il y l'oit pourvu par élettion des religieux
profès defditsmonafteres,fuivant la forme desfaints
decrets 6c conftitutions canoniques. Voye%_ ci-dev.
au mot C hef- lieu , vers la fin.
C hef- seigneur , ([Jurijp.) ce terme a différentes
lignifications, félon lès coutumes ; dans quelques-
unes il lignifie le feigneur fuqerain ; dans d’autres il
fignifie tout feigneur féodal, foit fuzeràin ou fimple
feigneur cenfier ou foncier. Pari 'art. iGG. de la coutume
de Normandie, le chef feigneur eft celui feule-
C H Ë
ment qui poffede par foi 6c par hommage, 6c qui 5
caufe dudit fief tombe en garde ; 6c comme tout fief
noble eft tenu par foi 6c hommage, & tombe en garde,
il s’enfuit que quiconque poffede un fief noble eft
chef-feigneury à l’exception des gens d’églife, parce
qu’ils ne tombent point en garde à came de leurs
fiefs nobles. Il fuit auffi de cet article que tout chef
feigneur ne releve pas immédiatement du R oi, parce
que cet article ne demande pas que le poffeffeur de
fief tombe en garde royale, mais feulement en garde J
ce qui peut convenir à la garde feigneuriale comme
à la garde royale. Voyc^ les coutumes de Ponthieu ,
art., n o . Anjou, 201; & fu iv . Maine, ziG .& fu iv i
Norman, anc. ch. xjv. xxxvj. E t liv. I . deCétabliffem„
pour, les prévôtés de Paris-& d'Orléans, Le grand cou-*
tum. liv. II. ch. x xv j. & liv. IV . ch. v, Galland, dit
franc-aleu , p. y8. Gloff. de Laurier e , au mot chef*
feigneur.
C hef de sens ,>le dit d’une ville principale quî
eft en droit dé donner avis aux autres villes 6c lieux
d’un ordre inférieur qui lui font foûmifes : par exemple
, la ville de Valenciennes eft chef de fins de fon
territoire. Voyelles art. 14S. & 146. de cette coutume•
CHEF' d'une Jentence , voyer ci-devant CHEF d'un
arrêt , fintence , Ô£C. (A ) •
C hef d’Escadre , (marine.') c’ eft un officier général
de la Marine qui commande une efcadre ou?
une divifion dans une armée navale : fon rang répond
à celui de maréchal de camp fur terre, avec1
lequel il roule lorfqu’ils fe trouvent enfemble. La
marque diftindive du chef d.'efcadre à la mer , eft la
cornette qui lui fert de pavillon. Voy. C o rn et te;
Le chef d'efcadre, en l’abfence du lieutenant général
de la Marine, fait les mêmes fondions, lôit à
la mer foit dans les ports. Voye^ à l'article L ieu ten
a n t GÉNÉRAL.
Les chefs d'efcadre ont féailce 6c voix délibérative
dans le confeil de guerre, chacun fuivant leur ancienneté.
Autrefois en France on divifoit la mariné du roî
en fix efcadres, fous les titres de Poitou, de Normandie
, de Picardie, de Provence, de Guienne, ôc
de Languedoc ; mais cette divifion n’à plus lieu, ÔC
le nombre des chefs tFefcadre n’eft pas limité : actuellement
il y en a quatorze en France. (Z )
C hef d’A cad émie , ( Manege. ) eft un écuyer
qui tient une académie, où il enfeigne à monter à
cheval. Voye{ A cad ém ie . ( V )
* C hef , ƒ. m. (Blafon.) fe dit de la partie fupé-'
rieure de l’écu, mais plus ordinairement d’une de
fes parties honorables, celle qui fe place au haut 6c
qui doit avoir le tiers de fa hauteur : elle peut être
ou échiquetée, ou emmanchée, ou dentée, ouher-
minée, ou lofangée, &c. Voye[ ces mots..
Le chef eft abaijjé, quand la couleur du champ le
détache du bord fuperieur de l’écu, le furmonte 6c
le rétrécit ; furmonté, quand il eft détaché par une
autre couleur que celle du champ ; bandé, quand il
a une bande ; chevronné, quand il a un chevron ; pa-
lé, quand il a un pal, &c. ( Voye1 Ba n d e , C hevron
, Pal , &c. ) ; coufu, quand il eft de couleur;
retrait, quand il a perdu une partie de fa,hauteur ;
foûtenu , quand il n’y a que les deux tiers de fa hauteur
au-deffus de l’écii, & que le tiers inférieur eft
d’un autre émail. Voye%_ le Diction, de Trcv.
* C hef , couper en chef y expreffion ufitée dans les
carrières d’ardoife. Voye^ Particle A rdoise.
* C he f , (Boulangé) fe dit du morceau de levain
plus ou moins gros, félon le befoin qu’on prévoit
pris fur celui de la derniere fournée, pour fervir à ‘
la fournée fuivante. Voye^ Pain.
* C h e f , (Coffret.) ce terme eft, chez ces ouvriers
, fynonyme à brin ou à bout : ainfi quand il
leur eft ordonné de copdre les ourlets & trepointea
des
C H E
des malles & autres femblables ouvragés à defix
chefs de ficelle neuve 8c poiffée, cela fignifie à deux
bouts ou à deux brins de ficelle, ,&c. Ainfi le chef n’eft
ni la ficelle fimple, ni la double ficelle ; c’eft un brin
ou un bout de la ficelle double.
* C h e f , ( Manufact. en foie, en laine , & en toile.)
c’eft la première partie ourdie, celle qui s’enveloppe
immédiatement fur l’enfuple de devant, & qui
fervira de manteau à la piqce entière quand elle fera
finie. Le chef des pièces en toile eft plus gros que le
refte ; celui des ouvrages en laine Sc en loie ne doit
être ni plus mauvais ni meilleur, à moins que l’ef*
pece d’étoffe qu’on travaille ne demande qu’on trame
plus gros, afin d’avoir en commençant plus de corps,
& de réfifter mieux à la première fatigue de l’our-
diffage. Les pièces de toile, de laine, 8c de foie ,
s’entament par la queue, ôc le chef eft toujours le
dernier morceau que l’on vend. La raifon en eft fim-*
pie ; c’eft que c’eft au chef que font placées les marques
, qui indiquant le fabriquant, -la qualité de la
marchandife, celle de la teinture , la vifite des gardes
6c infpeûeurs, l’aulnage, &c. ne doivent jamais
difparoître.
* C hef, ( Economie ritfiiqué. ) terme fynonyme à
piecé; -ainfi on dit cent chefs de volaille, pour dire
cent pièces de volaille. Il s’applique auffi aux bêtes à
cornes 8c à laine, quand on fait le dénombrement de
ce qu’on en a ,. ou de ce qu’on en .vend ; cent chefs de
bêtes à cornes, cent chefs de bêtes à laine. Le mot chef
ne s’employe cependant guere que quand la collection
eft un peu confidérable, 6c l’on ne dira jamais
deux chefs de bêtes à cornes. '
C hef , terme de rivière; c’eft ainfi qu’on appelle la
partie du devant d’ün bateau foncet.
* C hef-d’oeuvre , ( Arts & Mét.) c’eft un des
ouvrages les plus difficiles de la profeffion, qu’on
propofe à exécuter à celui qui fe préfente à un corps
de communauté pour en être reçu membre, apres
avoir fubi les tems preferits de compagnonage 6c
d’apprentiffage par les régleniens de la communauté.
Chaque corps de communauté afon chef-d'oeuvre;
il fe fait en préfence des doyens, fyndics, anciens *
6c autres officiers 6c dignitaires de la communauté ;
il fe .préfente à la communauté, qui l’examine ; il eft
dépofé. Il y a des communautés où l’on donne le
choix entre plulieurs chefsr d'oeuvre à l afpirant à la
maîtrife ; il y en a d’autres où l’on exige plüfieurs
chefs-d'oeuvre. Voye^ dans les réglemens de ces communautés
, ce qui fe pratique à la réception des maîtres.
Le chef-d'oeuvre de l’Architeûure eft une piece
de trait, telle qu’une defcente biaife par tête 6c en
talud qui racheté un berceau. Celui des^Charpen-
tiers, eft la courbe rampante d’un efcalier. Celui
des ouvriers en foie, foit pour etre reçus compagnons
, foit pour être reçus maîtres, eft la reftitution
du métier dans l’état qui convient au travail, après
que les maîtres 6c fyndics y ont apporté tel dérangement
qu’il leur a p lu, comme de détacher des cordages
, caffer des fils de chaîne par courfes interrom
pues. On ne voit guere quelle peut être l’utilité des
chefs-d'oeuvre. Si celui qui fe préfente à la maîtrife
fait très-bien fon métier, il eft inutile de l’examiner ;
s’il ne le fait pas, cela ne doit pas l’empêcher d’être
reçu , il ne fera tort qu’à lui-même ; bien- tôt il fera
connu pour mauvais ouvrier, ôc forcé de ceffer un
travail où ne réuffiffant pas, il eft neceffaire qu’il fe
ruine. Pour être convaincu de la vérité de cesobfer-
• varions , il n’y a qu’a favoir un- peu comment les
chofes fe paffen^t aux réceptions. Un homme ne fe
préfente point à la maîtrife qu’il n’ait palfe par les
préliminaires; il eft impoffible qu’il n?ait appris
quelque chofe de fon métier pendant les quatre à
cinq ans que durent ces préliminaires. S’il eft fils de
maître, affez ordinairement il eft ftifpenfé de chef-
Tams I II,
C H E ^73
d'oeuvre; s*il ne l’eft pas, fût-il le plus habile ouvrief
d’une v ille, il a bien de la peine à faire un chef-d'oeàr
vre qui foit agréé de la communauté» quand il eft
odieux à cette communauté ; s’il eft agréable au contraire
, ou qu’il ait de l’argent, fût-il le plus ignorant
de tous les ouvriers, il corrompra ceux qui doivent
veiller fur lui tandis qu’il fait fon chef-d'oeuvre ; ou il
exécutera un mauvais ouvrage qu’on recevra comme
un chef-d'oeuvre ; ou il en préfentera un excellent
qu’il n’aura pas fait. On voit que toutes ces manoeuvres
anéantiffent abfolument les avantages qu’on,
prétend retirer des chefs-d'oeuvre 6c des communaux
tés, 8c que les corps de communauté ôc de manu-*,
fatture n’en fubfiftent pas moins.
CHEFCIER, f. m. (Hifl. eccl.) en latin càpicerius±
eft la même chofe queprimicerius ; ce qui vient de ce
que le chefcier étoit le premier marque dans la table
ou catalogue des noms des eccléfiaftiques , comme
le premier en dignité : ainfi c’eft comme fi l’ on eût
dit primus in cerâ, parce qu’on écrivoit anciennement
fur des tables de cire. On nomme encore aujourd’hui
le chef de quelques églifes collégiales chef*
cier: par exemple, on dit le chefcier de faint Etienne
des Grés. Le nom de primicerius défignoit au tems de
S. Grégoire le Grand, une dignité eccléfiaftique, k
laquelle ce pape attribua plufieurs droits fur les clercs
inférieurs 6c la direttion du choeur, afin que le fer-
vice s’y f ît félon la bienféance. Il avoit auffi droit de
châtier les clercs qu’il trouvoit en faute, ôc il dénon*
çoit à l’évêque ceux qui étoient incorrigibles. Celui
qui étoit marqué le fécond dans la table, s’appelloit
fecondicerius , comme qui diroit fecundus in cerâê
M. Simon. (G)
CHEGÇ,, (Géog.) ville 6c comté de la haute Hon*;
grie, fur la Theiffe.
CHEGO ou K ECIO , ( Géog. ) grande ville d’A-
fie, capitale du royaume de Tunquin, ÔC la réfiden-
ce du roi. Long. 123.30 . lat. 22.
CHEGOS, f. m. (<Commerce,) poids pour les perles
à l’ufage des Portugais aux Indes. C ’eft le quart
d’un carat. Voye{ C ar at ; voye[ les diction, du Com*
merce, de Trévoux, & de Dish.
* CHEG&OS, f. m. (Côrdonn. Bo'urfel. Sellier, &
autres ouvriers qui employent du cuir.) c’eft un bout dé
filet plus ou moins long, compofé d’un nombre plus
ou moins grand de fils particuliers, cordelés enfemble
ôc unis avec de la poix ou de la cire. Pour cet
effet, on prend un morceau de cire blanche ou jaune
, ou de poix ; 6c lorfque les fils ont été cordelés
6c commis a la main, on faifit le filet qui en réfulte ,
& on le preffe fortement contre le morceau de cire
ou de poix, qu’on fait gliffer plufieurs fois fur toute
fa longueur, afin qu’il en foit bien enduit. Quand le
chegros, ou chigros , ou ligneul (car les Cordonniers
appellent ligneul, ce que la plûpart des autres appellent
chegros on chigros) eft bien préparé, on en arme
lés extrémités avec de la foie de fanglier, dont les
pointes très-menues paffent facilement dans les trous
pratiqués avec l’alene, lorfqu’il s’agit d’employer le
chegros à la couture des oiivrages. Voy. Selle, Soul
ie r , &c.
* CHEIROBALISTE ou CHIROBALISTE, f. f.
(Hijt. anc. & Art milit.) ou balifle à main : elle eft
compofée d’une planche ronde par un bout, échan-
créè.fcirculairement par l’autre bout- Le bois de l’arc
eft fixé vers l’extrémité ronde ; fur une ligne corref-
pbndanté au milieu du bois de l’arc 6c au milieu de
l’échancrure, on a fixé fur la planche une tringle de
bois , précifément de la hauteur du bois de l’arc :
cette tringle eft cannelée femi-circulairement fur
toute fa longueur^ Aux côtés de l’échancrure d’un
des bouts» ori a ménagé en faillie dans la planche,
deux éminences de bois qui fervent ’de poignée à
la balifte. Il paroît qu’on élevoit ou qu’on baiffoit la
Mm